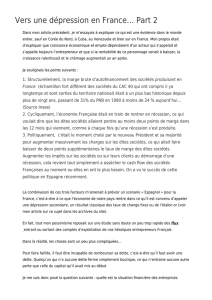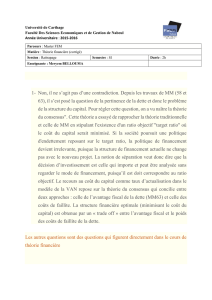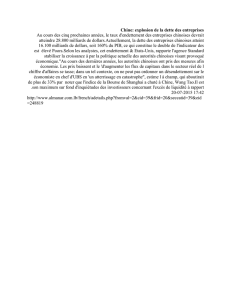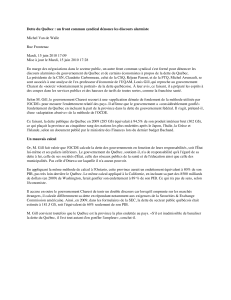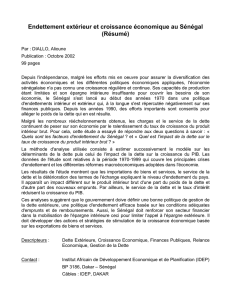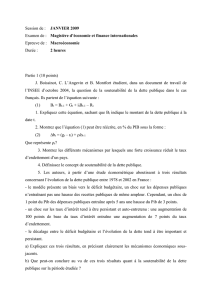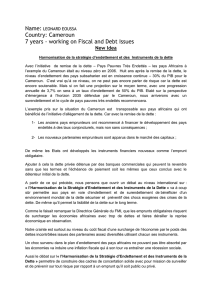Pr Moustapha o KASSÉ
publicité

Pr Moustapha
KASSÉ
$bn
300
250
200
150
100
50
o
1981
82
83
84
85
86
87
88
89
90
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ éditions NEAS-CREA
(Dakar)
L'AFRIQUE ENDETTEE
© Nouvelles Editions Africaines du Sénégal
et Centre de Recherches Economiques Appliquées
Dakar, juillet 1992
Pr Moustapha
KASSÉ
ENDETTEMENT
ET POLITIQUE ECONOMIQUE
EN AFRIQUE DE L'OUEST
Nouvelles Editions Africaines du Sénégal
NEAS
Centre de Recherches Economiques Appliquées
C.R.E.A.
Université Cheikh Anta Diop
DAKAR
A ma fidèle épouse et à mes enfants MAMAOOU,
Bousso, AzIZ et VIEux-DIOOIO
pour le soutien qu'ils m'apportent
dans mes tâches quotidiennes de recherche.
Introduction
La problématique de l'endettement est devenue une préoccupation
primordiale dans la recherche et la politique économiques et donne lieu
déjà à une littérature très impressionnante bien que de valeur inégale. La
question est évoquée à toutes les rencontres internationales. Partout, il est
perçu comme un problème difficile et complexe par son volume, sa croissance rapide et les menaces d'insolvabilité des emprunteurs. Il reste
encore préoccupant par l'absence de solutions concertées acceptables par
tous les acteurs impliqués malgré le fait qu'il introduit une situation dangereuse par les risques énormes qu'il fait courir à l'ensemble du système
productif mondial et à l'ordre monétaire et financier confronté à une crise
persistante. Enfin, il pose des problèmes complexes à la science économique qui ne dispose pas encore d'outils opératoires de diagnostic,
d'analyse et de prévision. C'est sans doute cela qui explique les bilans
terriblement sombres que présentent de l'endettement les professionnels
de l'économie, les experts financiers et les techniciens du développement.
Tous ces spécialistes semblent s'accorder sur l'idée que la dette enclenchera des dérapages qui déboucheront un jour sur des issues aux conséquences redoutables.
Pourtant, il y a quelques décennies la théorie et la pratique de l'endettement étaient plus rassurantes. La dette était considérée comme un
instrument de la politique économique et un moyen privilégié de financement de la croissance. L'on concevait alors qu'une économie connaissant
un déficit intérieur d'épargne ou momentanément affectée par un choc
extérieur qui déséquilibre sa balance de paiement, devrait recourir aux
marchés monétaires nationaux ou internationaux. On avançait même que
cela était un facteur incontournable d'adaptation de l'économie et de
relance de la croissance. La théorie économique avait fini par accréditer
l'idée que toute économie nationale lancée dans une dynamique de croissance devrait passer impérativement par une phase plus ou moins longue
7
d'emprunteur avant de s'achever sur une phase de prêteur mûr. On admettait ainsi que cc le paiement du service de la dette ne s'oppose pas au développement, puisqu'il peut être initié à partir des bénéfices réalisés par la
production pour le marché mondial, ce qui justifie du même coup l'intégration à ce marché et le respect du prix mondial comme norme de l'activité
interne» (G. Debernis).
Pourtant, les faits semblent infirmer cette vision prospective. Tout le
monde s'accorde pour reconnaître qu'il existe un problème d'endettement
que laissent apparaître les statistiques qui s'accumulent et permettent, en
leur état actuel, de faire trois observations.
La première observation concerne l'évolution exponentielle de la dette
des pays du Tiers-Monde. Selon la Banque Mondiale qui tient un répertoire
exhaustif, l'encours de la dette totale (publique et privée) des pays en
développement est passé de 109,3 milliards de dollars en 1973 à 830
milliards de dollars en 1982 pour se fixer à 1.292 milliards de dollars en
1987, les projections pour 1990 étant de 1.319 milliards de dollars. Dans le
même temps, le service total de la dette a évolué de 10,2 milliards de
dollars en 1973 à 63,8 milliards de dollars en 1982 et 102,1 milliards pour
1987 soit pour cette dernière année plus de 22 % des recettes d'exportation. La dette à court terme, qui n'est pas prise en compte dans ces statistiques, vient s'y ajouter pour aggraver davantage la charge de
l'endettement extérieur.
Pour 1983, la dette des pays en voie de développement non producteurs de pétrole était d'environ 664,3 milliards de dollars dont 53 % étaient
dûs à des banques commerciales. En 1988, elle s'élève à environ 800
milliards de dollars dont 68,2 % sont dûs à des banques commerciales.
Les agrégats les plus significatifs établissent que l'endettement a
progressé au rythme de 20 % dans la période 1970-1984 et de 26 % entre
1984-1989, alors même que le taux de croissance économique d'ensemble
a été respectivement pour les deux périodes de 5,9 %. Cela semble indiquer que l'accroissement de la dette publique ne procède pas d'une accélération du développement économique et social, mais provient d'autres
facteurs qui l'animent et l'entretiennent en l'amplifiant.
Cette évolution divergente de l'encours de la dette et du PIB explique la
détérioration de quelques ratios significatifs comme le ratio de la dette
totale décaissée au PIB (qui est passée de 14,3 % en 1973 à 23,5 % en
1982) et le ratio de la dette sur les exportations (piUS de 25 % depuis
1986) qui a atteint aujourd'hui un niveau insupportable. Tous ces ratios
semblent indiquer que les PVD ont contracté une dette sans commune
mesure avec leurs capacités effectives de remboursement. Au demeurant,
les charges auxquelles ils auront à faire face obèrent leurs finances nationales et les obligent à modifier les priorités de leur développement économique et social. De même, l'endettement par son caractère massif devient
un facteur d'interconnexion à l'économie mondiale, à sa division du travail
et à ses rapports monétaires et de crédit souvent inégaux. C'est dans ce
sens que l'on parle de l'arme financière par laquelle les créanciers tiennent
8
en respect leurs débiteurs en les dépossédant progressivement de toute
gestion de leur développement.
La deuxième observation se rapporte à la modification des sources de
financement en faveur du système bancaire privé. Depuis quelques
années, on constate une très forte diminution des ressources publiques qui
se réorientent vers les pays les plus pauvres des PVD, ceux-là même qui
ne peuvent pas avoir accès au marché international des capitaux. Alors,
les banques privées ont pris le relais du financement. Ainsi, la part de la
dette totale à moyen et long termes imputable aux prêts bancaires
s'établissait à 49,6 % en 1982,56,8 % en 1983 et 61,2 % en 1989 contre
moins de 25 % en 1973 pour leurs principaux emprunteurs. La proportion
est bien supérieure dans le cas des grands pays exportateurs qui sont
considérés par les banques commerciales comme de meilleurs débiteurs
potentiels.
Le rapport de la dette envers les banques au montant de recettes
d'exportation est, à cet égard, un indicateur caractéristique de l'importance
que revêtent de bonnes performances à l'exportation pour l'accè5 au financement bancaire. Selon des calculs effectués par la CNUCED pour
l'année 1981, le rapport dette bancaire à long terme/exportation était
d'environ 100 % pour les exportateurs d'articles manufacturés , de 40 %
pour les autres pays ayant un revenu par habitant supérieur à 500 dollars,
mais de quelque ~O % seulement dans le cas des pays les plus pauvres.
Cette intervention des banques privées introduit une certaine fragilité
du système financier international qui se manifeste, entre autre, par le fait
que les banques, comme des magiciens, ont réalisé dans les PVD des
prêts dont elles ne possédaient pas les ressources. A titre d'exemple, on
avait observé que les cents premières banques mondiales dont les fonds
propres s'élevaient à environ 100 milliards de dollars, avaient néanmoins
octroyé à l'Amérique latine des crédits qui dépassaient 200 milliards de
dollars. Elles ont alors abusé de la création monétaire ou ont transformé
des dépôts à court terme en prêts à long terme dans le but de bénéficier de
taux d'intérêt variables (crédits roll-over) et de plus en plus mercantiles.
Cette privatisation de la dette est à la base de l'introduction de conditionnalités impliquant l'intervention manifeste des banques dans la gestion de la
politique économique des Etats. En d'autres termes, le face à face Etats
endettés/ banques commerciales va compliquer un peu plus la recherche
d'une issue à la dette.
La troisième observation est relative au caractère à la fois dispersé et
concentré de la dette. Elle touche à des degrés divers tous les PVD mais
reste cependant concentrée au niveau de quelques pays à revenus élevés.
En 1982, treize pays seulement sur les cent sept qui sont concernés par
les statistiques de la Banque Mondiale détenaient près de deux tiers de la
dette du Tiers-Monde, cette proportion s'élevant à un peu moins de 80%
pour les vingt premiers pays les plus endettés. A eux cinq , le Brésil, le
Mexique, l'Argentine , le Chili et le Vénézuela devaient 163 milliards de
dollars, soit près du tiers de l'encours total de la dette des pays en déve-
9
loppement. En ce qui concerne l'Afrique, cetle répartition inégale apparaît
dans le tableau suivant:
1984
1975
Dene publique
Dette privée
Total
Montant "4
Montant "4
Montant "4
Dette publique
Dette privée
Montant
"4
Montant
"4
28,0
98
0,7
2
Total
1
Afrique à faible revenu
(26 pays) .................
8,1
92
Afrique au Sud Sahara
(42) pays) ................
0,7
14,0
93
1,0
Tous PVD (107 pays)
125,7
77
36,5
Montant "4
28,7
100
7
15,0
100
57,3
94
3,6
6
60,9
100
23
162,2
100
553,0
83
112,5
17
665,5
100
La détérioration accélérée de la situation d'endettement extérieur des
pays du tiers-monde et plus particulièrement des gros débiteurs a multiplié
les demandes de rééchelonnement et nourri les débats passionnés sur la
dette. Ceux-ci ont été axés principalement sur des questions telles que:
- la nature conjoncturelle ou structurelle des problèmes de la detle ;
- les origines et la structure de l'économie d'endettement;
- les effets sur le système financier international et sur les pays du
tiers-monde ;
- les solutions préconisées par les institutions financières internationales (FMI, SM) et les grands pays créanciers pour le remboursement;
- les politiques alternatives à l'économie d'endetlement.
Ces trois observations établissent que l'endettement des PVD constitue
un élément supplémentaire d'instabilité du système monétaire international. Pour appuyer ce propos, en 1982/1983, les perspectives de cessa·
tion de paiements de certains pays endettés majeurs d'Amérique latine,
révélaient les risques d'écroulement du système financier international qui
est resté précaire et fragile depuis l'abandon des règles de fonctionnement
du Gold Exchange Standard. Le krach n'a été évité que grâce à l'établissement de plans de sauvetage sous l'égide du FMI. Pendant les dix premiers
mois de l'année 1983, vingt deux pays en développement ont demandé le
rééchelonnement de leurs dettes officielles et bancaires, contre seulement
une moyenne de 4 pays par an au cours de la période 1975-1980. Dans le
même temps, le montant total des dettes réaménagées s'élevait (en
moyenne annuelle) de 1,5 milliard de dollars à 60 milliards de dollars. Ces
chiffres montrent toute l'ampleur des risques-pays qui ne peuvent laisser
indifférents les divers prêteurs.
Dans cette situation, les banques privées se trouvent placées dans
l'obligation technique non seulement de ne point pouvoir rejeter les
demandes de consolidation mais de renouveler aux emprunteurs les
10
10n
8,8
8
crédits indispensables. Ainsi s'installe une situation de dette perpétuelle
où un endettement entraîne un autre d'un montant supérieur traduisant
déjà une parfaite incompatibilité entre le service de la dette et le développement.
Comment la théorie économique a-t-elle réagi à cette problématique à
tous égards importante? S'est-elle comportée comme une théorie scientifique énoncée selon les règles de la logique formelle et capable de fournir
d'une part les outils indispensables pour mesurer l'endettement et expliquer ses mécanismes de formation et de propagation et d'offrir d'autre part
des moyens et des solutions pour régler définitivement la question? Peutelle établir une évaluation exacte, un diagnostic rigoureux et une thérapeutique appropriée? Peut-elle déterminer la répartition optimale des
ressources internes et externes ainsi que la capacité d'emprunter et
d'assurer le service de la dette?
La théorie économique devrait fournir les normes d'évaluation aux
experts et aux décideurs, seulement si elle s'avérait inapte à le faire au
plan pratique. alors elle ne peut avoir aucune prétention scientifique. Car
en définitive, selon le mot de J. Attali, pour qu'une cc théorie soit vraie, on
n'exige plus qu'elle soit universelle et invariante; il suffit qu'elle fournisse
un ensemble de recettes permettant de gérer au mieux l'irréversible" (1).
En conséquence, si la théorie économique n'est pas porteuse de sens pour
l'action et pour l'explication, elle devient un discours abstrait et déconecté
sur l'ordre social.
Dans ce domaine, les économistes académiques ont élaboré des
modèles à la suite du Pro Kindelberger pour établir les liens entre développement et endettement. Les travaux les plus remarquables ont été réalisés
par Chenery et Strout sur le double déficit ex-ante d'épargne et de devise
(2), par Saigal qui a adapté le modèle de Katano au cas Tanzanien en vue
de déterminer le taux optimal d'investissement et la structure chronologique optimale des flux de capitaux pour l'amorce d'une croissance autoentretenue et équilibrée (3) ; par G. Feder qui a tenté d'intégrer à l'analyse
de la croissance les politiques d'emprunt extérieur et de la capacité de
remboursement du service de la dette (4) ; par W.R .. Cline qui a orienté la
réflexion sur la capacité d'endettement et par Abramovic qui a établi les
liens entre des variables comme le niveau des réserves, le volume des
exportations, l'évolution du taux d'épargne et la capacité de remboursement (5).
(1) J. Allali : Les trois mondes: pour une théorie de l'après crise, Edit. Fayard, Paris,
1981,335 p.
(2) AB. Chenery et AM. Strout Foreign: Assistance and economic development, AER,
1956.
(3) J.-C. Saigal, La réalisation de la croissance auto-entretenue: différentes stratégies
possibles pour la Tanzanie. Collection d'études sur le développement, AEA Abidjan et
Dakar, 1978, p. 15 et 16.
(4) G. Feder, Economie Growth. Foreign Laons and Debt Sevicing capacity of developing
countries. World Bank Statf Working Paper n° 274, février 1978.
(5) Abramovic, Economie Growth and External debt. J. Hopkins Press, 1964, p. 152-192.
11
Ces modèles formalisés intégrant la dette partent de l'hypothèse que
les politiques de croissance sont limitées dans les PVD par le déficit des
ressources, ce qui rend nécessaire des apports de capitaux extérieurs. Les
ressources externes confèrent alors aux utilisateurs une certaine marge de
manoeuvre dans la gestion de leur balance de paiements en dehors de
leur rôle de soutien à la croissance économique. Dans cette direction,
Chenery et Strout observent" qu'un pays qui s'engage dans la transformation de son économie sans assistance extérieure doit satisfaire à toutes les
exigences d'une croissance accélérée au moyen de ses propres
ressources.ou d'importations payées par ses exportations. Le succès
suppose donc un accroissement simultané des compétences, de l'épargne
intérieure et des recettes d'exportation ainsi que de l'affectation de ces
ressources accrues de manière à satisfaire l'évolution de la demande qui
accompagne la hausse des revenus ». Cependant, cette évolution peutêtre compromise par un échec dans un seul domaine. Dès lors, " en écartant ces contraintes, l'assistance étrangère peut permettre une utilisation
plus complète des ressources intérieures et par conséquent accélérer la
croissance. Certains des goulots d'étranglement potentiels (savoir-faire,
épargne ou devises, etc...) peuvent être temporairement relâchés en introduisant des ressources extérieures dont le paiement peut être différé »(6).
Les autres formulations théoriques ont presque, en dehors de celle de
Salgal, la même préoccupation qui est de trouver le lien entre les variables
économiques de la croissance (taux de croissance d'ensemble, taux
interne d'épargne, coefficient marginal de capital, taux d'investissement,
flux de ressources extérieurs, exportation) et la capacité de remboursement du service de la dette. En d'autres termes, le développement appelle
toujours un endettement et la théorie doit alors contribuer à déterminer la
capacité d'absorption de ressources externes ainsi que les possibilités de
remboursement. L'analyse heuristique réalisée par Abramovic en donne la
meilleure illustration. Elle définit les phases que traverse un pays désireux
de mettre en place, grâce à l'endettement, une stratégie productive
pouvant lui assurer une croissance satisfaisante. Cet ordre d'idées a fini
par s'imposer même à Saigal qui avait pourtant une orientation originale :
introduire des instruments d'analyse et des moyens d'une stratégie au
départ liés aux structures économiques des PVD. Cette recherche avait
amené l'auteur à se poser la question de savoir si l'aide économique extérieure ne freine pas le taux d'accroissement de l'épargne intérieure et si
elle a, en toute circonstance, un effet positif sur les perspectives de développement à long terme d'une économie. Si tel était le cas, les autorités
politiques et économiques devraient alors recourir de plus en plus aux
forces propres de "économie (self reliance) d'autant plus qu'il devient de
plus en plus difficile d'accéder à ces capitaux quels qu'ils soient.
(6) Chenery, The IWo-gap approch ta Aid development : reply ta Bruton, A.E.R., juin
1969, p. 446-449.
12
Cependant, Saigal finira par intégrer dans l'analyse le recours à la dette en
estimant que les besoins en ressources financières sont de plus en plus
importants alors même que l'épargne locale s'avère largement insuffisante.
En définitive, comme pour nous rassurer, Saigal avance que la planification
devra prendre en compte le service de la dette. Quel aveu d'impuissance!
Il apparaît que ces théories, malgré leur finesse et leur cohérence n'ont
pas réussi à fixer le niveau optimal d'endettement et les capacités de
remboursement en liaison avec les politiques internes de croissance et les
perturbations économiques et financières de l'environnement extérieur. Cet
insuccès apparent procède de la non intégration de variables essentielles
de l'endettement comme les taux d'intérêt appliqués aux prêts, la structure
de la dette et sa privatisation qui a entraîné des montages financiers très
particuliers, le choix souvent non pertinent des investissements, l'évolution
erratique des taux de change qui introduisent des perturbations monétaires
permanentes et les politiques de développement appliquées qui se fondent
sur l'ajustement de l'ordre économique interne à l'économie mondiale.
Tout compte fait, les théories de l'endettement sont l'interface des théories de la croissance, c'est-à-dire qu'elles commencent par fixer un objectif
de croissance, pour ensuite déterminer ce qui fait défaut (double déficit
d'épargne et de ressources en devises) en vue de quantifier le volume
d'endettement nécessaire pour promouvoir la croissance. D'ailleurs, la
structure des modèles d'endettement est identique à celle des modèles de
croissance: mêmes hypothèses, identité des fonctions macroéconomiques, etc. Or, on sait aujourd'hui que les modèles de croissance sont
inopérants et pêchent par un excès de globalisme ce qui fait qu'ils n'ont
pas réussi à expliquer dans le Tiers-Monde toute la complexité de la dynamique de croissance, ni à permettre l'élaboration d'une politique de croissance auto-entretenueou tirée par les exportations.
Au total, les théories d'endettement telles qu'elles apparaissent ont de
très faibles capacités explicatives. Elles n'ont pas pu prévoir l'accélération
de la dette et tous les enjeux qui s'y attachent. Malgré leur très grande
sophistication, elles s'avèrent encore incapables d'évaluer les faits d'endettement, de les analyser au plan technique pour mesurer leurs incidences
sur la croissance et les structures économiques et enfin de prospecter
l'avenir pour une gestion adéquate de la dette.
Cette limite des théories nous prive d'un cadre méthodologique
adéquat et nous impose une évaluation essentiellement empirique qui
parte des faits et chiffres observés.
Par ailleurs, les observations globales sur l'évolution de l'endettement
et les théories explicatives usuelles indiquent l'opportunité d'un élargissement du débat pour résoudre des questions devenues aujourd'hui absolument urgentes et incontournables concernant les mécanismes de
génération et de propagation de la dette ainsi que les solutions à un
phénomène qui perturbe les équilibres économiques et affaiblit à perpétuité
les pays emprunteurs installés dans un état de crise permanente les
13
rendant incapables d'amorcer une relance de la croissance en vue
d'atteindre entre autres objectifs le remboursement de la dette.
Nous avons axé cette recherche sur l'Afrique de l'Ouest, c'est-à-dire
l'ensemble des 16 états regroupés au sein de la CEDEAO (Communauté
Economique des Etats de l'Afrique de l'Ouest) et de l'UMOA (Union
Monétaire Ouest Africaine). Cet espace offre des situations d'endettement
assez contrastées et encore mal étudiées.
Globalement et en comparaison avec les grands pays endettés
d'Amérique Latine, la dette Ouest-Africaine n'est pas particulièrement
lourde. On observera que celle du Mexique, en 1984, était deux fois et
demie plus élevée. C'est seulement en rapport avec les capacités effectives de remboursement que la dette soulève des problèmes quasi insurmontables.Cette capacité de remboursement est révélée par les ratios de
solvabilité que sont les rapports de la dette au PNB et aux exportations.
Ces ratios se présentent comme suit:
Principaux ratios d'endettement des pays
de la CEDEAO :1970-1987
Encours de la dette
extérieure publique
et privée (dette
totale à long tenne)
en pource ntage
du PNB
PAYS
Bénin
Burkina-Fasso
1970
1980
1987
15
7
30
57
44
69
Service de la dette
extérieure publique
et privée en pou,..
centage des expor·
tations de biens
et services
1970
Encours de la dette
publique extérieure
en pourcentage
du PNB
Service de la dette
publique extérieure
en pourcentage des
exportations de
biens et services
1980
1987
1970
1980
1987
2,4
2,9
15,9
57
2,4
n.c.
n.c;
n.c.
n.c.
44
69
6,8
n.c.
21
15
2,9
7,5
15,9
7,5
15
7
30
6,8
n.c.
n.c.
n.c.
1970 1980
1987
Côte-d'Ivoire
20
21
15
48
124
7,5
25,9
40,8
19
44
90
7,1
24,0
19,6
Gambie
10
44
151
0,5
1,2
12,9
10
44
151
0,5
1,2
12,9
Ghana
23
26
45
5,5
8,3
20,3
23
26
45
5,5
8,3
19,2
47
63
119
53
78
n.c.
17,2
n.c.
47
63
78
n.c.
17,2
n.c.
321
108
n.c.
n.c.
n.c.
321
108
n.c.
37,0
6,3
3,6
11,1
19,0
6,3
2,5
9,9
18,2
46,9
14
119
53
42
109
n.c.
8,1
1,4
3,4
37,0
2,5
9,9
5
16
11,7
Cap-Vert
n.c.
Guinée
Guinée-Bissau
n.c.
Mali
39
71
Mauritanie
14
Lbéria
Niger
42
109
96
215
73
n.c.
39
71
96
8,1
1,4
215
60
3,4
4,0
3,6
11,1
6,0
n.c.
18,2
33,5
Nigéria
4
28
5
22,3
4
33
10,0
4,0
3
12
1,8
34
2,8
22,1
4,3
16
111
69
110
Sénégal
68
2,9
21,6
21,4
Sierra-Léone
14
33
55
10,8
14,3
n.c.
14
33
55
10,8
14,3
n.c.
Togo
16
91
3,1
8,1
14,2
16
82
91
3,1
8,1
14,2
n.c.
82
7,1
Source: Banque Mondiale, Rapport 1989 sur le développement dans le monde.
14
Ces indicateurs ne laissent aucun doute sur l'apparition rampante d'une
crise potentielle de solvabilité pour presque tous les pays de la sous-région
dont au moins six en 1987 étaient engagés pour plus de leur production
intérieure; ce sont la Côte d'Ivoire, la Gambie, la Guinée-Bissau, le Libéria,
la Mauritanie et le Nigéria. Par ailleurs, le ratio de solvabilité est plus
mauvais dans la CEDEAO que dans l'ensemble des PVD, ce qui explique
parfaitement le degré de dégradation de la situation ouest-africaine et en
conséquence le désintérêt des investisseurs privés du Nord.
L'endettement des pays d'Afrique au Sud du Sahara en général, et de
la Communauté Economique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO)
en particulier, présente un certain nombre de caractéristiques qu'il convient
de souligner. En effet, sur une dette extérieure globale d'environ 142
milliards de dollars en 1987, chacun des 43 pays africains au Sud du
Sahara concernés par les statistiques de la Banque Mondiale (les données
ne sont pas disponibles pour le Mozambique et l'Angola) ne doit en
moyenne qu'environ 3,3 milliards de dollars. A titre de comparaison, cette
moyenne en 1987 représente 21,5 milliards de dollars en Amérique Latine
et aux Caraïbes ; 13,7 milliards de dollars en Asie du Sud-Est et dans le
Pacifique ; 9,2 milliards de dollars en Asie du Sud et 14,6 milliards de
dollars en Afrique du Nord et au Moyen-Orient.
En considérant par contre le ratio du service de la dette publique extérieure aux exportations de biens et services, on obtient pour l'ensemble
des 43 pays africains subsahariens étudiés un chiffre de 14,7 % en 1987
contre seulement 7,2 % en 1980 et 5,3 % en 1970.
En déglobalisant, on observe par exemple que ce ratio est encore plus
élevé pour certains groupes de pays africains pauvres :19,6% pour les 9
économies sahéliennes et 17,9% pour les économies à faible revenu
(Nigéria non compris du fait de son poids relatif important).
De même, en rapportant l'encours de la dette publique extérieure au
PNB, on mesure une fois de plus le caractère écrasant du poids de la dette
pour les fragiles économies africaines sub-sahariennes. En effet, de 13 %
seulement en 1970, ce ratio passe brutalement à 21 % en 1980 pour finalement atteindre le niveau record de 81 % en 1987.
Plus grave, en considérant le sous-groupe africain des économies à
faible revenu, on obtient un taux de 92 % en 1987 contre seulement 22 %
pour l'Asie du Sud et 28 % pour l'ensemble mondial des économies à
faible revenu.
Il ressort de ces statistiques que la situation d'endettement extérieur de
l'Afrique sub-saharienne ne présente ni la même acuité, ni la même importance relative que celle des autres parties du monde en développement
notamment l'Amérique Latine. Et pourtant, elle est une source de préoccupation croissante pour leur développement et leurs créanciers internationaux. En réalité, il existe deux raisons principales à cela:
- la première procède de la rapidité avec laquelle augmente l'endettement extérieur de l'Afrique sub-saharienne telle que nous venons de l'illustrer ;
15
- la deuxième raison tient au fait que les recettes d'exportation des
pays d'Afrique au Sud du Sahara proviennent pour l'essentiel de produits
primaires dont les prix sont soumis à de fortes fluctuations et à des baisses
tendancielles qui aboutissent à une détérioration de leurs revenus. Dès
lors, les milieux financiers internationaux n'accordent plus aux africains la
même confiance manifestée aux pays exportateurs de produits manufacturés, dont les recettes d'exportation sont plus stables et plus prévisibles.
Pour les pays d'Afrique de l'Ouest membres de l'Union Monétaire
Ouest-Africaine (UMOA), la dette extérieure est passée de 270,4 milliards
de FCFA en 1973 à 3 901 milliards en 1983 et à 5 511 milliards en 1988.
En l'espace de 15 ans, elle aura donc été multipliée par plus de 20.
Il faut dire qu'à l'image de l'ensemble du continent africain, cette croissance exceptionnelle de la dette dans les pays de l'UMOA a été déterminée par les modifications de l'environnement extérieur, les
développements économiques internes et bien entendu l'évolution subséquente de la position du compte courant.
C'est ainsi que dans un premier temps, de 1973 à 1976, l'ajustement
des pays de la zone au premier choc pétrolier a conduit à un recours
modéré à l'endettement extérieur, effectué pourtant à des conditions
douces.
Mais en 1976-1977, la brusque flambée des cours des matières
premières (café, cacao, phosphates notamment) a incité plusieurs Etats à
accroître leurs programmes d'investissements publics et à les financier par
des emprunts extérieurs à des conditions onéreuses. Ces emprunts furent,
pour l'essentiel, contractés auprès des banques internationales privées
désireuses de recycler leurs excédents de liquidités provenant des placements des pays pétroliers. Cette politique se poursuivra de 1978 à 1980.
Le second choc pétrolier en 1979 va entraîner une forte détérioration
de la situation du compte courant dont le financement sera assuré par des
ponctions sur les réserves de change accumulées en 1977. Mais à partir
de 1980, la persistance et surtout l'élargissement du déficit courant impliqueront un recours, de plus en plus accentué aux emprunts extérieurs, aux
concours du FMI et aux avances du Trésor français en compte d'opérations.
Dans le même temps. la récession mondiale s'étend, conduisant à un
ralentissement du commerce international, à un effondrement des cours
des matières premières, à une forte hausse des taux d'intérêt et à l'amplification du désordre monétaire international. Ces nouveaux développements
aggravent le déséquilibre des paiements extérieurs nets des pays de
l'UMOA dont le niveau évalué à - 465,7 milliards FCFA en 1979, atteint573 milliards en 1986 pour se situer à - 6599,7 milliards au 30 juin 1989.
L'ampleur de ces besoins de financement, dans un environnement
international de taux d'intérêt élevés et de surévaluation du dollar (198287), justifie l'explosion de la dette tout au long des années 80 malgré une
16
réduction concomitante du volume des investissements publics. Ainsi, en
l'absence du compte d'opérations, il est probable que l'endettement extérieur public des pays de l'UMOA aurait atteint des montants encore plus
élevés entre 1979 et aujourd'hui.
Cette analyse montre l'ampleur du phénomène contemporain de
l'endettement ainsi que ses incidences multiples et multiformes.
Incontestablement, il déterminera le cours de l'histoire immédiate des
économies en voie de développement au plan économique, politique,
social, voire culturel, et. probablement, il induira des modifications radicales des choix et options de développement par suite du poids que prennent les institutions financières et bancaires internationales. En effet, il
risque de s'opérer des transferts de souveraineté monétaire des Etats aux
banques créancières et cela ne manquera absolument pas d'avoir des incidences décisives sur la gestion du développement et sur les politiques
économiques.
Il est bien évident que si l'on continue à accumuler des dettes les pays
finiront par être incapables d'en assumer le service. Alors la question se
posera inévitablement de savoir qui doit payer cette insolvabilité, comment
répartir les coûts et que faire après?
Quelle solution au problème de la dette africaine face à l'attitude négative des créanciers? Faut-il attendre d'hypothétiques négociations multilatérales sans être sûr d'enrayer définitivement les causes profondes de
l'endettement ? Ne faut-il pas s'attaquer aux politiques qui ont généré cet
endettement massif et permanent? Quelles politiques appliquer pour
relancer l'économie, exploiter toutes les ressources nationales et
augmenter les richesses pour rendre les pays aptes à se passer de l'endettement ? Ce sont là des questions auxquelles cette analyse tente de
répondre. En effet, si l'endettement est capable de mettre en péril une
partie de l'économie mondiale, il devient très important de s'en préoccuper.
Pour ce faire, nous proposons d'analyser les statistiques disponibles pour
avoir une vision quantitative fiable de la dette, de son évolution et de sa
répartition par grandes sources de financement. Ainsi, on sera mieux à
même de comprendre les risques d'insolvabilité et les politiques mises en
place et conduites dans le cadre des conditionnalités des institutions financières internationales comme la Banque Mondiale et le FMI. Ces politiques
sur beaucoup d'aspects font retomber sur les populations le poids financier
d'erreurs passées et conservent à leur profit l'otage que l'on sait déjà être
incapable d'honorer ses engagements. Les limites des programmes rigoureux d'austérité appellent impérativement la recherche de solutions alternatives c'est-à-dire de nouveaux cadres de référence au développement
économique et social. Nous avons examiné toutes ces questions
complexes en trois points intimement liés mais que nous avons séparé
pour des raisons purement pédagogiques:
- la problématique de l'endettement économique à travers les pays
Ouest-Africains regroupés dans la CEDEAO et l'UMOA ;
17
- les mécanismes de propagation et d'élargissement de la dette extérieure ;
- les politiques de redressement et d'ajustement ainsi que leurs incidences au plan socio-économique.
18
PREMIERE PARTIE
L'ETAT DE L'ENDETTEMENT
EN AFRIQUE DE L'OUEST
19
Théoriquement, la montée de l'endettement dans les pays du TiersMonde en général et de l'Afrique de l'Ouest en particulier ne devrait relever
d'aucun mystère ni susciter aucune inquiétude. Les modèles de développement mis en place, s'inspirant des présupposés de l'analyse néo-classique et keynésienne croyaient aux vertus d'une croissance transmise de
l'extérieur.. En postulant que les pays sont en retard de développement et
qu'ils doivent réaliser une croissance rapide, aux taux le plus élevé
possible compte tenu des faibles bases de l'accumulation productive, la
réalisation de tels objectifs passerait nécessairement par le recours à des
ressources financières externes qui viendraient compléter l'épargne intérieure déficiente. Du coup l'endettement est inscrit dans la logique même
du développement. Les travaux du Pr Charles Kindelberger devraient
apporter quelques clarifications en établissant une corrélation entre la
croissance et le niveau d'endettement considéré comme une variable
essentielle du financement du développement(1).
Malgré tout, des appréhensions et des doutes commencent à habiter
les partisans des politiques de croissance en économie ouverte. Qu'est-ce
qui les inquiète véritablement dans l'allure que prend l'endettement du
Tiers-Monde ? Est-ce pour eux le temps de quelques incertitudes théoriques prenant leur source dans l'évolution irrémédiable vers une crise
généralisée d'insolvabilité, qui instaurerait une crise économique spectaculaire.
Comment se présente cette évolution de la dette des pays d'Afrique de
l'Ouest et quels sont les mécanismes explicatifs?
Au plan global les statistiques rendues disponibles par les Etats et les
Institutions Internationales (Banque Mondiale, Fonds Monétaire
International, OCDE) permettent d'observer trois moments dans la montée
de l'endettement des pays du Tiers-Monde, Le premier va de 1970-1979
et englobe le premier choc pétrolier. La dette dans cette période est
passée pour la Banque Mondiale de 114 milliards de dollars en 1970 à 369
(1) Ch.-P. Kindlberger, The World economic slowdown sine the 1970'5. Economie
Internationale, Collection .. Tendances actuelles ", 7' édit., Paris, 1983.
21
milliards et pour l'OCDE, elle a évolué de 119 à 388 milliards de dollars.
Bien que les deux agrégats ne soient point numériquement identiques, ils
ont progressé cependant au même rythme annuel de 20 %. Le deuxième
moment est l'expression d'une phase d'accélération de l'endettement qui
se fixe à 450 milliards de dollars avec une aggravation surtout du service
de la dette, qui, se situant à 87 milliards en 1980, est monté à 100 milliards
l'année suivante. C'est la période où beaucoup d'emprunts vont désormais
servir à payer des dettes. Dans cette période, les prêts en provenance des
organisations internationales et des organismes publics vont baisser et
passeront d'environ 61 % à 51 %. Les banques privées prendront le relais et
introduiront des éléments d'instabilité: conversion de dépôts à court terme
en prêts à long terme, engagements financiers excédant de loin les fonds
propres. Le dernier moment de l'endettement est celui d'une augmentation
encore plus substantielle dans une situation de dépression de l'économie
mondiale. Cette situation était aggravée par la montée des taux d'intérêt, la
surévaluation du dollar et la montée du protectionnisme. Des perspectives
de banqueroute se dessinaient particulièrement pour les grands endettés
du Tiers-Monde, les cessations de paiement et les demandes de rééchelonnement s'étaient multipliées.
Dans cette situation, des évaluations diversifiées se font, des bilans qui
souvent manquent d'innocence s'établissent et des opinions se forment.
Pour certaines, les dettes du Tiers-Monde vont ébranler l'édifice économico-financier mondial par la faute des institutions financières internationales qui, par des montages financiers trop laxistes, ont fait preuve d'une
folie suicidaire. Pour d'autres, au contraire, cette attitude alarmiste n'a
aucun fondement rigoureux ni théoriquement ni pratiquement car, en
dernière analyse, tous les pays riches vivent à crédit et sur des montagnes
de dettes. C'est la cas surtout des Etats-Unis où la simple dette des collectivités locales est l'équivalent de six fois "ensemble de la dette du TiersMonde et des pays d'Europe de l'Est.
Il importe, pour avoir des idées plus nettes, d'analyser les comportements caractéristiques de la dette des Etats d'Afrique de l'Ouest, pour
ensuite cerner les facteurs et les mécanismes de sa propagation. De la
sorte, on sera plus édifié sur les aspects de la dette qui suscitent tant
d'interrogations, de controverses mais aussi d'inquiétude.
CHAPITRE 1 - LA MONTEE DE L'ENDETTEMENT EN
AFRIQUE DE L'OUEST ET DANS L'UMOA
Bien que l'endettement de l'Afrique de l'Ouest remonte avant les indépendance des Etats, on s'accorde à établir que le premier envol a véritablement démarré après le premier choc pétrolier de 1973. Les pays
pauvres et pauvres en pétrole se sont retrouvé avec des déficits commer22
ciaux qu'ils ont financé par recours au système financier international qui
était dans une situation de surliquidité et cherchait en conséquence des
placements à tous les prix.
Comparativement aux grands endettés d'Amérique latine, la dette des
(16) pays d'Afrique de l'Ouest regroupés au sein de la CEDEAO
(Communauté Economique des Etats de l'Ouest) est relativement
modeste. Elle équivaut à la moitié de la seule dette du Mexique. Toutefois,
rapportée aux indicateurs économiques comme le PIB et les exportations,
elle prend un poids insupportable. Pour y faire face, et au regard de "insuffisance de l'aide publique au développement, les Etats de la CEDEAO vont
recourir de plus en plus à l'endettement extérieur pour éviter l'asphyxie
financière.
1) L'ampleur de l'endettement
Selon le Rapport 1989 de la Banque Mondiale sur cc le développement
dans le monde ", l'encours de la dette extérieure publique et à garantie
publique de l'ensemble des seize pays ouest-africains est passé de 16,2
milliards de dollars en 1980 à 53,7 milliards en 1987et 70,3 milliards en
1989.
Ces chiffres recouvrent les dettes à moyen et long terme contractées à
l'extérieur par le secteur public ou des organismes publics ainsi que les
dettes de même échéance contractées à l'extérieur par le secteur privé et
dont le remboursement est garanti par un organisme public. Ils ne
comprennent donc pas les dettes à échéances inférieures à un an, ni les
tirages auprès du Fonds fiduciaire, ni les dettes remboursables en monnaie
nationale, ni non plus les investissements directs.
Or, ces " omissions " peuvent représenter parfois jusqu'à 50 % des
obligations extérieures reprises en compte dans le système d'enregistrement de la dette. C'est ainsi par exemple qu'en 1980, l'ensemble ce ces
seize pays ouest-africains totalisait en réalité une dette extérieure globale
de 24 milliards de dollars pour les 16,2 milliards enregistrés au titre de la
dette publique et à garantie publique, soit une cc omission" de 48 % (voir
tableau page 24).
Le principal enseignement qu'il convient de tirer de ces précisions
statistiques est que les chiffres connus de la dette extérieure ouest-africaine ne rendent qu'imparfaitement compte de la situation des obligations
extérieures des Etats; ils n'en sont donc que plus inquiétants.
Au niveau global, on constate que la dette extérieure de la sous-région
s'est accrue à un rythme moyen annuel soutenu de 19,8 % entre 1970 et
1982 et, modifiant la base, de 24 % entre 1980 et 1987. Rapportée au PNB
global de la sous-région (69,4 milliards de dollars en 1987), elle absorbe
92,8 % de ce lu i-ci en 1987 contre seu lement 9,3 % en 1977 et 16 % en
1982.
23
1\)
~
(I)"O
<:
0°0
c: ....
c III
...
Dette il long terme
!il.• "iii""Tl
~
llJ~1l>
C
PAYS
Il> CD~
CD Q)
.D~
~~fS
s::::0Q.
°
CD °
:J~5
Dette publique et il
garantie publique
1970
1980
1987
41
21
348
20
4328
106
1128
1032
125
573
929
794
121
8450
273
2207
2010
391
1152
1847
1868
1259
27769
Dette privée
non garantie
1970 1980
Recours
au crédit FM
Total de la dette
extérieure
Dette
il court terme
1987 1970 1980 1987
1970
1980
1987
970
1980
1989
n.c.
68
204
n.c.
416
n.c.
n.c.
35
n.c.
334
n.c.
5801
5801
137
1312
1117
131
708
720
1177
756
130
15412
342
3078
2176
449
1761
2157
2010
1578
32832
4189
1056
1186
c
!!
m
m
Q,"o CD-
Il>
ëD-
.CD en
CD
CD
CI)
li)
JJ~C
)(
Bénin
Q)~::'
Burkina-Fassa
Cap-Vert
n.c.
iô~~
Côte-d'Ivoire
Guinée
255
5
487
312
Guinée-Bissau
n.c.
158
238
27
32
452
100
59
40
:goll>
0°0.
~ 3 CD
$=
li)
Ill-
l3 8 Gambie
f:i :;) C
-o~
(1)0_
o.~ro
~.~ 3
~ : ro
O~ro
"o~~
Ghana
".
(])~
......
Libéria
3.
.0
Mali
0.
ro
ë
Mauritanie
3~CO
ro
-..J
Il>
~
li)
ro
~
Niger
3
i
Nigéria
°~
0.
.ro
DI
Sénégal
"0
i
~
Sierra-Léone
ro
CD
Togo
~
lX>
~
ffi' Total
C
ro
2227
299
685
734
399
4204
958
351
913
16203
3068
513
1042
53693
0
0
0
0
0
0
414 3264
0
0
10
30
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
305 254
1097 352
9
42
0
0
0
0
0
0
0
0
0
46
3
0
4
9
0
0
0
0
0
0
167 1835 3942
62
0
0
0
11
0
10
0
0
0
0
0
n.c.
115
31
0
0
0
0
0
0
8
43
5
1
53
11
34
0
0
98
28
14
0
0
0
576
23
778
30
2
291
75
47
91
0
267
n.c.
65
n.C.
67
11
1265
24
108
138
31
175
94
119
75
1657
319
63
102
4452
n.c.
n.c.
n.c.
0
1059
23
131
n.c.
80
n.c.
5
81
24
n.c.
n.c.
83
n.c.
78
n.c.
159
3553
219
54
113
295 2341
n.c.
5669
n.c.
n.c.
n.c.
n.c.
n.c.
n.c.
n.c.
n.c.
n.c.
n.c.
833
n.c.
863
n.c.
8854
n.c.
1284
433
1041
n.c.
n.c.
n.c. 24004 70296
.... (D.
co~
...... m
Oc:
1
...
.... m
co_
0)0
......
D)
3iD
=0.
-m
0(1)
::::J'a
UlD)
0.0<
m(l)
0.0.
2,m
...
iiii.)
(1)0
-m
C
m
»
o
Ces chiffres indiquent manifestement une détérioration croissante de la
situation d'endettement extérieur, n'ayant du reste épargné aucun des
seize Etats de la CEDEAO. C'est ainsi que sur le plan individuel, si en
1980, la dette extérieure publique et privée absorbait entre un minimum de
5 % (Nigéria) et un maximum de 119 % (Guinée-Bissau) du PNB contre
respectivement 4 % (Nigéria) et 71 % (Mali) en 1970, ces deux taux
extrêmes atteignent respectivement 44 % (Burkina-Faso) et 321 %
(Guinée-Bissau) en 1987.
En valeur absolue, le Nigéria et la Côte-d'Ivoire demeurent les Etats de
loin les plus endettés de la CEDEAO puisqu'à eux deux, ils détenaient
67 % de la dette extérieure totale contre 54 % en 1982. Ils sont suivis par le
Sénégal, la Guinée Conakry, le Ghana et la Mauritanie qui, à eux quatre,
détenaient 17 % de la dette totale en 1987 contre 24 % en 1982.
On sait cependant que ce n'est pas tant la valeur absolue des engagements extérieurs qui importe, mais plutôt leur valeur relative rapportée à la
capacité de remboursement du pays débiteur. Et dans cette optique, les
données deviennent presque inversées lorsqu'on sait par exemple que la
dette extérieure du Nigéria - réputée la plus lourde de la région - ne
représentait que 5 % de son PNB en 1980, 6 % en 1981, 9 % en 1982,
mais brutalement 111 % en 1987.
A l'inverse, en excluant la Gambie et le Cap-Vert, deux petits pays
sous-peuplés (respectivement 800 000 et 300 000 habitants en 1987), le
pays le moins endetté en valeur absolue - à savoir la Guinée-Bissau traînait le poids relatif le plus important avec une dette extérieure représentant 119 % de son PNB en 1980 et 321 % en 1987.
De même, en rapportant le service de la dette extérieure publique et
privée aux exportations de biens et services (principal indicateur de la
capacité effective de remboursement), la situation demeure alarmante
dans la région. C'est ainsi que les taux variaient entre un minimum de
2,5 % (Libéria) et un maximum de 46,9 % (Niger) en 1987 contre respectivement d'une part 2,8 % (Nigéria) et 25,9 % (Côte-d'Ivoire) en 1980 et
d'autre part seulement 0,5 % (Gambie) et 10,8 % (Sierra-Léone) en 1970.
Pour 1989, la structure de l'endettement est la suivante:
Endettement de la CEDEAO en 1989
1) Pays à faible revenu gravement endetté
PNB par tête
1 Bénin
2 Ghana
3 Guinée
4 Guinée·Bissau
5 Libéria
6 Mali
7 Mauritanie
8 Niger
9 Nigéria
10 Sierra-Léone
11 Togo
en dallars
Dette par tête
en dollars
Dette totale
en millions dollars
356
345
460
174
404
241
474
266
242
220
368
256
213
392
468
712
263
1 029
211
289
261
328
1 177
3078
2176
449
1 761
2157
2010
1578
32839
1 056
1 186
Total ..............................................................................
49467
2) Pays à revenu intermédiaire gravement endetté
PNB par têle
en dallars
Dette par tête
Dette totale
en dollars
en millions dollars
722
1 316
616
574
12 Côte-d'Ivoire
13 Sénégal
15412
4189
3) Pays à faible revenu modérément endetté
403
223
14 Gambie
342
4) Pays à revenu entermédlalre modérément endetté
15 Cap-Vert
764
130
352
5) Autres pays
16 Burkina-Fasso
291
1
86
1
756
1
RECAPITULATION:
• Dette de 48 Etats africains
• Dette de la CEDEAO
Salt
.
.
.
249,220 milliards
70,296 milliards
28,30 % de la dete africaine.
En considérant le cas du sous-groupe des sept pays appartenant à
l'UMOA (Bénin, Burkina-Faso, Côte-d'Ivoire, Mali, Niger, Sénégal et Togo),
on observe une situation explosive de l'endettement dans la région.
En effet, l'encours du service de la dette y passe de seulement 47,2
milliards FCFA en 1975 à 652,8 milliards en 1983,758,0 milliards en 1985
et 504,0 milliards en 1987, absorbant depuis 1984 en moyenne 35 % des
recettes d'exportation (voir tableau).
U.M.O.A. -
1975 1976
Bénin
Burkina-Fasso
Côte-d'Ivoire
1,4
1,1
Evolution du service de la dette extérieure
(en milliards de francs CFA)
1977
1978
1,0
1,3
1,6
1,2
1,2
1,3
29,6
44,0
66,6
1979 1980
1981
1982
1983 1984
1985
1986
1987
1,1
1,5
5,9
15,2
24,8
37,8
38,5
28,9
26,4
2,0
3,6
4,1
5,8
6,8
9,5
20,0
13,2
11,9
447,3 504,0 498,1
364,1
318,9
89,7 128,8 173,3 206,0 320,5
Mali
0,7
1,0
1,7
2,0
1,9
1,8
2,5
2,7
12,8
28,6
34,3
39,0
31,0
Niger
1,8
2,3
2,3
2,1
2,8
8,2
17,2
36,2
37,4
44,1
44,3
33,1
31,1
Sénégal
8,8
10,6
13,9
22,4
26,0
37,4
25,2
21,4
72,5
79,7
82,3
65,0
62,0
Togo
3,7
5,7
13,9
10,8
7,9
12,7
11,0
11,0
51,2
47,6
39,S
27,6
22,7
Union
47,2
652,8 751,3 758,0 560,9
504,0
65,9 100,7
129,9 170,5 238,5 271,9 412,8
Source: Banque Mondiale· External Debt. System, BCEAO countries· : 1986 : 1 § US =340 F CFA; 1987: 1 § US =330 F CFA.
Suivant la même tendance, l'encours de la dette publique extérieure y
explose en moins d'une dizaine d'années passant de 1 120 milliards FCFA
en 1979 à 5511 milliards en 1988 (voir tableau).
UMOA - Evolution de l'encours
de la dette publique extérieure (en milliards francs CFA)
1979 1980 1981
Bénin
Burkina-Fasso
Côte-d'Ivoire
Mali
Niger
Sénégal
Togo
UMOA
62
52
745
219
55
133
73
1982 1983 1984 1985
1986 1987 1988
76 116 191 258 278 293 310 327 336
71
52 120 172 186 181
193 223 253
972 1396 1815 2186 2488 2372 2306 2550 2600
303 422 569 621
571
555 541 568 608
87 184 203 275 334 327 340 366 380
187 273 426 668 785 826 869 914 975
209 257 271
342 352 331
361 348 359
1120 1 602 2251 3026 3901 4994 4885 4920 5296 5511
(') Mali inclus à partir de 1984.
Source: BCEAO, Dakar, 1989.
Cependant, la source principale des problèmes de la dette dans les
pays de l'Union Monétaire Ouest-Africaine réside dans la faiblesse des
emprunts contractés en francs français (FF). Bien souvent, beaucoup de
partisans de la Zone Franc ont soutenu que les fluctuations du FF par
rapport aux principales devises n'avaient pas d'jncidence significative sur
la dette extérieure des pays africains membres de ladite zone, dont ceux
de l'UMOA, du fait de leurs relations financières privilégiées avec la
France. Cette assertion qui implique que la plupart des emprunts de ces
pays soient libellés en FF est démentie par l'expérience de l'UMOA. En
effet, comme l'indique la répartition de "encours de la dette de l'UMOA par
devises, la part des emprunts contractés en FF a constamment varié au
cours de la période 1973-1983 entre un seuil maximum de 35,4 % et un
minimum de 22,5 %. Depuis lors, la situation n'a pas sensiblement évolué.
En fait, la structure de la dette des Etats de l'UMOA fait apparaître, à partir
de 1976, une nette prédominance des emprunts libellés en dollars US, à
l'exception notable des années 1980 et 1981. Ainsi, l'essentiel des prêts
bancaires internationaux se faisant dans la devise américaine, principale
monnaie de réserve du système monétaire international, la dépréciation
prononcée du FF vis-à-vis du dollar au cours de la décennie 1980 (de
moins de 4 FF en 1980 à plus de 10 FF en 1987 pour 1 dollar US) a nota27
blement aggravé les problèmes de la dette dans l'UMOA à l'instar de
l'ensemble de la région.
L'ampleur des difficultés engendrées par l'alourdissement ininterrompu
de la dette ouest-africaine va conduire dès la fin des années 1970 aux
premiers rééchelonnements dans la région et qui vont par la suite se généraliser à "ensemble des pays tout au long des années 1980. C'est ainsi
que de seulement 15 milliards FCFA rééchelonnés en 1980, les pays de
"UMOA se retrouvent avec 313 milliards en 1985 et 174 milliards en 1988.
Sur une dizaine d'années, le montant cumulé des rééchelonnements pour
les sept pays membres (voir tableau) atteint la somme de 1 558 milliards
FCFA, soit l'équivalent de 6 milliards de dollars US.
UMOA - Rééchelonnements obtenus par les pays :
1980-1988 (enmilliards de francs CFA)
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988
Bénin
Burkina-Fasse
Côte-d'Ivoire
Mali
Niger
Sénégal
Togo
UMOA
16
217
235
252
273
26
14
4
38
30
9
28
27
20
37
21
20
23
17
16
19
15
14
13
15
27
40
88
281
313
312
308
174
174
(*) Mali inclus à partir de 1984
Source: BCEAO, 1989. Dakar.
A l'évidence, les économies africaines ne peuvent soutenir à la longue
de telles charges excessives au titre des échéances annuelles en intérêts
et en capital, sans compromettre dangereusement leur croissance et la
poursuite de leur développement, par instauration d'un cycle de déflation
qui réduirait leur capacité de remboursement déjà insuffisante.
2) Les caractéristiques principales de la dette
L'une des caractéristiques majeures de la dette extérieure ouest-africaine réside dans la part prépondérante prise progressivement par les
emprunts auprès des sources privées dans l'encours global de la dette. En
effet, celle-ci est passée de 25,9 % de la dette totale en 1970 à 50,6 % en
1982 et 58,3 % en 1988.
28
Ce retournement de situation est d'autant plus remarquable qu'il
s'inscrit dans une tendance inverse à celle de l'ensemble des pays africains subsahariens pour lesquels les taux correspondants sont de 40,8 %
en 1970,31,5 % en 1982 et 34,1 % en 1988.
En réalité, une déglobalisation permet d'observer que cette tendance à
la prépondérance des crédits d'origine privée dans l'encours de la dette
extérieure ouest-africaine à partir de la fin des années 1970 tient essentiellement au comportement des deux principaux emprunteurs de la région
(Nigéria et Côte-d'Ivoire) où le boom pétrolier (pour le premier) et cacaoyer
pour le second ont conduit à des emprunts massifs et imprudents auprès
d'un système bancaire international intéressé et complaisant.
La conséquence d'un tel laxisme ne s'est pas fait attendre : ce sont
l'alourdissement de la dette et l'accumulation d'arriérés de remboursement
conduisant à la situation où la dette extérieure absorbe en 1987 111 % du
PNB nigérian et 124 % de celui de la Côte-d'Ivoire, et dont plus des deux
tiers ont été contractés auprès de sources privées.
Une autre caractéristique importante de la dette ouest-africaine est
qu'elle ne contribue pas significativement à accroître la production nationale, ni a fortiori les exportations.
En effet, alors même que la dette extérieure s'est accrue au rythme
annuel moyen de près de 20 % entre 1970 et 1982 et de 24 % entre 1980
et 1987, le taux moyen de croissance du PIS des Etats de la région restait
en général faible, voire négatif (3,1 % entre 1973-1980 et - 0,1 % entre
1980-1987). Il en est de même pour les exportations de marchandises:
1,2 % entre 1973-1980 et - 2,3% entre 1980-1987.
Une telle situation tient au fait que, bien souvent, les emprunts extérieurs n'ont pas servi à financer des investissements productifs, mais plutôt
des dépenses d'infrastructures à rendement différé pour la plupart ainsi
que des dépenses de prestige par nature improductives.
Enfin, une dernière caractéristique de la dette extérieure ouest-africaine
réside dans sa mauvaise gestion qui a été en partie à l'origine des difficultés de service de la dette à partir de 1982. Cette mauvaise gestion de la
dette procède en effet de facteurs comme:
- la multiplicité des organismes publics pouvant contracter des
emprunts au nom de l'Etat;
- la méconnaissance quasi totale des emprunts non garantis
contractés par le secteur privé et remboursables en devises;
- l'absence de structures adéquates de gestion de la dette dotées de
moyens et de pouvoirs nécessaires pour collecter et centraliser les informations en vue d'un suivi efficace et d'un contrôle opérant de la croissance
de l'endettement.
Dans la pratique, cette mauvaise gestion de la dette conduit fréquemment à des ruptures de trésorerie en devises impliquant des demandes
subséquentes de réaménagement de certaines échéances.
29
3) L'endettement commercial et la situation relative des Etats
Pour illustrer la situation relative des Etats ouest-africains en matière
d'endettement commercial, nous avons choisi de considérer le cas typique
constitué par les pays de l'UMOA parmi lesquels figure le deuxième gros
emprunteur de la région (la Côte-d'Ivoire).
La structure de la dette de ces pays, à l'instar de l'ensemble de la
région, s'est profondément modifiée depuis la deuxième moitié des années
1970, se traduisant par une régression relative des concours publics
(gouvernementaux et internationaux) au profit des financements extérieurs
aux conditions du marché.
C'est ainsi qu'en 1985, l'endettement commercial y atteint 62,5 % du
total du service de la dette du fait du coût onéreux et des échéances plus
courtes des prêts consentis par les sources privées (crédits bancaires et
crédits fournisseurs). Ce ratio, pour la même année, varie d'un minimum
de 3,3 % (Mali) à un maximum de 78,8 % (Bénin). le principal emprunteur
du groupe (la Côte-d'Ivoire) affichant un taux substantiel de 77,2 %. En
1986, la tendance demeure sensiblement la même avec respectivement
pour les trois pays ci-dessus qui continuent d'occuper les mêmes positions
2,0 % ; 75,4 % et 74,1 % (voir tableau).
Service de la dette axtérieure en 1985 et 1986
dans l'UMOA (en millions de francs CFA)
1985
Bénin
Burkina Côte·d'Ivolre
Mali
Niger
Sénégal
Togo
Delle multilatérale
Delte bilatérale
Delte bancaire
Crédits fournisseurs
5037
3471
30505
1220
7577
6196
7036
1367
70303
48266
362709
39749
7714
26914
993
211
8026
13004
22116
3175
20177
44635
19636
2647
9300
30800
7500
1300
Total
40233
22176
521027
35832
46321
87095
48 900
78,8
37,8
77,2
3,3
54,6
25,5
17,9
Delte multilatérale
Delte bilatérale
Delte bancaire
Crédits tournisseurs
5958
3653
28296
1 170
8708
7055
2943
1283
78358
50164
329716
34299
8204
29897
900
203
8455
14480
19871
1 966
23079
51022
12367
1 535
7900
36 800
7500
2100
Total
39077
19989
492537
39204
44772
88003
54 300
75,4
21,1
74,1
2,0
48,7
15,7
17,6
Part de la delte commerciale (%)
1986
Part de la delte commerciale (%)
Source: Banque Mondiale, BCEAO, Cinquième Club de Paris, 1987.
30
CHAPITRE Il - LES EXPLICATIONS DE LA MASSIFICATION DE L'ENDETTEMENT EN AFRIQUE DE L'OUEST
La décennie des années 1960 a été caractérisée par une conjoncture
mondiale particulièrement favorable, avec une expansion économique au
niveau des pays industrialisés et une très forte accélération des échanges
internationaux. Cet ensemble de facteurs a été positif pour une bonne
partie des pays du Tiers-Monde, particulièrement ceux dont les revenus
sont élevés et dont les dotations factorielles naturelles importantes constituent un potentiel de développement. Ces pays ont connu dans cette
période des taux de croissance élevés compris entre 4 et 8 % ; ceux-ci
s'expliquent d'abord par la conjoncture mondiale favorable qui accroit la
demande externe de ces pays, ensuite à la relative stabilité des prix à la
fois des matières premières, et surtout des biens d'équipement et des
produits manufacturés et enfin par l'importance des transferts de
ressources financières d'origine publique. Dans chaque région émergent
quelques pays semi-développés qui élargissent l'aire géographique du
capitalisme. Par leurs performances économiques réelles et potentielles, ils
vont bénéficier d'une crédibilité vis-à-vis du système mondial, pour trouver
les moyens d'amorcer et d'entretenir une dynamique interne de croissance.
Ce sont ces pays qui, par la suite, négocieront au moins 90 % des grands
prêts consentis au Tiers-Monde.
Toutefois, dans les années 1970, s'opère un renversement de
tendance avec le quadruplement des prix des produits pétroliers, l'augmentation des prix des biens d'équipement et de consommation, la détérioration des cours des matières premières et l'élévation des prix des produits
alimentaires. Cette situation a entraîné un double déficit de la balance des
paiements et des finances publiques et cela particulièrement au niveau des
pays sous développés les plus fortement reliés à la division internationale
du travail.
Cette montée des déséquilibres sera aggravée par d'autres contradictions du système mondial comme les ruptures des équilibres économiques,
la ruine de l'édifice monétaire international, la redistribution des surplus
financiers en faveur des pays arabes du Golfe. Les pays déficitaires du
Tiers-Monde offrent des opportunités d'opérations financières mercantiles.
Les banques privées réalisent des crédits à la fois souples et coûteux pour
les utilisateurs. Ainsi il apparaît que l'endettement tient à plusieurs phénomènes et ne saurait alors s'expliquer par une cause unique. A la lumière
de l'analyse de l'évolution de la dette en Afrique de l'Ouest les facteurs de
l'endettement procèdent:
- d'abord de l'extrême précarité des modèles d'accumulation et de
développement appliqués par les États en se fondant sur la rente minière
ou agricole pour la formation des surplus;
- ensuite du recours au système financier international pour la résorption des déséquilibres physico-financiers internes ;
31
- enfin de l'utilisation des institutions financières privées évoluant sans
règles rigides et échappant au contrôle des Banques centrales.
1) La précarité des modèles d'accumulation et de développement en
Afrique de l'Ouest fondés sur la rente minière ou agricole
L'analyse économique établit J'importance de l'accumulation du capital
dans le développement économique et social. L'élargissement des forces
productives matérielles et humaines, la mise en valeur des ressources de
base, le renouvellement du processus de production sur des bases élargies sont impossibles sans accumulation, sans disponibilité d'un surplus
important. Or, tel n'est pas le cas en Afrique de l'Ouest, où l'accumulation
primitive ne s'est pas opérée par suite d'un fonctionnement régulier des
présupposés du capital, de la distraction d'une partie des surplus par des
groupes sociaux homogènes, très peu hiérarchisés et de la mise en place
de mécanismes de transfert des plus-values vers l'ancienne métropole.
Dès lors, au moment des indépendances, la plupart des Etats ne disposaient pas de surplus économiques pouvant être mobilisés pour le financement du développement. Certains ont même hérité des formes
particulières de mise en valeur coloniale, d'une crise de leurs finances
publiques. Par la suite, les déficits courants absorberont les maigres
ressources, qui se formeront dans le système économiques.
A l'indépendance, les États Ouest-Africains ont mis en place des
modèles d'accumulation et de développement se fondant essentiellement
sur la rente minière ou agricole. L'exploitation systématique des matières
brutes visait à obtenir les devises nécessaires pour couvrir les importations
et financer les autres activités. Quant à l'agriculture, elle a eu pour objectif
d'abord d'accroître et d'améliorer les ressources en devises ; ensuite de
procurer des revenus monétaires aux producteurs ce qui permet d'élargir
les bases objectives du marché national et enfin de libérer une partie de la
main-d'œuvre pour d'autres secteurs d'activité. Ainsi ces politiques ont
développé les activités exportatrices et articulé les systèmes productifs
internes à l'économie mondiale. Les résultats furent partout désastreux.
Ce modèle d'accumulation et de développement que tous les pays ont
adopté, quelle que soit du reste leur option de système, est à la base de
quatre situations que sont:
- l'amplification du déficit de la balance commerciale par suite d'un
mouvement contradictoire d'augmentation en valeur des importations (du
fait d'une inflation persistante et du caractère incompressible de la
demande de biens importés) et d'une baisse des exportations liée au
caractère oligopolistique des marchés des matières premières et des
faibles élasticités de la demande;
- l'approfondissement du déficit fiscal consécutif au désarmement
douanier et fiscal, de même que d'autres concessions pour inciter le capital
32
privé étranger, à la dévalorisation du capital public et à la forte évasion
fiscale des titulaires de revenus importants: capitalistes et rentiers;
- le déficit alimentaire provenant d'une grave crise agro-alimentaire
qui se matérialise par la baisse de la production vivrière par tête et l'avènement de pénuries alimentaires de plus en plus importantes; pénuries dues
aux faibles productions vivrières des systèmes agraires locaux, à une forte
demande alimentaire liée à l'explosion urbaine et à la généralisation du
modèle de consommation urbain fondé sur des biens importes;
- les transferts multiples qu'opèrent les entreprises étrangères et
certains opérateurs nationaux.
La conjugaison de tous ces facteurs, aggravée bien souvent par des
chocs extérieurs (tendances conjoncturelles de renforcement de la détérioration des termes de l'échange, l'élévation des taux d'intérêt, surévaluation
ou même la sous-évaluation des monnaies fortes), produit le déficit des
paiements extérieurs et des finances publiques obligeant les Etats à
recourir au financement extérieur.
En d'autres termes l'endettement est un produit du modèle de développement et se présente comme un moyen d'ajustement et d'équilibre. Ainsi,
en Afrique de l'Ouest, on observera que l'alourdissement de la dette extérieure s'est accentué à la suite de la détérioration des finances publiques et
de la mise en oeuvre de certains projets de développement.
Le poids de la dette va constituer un sérieux handicap et annihiler tous
les efforts de développement accomplis par les pays. Une part de plus en
plus importante des recettes d'exportation est absorbée par le service de la
dette.
2) Le recours au système financier international pour la résorption
des déséquilibres physico-financiers internes.
Dans les années 1960, la marge de manœuvre dont disposait le
système financier international pour résorber les déséquilibres financiers
des pays était très étroite. Le financement ne pouvait provenir que des
mouvements autonomes de capitaux (investissements directs, crédits,
aides publiques bilatérales ou multilatérales) ou de mouvements compensatoires du FMI qui sont des crédits octroyés selon des conditions très
strictes. Dans ces circonstances, les déséquilibres extérieurs des Etats
étaient soumis à des règles très rigoureuses. De plus, le système avait mis
en place des mécanismes financiers pour assurer la régulation et
permettre le retour à l'équilibre. C'est dire que les règles du jeu monétaire
issues de Bretton Woods étaient bien observées et les mouvements financiers étaient soumis au contrôle strict des Banques centrales.
Cependant, dans les années 1970, ces institutions ont évolué très rapidement et le système financier international a éclaté sous le double effet
de l'énorme accroissement des liquidités et de leur manipulation par les
banques commerciales privées et les multinationales. Celles-ci opèrent à
33
l'échelle internationale et échappent totalement au contrôle des Banques
centrales.
Les pays du Tiers-Monde, confrontés à des besoins énormes de financement par suite d'une chute en valeur de leurs exportations et d'un
gonflement de leurs importations, vont recourir au marché financier surliquide où les pétrodollars surabondants cherchaient à se placer.
Au vu de cette conjoncture favorable, les pays du Tiers-Monde ont
établi des projets industriels destinés à la substitution aux importations
donc à la consommation des élites (automobiles, électro-ménager, petite
électronique, etc.) et, en même temps, ils élaborèrent de vastes et coûteux
programmes d'investissements dans les infrastructures socialeset de base.
En somme ces pays s'accommodent d'importants déséquilibres et sont
assurés de pouvoir recourir à l'endettement pour les résorber. De la sorte,
ils deviennent des clients artificiellement « solvabilisés » des industries des
pays développés.
Ainsi, il ressort de ces constats que l'endettement du Tiers-Monde peut
exercer une double incidence positive sur les économies des pays industrialisés. D'une part, il fonctionne comme un facteur de relance économique et de soutien aux exportations des pays riches. D'autre part, il
participe à la stratégie de redéploiement du capital qui consiste à créer des
divisions régionales du travail permettant une délocalisation industrielle et
une redistribution des autres activités productives. Cet aspect est remarquable en Amérique Latine.
En dernière analyse, l'endettement participe à la constitution et à la
consolidation de blocs géo-politiques relativement autonomes autour des
cinq pôles du monde: les Etats-Unis, l'Europe, le Japon, l'URSS et la
Chine. A l'intérieur de chaque bloc s'opère une division du travail qui peut
permettre tout au moins une industrialisation partielle de certains pays du
Tiers-Monde au prix d'un endettement massif. Parmi ceux-ci, on peut noter
le Brésil, le Mexique, Israël, l'Egypte, le Nigéria, la Côte-d'Ivoire.
Comme maintes fois souligné, les Banques privées ont joué un rôle
extrêmement actif dans l'amplification de l'endettement.
3) Le rôle des Banques Privées dans l'accélération de l'endettement
L'accroissement de la part des crédits bancaires privés dans la dette
(60 %) par rapport aux crédits publics et internationaux, indique les rôles
essentiels joués par le système bancaire dans l'expansion de l'endettement. Le caractère technique de cette privatisation de la dette en fait un
élément particulièrement sous-étudié. On a souvent fait observer que face
à un marché financier largement demandeur, les Banques privées ont mis
en place des mécanismes financiers qui ont rapidement pris le relais de
l'aide publique au développement qui non seulement a baissé en volume
mais s'est réorientée vers le financement des pays les plus pauvres du
34
système mondial. Il importe d'analyser de plus près ce comportement
bancaire dans la montée de l'endettement.
La période 1974-1982 a été marquée selon P.B. Ruffini par cc la bancarisation de la dette des PVD c'est-à-dire l'émergence, comme bailleur de
fonds principal de ces pays, du groupe des banques multinationales en
remplacement des agences officielles, nationales ou internationales. Une
telle substitution a conduit à une modification importante des caractéristiques des flux financiers vers les pays en développement »(2). Comment
cette évolution s'est-elle opérée? Le premier choc pétrolier a permis
l'accumulation d'énormes surplus financiers qui furent déposés à court
terme auprès des grandes banques internationales. Celles-ci devaient leur
trouver des emplois immédiats en les plaçant sur le marché interbanque
alimentant ainsi le développement des euro-marchés et les moyens des
institutions financières bénéficiaires des ressources nouvelles. Ces
dernières ont cherché des placements auprès des PVD qui avaient
d'énormes besoins financiers pour couvrir leurs factures pétrolières et
financer les investissements intérieurs. Les placements dans les PVD
étaient d'autant plus importants que les besoins financiers des grandes
entreprises multinationales des pays développés s'amenuisaient du fait de
la récession réductrice de l'activité économique. Dans ces conditions, les
banques privées réalisent des financements qui ont modifié systématiquement la composition de leurs actifs qui comprennent désormais un portefeuille de plus en plus volumineux de créances sur les PVD.
L'amplification de ce processus pose à la fois le problème de l'évaluation des risques-pays encourus par les banques commerciales et celui de
leur responsabilité dans la montée de la dette et son utilisation laxiste.
Selon un praticien de la Banque, R. Bertieaux, cc pour limiter les risques
d'un caractère nouveau, la pratique bancaire développa des méthodes plus
ou moins sophistiquées de plafonnement des risques par pays, de diversification du portefeuille-crédits par le jeu de la syndication. On crut trouver
une protection supplémentaire en recherchant de préférence aux risques
privés, des risques ccsouverains» c'est-à-dire des crédits à des Etats ou à
des entités jouissant de la garantie des Etats »(3). Pareille recherche de
sécurité se fonde sur l'opinion que la puissance publique ne risque jamais
d'être insolvable.
Une institution comme la BRI (Banque des Règlements Internationaux)
observe que sur toute la période 1974-1982, les banques ont commis de
très graves erreurs d'appréciation dans leur activité de prêt à l'étranger, ce
qui fait dire à H. Bourguinat qu'elles ont adhéré trop tardivement au
discours vertueux de la rigueur.
(2) P.S. Rulfini, La montée de l'endettement des PVD au cours de la décennie 1970: un
examen à partir du comportement bancaire, Congrès des Economistes de langue française,
Clermont-Ferrand, 24-26 mai 1984.22 p.
(3) R. Sertieaux, .. Rôle respectif des banques privées et des organisations internationales à l'égard du financement des pays en difficulté ". Congrès des Economistes, ClermontFerrand, mai 1984, 19 p.
35
Cette sous-évaluation des risques a entraîné une distribution excessive
de crédits, donc un gonflement des créances sur le Tiers Monde mais
aussi une dégradation progressive des ratios de fonds propres des
banques.
Bien sûr, cette générosité et ce laxisme des banques s'expliquaient par
la situation surliquide des marchés financiers qui a déterminé le choix d'un
accroissement des actifs au détriment de la qualité des créances. Les
banques commerciales se sont trouvées avec des ressources énormes à
court terme qu'elles ont prêté à long terme aux PVD par le mécanisme des
crédits roll-over qui consistent pour les banques commerciales à consentir
de leurs dépôts à court terme, des crédits à moyen terme à taux flottant
pour ajuster, par ce biais, le taux des intérêts débiteurs aux variations des
taux de dépôt à court terme. En d'autres termes, les crédits roll-over
permettent de transformer les dépôts à court terme des banques en crédit
à long terme. R. Bertieaux observe que ces divers procédés, en facilitant le
recyclage des pétrodollars ont contribué à accroître le volume des crédits
aux PVD, mais ils portaient en germe les difficultés futures auxquelles
auraient à faire face bon nombre de banques engagées dans ces opérations de financement des PVD.
Au total, face à un marché financier largement demandeur dans le
Tiers-Monde et à la baisse des liquidités du fait de l'adoption par les pays
développés de politiques monétaires plus restrictives, destinées à freiner
les anticipations inflationnistes, les Banques privées ont créé des mécanismes financiers facilement mobilisables et coûteux pour les bénéficiaires.
Elles ont mis en place une organisation créatrice de liquidités financières
par le biais du développement des opérations inter-bancaires. Il s'agit de la
création du capital-prêt.
Le système bancaire prend ainsi d'énormes risques en vue de bénéficier des taux d'intérêt mercantiles. Cette ruée vers les pays périphériques
les plus avancés, les plus stables et les plus crédibles avaient amené les
banques à engager des ressources qui dépassent de très loin leurs fonds
propres. Cela apparaît, à titre d'illustration, dans le niveau élevé du ratio
prêUfonds propres qui se présentait comme suit:
Ratios
Prêts/fonds
propres
Banques
City Corpo
Bank of America
Chase Manhattan Bank
Morgan Guaranty Trust
Manufactures hanover Trust
Chimical Bank
Continental Illinois
Banker Trust
First Chicago
Wells Fargo '"
36
.
..
.
.
.
.
..
'"
.
..
174,5 %
158,2 %
154,0 %
140,7 %
262,8 %
169,7 %
107,5 %
141,2%
134,2 %
126,6 %
Cette technique de financement et de mobilisation facile des
ressources, sera très amplement exploitée par les pays qui poursuivent
des stratégies de croissance et de valorisation de certaines ressources.
Pourtant, pour les emprunteurs, les crédits bancaires ainsi octroyés sont
inadaptés et soulèvent deux problèmes ayant trait l'un à l'échéance et
l'autre au coût. Concernant l'échéance, on peut observer que les PVD ont
besoin de ressources de longue durée pour financer leurs investissements
et faire face à des difficultés conjoncturelles. Or, le système bancaire ne
met à leur disposition que les crédits de court terme. Dès lors, le délai de
remboursement ne va point coïncider avec le délai de maturité et de rentabilité des opérations financées. Cette contradiction ouverte n'est même pas
réglée par les crédits roll-over à moyen terme.
Une seconde catégorie de problèmes soulevés par les crédits
bancaires privés est relative aux coûts. les frais financiers supportés sont
excessifs et ne peuvent point être couverts par les ressources dégagées
par des investissements. C'est dire qu'ils compromettent au départ la
rentabilité même des projets. Par ailleurs, la pratique des taux d'intérêt
variables introduit un autre élément de complication dans la gestion des
crédits bancaires et pénalise les pays emprunteurs.
En définitive, il semble de plus en plus que le développement de
l'endettement aboutit à une situation dans laquelle la survie même des
institutions financières privées dépendra de la solvabilité de leurs clients.
En effet, les Banques privées ayant très mal apprécié les risques étaient
obligées, dans les situations de difficultés des débiteurs, d'accepter "accumulation d'arriérés de paiement et le report des échéances qui entraînait
inévitablement leur faillite ainsi que celle des entreprises avec lesquelles
elles ont de plus en plus de liaisons étroites. Cette situation affecte
l'ensemble de l'économie mondiale. Si les banques peuvent alors attendre
pour le recouvrement du principal de la dette qui est un actif mobilisable,
elles ne peuvent le faire pour les charges d'intérêt dont les pays doivent
impérativement s'acquitter.
La perspective d'insolvabilité qui se dessine tendancielle ment devient
alors la source d'inquiétude à la fois pour les créanciers et leurs économistes car un défaut de paiement serait extrêmement lourd de conséquences économiques, financières et sociales. Il entraînerait sans nul
doute un écroulement de certaines banques privées, un ébranlement de
l'édifice du système financier international et la faillite des entreprises
nationales et multinationales alliées au capital financier. Au demeurant,
tout le monde mesure parfaitement ces enjeux de la dette et se préoccupe
de la nature de la crise qu'elle génère et entretient.
S'agit-il d'une crise de solvabilité ou d'une crise de liquidité? Telle est
la question que les créanciers du Tiers-Monde et leurs experts se posent et
qui les éloigne de leurs conceptions initiales selon lesquelles l'endettement
est un moyen indispensable de financement du développement.
En fait, le recours de plus en plus fréquent des pays d'Afrique de
l'Ouest au rééchelonnement de leurs engagements extérieurs, pour des
37
montants de plus en plus importants, dénote une crise aiguë et durable de
la dette. Il est alors tout à fait légitime de s'interroger pour savoir s'il s'agit
d'un problème de liquidité ou plus profondément d'une situation d'insolvabilité issue d'un blocage de la mécanique économique.
Les difficultés de la dette auxquelles sont confrontés actuellement la
plupart des Etats Ouest-Africains peuvent tenir soit d'une insuffisance de
leurs réserves de change, soit d'une insuffisance de leur capacité de
remboursement. Dans le premier cas, la dette pose un problème de liquidité et dans le second, elle soulève une question plus grave de solvabilité.
Ces questions importantes de l'incidence à moyen et long terme de la dette
sur les politiques de développement économique et social méritent d'être
précisées et analysées. Cependant, malgré les innombrables difficultés
des pays à faire face au paiement du service de la dette, malgré les
énormes difficultés d'insolvabilité des débiteurs, on continue d'observer
une assez forte accélération de l'endettement. Les crédits bancaires
augmentent pendant que diminue de façon notable l'aide publique au
développement. Ces deux éléments ne manqueront pas d'avoir des incidences négatives sur les politiques économiques et financières internes et
les déséquilibres déjà profonds. Il importe alors d'analyser de plus près
tous les facteurs qui président à l'accélération de l'endettement pour mieux
comprendre leur dynamisme. Ce sera l'objet de cette seconde partie de
l'analyse.
38
DEUXIEME PARTIE
Facteurs d'accélération
et mécanismes de propagation
de l'endettement
Que l'endettement soit devenu un phénomène massif, toutes les statistiques permettent de le constater, bien qu'avec de notables différences
quantitatives tenant principalement aux concepts et méthodes de comptabilisation différents d'une source à une autre. Prenons le volume de
l'endettement du Tiers-Monde: pour 1979, la Banque Mondiale l'évalue à
369 milliards et le Comité d'Aide au Développement de l'OCDE l'estime à
388 milliards de dollars. Cet écart n'est tout de même pas négligeable pour
être accepté comme une simple marge d'erreur.
Il existe un réel problème de méthodologie de comptabilisation qu'il ne
faut pas occulter. Comme l'observe Marie France L'Hériteau, en passant
des grandeurs nominales aux grandeurs réelles, on donne au phénomène
de l'endettement un éclairage tout à fait différent. De même, selon les
variables macro-économiques auxquelles on rapporte le volume de l'endettement, on obtient des appréciations différentes(1).
Cependant, pour normaliser les instruments de mesure et unifier le
langage, il est élaboré une batterie d'indicateurs qui sont à la fois des outils
d'intervention et de prise de décision, des instruments d'évaluation et des
étalons de comparaison internationale.
Dans le domaine de l'endettement, ces indicateurs sont utilisés à deux
fins principales: apprécier le niveau des ponctions du service de la dette
sur les ressources internes et évaluer l'incidence de l'endettement sur
l'économie et principalement sur la formation brute du capital fixe. Ainsi,
comme au niveau de la macroanalyse, les indicateurs agrégés vont se
présenter comme des raccourcis de l'analyse et permettre un transfert de
la réflexion théorique vers la stratégie.
Dans cette direction, les bailleurs de fonds ainsi que les experts des
pays débiteurs élaborent plusieurs indicateurs qui se classent en deux
catégories essentielles: les indicateurs liés à la balance des paiements et
ceux liés aux ressources.
La première catégorie d'indicateurs procède du fait que la dette est
fonction de la balance des paiements. En conséquence les indicateurs les
(1) Marie F. L'Hériteau, Dette extérieure et modèle de développement. Revue TiersMonde, tome XX, n° 89, octobre-décembre 1979.
41
plus usuels servent à quantifier l'endettement et surtout à analyser la capacité du pays à honorer ses engagements. Dans ce cas, quatre ratios sont
généralement calculés à savoir:
- Le ratio du service de la dette par rapport aux exportations de biens
et services qui indique la part des recettes en devises absorbée par le
service de la dette. On avance souvent que ce ratio, quand il est inférieur à
10 %, est acceptable, mais. dès qu'il se fixe au-dessus de 20 % cela
signifie que le pays débiteur va connaître de graves problèmes de service
de la dette. Pour l'UMOA, il est passé de 5,1 % en 1970 à 18 % en 1980 et
il s'est élevé à 34 % en 1982 pour la Côte-d'Ivoire. On observera enfin que
ce ratio est évolutif et dépend des fluctuations amples et imprévisibles des
exportations des PVD.
- Le ratio des revenus et des remboursements du capital par rapport
aux recettes d'exportations qui permet surtout d'apprécier les engagements extérieurs d'un pays.
- Le ratio des amortissements payés par rapport aux prêts reçus, est
par excellence le ratio de reconduction de la dette et montre dans quelle
mesure l'amortissement de la dette a été refinancé par de nouveaux
emprunts. Ce ratio pour l'UMOA est passé de 23,8 % en 1982 à 32,9 % en
1984.
- Le ratio des paiements d'intérêt par rapport aux exportations de
biens et services qui est un indicateur d'appréciation des revenus versés
aux prêteurs étrangers.
La deuxième catégorie d'indicateurs comprend trois ratios:
- Le ratio de l'encours de la dette extérieure par rapport au PIS. Ce
ratio permet d'apprécier le degré d'implication du secteur étranger dans
l'économie nationale, la solvabilité et la valeur des ponctions opérées sur
les ressources pour le compte du service de la dette. Dans la plupart des
Etats, le ratio montre que le niveau atteint est supérieur au PIS : 110 %
pour la Côte-d'Ivoire, 163,7 % pour le Mali, 108 % pour le Sénégal et
151,4 % pour le Togo et cela pour l'année 1985.
- Le ratio des transferts nets de ressources par rapport aux investissements indique la contribution de l'épargne extérieure au processus de
développement du pays bénéficiaire.
- Le ratio du service de la dette publique par rapport aux recettes
publiques ; il est surtout très important pour les pays de l'UMOA dans la
mesure où les difficultés du service de la dette extérieure se manifestent
plus comme une insuffisance de ressources publiques que comme un
problème de disponibilité de réserves de change.
Ces ratios sont d'une très grande utilité à la fois pour l'analyse et pour
la gestion même si leur calcul se heurte aux déficiences remarquables des
statistiques disponibles. Ils constituent des paramètres permettant l'insertion de l'endettement dans la politique économique et financière.
42
Cependant, ces ratios comme tout indicateur doivent être manipulés avec
beaucoup de prudence, car, ce sont des éléments pouvant faire l'objet de
plusieurs modes de calcul. Par exemple, le ratio montant de la dette sur
PNB donne des taux alarmants, alors que le résultat change si l'on considère le ratio dette sur exportations car celles-ci ont notablement augmenté
en volume ces dernières années. Enfin, l'éclairage se modifie à nouveau si
on passe du montant du capital au montant des remboursements de
l'intérêt dus annuellement.
En d'autres termes, chaque auteur possède sa propre batterie d'indicateurs qui confortent son argumentation. Selon que l'on est créancier, débiteur ou simple expert, on indexe toujours le ratio qui alarme ou rassure. En
somme, en manière d'endettement, ni les chiffres, ni les bilans, ni les
diverses comptabilités ne sont neutres.
Malgré le flou des instruments ainsi que leur impressionnante imprécision, ils révèlent de quelque côté qu'on les manipule une augmentation
soutenue du volume de la dette. Quelles en sont les causes profondes et
les conséquences sur le développement économique et social?
Sans avoir cerné avec précision tous les facteurs et les mécanismes
d'accélération de l'endettement, il sera probablement impossible de qualifier la nature de la crise de la dette et les perspectives de son évolution, et
d'appréhender conséquemment tous les enjeux qui lui sont intimement liés.
Il est manifestement facile de soupçonner que l'endettement pourrait être
une arme financière redoutable aux mains de créanciers qui pourraient
s'en servir pour contrôler et téléguider les orientations économiques et politiques des débiteurs. Surtout quand ceux-ci sont affaiblis et financièrement
asphyxiés. Ainsi, se dessine tout l'intérêt de l'analyse des facteurs de
massification de la dette.
Comme il a été observé plus haut, l'endettement n'apparaît pas comme
le résultat d'une cause unique, donc son accélération et son augmentation
relèveront aussi de la combinaison de plusieurs facteurs externes et
internes.
CHAPITRE 1. - LES FACTEURS INTERNES D'AGGRAVATION DE
L'ENDETTEMENT
Bien que la distinction entre facteurs externes et facteurs internes ne
soit pas facile, on peut définir les facteurs internes comme un ensemble de
variables d'origine interne contribuant à l'accroissement de la dette et
directement contrôlables par les Etats. Il reste que si nous prenons par
exemple l'environnement géoclimatique défavorable (sécheresse, désertification) et qui prévaut dans la majeure partie de la sous-région, nous
pouvons le classer comme facteur externe ; mais, ce faisant, nous occulterions le fait que les gouvernements concernés n'ont pas adopté et mis en
œuvre des politiques adéquates pour en minimiser les effets négatifs. La
même observation vaut également pour le déficit vivrier et les importations
43
alimentaires auxquelles il conduit ou pour la mauvaise gestion de la dette
qui est pratiquée.
Dès lors, nous pouvons retenir comme facteurs internes explicatifs de
la montée rapide de l'endettement en Afrique de l'Ouest:
Etats
-
les modèles de développement adoptés dans la quasi-totalité des
d'Afrique de l'Ouest et les erreurs de gestion;
les politiques de gestion de la dette et d'allocation des ressources;
les fuites de capitaux ;
les facteurs naturels.
1) Les modèles de développement
Les modèles de développement appliqués depuis plus de deux décennies ont imposé des politiques sectorielles (industrielle et agricole) qui sont
pour une part essentielle responsables des désastres économiques ayant
conduit au recours massif aux marchés financiers et au crédit des banques
commerciales. Inspirées de la théorie keynésienne et néo-classique, les
stratégies de développement faisaient de la croissance l'objectif économique et politique majeur. La croissance désirée devrait être rapide, régulière, harmonieuse et débarrassée de toute fluctuation trop forte en baisse
comme en hausse et enfin être équilibrée en faisant correspondre et
s'ajuster les capacités de production et de consommation.
Ces stratégies souvent conduites dans une logique libérale ont
débouché sur des politiques agricoles, industrielles et tertiaires intégrées
au système financier mondial et mettent au centre l'investissement privé
étranger qui détermine à la fois les transferts de surplus, l'allocation des
ressources, les choix technologiques et les modes de consommation.
L'analyse traditionnelle du couple déficit de la balance des
paiements/endettement est très partielle pour rendre compte de l'accélération de la dette extérieure. Car on peut observer des pays fortement
endettés avec cependant des balances de paiement excédentaires ou tout
au moins équilibrées.
Ce sont les politiques de développement qui sont, en dernière analyse,
génératrices à titre principal de l'endettement. Cela apparaît dans:
- le développement prioritaire des activités exportatrices agricoles ou
minières où les recettes et les surplus sont fonction des marchés mondiaux
de matières premières caractérisés par des cours instables et aléatoires.
On connaît maintenant avec beaucoup plus de précision le phénomène de
la détérioration séculaire des termes de l'échange cc soit formel c'est-à-dire
comptabilisé comme une non équivalence des valeurs en termes de prix
courants, ou informel, c'est-a-dire dissimulé à l'intérieur de la structure
même de ces prix courants comme une non-équivalence de leurs
éléments. Dès lors, à l'époque contemporaine, les exportations de la
Périphérie vers le Centre évaluées aux prix mondiaux existants, non seule-
44
ment n'excèdent pas les importations, évaluées sur la même base mais
leur sont inférieures »(2). Il s'ensuit un transfert de valeurs réelles dans le
sens Périphérie-Centre;
- l'instauration d'un modèle de consommation extraverti destiné à
satisfaire les besoins de la minorité privilégiée par la fortune et ceux des
élites urbaines. Un tel modèle accélère les importations de biens de luxe,
modernise l'infrastructure de base et promeut une industrialisation dépendante qui repose sur la substitution des importations. Ce modèle de
consommation entraîne également des importations qui ne peuvent être
financées que par les exportations ou l'emprunt. J. C. Sanchez Arnau cite
à titre d'illustration l'introduction de la fabrication ou du montage des
voitures qui engendre la nécessité de construire des routes, de trouver des
biens d'équipement et des technologies. Ce qui entraîne une série d'opérations conduisant à un premier type d'endettement lié aux crédits qui
accompagneront les capitaux étrangers et un second lié aux importations.
Malgré cet alourdissement de la dette, l'introduction de l'automobile n'aura
satisfait que les besoins des élites et des classes moyennes mais ne
règle ra ni le problème du transport, ni celui du développement des biens
exportables pour se procurer des devises en vue de couvrir les importations croissantes;
- le déficit alimentaire qui est une autre conséquence du développement des cultures de rente au détriment des cultures vivrières et de généralisation du modèle de consommation urbaine axé sur des produits
vivriers d'importation. Les villes qui se développent par suite de l'échec des
politiques agricoles, amplifient le déficit vivrier. Dans ce cas, une bonne
partie des réserves en devises sont consacrées à payer une facture
alimentaire de plus en plus lourde. Si ces réserves ne sont pas disponibles,
le pays recourt alors à l'endettement ou à l'assistance alimentaire;
- les distorsions très grandes en faveur des activité hautement improductives dont l'armement devient de plus en plus une composante essentielle en terme d'immobilisation des ressources humaines, matérielles et
financières. Le matériel militaire est coûteux aussi bien à l'achat qu'à
l'entretien et il est à la base d'un endettement lourd dont les montants
restent encore sous le sceau du confidentiel. Les ressources humaines les
plus saines de la nation sont extraites de la vie active et rendues totalement oisives.
Tous ces éléments ont contribué à la constitution d'un déficit des
ressources mais aussi de la balance des paiements qui était couvert par
l'aide publique au développement (APD). Cependant, l'APD a amorcé une
tendance à la baisse (de 53 % des ressources dans les années soixante à
un peu plus de 20 % dans les années quatre-vingts) pour se réorienter
(2) A. Emmanuel, L'échange inégal et la revendication de prix rémunérateurs par les
pays en voie de développement, Revue Tiers-Monde, repris par" Problèmes économiques ",
na 1684 du 30 juillet 1980.
45
principalement vers les pays les plus pauvres dénommés PMA dans le
jargon onusien. Le financement privé prend le relais et réalise des financements généreusement octroyés sur des projets pas toujours rentables ou
sur des investissements somptuaires appelés éléphants blancs. Cela
confirme que les modèles de développement ont produit à la fois l'accélération de l'endettement et sa privatisation par le système bancaire international.
2) Les politiques inefficientes de gestion de la dette et d'allocation
des ressources,
L'insuffisante gestion de la dette constitue indéniablement une des
caractéristiques des pays en développement . Dans ces Etats, la gestion
de la dette était souvent confiée, jusqu'à une date récente, à un service du
Ministère chargé des Finances ou du Plan. La plupart des gouvernements
ont créé par la suite une structure autonome: Caisse Autonome
d'Amortissement (Bénin, Côte d'Ivoire, Sénégal) ou Société Nationale
d'Investissement (Togo). Mais, bien souvent, ces structures n'ont pas été
dotées de pouvoirs et de moyens indispensables à une gestion réelle et
efficace.
En matière de pouvoirs, la multiplicité des centres de décision habilités
à contracter des emprunts au nom de l'Etat a conduit à tous les abus, tous
les scandales et a empêché une coordination véritable des actions et une
centralisation des informations. C'est ce qui explique que les difficultés
d'évaluation et de recensement de la dette demeurent préoccupantes. Une
bonne connaissance de la dette est pourtant un préalable indispensable à
une bonne gestion. Ainsi, une planification de la dette par l'établissement
d'un calendrier prévisionnel des tirages, des paiements d'intérêts et
d'amortissements, s'avère impossible dans ces conditions. De même, tout
arbitrage entre les sources de financement et les devises d'emprunt est
difficile à réaliser dans les conditions actuelles d'organisation. Il saute aux
yeux que dans bien de pays le volume, la structure et l'utilisation de la
dette ont été sciemment obscurcis par ceux-là même qui l'ont négocié.
S'agissant des moyens, les ressources humaines et matérielles des
organismes chargés de la gestion de la dette sont bien souvent limitées. La
formation du personnel aux méthodes et techniques modernes de gestion
de la dette est généralement négligée. La dotation en matériel est des plus
rudimentaires, si bien que le traitement de la dette n'est pas informatisé ou
même automatisé. A l'évidence, l'importance d'une gestion rapide, fiable et
rationnelle n'a pas encore été perçue ni politiquement, ni techniquement.
L'allocation non optimale des ressources d'emprunt constitue une autre
des causes internes des difficultés du service de la dette dans les Etats
d'Afrique de l'Ouest. Ainsi une part non négligeable des prêts extérieurs,
surtout dans les années 1977-1979, a été affectée, par plusieurs Etats, au
46
financement d'investissements de prestige ou à des projets de rentabilité
douteuse. Faute d'études et d'analyses approfondies, des erreurs ont été
commises dans le choix de certains sites de barrages ou dans la construction de certaines usines, dont le coût de réalisation a été surfacturé par les
fournisseurs pour un matériel partois vétuste ou totalement obsolète. De
nombreux investissements, financés sur emprunts extérieurs, non seulement ne génèrent pas les ressources nécessaires pour couvrir le service
correspondant de la dette, mais encore absorbent des aides reçues par
l'Etat.
La multiplication des projets d'infrastructure ou d'utilité générale dont la
contribution au développement économique est appréciable, pose égaIement des problèmes. Dans la mesure où de tels projets ne dégagent pas
directement des ressources pour faire face au service de la dette correspondante et ou ils entraînent des charges récurrentes d'un montant élevé,
l'Etat doit pouvoir accroître ses recettes et produire une épargne budgétaire suffisante pour couvrir ces différentes charges. Or, les Etats dans leur
ensemble, sont confrontés depuis l'année 1980, à des difficultés de trésorerie inextricables se traduisant par des cessations de paiement qui ne leur
permettent même plus d'assurer le traîtement des fonctionnaires.
3) La fuite des capitaux
La fuite des capitaux est aujourd'hui un des phénomènes majeurs qui
accentue les problèmes de liquidité des pays d'Afrique de l'Ouest. D'importants placements sont en effet maintenus à l'extérieur dans les places
financières reputées stables et sûres. Ils sont le fait de sociétés tant
privées que publiques mais aussi de particuliers dont l'origine des
richesses n'est pas toujours licite. Ces transferts unilatéraux selon les estimations de l'OCDE (Organisation de Coopération et de Développement
Economiques) ont représenté entre 50 et 60 milliards de dollars en 1982
pour les pays du Tiers-Monde non producteurs de pétrole.
Cette question est aujourd'hui assez préoccupante par son ampleur et
ses incidences négatives sur les ressources provenant de la dette. Les
institutions financières internationales (FMI et BM) entreprennent des
évaluations quantitatives et s'inquiètent des tendances déjà observées. Il
leur restera à perfectionner les analyses pour mieux cerner les groupes
sociaux et les mécanismes responsables de cette fuite des capitaux vers
les grandes places financières sûres. En attendant, la Banque Mondiale et
le FMI ont observé que le phénomène est quantitativement important.
Ainsi, en Argentine entre 1973 et 1983, la fuite des capitaux a représenté
71 % de la dette alors qu'au Mexique, durant trois années (1982-1985),
pour un endettement de 17 milliards de dollars, la fuite a été de 24
milliards. Des recherches entreprises par l'Université de Washington ont
confirmé toutes ces tendances pour des pays comme le Brésil, le
47
Vénézuéla, le Mexique qui ont, à eux seuls, transféré vers les Etats-Unis
entre 1982 et 1985, 48 milliards de dollars.
De tels faits sont des motifs réels pour imposer une plus grande rigueur
aux pays. Comme le note H. Bourguinat, ceux-ci ne doivent pas être
exonérés de cette utilisation des fonds empruntés(3).
Pour l'Afrique, ces fuites sont principalement opérées par les multinationales qui procèdent par des transferts licites sous forme d'intérêts, de
dividendes, de bénéfices et illicites, par le double moyen d'une sur-facturation des biens et services vendus aux filiales et d'une sous-facturation des
achats locaux.
Dans des pays comme ceux de l'UMOA, à ces transferts s'ajoutent les
sorties de billets de banque qui atteignent par an un volume de 150
milliards et sont sans commune mesure avec les besoins du commerce et
les dépenses de voyage des résidents.
En définitive, l'ampleur des fuites dépend principalement du degré
d'extraversion et d'articulation à l'économie mondiale. Dans ce contexte,
des ressources financières importantes sont détournées des circuits des
économies nationales et vont accentuer les déficits de liquidité et
d'épargne. On s'aperçoit alors que ce sont les pays endettés du Sud qui
financent les pays du Nord.
4) Les autres facteurs internes d'aggravation de la dette
Certaines études établissent qu'une série de facteurs divers peuvent
aussi contribuer à l'aggravation de l'endettement. Parmi ceux-ci, on retient
pour les plus importants: les facteurs naturels, la mauvaise gestion des
environnements instables, les erreurs de politique économique et financière et les rééchelonnements répétés.
La sécheresse ces récentes années a contribué à une détérioration des
conditions intérieures de production qui sont aggravées parfois par des
accidents imprévisibles. C'est le cas entre autres des feux de brousse qui
ont ravagé en 1983 le Bénin, la Côte d'Ivoire et le Togo. Il en est résulté
une contraction de la commercialisation vivrière, un rétrécissement des
disponibilités agricoles d'exportation et des recettes de l'Etat. L'endettement est alors intervenu pour financer ces déséquilibres.
Des erreurs de politique économique et financière sont aussi à l'origine
du problèmes de la dette. Ainsi, selon le Plan d'Action de Lagos, il se
produirait en Afrique un gaspillage d'environ 30 à 40% des productions
vivrières, en raison de la médiocrité des méthodes de traitement, de
commercialisation, de transport et d'entreposage. Pareille situation a pour
conséquence une augmentation des importations alimentaires qui font de
(3) H. Bourguinat. L'économie mondiale à découvert. Edit Calman-Lévy. Paris, 1985,
270 p.
48
l'Afrique une zone d'insécurité agro-alimentaire grave la soumettant ainsi à
la dépendance de ceux qui contrôlent le pouvoir vert et l'alimentation
mondiale. D'ailleurs, le continent africain a remplacé l'Asie (4) dans le
recours à l'assistance alimentaire internationale par suite d'une dégradation prolongée de sa production vivrière et de l'explosion de sa demande
alimentaire due à deux facteurs: l'accroissement démographique et l'urbanisation accélérée. Pour combler ce déficit grandissant, l'Afrique augmente
ses importations surtout céréalières ce qui lui vaut des pertes de
ressources budgétaires et de réserves de change dont le montant aurait pu
être affecté au service de la dette. Il est par ailleurs bien connu que les
négociations d'emprunts donnent souvent lieu à des corruptions (commissions, ristournes, pots de vin) et même à des détournements de fonds qui
traduisent un manque de rigueur dans la politique financière des Etats.
Enfin, le dernier facteur interne qui est à la fois cause et conséquence
est le rééchelonnement qui devient une pratique courante des Etats en
Afrique de l'Ouest. Certains pays ont déjà établi des records dans les
recours successifs et dans des délais de plus en plus rapprochés au Club
de Paris et à celui de Londres. Or, le rééchelonnement, en supprimant
l'amortissement régulier du capital, fait monter le volume global de la dette.
En effet, les rééchelonnements ont été rendus nécessaires ces dernières
années pour éviter à certains pays débiteurs d'être déclarés officiellement
défaillants, toutefois, ils ont un coût qui peut se révéler important en termes
de commissions, de taux d'intérêt et de crédibilité financière. Les
échéances futures sont ainsi plus élevées et la situation à moyen terme
devient critique.
Observons qu'un pays qui rééchelonne doit verser des commissions
qui viennent s'ajouter à sa dette. De plus, il doit continuer à payer les intérêts afférents au montant global de l'encours qui comprend la partie
rééchelonnée. Il s'ensuit que les intérêts à verser sont supérieurs à ceux
qu'ils auraient dû être si le pays avait été en mesure d'assurer les remboursements du principal de sa dette. Dans certains cas, il est imposé sur la
portion de la dette rééchelonnée un taux d'intérêt plus élevé que sur les
prêts antérieurs, en raison des risques plus grands encourus sur les
nouveaux prêts. Il arrive alors dans les rééchelonnements en chaine que
l'échéancier après rééchelonnement soit supérieur à l'échéancier initial.
Même si les bailleurs interviennent pour couvrir le cc gap .. , l'accumulation
de la dette posera des problèmes insurmontables sur le moyen terme.
Enfin, la perte de crédibilité financière consécutive à un rééchelonnement de la dette se paie par des conditions de prêt, plus dures (taux
d'intérêt plus élevés, échéances plu~ courtes) pour les emprunts ultérieurs
sur les marchés de capitaux.
(4) On soulignera que le gouvernement indien avait considéré que l'aide alimentaire
constituait un moyen de pression sur sa politique. Il avait alors décidé en 1975 de renoncer
définitivement à cette aide et d'élaborer une politique agricole permettant de restaurer une
certaine autonomie alimentaire. Des succès appréciables ont été remportés dans ce domaine
avec un taux élevé de couverture des besoins alimentaires.
49
CHAPITRE Il - LES FACTEURS EXTERNES D'AGGRAVATION DE
L'ENDETTEMENT
Les facteurs extérieurs interviennent aussi comme des contraintes qui
contribuent à l'érosion des ressources internes et partant, poussent à
l'endettement. Les plus déterminants de ces facteurs sont:
- l'environnement économique international;
- les politiques monétaires restrictives qui élèvent les taux d'intérêt;
- les échanges internationaux et la détérioration des recettes des
exportations.
1) L'environnement économique International
Le comportement de l'environnement économique international, à
l'exception de l'année 1977, a défavorisé les pays en développement non
exportateu rs de pétrole : chocs pétroliers de 1973 et 1978, stagnation du
commerce international, chute des cours des produits de base jusqu'au
début de l'année 1983, flambée des taux d'intérêt, amples fluctuations des
taux de change, baisse de l'aide publique au développement, restriction de
l'accès aux financements bancaires internationaux. La conjugaison de ces
facteurs a abouti à une profonde détérioration de la situation des pays
d'Afrique de l'Ouest et a décuplé leurs besoins de financement, aggravant
la situation de leur endettement. Ces difficultés sont en outre exacerbées
dans des pays comme ceux de l'UMOA par l'implantation des firmes multinationales ou étrangères qui, compte tenu d'une réglementation des
changes libérale et de la liberté des transferts, drainent d'importantes
ressources intérieures vers l'extérieur.
A une échelle globale, une étude réalisée par W.R. Cline(5) établit que
les incidences des chocs externes ont contribué à concurrence de 401
milliards de dollars, à l'augmentation de la dette globale des pays en développement évaluée à 482 milliards de dollars entre les années 1973 et
1982. Ces incidences se décomposent comme suit:
- 260 milliards de dollars au titre des deux hausses du prix du pétrole;
- 41 milliards de dollars au titre de l'élévation des taux d'intérêt audessus de leur moyenne calculée pour la période 1961-1980 ;
- 79 milliards de dollars au titre de la détérioration des termes de
l'échange pour les seules années 1981 et 1982 ;
- 21 milliards de dollars au titre de la chute du volume des exportations, liée à la récession économique mondiale pour les deux mêmes
années.
A partir de ces considérations et d'hypothèses sur le niveau prévisible
de certains agrégats des relations économiques internationales, l'auteur a
(5) Cline William R., International debt and the stability of the world economy, distribué
par MIT Press, Cambridge London.
50
simulé l'évolution probable de l'endettement extérieur des dix-neuf pays en
développement les plus débiteurs. Pour la seule année 1986, la sensibilité
de ces pays aux chocs externes s'établirait ainsi:
- une aggravation du déficit de leur compte courant de l'ordre de 53,4
milliards de dollars, si la croissance moyenne dans les pays industrialisés
se réalisait à compter de l'année 1984 à un taux de 1,5 % l'an au lieu de
3%;
- une amélioration de la situation de leur compte courant, évaluée à
7,8 milliards de dollars, si le prix du baril de pétrole venait à tomber de
31 dollars à 25 dollars;
- une chute des paiements d'intérêts d'environ 29 milliards de dollars,
si le niveau moyen des taux d'intérêt nominaux était ramené de 13,8 % à
10 % l'an;
- une détérioration du compte courant, chiffrée à 3,5 milliards de
dollars, conjuguée à une aggravation de 11,9 milliards de dollars de la
situation de la dette, au cas où la dépréciation moyenne du dollar atteindrait 10 % vis-à-vis des principales autres devises au lieu de 5 %.
Ces chiffres sont suffisamment éloquents pour établir que, contrairement aux analyses néo-classiques, les relations économiques et financières ne confèrent pas toujours les mêmes chances de développement
aux différents partenaires.
Cette érosion des ressources des pays en développement, du fait des
chocs externes, sera aggravée par l'inflation qui a une incidence sur la
dette. Le quadruplement en termes nominaux de la dette, intervenu entre
les années 1972 et 1979, correspond seulement à prix constants à une
augmentation de 56 %. Par ailleurs, la dette ne s'est accrue dans la même
période qu'à un taux réel moyen de 6,6 % supérieur à celui du PIS (5,2 %)
mais inférieur à celui des exportations (7,3 %). Par conséquent, l'évolution
de la dette apparaît dans cette période compatible avec celle des agrégats
réels contrairement à une certaine opinion généralement répandue.
Cependant, à partir de 1980, des changements vont s'opérer du fait de la
détérioration des finances publiques des pays et d'une conjoncture internationale récessive caractérisée par une croissance ralentie, parfois négative,
au niveau des pays industrialisés, des taux d'intérêt excessifs, une restriction du commerce international, une érosion accélérée du pouvoir d'achat
des devises, une instabilité des marchés de change et une baisse des prix
des matières premières.
L'inflation persistante a eu pour effet d'alourdir le service de la dette et
d'accélérer, en termes constants, l'amortissement des prêts, tout en faisant
apparaître une dégradation des indicateurs usuels et un affaiblissement de
la situation financière des pays débiteurs.
Ainsi, le service initial d'un prêt à 20 ans est doublé lorsque le taux
d'inflation, nul à l'origine, s'élève de 15 %. Dans Je même temps, les pays
en développement n'ont pas bénéficié du transfert de ressources réelles,
généralement opéré du créancier au débiteur par l'inflation, cet effet ayant
51
été contrecarré par l'adoption des taux d'intérêt variables indexés sur la
hausse des prix. La cure de désinflation engagée depuis 1980 dans les
pays industrialisés a encore aggravé la situation des pays en développement car la rigidité à la baisse du taux d'intérêt a accru leur niveau réel
positif, favorisant ainsi un transfert effectif de ressources des débiteurs aux
créanciers.
2) Les politiques monétaires restrictives, l'augmentation des taux
d'Intérêt et la surévaluation du dollar
Depuis 1978, les situations des paiements se sont renversées avec
une montée des déséquilibres dans les pays industrialisés. Ainsi, aux
Etats-Unis, les entreprises, les familles et le gouvernement, vivent à crédit.
L'endettement des entreprises est passé de 900 milliards de dollars en
1974 à 2589 en 1984, celui des ménages de 671 milliards en 1974 à 1 832
milliards en 1984 et enfin l'Etat voit sa dette évoluer de 543 milliards en
1974 à 1 573 en 1984. Comme dans les pays du Tiers-Monde, on observera également l'avènement et l'aggravation du double déficit commercial
et budgétaire. Le déficit commercial s'est amplifié, passant de 2,3 milliards
de dollars en 1971 à environ 100 milliards en 1984 tandis que le déficit
budgétaire qui était de 127 milliards de dollars en 1979 s'est fixé à 220
milliards en 1984 et 230 milliards en 1988.
Manifestement, les Etats-Unis vivent à crédit sur une montagne de
dettes et se trouvent dans la nécessité de financer ces déficits. Deux
mesures monétaires vont y aider: la surévaluation du dollar rendue
possible par la non convertibilité de cette monnaie en or introduite depuis
le 15 août 1971 et l'élévation des taux d'intérêt devenue possible depuis
l'abandon en octobre 1979 du contrôle des taux d'intérêt pour celui de la
masse monétaire.
Aujourd'hui les choses s'aggravent car le surendettement s'est élargi
affectant tous les agents: les ménages, les collectivités locales, les entreprises et l'Etat. Ainsi, entre 1970 et 1990 la dette des entreprises et des
ménages est passée de 1 400 à 10 500 milliards de dollars (soit deux fois
le PNB). La dette publique a évolué de 1 000 milliards en 1981 à 3 000
milliards en 1990 alors que la dette extérieure gravite autour de 400
milliards de dollars.
Les deux volets de la politique monétaire vont entraîner d'abord une
déréglementation du système bancaire et la promotion du capital financier;
ensuite la libération de la banque et du crédit qui deviennent les instruments de mobilisation des ressources et de régulation de la demande de
monnaie; enfin le pompage au profit des Etats-Unis de toutes les poches
excédentaires de liquidité. De la sorte, le dollar surévalué et les taux
d'intérêt élevés permettent une mobilisation des capitaux et de l'épargne
étrangère au profit de l'économie américaine qui présente des garanties de
stabilité et de crédibilité et où la reprise économique devient de plus en
52
plus effective. Ce pays va alors vivre bien au-dessus de ses moyens et
s'en tirer en exploitant au maximum la position clef du dollar dans le
système économique et financier mondial.
Quelle va être alors l'incidence de cette politique monétaire sur les
PVD?
Les taux d'intérêt nominaux ont été relevés sur les marchés financiers
internationaux et sont passés du simple au triple entre 1976 et 1981. On
peut dire que l'escalade de la dette extérieure à partir de 1973 a principalement été un phénomène voulu par les débiteurs et les créanciers. En effet,
on était dans une conjoncture mondiale euphorique où les pétrodollars
surabondants cherchaient à se placer au moindre risque et au moindre
coût puisque les taux d'intérêt réels étaient généralement négatifs. Il en va
aujourd'hui différemment avec les politiques monétaires appliquées dans
les pays développés qui ont abouti à l'avènement de taux d'intérêt élevés.
De récentes études du Fonds Monétaire International ont d'ailleurs
souligné l'impact des taux d'intérêt sur la situation de la dette des pays en
développement. De 1977 à 1982, le coût moyen de la dette à taux fixe est
passé de 5 % à 7,9 % l'an, tandis que celui de la dette à taux variable
s'élevait de 7,8 % à 17,5 %. Le coût moyen pondéré des emprunts extérieurs des pays en développement a ainsi augmenté de 5 % à 10 % l'an.
Dans le même temps, la part de la dette à taux variable se renforçait et
devenait prépondérante, en relation avec la modification de la structure de
la dette vers une prédominance des prêts bancaires dont le coût est indexé
sur celui du L1BOR (taux de base pour les prêts interbancaires à Londres).
Or, selon des tests économétriques réalisés par le FMI, une variation de
1 % du L1BOR entraîne une variation de même sens des paiements d'intérêts au titre de la dette des pays en développement, variation évaluée à
environ 2 milliards de dollars par an, soit une modification de 0,5 % du ratio
des paiements d'intérêts par rapport aux exportations de biens et services.
En outre, cette variation exerce une influence de sens contraire sur le
produit national brut de ces pays dont le volume serait modifié d'environ
0,1 %.
L'Organisation de Coopération et de Développement Economiques
(OCDE), a montré que le coût moyen pondéré des ressources d'emprunts
des pays en développement excède d'au moins quatre points le taux
d'inflation mondiale. La réduction de ce coût dans les proportions ci-dessus
aurait pour effet une amélioration de deux points du ratio des paiements
d'intérêts par rapport aux exportations de biens et services et un relèvement de 0,4 point du taux de croissance des pays en développement.
Cette observation montre que le niveau excessivement positif des taux
d'intérêt réels a non seulement accru le coût de l'endettement des pays en
développement, mais a encore restreint leur capacité à s'acquitter de leurs
obligations.
Selon les statistiques de la Banque mondiale, le taux d'intérêt moyen
appliqué à la dette privée contractée par les pays d'Afrique au Sud du
Sahara a pratiquement doublé en quatre années seulement, passant de
53
7,8 % en 1977 à 14,5 % en 1981, pour retomber à 12 % en 1982. Il
reprend son ascension en 1983 pour se fixer à 16,3 % en 1987. Il en est
résulté une augmentation considérable des paiements d'intérêt au cours de
cette période.
Ainsi, de 345,7 millions de dollars en 1978, les paiements d'intérêt de la
région sont passés à 949,4 millions de dollars en 1980 et 1,4 milliard de
dollars en 1982. En 1987, ils atteignent 3,2 milliards de dollars. Les
augmentations les plus sensibles ont concerné les deux pays les plus
fortement endettés à des taux d'intérêt variables, à savoir le Nigéria et le
Côte-d'Ivoire dont les paiements d'intérêt sont passés respectivement de
49,5 millions de dollars et 172,2 millions de dollars en 1975 à 721,5
millions de dollars et 596,7 millions de dollars en 1987.
L'augmentation des paiements d'intérêt a, bien entendu, alourdi de
manière significative la charge du service de la dette dont ils représentaient
plus de la moitié en 1987 (53,1 %) contre 49,5 % en 1982 et à peine
27,5 % en 1975.
Tous ces chiffres illustrent l'incidence perverse des politiques monétaires et de la montée des taux d'intérêt sur la dégradation de la situation
financière des pays d'Afrique de l'Ouest. Les taux d'intérêt réels positifs ont
produit des transferts de ressources en termes réels en faveur des créanciers. D'ailleurs, la Banque Mondiale (Rapport de 1984) estime que les
taux d'intérêt réels (c'est-à-dire les taux d'intérêt nominaux déflatés par les
prix à l'exportation des pays en voie de développement pour mesurer la
charge des paiements d'intérêt par rapport aux recettes d'exportation) sont
passés de moins de 10 % en 1980 à 19,4 % en 1982. Ceci sous le triple
effet conjugué de la hausse des taux nominaux, de la baisse des prix à
l'exportation et du renchérissement du dollar.
Malheureusement, c'est cet environnement qui va se maintenir
jusqu'en 1987. contribuant ainsi à aggraver le problème de la dette en
Afrique de l'Ouest tout au long des années 1980. Mais il faut noter que
depuis la fin 1988, une détente sensible s'est amorcée sur les taux d'intérêt
et le taux du dollar (les deux phénomènes étant du reste partiellement liés)
tandis que les prix à l'exportation des produits de base ont accentué leur
tendance à la baisse. Malheureusement, cette évolution a contribué à
annuler "effet théoriquement favorable que les pays Ouest-africains étaient
en droit, depuis deux ans, d'attendre quant à l'évolution de leur problème
d'endettement.
3) Les échanges Internationaux et la détérioration des recettes des
exportations
Les échanges extérieurs de la région ouest-africaine se sont dans
l'ensemble notablement dégradés ces dernières années sous l'influence
d'un accroissement soutenu des importations que n'arrive pas à
compenser le rythme lent et fluctuant de la croissance des exportations. Il
54
en résulte une détérioration des termes de l'échange qui affecte tous les
pays de la CEDEAO aggravant alors le déficit de leur balance commerciale. L'ampleur du phénomène est résumée dans le comportement des
termes de l'échange dans la période 1979-1982.
TERMES DE L'ÉCHANGE: 1980
Bénin
Burkina
Côte-d'Ivoire
Ghana
Libéria
Mali
Mauritanie
Niger
Nigéria
Sénégal
Sierra-Léone
Togo
=100
1979
1981
1982
1979-1980
1980-1989
115
113
119
136
121
107
101
112
67
110
121
108
95
106
91
68
91
107
92
82
110
101
82
101
75
97
91
61
92
102
97
89
92
89
84
112
-13
-12
- 6
-26
-17
- 7
- 1
-11
49
- 9
-17
- 8
-25
- 3
- 9
-39
- 8
+ 2
- 3
-11
- 8
-11
-16
+ 12
Source: Kathie L. Krumm : Dette extérieure de l'Afrique au Sud du Sahara. Origines,
montant et décisions à prendre. Document de travail, Banque Mondiale, p. 59.
Les exportations ouest-africaines sont encore composées pour une
large part de produits de base non - ou peu - transformés dont les cours
mondiaux ont subi une baisse importante ces dernières années, qui
s'ajoute à la baisse des volumes exportés, Ainsi, sur la période 1970-1982,
le taux de croissance moyen du volume et des prix des principaux produits
de base exportés par les Etats de l'Afrique de l'Ouest, a évolué comme
suit:
Volume
Minerai de fer
Phosphate
Café
Cacao
Huile d'arachide
Huile de palme
Maïs
Bois
Coton
..
.
.
.
.
.
.
..
.
-5,1
2,2
-1,0
-1,2
-4,6
-6,7
-6,9
-2,3
-4,0
PrIx
-4,6
1,7
1,8
3,0
-4,0
-3,2
-4,2
3,6
-1,9
Source: Banque Mondiale.
55
Les taux de croissance moyens positifs des prix de certains produits de
base pourraient laisser croire à une amélioration des termes de l'échange
sur l'ensemble de la période: mais il n'en est rien. Les relèvements des
cours des matières premières ont généralement coïncidé avec les hausses
des prix du pétrole. Ainsi, l'indice global des prix des produits primaires non
pétroliers a augmenté de 28 % en 1974 et de 12 % en 1979-1980, ce qui
correspond aux deux chocs pétroliers de la décennie. Entre 1980 et
1982,les prix des matières premières autres que le pétrole ont diminué de
27 % en dollars courants. Au cours de cette période, la perte de revenu
résultant de la détérioration des termes de l'échange a atteint 1,2 % du PIS
de ('Afrique au Sud du Sahara.
Les variations des taux d'intérêt, des taux de change et des liquidités
internationales ont joué un rôle décisif dans cette situation depuis 1977. En
effet, on peut observer que toute variation des taux d'intérêt se répercute
directement sur le volume des transactions, des stocks et de la demande
spéculative. Le volume des transactions pour une catégorie de produits
dépend de son utilisation comme matière première ou comme consommation finale. Une augmentation des coûts des facteurs de production due,
par exemple, à une hausse des taux d'intérêt réels, relève le coût de
production du produit fini et abaisse les quantités produites. Cela peut
restreindre la demande de facteurs, et donc de produits de base. Des taux
d'intérêt élevés réduisent aussi le volume des stocks et la demande spéculative de produits de base, car ils en font augmenter le coût d'opportunité.
Par ailleurs, le niveau élevé des taux d'intérêt, surtout aux Etats-Unis, a
eu pour effet de comprimer la demande en produits primaires facturés en
dollars.
Ainsi, l'instabilité du système financier international a contribué à faire
chuter les cours des matières premières - et donc les recettes d'exportation - des pays Ouest-Africains et, par conséquent. elle a pesé négativement sur leurs termes de l'échange. On pourrait ajouter que les effets du
protectionnisme des grandes nations développées a joué un rôle non négligeable dans les faibles performances à l'exportation des Etats de la région
Ouest-Africaine.
La perspective est toute autre au niveau des importations qui, elles, ont
considérablement et régulièrement augmenté sous le double effet du
renchérissement du prix du pétrole et de l'augmentation des achats de
produits alimentaires.
En définitive. si les pays industrialisés refusent un déficit commercial et
s'ils poursuivent leur politique protectionniste vis-à-vis des produits du
Tiers-Monde, il serait complètement illusoire de trouver une solution à l'endettement et même au développement dans le cadre de la DIT.
En ce qui concerne le prix du pétrole, il n'est guère besoin de s'étendre
sur ses effets dans les pays ouest-africains non producteurs. Il faut simplement observer que, dans bien des pays, la facture pétrolière a été multipliée par dix et cela pouvait représenter jusqu'à 6 % du PIS en 1982 contre
1,3 % à peine en 1970.
56
Le second facteur de hausse des importations est l'augmentation
considérable des achats de produits alimentaires, qui est la conséquence
de la baisse tendancielle de la production céréalière par habitant et de la
sécheresse endémique qui sévit dans la plupart des Etats de la région
Ouest-Africaine. Entre 1969-1971 et 1980-1982, la production de céréales
(maïs, mil, riz paddy, sorgho et blé) de l'Afrique sub-saharienne a
augmenté à un taux moyen annuel de 1,5 % alors que la population totale
se reproduisait au rythme annuel de 3 %. Dans de telles conditions, les
importations de céréales sont passées de 225 millions de dollars en
moyenne au cours de la période 1969-1971 à 2,3 milliards de dollars en
moyenne dans les années 1980-1982.
De 1982 à 1989, la tendance générale au déclin de l'agriculture vivrière
s'est maintenue malgré un léger fléchissement de la production dans la
zone sahélienne suite au retour des pluies en 1985-1986 et 1987.
A ces facteurs de renchérissement des importations, il conviendrait
d'ajouter la dépréciation des monnaies ouest-africaines, résultant de la
volatilité des taux de change des grandes monnaies internationales et de
l'extraversion économique des pays de la région, qui se traduit par une
forte dépendance de la croissance, de la consommation et de l'industrialisation à l'égard des exportations et des importations.
Des seize pays ouest-africains, sept ont une monnaie liée par une
parité fixe au Franc français (les pays de l'UMOA) ; trois ont des monnaies
rattachées au dollar (Libéria et Sierra Léone) ou à la livre sterling (Gambie) ; les monnaies de la Guinée et de la Mauritanie sont respectivement
rattachées au DTS et à un panier de monnaie tandis que celles du Ghana,
de la Guinée-Bissau et du Nigéria flottent librement ; quant à la monnaie
cap-verdienne, elle est liée à la zone escudo.
Or, entre 1980 et 1983, le taux de change effectif réel (c'est-à-dire la
moyenne des taux de change pondérée par le volume des échanges) du
Franc français s'est déprécié de plus de 25 % et celui de la livre sterling de
près de 14 % tandis que celui du dollar s'appréciait de près de 33 %. Ces
variations ont eu des répercussions certaines sur le comportement des
monnaies ouest-africaines, toutes choses égales par ailleurs.
Les mêmes effets se sont reproduits, mais cette fois-ci à l'envers,
depuis la fin 1987 jusqu'à aujourd'hui, c'est le dollar qui a amorcé une forte
dépréciation vis-à-vis du franc français et de la livre sterling.
L'ensemble des facteurs externes ainsi analysés ont tous contribué soit
à ponctionner les ressources en devises, soit à réduire les gains en
devises (exportations) des économies ouest-africaines, les obligeant ainsi
à recourir à l'endettement pour faire face aux déséquilibres et aux obligations financières.
De cette analyse, il ressort que plusieurs facteurs se conjuguent pour
accroître l'endettement en Afrique de l'Ouest. Les turbulences d'une
économie mondiale totalement éclatée et l'extrême fragilité du système
financier international ont contribué à la massification de l'endettement qui
devient l'unique solution aux déséquilibres qui naissent de l'articulation des
57
pays à la DIT. Par ailleurs, l'absence de politiques cohérentes et correctrices de l'aggravation de la dette, pose la question des issues de cette
crise de l'endettement en Afrique de l'Ouest. \1 importe d'élucider cette
question pour mieux cerner les perspectives de solution.
CHAPITRE III - LA NATURE DE LA CRISE DE L'ENDETTEMENT:
CRISE DE LIQUIDITE OU CRISE D'INSOLVABILITÉ
Malgré la très grande hétérogénéité des situations nationales. les difficultés de la dette en Afrique de l'Ouest se compliquent chaque jour davantage et suscitent beaucoup d'interrogations qui renvoient à la nature même
de la crise d'endettement. La question est posée de savoir si cette crise
d'endettement est une crise liée à une conjoncture dépressive ou alors si
elle est une crise de solvabilité tenant aux déficiences des systèmes
productifs incapables de générer des ressources suffisantes pour couvrir
les services de la dette. En partant des facteurs conjoncturels, comme la
chute des cours des matières premières, les taux d'intérêt élevés, le
renchérissement du dollar et la baisse des aides financières sans contrepartie, on pourrait penser que l'amélioration de ces facteurs entraînerait
une disparition totale ou partielle de la dette. Si cette preuve était faite, la
crise de l'endettement ne serait qu'une crise de liquidité.
Trois arguments militent en faveur de cette opinion et établissent que
les difficultés de la dette tiennent davantage à une insuffisance des
réserves de change qu'à une insuffisance structurelle de leur capacité de
remboursement. Voyons comment ces arguments se présentent concrètement dans le cas des pays de l'UMOA.
Le premier argument est que la baisse continue des cours des matières
premières jusqu'en 1982 et les difficultés d'écoulement des récoltes de
café et de cacao ont incontestablement réduit d'au moins 30 à 40 % les
recettes d'exportation des Etats de l'Union, selon certains calculs du Fonds
monétaire et de la Banque Mondiale. Sur cette base, on peut on évaluer à
environ 450 milliards de francs CFA la perte correspondante de ressources
pour la seule année 1982. En dehors de quelques éclaircies (1983, 1985 et
1986), la situation s'est depuis lors aggravée.
Le second argument procède du fait que le niveau excessivement
positif des taux d'intérêt a considérablement alourdi les charges d'intérêts
pour tous les pays en développement. Cependant. le niveau de ces taux
compromet également les investissements dans les pays industrialisés et
constitue une source potentielle de regain des tensions inflationnistes. La
réduction prochaine de ces taux est probable et découlerait des pressions
internes et externes dont sont de plus en plus l'objet, les gouvernements
des nations industrialisées.
Le troisième argument en faveur de la thèse du problème de liquidité
est constitué par les amples fluctuations des taux de change. notamment
du dollar. La vive et constante appréciation du dollar par rapport au franc
58
depuis l'année 1981 avait non seulement alourdi en moyenne le service de
la dette des pays de l'UMOA d'environ 20 % par an, mais avait encore
entraîné une détérioration de leur compte courant, accroissant ainsi leurs
besoins de financement Toute fixation du cours du dollar qui le situerait à
un niveau plus conforme aux parités des pouvoirs d'achat des différentes
monnaies, allégerait sensiblement le poids du service de la dette pour les
Etats de "UMOA. Ce qui est le cas actuellement.
Certainement, il faut nuancer de telles opinions. En effet, les variables
conjoncturelles impliquées dans l'endettement ont des comportements que
déterminent les seules nécessités des politiques nationales et de valorisation du capital des grandes puissances industrielles.
Dès lors, il serait dangereux de subordonner la solution du problème
d'endettement au renversement d'une tendance qui pourrait se révéler
beaucoup plus durable qu'on ne le pense généralement. Tout au plus peuton espérer une détente sur les fronts du taux d'intérêt et du taux de change
qui allégerait la crise de liquidité tout en augmentant les ressources disponibles pour le développement des forces productives.
Si maintenant, nous nous intéressons aux causes structurelles, nous
devons alors reconnaître que pour le moyen terme, l'Afrique de l'Ouest est
confrontée à une crise de solvabilité, dont la solution passera par la mise
en œuvre de réformes substantielles des structures économiques.
En effet, les pays concernés ont à faire face dans les prochaines
années au service d'une dette importante, dans une conjoncture caractérisée par un rétrécissement des flux de capitaux extérieurs d'origine
publique et privée. Les projections faites par la Banque mondiale du
service de la dette sont présentées dans le tableau suivant. Les chiffres
sont en millions de dollars.
Projection du Service de la Dette de quelques pays africains (en millions de dollars)
CREANCIERS PUBLICS CREANCIERS PRIVES
1985
1986
1985
1986
1987
1988
1989
1990
TOTAL
Principal Intérêts
Principal Intérêts
Principal Intérêts
810,4
1 030,2
810,4
1 030,2
1 013,2
1 016,2
949,6
320,2
2 121,3
3 060,8
2 121,3
3 060,8
2 657,7
2 040,5
1 554,1
826,6
2 931,7
4 091,1
2 931,7
4 091,1
3 670,9
3 670,9
3056,7
2503,7
498,8
499,3
498,8
499,3
473,2
433,8
389,9
345,2
1 140,8
978,6
1 140,8
978,6
712,0
465,4
269,3
128,7
1 139,6
1 477,9
1 139,6
1 477,9
1 185,2
899,2
659,2
473,9
Source: Banque mondiale: World Debt Tables, 1983-1984 édition.
59
Face à ces obligations financières en rapide progression, les perspectives économiques restent plutôt sombres sur le reste de la décennie
puisque sur la base des tendances actuelles, la Banque Mondiale ne
prévoit qu'une légère croissance du PIS (2,4 % en moyenne annuelle) pour
l'ensemble des pays africains importateurs de pétrole, à la condition que
les décaissements nets d'APO passent de 4,7 milliards de dollars en 1980
à 7,5 milliards de dollars en 1985 et 11,5 milliards de dollars en 1990. Les
statistiques actuellement disponibles sont encore loin de confirmer pareille
tendance. Entre 1980 et 1989, il Y a eu une détérioration générale des indicateurs macroéconomaques, une plus grande désintégration des structures de production, une dégradation plus prononcée des niveaux de vie et
du bien-être social.
C'est dire que les difficultés vont s'amonceler et devront s'aggraver si
('on tient compte de la baisse des libéralités dans les prêts et du fait que :
- une fraction importante et croissante du service de la dette extérieure, correspondant à la dette multilatérale ne peut pas être rééchelonnée;
- les rééchelonnements ne peuvent être indéfiniment extensibles et
renouvelables ;
- les échéances de certains réechelonnements commencent en 1986
sans que la situation n'ait subi le moindre changement dans le sens de son
amélioration.
A ce niveau, il apparaît que l'ampleur du poids de la dette assombrit
toute perspective de développement en Afrique de l'Ouest. La crise qui
s'installe risque d'être durable par suite de la présence de très nombreux
facteurs de propagation et d'approfondissement. Les possibilités d'expansion et de croissance sont notablement amoindries voire totalement annulées par l'encours excessif de la dette. De plus, la situation est compliquée
par une réduction. des sources extérieures de financement qui, du reste,
se montrent de plus en plus réticentes à mobiliser les capitaux pourtant
indispensables pour le développement des Etats Ouest-Africains.
Pendant ce temps, la crise agro-alimentaire de l'Afrique de l'Ouest
s'approfondit par suite de la conjugaison de trois facteurs qui ont été déjà
soulignés à savoir:
-la faible croissance de la production agricole (1,3 %) conjuguée avec
une forte croissance démographique, (3,0 %) qui entraîne une baisse de la
production agricole par tête;
- le recul de la production vivrière au profit des cultures de rente qui
contribue à accentuer le déficit alimentaire si bien que l'Afrique de "Ouest
qui importait 2 millions de tonnes de céréales en 1950 en importe
aujourd'hui environ 20 millions;
- la forte expansion urbaine et l'incohérence de la croissance accélérée des villes qui accroit la demande d'infrastructures sociales de base et
les charges improductives de l'Etat.
60
A cela viendront s'ajouter comme autres facteurs aggravants: l'élévation de la facture pétrolière ; l'accroissement des charges financières de
l'Etat par suite de l'existence d'un vaste secteur public et parapublic fortement déficitaire et maintenu par des subventions ; la diminution des dons
et autres transferts unilatéraux et la dépréciation des recettes d'exportation.
Les conditions et les éléments sont ainsi réunis pour l'élargissement de
la crise des finances publiques et de la balance des paiements. Cette
dégradation financière interne est non seulement incompatible avec
l'objectif de croissance et de développement, mais inquiète les bailleurs de
fonds et tous les créanciers des pays d'Afrique de l'Ouest.
Cette crise appelle de toute urgence des solutions qui soient à la fois
acceptables par les créanciers et les débiteurs et qui puissent restaurer la
capacité de remboursement et ne plus servir de prétexte pour masquer les
mauvaises politiques de gestion économique. Dans cet ordre d'idées, en
considérant que les pays si fortement endettés ne pourront jamais payer
aux conditions de leurs créanciers et que d'autre part les banques
commerciales détentrices de la part la plus importante de la dette ne
supporteront pas un non remboursement, les propositions de la discussion
se situent à trois niveaux:
- la mise en œuvre de programmes d'ajustement strucrutel selon le
modèle des conditionnalités des institutions monétaires et financières internationales;
- l'organisation de rééchelonnements appropriés à chaque cas de
figure et qui tiennent compte de tous les paramètres favorables à la croissance et au développement;
- la création d'un organisme multinational recevant dans son portefeuille les créances des pays développés.
Il est vrai que bien d'autres plans sont en circulation et rivalisent d'originalité mais ils ont en commun que la solution de l'endettement nécessitera
la révision des règles du jeu économique des pays débiteurs et l'établissement d'un compromis acceptable par toutes les parties concernées.
Présentement, l'ajustement semble être la solution préconisée par les
institutions financières internationales et les bailleurs de fonds pour créer
une nouvelle donne économique à même de rétablir les grands équilibres
macrofinanciers, de relancer la croissance et en conséquence de rendre
possible le remboursement des dettes. Comment fonctionne cette nouvelle
politique et quelles sont ses performances en Afrique de l'Ouest? C'est
l'objet de la troisième partie de cette réflexion.
61
TRO/S/EME PARTIE
POLITIQUES D'AJUSTEMENT
OU CHANGEMENT DE MODELE
DE DEVELOPPEMENT
CHAPrrRE 1 - LE MODELE D'AJUSTEMENT ET DE
STABILISATION PRECONISE PAR LES INSTITUTIONS
FINANCIERES INTERNATIONALES
Tout le monde s'accorde pour admettre que la montée rapide de la
dette entraîne des charges insupportables pour les économies nationales.
Par ailleurs, le paiement de la dernière dette entraîne toujours le début
d'un autre endettement créant ainsi un cycle infernal dont la seule issue est
une dégradation économique et financière qui compromet tout processus
de croissance. L'unanimité s'est faite également sur les facteurs d'accélération et d'amplification de l'endettement. Les désaccords qui se manifestent sont bien mineurs et portent sur le poids respectif que tel ou tel facteur
peut prendre dans l'accélération de la dette extérieure en Afrique.
Quant aux conséquences, elles sont identiquemenr évaluées par tous
les auteurs quelles que soient leur famille de pensée. Ainsi néo-classiques,
keynésiens et autres marxistes partagent les idées selon lesquelles:
1) Sur le plan économique, la crise de la dette réduit voire anéantit
toutes les possibilités de croissance et de développement des Etats ouestafricains. De fait, une part de plus en plus importante des ressources intérieures est affectée au service de la dette, au détriment du financement du
développement. L'affaiblissement de la demande intérieure qui en résuhe
hypothèque toute possibilité d'expansion;
2} Sur le plan financier, l'augmentation soutenue du volume de "endettement réduit les investissements publics et partant exerce un impact déflationniste sur l'ensemble de l'économie. L'Etat, pour faire face à ses
charges et accroître l'épargne budgétaire, se trouve dans l'obligation de
relever la fiscalité intérieure, de supprimer les diverses subventions à la
consommation, de relever les tarifs publics et les taux d'intérêt, de
comprimer les dépenses publiques. En somme, il s'opère une modification
de la politique de répartition du revenu au profit de l'extérieur;
65
3) En matière de politique extérieure, les règlements au titre de la dette
dégradent davantage la balance des paiements déjà structurellement déficitaire.
Toutes ces conséquences, de même que leur ampleur, sont aujourd'hui
communément admises à la fois par les pays créanciers, les débiteurs, les
théoriciens et les divers experts.
On peut donc dire qu'en matière de diagnostic, jamais les économistes
n'ont réussi une aussi parfaite identité de vue entre des écoles aussi différentes et aussi opposées par leurs orientations et leurs méthodes.Tout
laisse à penser que les théories sont prises à défaut par les faits.
Cependant dès l'analyse des mécanismes de l'endettement, les oppositions traditionnelles réapparaissent et certaines théories économiques
révèlent leurs faiblesses. La question de la dette est le microcosme des
relations économiques internationales, des questions des échanges et du
développement. Rapporté à la théorie néo-classique selon laquelle le libre
échange favorise l'efficacité de la production mondiale et confère des
chances de développement aux divers partenaires, l'endettement se
présente comme un élément qui infirme justement cette vision optimiste
des relations économiques et financières internationales. Des décennies
de spécialisation et de commerce sans entrave ont produit l'économie de
l'endettement dont les conséquences ultimes sont, en dernière analyse, le
blocage du développement économique et social par asphyxie financière.
Il apparaît alors que les mécanismes de l'endettement révèlent toute la
fragilité de la théorie économique néo-classique qui est pourtant le référentiel souvent présenté comme infaillible.
Qu'en est-il maintenant de la thérapeutique? En d'autres termes,
quelles sont les politiques proposées pour résoudre la dégradation économique, financière et sociale des pays endettés? Comment les sortir des
mécanismes d'accumulation et d'élargissement de la dette et des
problèmes que pose son service? Les solutions sont-elles internes, ce qui
suppose une modification du système productif ainsi que ses règles de
génération et d'absorption des surplus? Les solutions sont-elles pour
l'essentiel externes ce qui passerait par la renégociation impliquant la participation de tous les acteurs à l'endettement.
L'importance et la variété de ces questions indiquent les enjeux
multiples et complexes de la crise d'endettement et conduisent à plusieurs
propositions de solution dont aucune ne connaît encore un début d'exécution. Il en est ainsi des solutions strictement financières parfois très pertinentes par rapport aux données techniques mais qui se heurtent toujours à
l'attitude négative des créanciers.
Les plus en vue de ces solutions sont certainement les politiques
d'ajustement et de stabilisation qu'inspirent les institutions financières internationales et notamment le FMI et la BM dont les interventions en Afrique
de l'Ouest sont de plus en plus marquées au point de concerner tous les
seize Etats de la CEDEAO. En effet, il est de la mission du FMI, dans le
66
cadre des accords de confirmation et des accords élargis, de venir en aide
aux pays connaissant des difficultés de balance de paiements. Le Fonds
pose des conditionnalités trop strictes visant à s'assurer d'une part que les
politiques économiques mises en œuvre garantissent le remboursement de
la dette et d'autre part que. les ressources financières mobilisées soient
affectées à des opérations qui permettent réellement de restaurer l'équilibre de la balance des paiements.
On peut observer déjà que les PVD critiquent avec acharnement ces
conditions d'octroi de prêts qui sont trop rigides et souvent inadaptées à
leur situation économique et financière et qui s'inspirent d'une orthodoxie
financière contestée. Malgré tout, l'aggravation de la crise financière a
amené le recours au FMI dans le processus de renégociation de la dette.
Depuis 1979, ces renégociations se sont élargies en Afrique de l'Ouest
comme l'indique le tableau suivant:
Rééchelonnements de la dette en Afrique de l'Ouest
1980-1988
Date
de l'accord
Début de la
consolldaUon
Durée de la
consolldaUon
Montant
rééchelonnée
(en millions de
dollar. US)
Club de Londres
Mal 1985
Novembre 1986
Avril 1988
Décembre 1983
Janvier 1986
Janvier 1983
25
48
96
501
691
2211
Club de Paris
Mai 1984
Juin 1984
Juin 1986
Décembre 1987
Décembre 1983
Janvier 1985
Janvier 1986
Janvier 1988
13
12
36
16
265
242
520
567
Club de Londres
Mars 1984
Avril 1986
Odobre 1983
Odobre 1985
24
39
27
52
Club de Pari
Novembre 1983
Novembre 1984
Novembre 1985
Novembre 1986
Avril 1988
Odobre 1983
Odobre 1984
Décembre 1985
Décembre 1986
Décembre 1987
12
14
12
12
13
32
40
40
33
43
Février 1984
Mal 1985
Mal 1981
Juillel1984
38
24
78
20
PAYS
Côte-d'Ivoire
Niger
Sénégal
Club de Londres
(Suite D. 68)
67
Montant
rééchelonnée
(en millions de
dollara US)
Date
de l'accord
Début dela
consolidation
Durée de la
consolidation
Octobre 1981
Novembre 1982
Décembre 1983
Janvier 1985
Novembre 1986
Novembre 1987
Juillet 1981
Juillet 1982
Juillet 1983
Janvier 1985
Janvier 1986
Novembre 1987
12
12
12
18
16
12
84
64
105
87
79
Club de Londres
Mars 1980
Octobre 1983
Décembre 1979
Décembre 1982
-
69
84
Club de Paris
Février 1981
Avril 1983
Juin 1984
Juin 1985
Mars 1988
Janvier 1981
Janvier 1983
Janvier 1984
Mai 1985
Janvier 1988
24
12
16
12
15
122
118
65
35
125
PAYS
Club de Paris
n
Togo
Source: Banque Africaine, numéro 298 du 13 février 1989.
Le rééchelonnement et l'obtention de nouveaux crédits du FMI et
même des autres institutions financières seront de plus en plus subordonnés à la mise en place de programmes d'ajustement et de stabilisation.
Ces programmes et surtout les conditionnalités liées à leur mise en œuvre
ont toujous fait l'objet de vives controverses sur leur pertinence et leur
performance. Ils ont également suscité de vives contestations du fait des
tensions qu'ils créent et des menaces qu'ils exercent sur les précaires
édifices sociaux particulièrement en Afrique de l'Ouest. Certains auteurs
soutiennent que les politiques d'ajustement bien que pouvant améliorer le
déficit de la balance des paiements ont un coût social excessif. Par
ailleurs, elles ont beaucoup d'incidences négatives sur le processus socioéconomique. D'autres estiment que les conditionnalités pouvaient même
retarder le processus de croissance économique et empêcher une répartition appropriée des revenus.
C'est donc au niveau des solutions que se révèlent tous les enjeux de
l'endettement massif. Quelles solutions proposent les divers créanciers aux
pays qui, par le poids de leur dette, présentent des signes de faillite et
d'insolvabilité ? Ces solutions ont-elles des incidences positives sur la
poursuite de la croissance et du développement? Ont-elles pour principale
préoccupation la restauration de la solvabilité des débiteurs? Quelle
marge de manœuvre cèdent-elles aux pays endettés? N'y aura-t-il pas de
plus en plus un transfert de souveraineté politique et économique au profit
68
des créanciers faisant ainsi de la Dette du Tiers-Monde une arme financière pour maintenir le lien de dépendance et de rapports économiques
inégaux?
Toutes ces questions vitales donnent une indication des enjeux que
cachent les solutions technocratiques qui, en réalité, ne sont que d'une
neutralité bien apparente. Elles montrent également la nécessité d'une
évaluation rigoureuse des politiques d'ajustement et de stabilisation, et de
leurs effets économiques, politiques et sociaux, en vue d'une recherche de
solutions et de stratégies alternatives qui permettront véritablement aux
pays ouest-africains de s'en sortir et d'amorcer des processus de développement au service des besoins de base comme le recommande le Plan de
Lagos.
Pour ce faire, nous analyserons deux points:
- les politiques d'ajustement et de stabilisation et leurs incidences sur
le modèle de développement;
- les solutions alternatives.
1) Les politiques d'ajustement et de stabilisation préconisées par les
Institutions fananclères Internationales(1)
Beaucoup de recherches ont montré que les Etats Ouest-Africains ont,
dans leur majorité, abordé la décennie des années quatre-vingts avec une
crise économique et financière qui se manifeste par la faible croissance de
la production et le déficit de la balance des paiements et des finances
publiques. Ces déséquilibres ont été surmontés par des politiques d'endettement massif qui sont devenues, aujourd'hui, absolument insoutenables.
Partout, l'encours de la dette a atteint des niveaux parfaitement insupportables par une production stagnante et des exportations qui régressent
surtout en valeur. Dans ce contexte des bailleurs de fonds et notamment le
FMI imposent une politique d'ajustement économique et financier devant
permettre d'atteindre" un déficit du solde courant qui peut être soutenu
par des entrées de capitaux à des conditions compatibles avec les perspectives de développement du pays, sans que celui-ci ait à recourir à des
restrictions sur les échanges et les paiements .. (2).
La mobilisation de nouvelles ressources en provenance surtout des
institutions financières est strictement liée à une restructuration économique et financière car selon le FMI" il n'est ni souhaitable, ni possible de
financer des déficits importants et durables de la balance des paiements
sans chercher à réduire ou à éliminer les causes profondes de ces difficultés qui sont dues à des déséquilibres structurels de l'économie ". Le
Fonds ajoute que" si les déficits sont éliminés par le recours à des restric(1) Nous avons entrepris une étude factuelle de l'ajustement dans un ouvrage récemment publié et intitulé: .. Sénégal: crise économique et réajustement structurel .. , Edit. Les
Nouvelles du Sud, 1990.
(2) Bulletin du FMI, Supplément spécial, mai 1981.
69
tions des échanges internationaux, ou s'ils sont simplement financés par
des emprunts extérieurs, il est probable qu'ils réapparaîtront rapidement
peut-être sous une forme plus aiguê renforçant ainsi la sévérité des
mesures de redressement nécessaires »(3). En définitive, l'utilisation des
ressources du FMI sera toujours liée à des dispositions et mesures rigoureuses qui forment les conditionnalités ou encore les cc packages » du
Fonds dont les interventions se sont accélérées au point de représenter
17,5 % de ses opérations.
Les évolutions et les grandes tendances analysées, établissent que le
volume de l'endettement va augmenter si la conjoncture économique
mondiale continue de se détériorer et d'être défavorable. Dans ce contexte,
le FMI se présentera comme le bailleur de fonds incontournable des Etats
africains, l'institution qui va commander et coordonner l'attitude des autres
bailleurs de fonds et des créanciers publics et privés. De fait, il exercera
progressivement des fonctions exorbitantes de gestion et de régulation des
économies endettées et cela l'installera alors au cœur des processus de
renégociation des dettes, de la mise en place des accords et de l'établissement de nouveaux mécanismes de financement dans le cadre de
programmes qui constituent les politiques d'ajustement et de. stabilisation.
Ainsi, les régulateurs principaux de l'ordre économique et financier
mondial, le FMI et la Banque Mondiale, vont concentrer de fait beaucoup
de pouvoirs de réflexion et de décision économiques pour mieux imposer
un développement libéral assisté, sous perfusion permanente mais sécurisant pour les créanciers.
Dès l'instant où ces politiques concernent la quasi totalité des seize
Etats de la CEDEAO, on est en droit de se demander d'abord si elles sont
compatibles avec les priorités et objectifs nationaux de développement
économique et social et ensuite si elles permettent de sortir de la crise par
une relance de la croissance? La réponse à ces questions appelle une
évaluation des politiques d'ajustement structurel au niveau théorique c'està-dire celui de la pertinence ou non des présupposés théoriques et doctrinaux et au niveau pratique c'est-à-dire celui des performances des
expériences en cours.
2) Les politIques d'ajustement et de stabilisation préconisées par le
FMI
Les politiques d'ajustement préconisées par le Fonds sont formulées
en trois étapes :
- la première consiste pour les experts en l'établissement d'un bilandiagnostic de J'économie et l'identification de toutes les causes de la
montée des déséquilibres économiques et financiers;
(3) Bulletin du FMI, ibid.
70
- la deuxième étape concerne l'élaboration des objectifs économiques
et financiers ainsi que celle de la durée de réalisation des programmes
retenus;
- la troisième est celle de la formulation des ajustements nécessaires
des politiques économiques compte tenu des objectifs du pays et de
l'évolution des facteurs extérieurs.
L'ajustement n'est pas un phénomène inconnu dans l'analyse économique. Il est souvent conçu comme une politique de réallocation des
facteurs et des ressources en vue du retour vers l'équilibre et la relance du
processus de croissance et d'expansion. Cette réallocation est alors
obtenue par des variations conjuguées et simultanées des prix relatifs, des
revenus et des taux de change.
Les politiques d'ajustement doivent permettre de résoudre les déséquilibres économiques et financiers et rendre possible le retour à une croissance saine et durable.
Lorsque les déséquilibres sont de nature temporaire et peuvent se
corriger d'eux-mêmes dans un intervalle de temps raisonnable, un financement temporaire adéquat - souvent fourni par le FMI dont c'est la mission
- sera suffisant pour en venir à bout(4). Ce financement sera accompagné, le cas échéant, de correctifs compensatoires susceptibles de modifier les mouvements de marchandises ou de capitaux.
Si tel n'est pas le cas, il faut alors mettre en œuvre d'autres mesures
capables de favoriser le retour à une balance des paiements valable au
cours d'une période raisonnable, c'est-à-dire ajuster l'économie à une
nouvelle situation estimée acceptable.
Dans la dégradation persistante de la balance des paiements et des
finances publiques, l'ajustement pour le Fonds est devenu un impératif.
Dans son rapport de 1981, il est souligné que le Fonds a un rôle important
à jouer en aidant les pays à concevoir des programmes d'ajustement
appropriés et en dosant dans des proportions judicieuses l'ajustement et le
financement. Dans le cas de l'Afrique ces mesures sont-elles effectivement
suffisantes pour relancer la croissance et le développement?
Globalement, les experts du FMI mettent l'accent sur l'élaboration des
politiques d'ajustement :
- d'abord par une approche monétariste de la politique économique
avec une restriction de la demande;
- ensuite par certaines mesures comme la dévaluation de la monnaie,
le relèvement du taux de l'intérêt, la hausse des prix surtout des services
publics, etc. ;
- enfin par les restrictions salariales et les réductions de toutes les
subventions qui faussent une libre détermination des prix.
(4) CeNe mission de gestion des politiques d'ajustement est devenue une fonction
majeure depuis que le Fonds s'est révélé incapable de stabiliser le Système Monétaire
International et de le doter de nouveaux mécanismes et de nouvelles règles de fonctionnement.
71
Ces programmes d'ajustement s'inspirent de la théorie néo-classique et
de la doctrine libérale: théorie quantitative de la monnaie, théorie des
parités de pouvoir d'achat et théorie des coûts comparatifs.
La théorie quantitative de la monnaie est invoquée pour expliquer et
justifier que tout processus d'inflation est ruineux et entraîne de multiples
distorsions qui auront une incidence négative à la fois sur la balance des
paiements et sur "allocation des ressources pour la croissance(S). Or, la
demande excessive de monnaie est la source principale de l'inflation et
des difficultés des paiements. Dès lors, les experts du Fonds s'efforcent
d'évaluer un agrégat monétaire déterminant dont le niveau dépend à la fois
du volume du crédit intérieur, de la dette extérieure et du déficit budgétaire.
Ces trois éléments vont alors constituer les variables macro-économiques
sur lesquelles il faut agir pour enrayer ou amoindrir l'inflation. Ainsi la limitation du crédit devra avoir une incidence sur les décisions du secteur privé
et public. Elle pourra contraindre le secteur public à réduire de ce fait ses
déséquilibres. Quant à la restriction de l'endettement, elle doit se traduire
par une compression de crédit et un contrôle de ses effets sur l'accumulation inteme car en fait, il faut veiller à ce qu'une dette excessive ne vienne
compromettre la réalisation des investissements productifs. Le déficit
budgétaire constitue le dernier élément de la demande excessive de
monnaie. Ce déséquilibre pour le Fonds procède de l'entretien d'une fonction publique pléthorique et surtout de subventions au secteur public et
parapublic.
Ces trois variables macro-économiques seront surveillées strictement
et maintenues à des niveaux relativement bas pour empêcher une élévation de la masse monétaire qui serait génératrice d'inflation.
La théorie de la parité des pouvoirs d'achat, quant à elle, montre que
l'évolution du change doit refléter le différentiel d'inflation existant entre
deux pays. Elle constitue la référence dans l'élaboration des politiques des
taux de change et de l'intérêt. Les taux d'intérêt selon le FMI sont souvent
maintenus dans les pays en voie de développement à des niveaux bas. Il
en résulte alors une érosion et une mauvaise affectation de l'épargne intérieure.
Enfin, c'est à la théorie des coûts comparatifs qu'on fait appel pour
justifier la nécessité d'un commerce sans entrave sur la base d'une spécialisation des Nations dans les productions où elles ont les meilleures dotations factorielles naturelles, car le commerce extérieur élève la
rémunération des facteurs. Il est donc avantageux pour tous les partenaires à l'échange. Donc les nations doivent s'ouvrir aux relations écono(5) Pourtant ni l'expérience (Amérique latine, Nouveau Pays Industriels) ni la théorie n'ont
établi que l'inflation en soi est ruineuse et la sagesse monétaire payante. Certains pays s'éternisent dans la stagnation Il la suite d'une orthodoxie financière anti-inflationniste. Les
réflexions de grande hauteur de H. Benissadr (Un modèle théorique et empirique de déll'8loppemant par /'inflation, Revue Algérienne des Sciences Juridiques et Economiques n° 2, juin
1969) ont montré au double plan historique et théorique qu'il est possible de financer le développement par l'inflation.
72
•
miques internationales car l'ouverture des frontières confère les mêmes
chances de développement aux partenaires. Les techniciens du Fonds
évoquent la théorie des coûts comparatifs pour recommander la promotion
des échanges internationaux qui sont un moyen pour réaliser le bien-être
mondial.
Sur ce fond doctrinal d'apparence très cohérente, le FMI finit, par
élaborer une politique générale d'ajustement qui a la prétention d'être
valable pour tous les pays en voie de développement. Le caractère
universel de ces solutions procède du fait que pour le FMI. le diagnostic
permet d'établir pour tous les pays du Tiers-Monde un mal identique : les
difficultés de balance des paiements. Dans ce contexte, le programme
d'ajustement doit permettre de parvenir dans un délai raisonnable à une
situation de paiements extérieurs équilibrés.
Le programme d'ajustement s'articule souvent en cinq mesures qui
agissent et se renforcent mutuellement pour permettre de restaurer les
grands équilibres internes et externes et d'améliorer la solvabilité.
La première mesure porte sur la croissance économique. Dans
l'optique du FMI, les pays en voie de développement doivent réaliser une
politique de croissance rapide. Le taux doit être le plus élevé possible
compte tenu de toutes les ressources matérielles et humaines, internes et
externes dont ils peuvent disposer. Cette croissance doit être, en outre,
continue, régulière et débarrassée de toute fluctuation trop forte en baisse
comme en hausse. Cependant, théoriquement, le taux de croissance est
une fonction du taux d'accumulation du capital ou encore du taux d'investissement.
En effet, plus l'investissement productif est élevé plus la croissance
sera rapide. En conséquence, il faut mobiliser toute l'épargne disponible
pour financer ces investissements productifs. Mais également il faut
résoudre toutes les distorsions qui empêchent une réallocation des
ressources en faveur des secteurs productifs. Ce serait le cas des prix
relatifs. des taux de change surévalués qui découragent la production de
biens d'exportation et de substitution aux importations.
Une telle orientation a un caractère productiviste et tend à stimuler les
projets productifs au détriment des investissements sociaux qui concernent
généralement la santé, l'éducation et d'autres sous-secteurs sociaux qui
sont, dans la logique du Fonds, réputés non rentables.
La seconde mesure des politiques d'ajustement concerne la monnaie
et le crédit qui doivent être manipulés pour aboutir d'une part au maintien
de la demande intérieure à un niveau compatible avec l'équilibre et d'autre
part à la réduction des pressions inflationnistes.
Comme établi plus haut, l'accent est mis sur la nécessité d'un contrôle
strict des agrégats financiers liés à la demande comme le crédit intérieur,
le volume de la dette et le déficit budgétaire. Un emballement de l'un quelconque de ces agrégats peut se traduire par l'avènement d'une demande
excessive de monnaie génératrice d'inflation qui, à son tour, introduit une
distorsion négative dans l'allocation des ressources.
73
Dès lors, les mesures qui permettent cette compression de la demande
sont de trois ordres:
- d'abord, le contrôle du crédit de la Banque Centrale au Trésor,
permet de contenir le déficit budgétaire dans des limites étroites poussant,
en dernière analyse, l'Etat à restreindre la croissance de ses dépenses et
surtout à modifier la répartition des ressources financières publiques en
faveur des secteurs liés à la croissance économique. Ainsi, l'ajustement
budgétaire s'avèrera nécessaire dans ce contexte de restriction des crédits
au Trésor et il s'organisera en deux composantes, d'une part de mobilisation des ressources supplémentaires par le moyen de la fiscalité et de
l'emprunt auprès du secteur non bancaire et d'autre part de restriction des
dépenses totales et de modification de leur destination ;
- ensuite, la réduction du volume du crédit bancaire aux secteurs
productifs en vue d'une compression éventuelle de l'expansion globale du
crédit;
- enfin. la hausse du taux de l'intérêt particulièrement pour stimuler
l'épargne intérieure.
Le FMI estime que, généralement dans les pays en voie de développement, les taux d'intérêt ainsi que d'autres prix sont maintenus à des
niveaux qui ne correspondent à aucune réalité économique entraînant en
toute logique une augmentation de la demande de consommation et une
érosion de l'épargne nationale. Ces deux derniers phénomènes expliqueraient, pour une bonne part la stagnation et le déclin de la production.
La troisième mesure de la politique d'ajustement concerne la vérité des
prix et des salaires. La politique des prix revêt une importance décisive car
dans l'analyse néo-classique, le prix est un indicateur de rareté, un instrument irremplaçable d'allocation des ressources. Il importe alors de
combattre toutes sortes de distorsions dans les mécanismes de fixation
des prix relatifs. Or, celles-ci proviennent généralement des prix administrés fixés arbitrairement à des niveaux très bas et des diverses subventions
qui ne correspondent à aucune logique économique mais grèvent inutilement les finances publiques.
Des mécanismes de libre détermination des prix doivent alors être mis
en place pour que les prix qui se forment reflètent les raretés relatives et
opèrent une juste rémunération des facteurs. Il en va de même pour le
salaire considéré comme le prix du travail. Le niveau de cette variable
économique sera déterminé en fonction des paramètres du marché du
travail, mais en plus, les travailleurs ne pourront obtenir aucune rémunération qui ne soit en conformité avec leur productivité.
La quatrième mesure se rapporte à la politique budgétaire qui s'organise autour des axes suivants:
- une régénération des recettes par une amélioration de l'administration fiscale et douanière, et par le développement d'emprunt surtout au
niveau du secteur non bancaire:
74
- des mesures tendant à la réalisation d'économies budgétaires et qui
passent par une compression des dépenses publiques notamment par une
réduction du train de vie de l'Etat, par une diminution et un contrôle plus
rigoureux de la masse salariale et enfin par la suppression de toutes les
subventions au secteur public et parapublic.
Ces différentes mesures visent principalement la régulation de la
demande par le freinage des dépenses et l'accroissement des recettes.
Les réformes budgétaires deviennent alors des instruments de la politique
générale d'ajustement structurel.
Toutes les opérations que réalise l'Etat, quelle que soit leur nature, sont
consolidées dans le programme d'ajustement. Le rayon d'action éconornique et sociale de l'Etat est de la sorte terriblement réduit, ce qui explique
que dans le processus d'ajustement, les mécanismes spontanés du
marché doivent l'emporter sur tout interventionnisme étatique réputé, à la
fois coûteux, inefficace et paralysant.
La cinquième mesure, de loin la plus importante concerne la dévaluation. La dévaluation des taux de change est considérée par les institutions
financières, comme le moyen privilégié d'ajustement et de stabilisation,
l'instrument approprié pour mener une rapide relance de la croissance et
assurer un retour vers l'équilibre souhaité de la balance des paiements.
Pourtant, les choses sont très loin de se passer de cette manière ce qui
justifie, du reste, l'extrême réticence des pays à la dévaluation considérée
par la Banque Mondiale (Rapport sur le développement, 1984) comme une
mesure dont la nécessité devient de plus en plus urgente et inévitable.
Cependant, le succès d'une telle mesure est lié à deux conditions essentielles que les pays africains ne remplissent pas à savoir : d'une part la
compétitivité des prix par rapport aux concurrents et d'autre part la flexibilité de l'appareil de production par rapport à une modification des prix relatifs. Au contraire, toute dévaluation entraîne de manière quasi automatique
une hausse drastique du coût des importations incompressibles (biens
intermédiaires et d'équipement), des tensions inflationnistes persistantes,
une amplification de la fuite des capitaux, une perte de pouvoir d'achat des
producteurs et des consommateurs, une instabilité sociale permanente
créant, en définitive, un climat peu propice à l'investissement. Dans l'état
actuel des économies africaines les inconvénients d'une dévaluation
l'emportent de loin sur les avantages attendus. Il ne s'agit nullement d'une
cc attitude négative et dogmatique" mais d'une observation des faits et des
situations tels qu'ils se présentent réellement.
Bien sûr cette mesure exerce, à l'expérience, des effets négatifs sur la
balance de paiements et cela le Fonds le reconnaît lorsqu'il écrit dans un
document qu'une cc dépréciation du taux de change se produit souvent à
court terme par une détérioration de la balance commerciale parce que
dans la plupart des pays, les prix à l'importation ont tendance à varier plus
rapidement en termes de monnaie locale que les prix à l'exportation et que
75
le volume des exportations et importations réagit plutôt lentement ". Le
Fonds sait également que les pays en développement n'ont qu'une faible
prise sur les prix en monnaies étrangères des importations et des exportations.
Pourtant, malgré ces limites, le Fonds reconnaît une certaine efficacité
à la dévaluation qu'il érige au rang des mesures impératives de l'ajustement. Cette foi en l'efficacité des mécanismes de la dévaluation procède,
chez les experts du FMI, de la forte conviction que les monnaies africaines
sont surévaluées et qu'en conséquence la dévaluation établirait une structure de prix relatifs qui stimulerait les activités exportatrices et exercerait
des effets dissuasifs sur les importations. Tous ces effets devraient aboutir
à l'instauration d'un climat favorable au commerce international et produire
un équilibre des échanges extérieurs. La dévaluation non seulement
améliorerait la balance des paiements mais elle opérerait une réallocation
des revenus favorables aux agents liés aux activités exportatrices. Ceux-ci
finiront par se retrouver avec la part la plus importante du revenu national.
Donc à terme, par leurs actions de production et d'investissement, ces
agents pourront contribuer à l'équilibre de la balance des paiements.
Ces cinq volets forment le programme d'ajustement proposé indistinctement comme une taille unique aux pays qui recourent aux services du
FMI. Mais, à y regarder de près, ils constituent un ensemble de mesures
qui affectent de façon irréversible les orientations et les structures d'un
pays. Il s'agit en fait de la mise en place, parfois jusque dans les moindres
détails, de politiques économiques d'un modèle de développement qui
repose sur l'idéologie et les principes du libéralisme et dont le fonctionnement est lié à la division internationale du travail. C'est la référence à cette
philosophie économique et à ses présupposés théoriques qui explique la
très grande cohérence des politiques d'ajustement. Les causalités privilégiées pour reprendre Marie-France L'Hériteau ont abouti à ces certitudes
combinant les enseignements de la théorie quantitative de la monnaie et
ceux de la parité des pouvoirs d'achat. Elles peuvent être schématisées
ainsi(6) :
Politiques de crédit
laxiste..............
~
, ,
--...creation
't' ~Hausse
.=.- d e
mone aire ues priX
des
Hausse de la masse . /
salariale
'/
'f't bd'
,
Del
u getalre
Endettement
/
Défit
ba1ances et/ou
'~"
paiements
Devaluation de la
monnaie nationale
Ces politiques d'ajustement inspirées et soutenues par les Institutions
Financières Internationales et les bailleurs de fonds ont suscité beaucoup
(6) D'après Marie-France L'Hériteau, Endettement et ajustement structurel: la nouvelle
canonnière, Revue du Tiers-Monde, tome XXIII, n° 91,
76
de controverses. Il importe alors d'en évaluer les résultats au double plan
théorique et pratique.
3) Les limites pratiques des politiques d'ajustement
D'une manière générale et en toute logique économique les déficits
structurels des balances de paiement dans les pays en voie de développement traduisent les déséquilibres au niveau de la production, de la
demande globale et des prix des produits et des facteurs. De ce fait, si
l'offre est insuffisante, ce qui se reflète dans des distorsions des prix intérieurs, il importe d'améliorer l'affectation des ressources pour renforcer les
bases matérielles de la production des biens et de restreindre la demande
en attendant de pouvoir élargir les capacités productives de l'économie. En
somme, du fait qu'il est impossible de s'accommoder de déséquilibres
permanents, l'ajustement économique et financier devient un exercice
inévitable et devrait permettre la correction des distorsions, la relance de la
croissance par une réorientation des ressources au profit des secteurs
productifs et la limitation des consommations improductives privées ou
publiques.
Cependant, l'expérience établit que les économies contemporaines ont
tendance à s'accommoder de plus en plus de déséquilibres des balances
de paiement qu'elles règlent par le recours systématique à l'endettement
extérieur. Ce n'est que lorsque la charge de la dette ainsi contractée
devient trop lourde ou lorsque se réduisent les possibilités de nouveaux
emprunts qu'elles se tournent vers le FMI.
Or, l'utilisation des ressources du FMI est subordonnée à la mise en
œuvre de programmes d'ajustement dont les lignes directrices ont été
analysées. Ceci explique pourquoi l'ajustement est presque toujours
associé à l'intervention du FMI. Dès lors, le succès, ou l'échec d'un
programme d'ajustement est principalement le succès - ou l'échec - du
FMI, qui en est le principal concepteur et également le contrôleur certes
discret mais ferme et déterminé.
La question de l'évaluation de l'efficacité des programmes financiers
est au centre d'un débat qui oppose depuis quelques années le Fonds à
certains experts et chercheurs. Cette évaluation des PAS peut s'opérer à
trois niveaux :
- celui de la pertinence théorique du modèle de référence;
- celui des performances en rapport avec les objectifs;
- et celui des conséquences non économiques.
Ainsi, une étude récente publiée par l' " Overseas Development
Institute of London» conclut, selon Tony Killick qui en est le Directeur,
que: " les programmes soutenus par le Fonds dans les pays en développement n'ont qu'une efficacité restreinte »(7).
(7) Revue Finances et Développement, numéro de septembre 1984.
77
L'étude, menée sur la base de documents internes du FMI, résume
ainsi qu'il suit les effets constatés des programmes financés par le Fonds:
s'ils visent à renforcer la balance des paiements, les résultats sont statistiquement peu significatifs et souvent bien en deçà des objectifs fixés ; ce
n'est qu'en quelques occasions que les programmes ont donné lieu à une
forte augmentation des entrées de capitaux provenant d'autres sources et
l'on n'a pas observé de relation systématique entre les programmes et la
libéralisation durable des échanges et des paiements; les effets déflationnistes des programmes sont généralement peu marqués.
Les différentes monographies réalisées sur les expériences d'ajustement montrent qu'en Afrique de l'Ouest, les programmes ont enregistré de
très médiocres résultats, ont contribué au délabrement des systèmes
productifs et à la désorganisation des appareils administratifs et institutionnels. L'initiateur et le père spirituel des Programmes d'Ajustement
Structurel Eliot Berg vient de reconnaître dans une étude de réalisée au
Sénégal et au titre évocateur « L'ajustement ajourné .. que cette stratégie
appliquée depuis 1979 n'a produit aucun résultat significatif malgré les
énormes sacrifices imposés à la population(8). Eliot Berg accuse au
premier plan la Banque Mondiale qui a établi un diagnostic incorrect et une
mauvaise conception du programme et en définitive a commis des erreurs
et des imperfections dans la conception et le suivi des réformes stratégiques et institutionnelles. Au second plan l'auteur dénonce, ce que tous
les intellectuels africains font depuis les indépendances, la médiocrité des
assistants techniques résidents et recommande le recours aux compétences locales. Ces critiques nous les avons développé avec d'autres
économistes depuis les années 1980 lors de l'élaboration du fameux Plan
BERG dont l'auteur vient de faire une autocritique.
De plus, en termes de coûts/bénéfices, nous pouvons nous poser la
question de savoir quels sont les coûts économiques et sociaux supportés
pour résoudre les déséquilibres et relancer la croissance, et si ces coûts
ont permis effectivement aux politiques d'ajustement d'atteindre leurs
objectifs.
a) Les coûts économiques et sociaux des politiques d'ajustement
Les mesures qui ont été analysées devraient aboutir à un programme
cohérent de compression de la demandè.globale, de libéralisation du
commerce extérieur, de modification de la répartition du revenu et de diminution du pouvoir d'achat des masses laborieuses. Il s'agit d'évaluer les
diverses conséquences sociales de ces différentes mesures.
La compression de la demande qui joue un rôle moteur dans l'ajustement économique et financier se réalise par un ensemble d'actions visant à
réduire le niveau des dépenses afin de les rendre compatibles avec celui
(8) Eliot Berg. L'ajustement ajourné: réforme de la politique économique au Sénégal
dans les années 1980, USAI D, Dakar, 1990, 63 p.
78
de la production. Ces mesures sont: la diminution des dépenses
publiques, l'élimination des subventions, "augmentation des ponctions
fiscales, le ralentissement de l'expansion de la masse monétaire, le relèvement des taux d'intérêt et la hausse des prix même administrés.
Ces mesures entraînent des conséquences sociales assez lourdes
particulièrement pour les populations les plus démunies: accroissement du
chômage, réduction des revenus et du pouvoir d'achat, diminution des
salaires réels par suite de l'augmentation des prix. Tout cela sera aggravé
par les ponctions fiscales supportées par les salariés, les producteurs du
secteur moderne et les consommateurs urbains.
Quant à la réduction de la masse de crédit, elle affecte particulièrement
les petites et moyennes entreprises qui risquent de voir leurs affaires
tomber en ruine faute de moyens de financement.
En ce qui concerne la dévaluation, il est établi théoriquement et pratiquement qu'elle n'a guère cette vertu d'améliorer automatiquement l'équilibre de la balance commerciale. Bien au contraire, dans les pays africains,
elle renchérit les importations sans pouvoir favoriser les exportations
composées essentiellement de matières premières dont la détermination
de la demande et des prix échappe totalement aux pays producteurs. Les
statistiques et beaucoup de monographies convergent pour établir que la
formation internationale des prix des matières premières dépend principalement de facteurs extra-économiques qui s'imposent comme des données
exogènes sur lesquelles les PVD n'ont aucune prise. Dès lors, la dévaluation n'accroit en aucune manière le volume des exportations si tant est que
celles-ci sont indéfiniment extensibles. A cela s'ajoute cette autre observation extrêmement pertinente de A. Emmanuel: on délibère comme si 1 000
tonnes de café à 1 000 dollars apportaient au pays exportateur autant de
devises que 500 tonnes à 2 000 dollars. Les sacs, les engrais, les
machines de décorticage et leurs carburants, les moyens de transport,
toutes choses payées en devises, sont entièrement ignorées.
Dans ces conditions, les changements introduits par les programmes
d'ajustement affectent principalement les catégories les plus pauvres de la
population, en modifiant à leur détriment la distribution interne des revenus.
Il en est particulièrement ainsi de l'inflation qui affecte plus durement cette
frange de la population dont l'épargne est le plus souvent détenue sous
forme monétaire.
En définitive, on peut dire que le prix immédiat à payer par un pays qui
engage un processus d'ajustement est fort élevé, particulièrement pour les
catégories défavorisées de la population qui, ne disposant pas de moyens
de se prémunir, supportent en fin de compte une bonne partie du poids de
l'ajustement
C'est cela qui fait dire que les institutions financières internationales
proposent aux Etats des programmes de cc guerre civile, une prime à la
.. révolte" ". En effet, l'application de la thérapie d'ajustement tend toujours
à entraîner des mouvements sociaux très amples, qui peuvent soit
préparer une instabilité politique soit introduire des perturbations sociales
79
parfaitement préjudiciables à la paix civile. Les émeutes populaires intervenues dans certains pays après une augmentation des denrées de première
nécessité en sont une parfaite illustration.
En ce qui concerne les effets directs de ces programmes d'ajustement
sur les secteurs de base du développement que sont l'éducation, la formation, la science et la recherche en Afrique de l'Ouest, le tableau de la page
80 nous indique clairement deux tendances majeures lourdes de signification:
- d'abord, entre 1965 et 1980 (période sans ajustement), le taux de
scolarisation a constamment augmenté dans l'ensemble des seize pays
ouest-africains, doublant en moyenne dans les enseignements primaire et
supérieur et triplant dans l'enseignement secondaire;
- ensuite. entre 1980 et 1986 (période d'ajustement), ce taux s'est
difficilement maintenu dans le primaire, a sensiblement baissé dans le
secondaire (surtout au Togo, au Ghana et en Guinée) et a chuté en
moyenne de près de moitié dans le supérieur.
Ce constat est d'ailleurs corroboré par la baisse continue de la part de
l'éducation dans les dépenses totales des Etats ouest-africains depuis
1980 (début de la plupart des programmes d'ajustement dans la région). A
titre d'exemple, le Nigéria, géant économique de la région (population,
PNB) ne consacrait en 1987 que 2,8 % de ses dépenses publiques au
secteur de l'éducation contre 4,5 % en 1980.
Situation de l'éducation dans les pays de la CEDEAO
1965-1986
Nombre d'Inscrits en pourcentage du groupe d'âge
PAYS
1Bénin ...........................
2 Burkina-Fasse ...............
3Cap-Vert .......................
4 Côte-d'Ivoire ..................
5Gambie ........................
6Ghana...........................
7Guinée .........................
8Guinée-Bissau ...............
9 Libéria ..........................
10 Mali .............................
11 Mauritanie.....................
12 Niger ...........................
13 Nigéria .........................
14 Sénégal ........................
15 Sierra-Léone ..................
16 Togo ............................
Enseignement
primaire
Enseignement
secondaire
1965
1980
1986
1965
1980
34
64
21
112
80
52
73
31
67
76
25
65
35
108
78
75
63
29
60
n.c.
22
46
29
n.c.
55
n.c.
102
3
1
n.c.
6
6
13
5
2
5
4
1
1
5
7
5
5
16
3
8
19
13
37
14
6
23
8
10
5
19
11
14
12
n.c.
60
21
69
31
26
41
24
13
11
32
40
29
55
34
27
97
46
54
122
34
Enseignement
supérieur
1986 1965 1980 1986
16
6
14
20
20
35
9
11
n.c.
7
15
6
n.c.
13
n.c.
21
Source: Banque Mondiale, Rapport sur l'Afrique subsaharienne :
sance durable n, 1989.
«
0
0
n.C.
0
n.c.
1
0
n.c.
1
0
n.c.
n.c.
0
1
0
0
0 n.c.
1
0
n.c. n.c.
3
3
n.c. n.c.
n.c.
2
4
1
n.c. n.c.
n.c. n.c.
0
1
n.c.
0
0
1
2
3
3
2
1 n.c.
2
2
De crise à une crois-
Même la Banque Mondiale (Afrique subsaharienne : de la crise à une
croissance durable, 1989, p. 76) fait un constat identique en remarquant
que: cc depuis "indépendance, l'Afrique a fait de remarquables progrès
dans la valorisation des ressource humaines, mais on constate un ralentissement inquiétant, dû principalement à des difficultés financières et à
l'accroissement de la population. Si les tendances actuelles se poursuivent, c'est la base même du développement à long terme qui se trouvera
menacée ".
Or, la perspective de l'ajustement mis en œuvre depuis plus d'une
décennie en Afrique de l'Ouest débouche irrémédiablement sur le sacrifice
d'un secteur social éminemment stratégique pour le développement que
sont l'éducation, la science, la formation et la recherche appliquée.
b) Les résultats économIques des politiques d'ajustement
Dans la majorité des cas, les programmes d'ajustement en Afrique de
l'Ouest tournent autour des objectifs principaux de :
- promotion de la croissance économique;
- réduction de l'inflation à un taux annuel acceptable;
- amélioration de la position de la balance des paiements ;
- dévaluation qui modifierait positivement les prix relatifs avec une
réorientation du commerce.
A ces objectifs prioritaires s'ajoutent d'autres d'une moindre importance
tels que:
- la réduction du ratio du déficit du secteur public/PIB ;
- l'amélioration de l'affectation des ressources intérieures afin de favoriser l'épargne et l'investissement intérieur;
- le contrôle de la dette et son maintien à un niveau compatible avec
la capacité du pays à assurer le service de la dette.
A l'expérience, on a souvent observé des écarts grandissants entre les
objectifs fixés dans les programmes d'ajustement et ceux effectivement
réalisés. Cette observation montre les faiblesses caractéristiques des politiques d'ajustement et révèle leur difficulté à résoudre la crise économique
et sociale dans les PVD. Dans un article célèbre, S.K. Thasan notait que
" l'expérience des pays africains montre que des divergences ont
tendance à apparaître non pas tant au niveau du diagnostic des pays (bien
que naturellement, les autorités aient plus que le Fonds tendance à blâmer
surtout les facteurs exogènes) ni au niveau de la détermination des objectifs économiques et financiers des pays (bien que la suffisance des
données puisse les rendre difficiles à quantifier), mais au niveau de l'élabo(9) Voir également Moustapha Kassé, .. Les effets sociaux des programmes d'ajustement communication au Séminaire Régional du CAFRADES organisé à Tripoli du 20 au
25 août 1990 .. Sur l'impact social .. des PAS par la CEA.
>l,
81
ration des politiques d'ajustement nécessaires »(10). Sur ce plan, les divergences portent sur les questions suivantes:
1) l'approche monétaire stéréotypée de la politique économique;
2) les justifications des mesures orientées vers le marché, comme la
dévaluation du taux de change, le relèvement des taux d'intérêt, la hausse
des prix alimentaires ou des services publics;
3) l'importance très secondaire apportée aux considérations de justice
sociale et J'inopportunité politique de mesures comme la dévaluation du
taux de change, des restrictions salariales ou la réduction des subventions
à la consommation. Ainsi, sur un autre plan, S.K. Thasan reconnaît que
l'ajustement peut entraîner le recul de la production et de l'emploi car, il ne
s'intéresse qu'aux aspects financiers qui ouvrent l'accès aux ressources du
Fonds.
Dans la même ligne de pensée, le Directeur du Département Afrique du
FMI et son adjoint se sont livrés à cet exercice dans un autre article publié
dans la revue: « Finances et Développement » et intitulé: « Les
programmes d'ajustement en Afrique ... Partant de l'évaluation de vingt et
un pays africains ayant des programmes en cours entre 1980 et 1981 et
pour lesquels le Fonds avait engagé 4,3 milliards de DTS à la fin de
l'année 1981 (contre 455 millions de DTS à la fin de l'année 1979), les
auteurs observent que :
- les objectifs liés à la croissance économique ont été atteints dans
20 % des cas environ;
- les objectifs relatifs à l'inflation ont été réalisés dans près de la
moitié des cas ;
- les objectifs ayant trait à la situation extérieure ont été atteints dans
40 % des cas environ.
Par ailleurs, les deux auteurs remarquent que les ratios correspondant
aux dépenses publiques ont presque toujours dépassé les montants
prévus, de sorte que la part du déficit budgétaire dans le PIS a été supérieure aux prévisions dans deux pays sur cinq; en conséquence, le taux de
croissance du crédit net au secteur public n'a pas été conforme aux objectifs. Et comme le crédit au secteur privé a lui-même été souvent supérieur
aux prévisions, il en est résulté un dépassement des objectifs d'expansion
du crédit intérieur net dans près de la moitié des cas environ.
Le moins que l'on puisse dire, face à ce constat, c'est que les politiques
d'ajustement malgré leurs coûts sociaux parfois excessifs n'ont pas
toujours été performantes. Elles n'ont pas permis de résoudre les déséquilibres et de sortir les pays de la crise par la relance des investissements.
Dans le meilleur des cas, elles ont fait reculer les échéances mais n'ont
(10) S. Kanesa-Thasan. Le Fonds et les politiques d'ajustement en Afrique, Revue
Finances et Développement, septembre 1981.
82
réglé aucune des distorsions fondamentales, ainsi, la croissance ne s'est
nulle part améliorée de façon notable tout comme les déséquilibres extérieurs n'ont pas été résorbés. Bien au contraire, l'endettement s'est
aggravé et l'inflation s'est partout maintenue. D'ailleurs, l'inflation n'est pas
apparue en Afrique, comme un phénomène déterminé uniquement par une
expansion excessive de la masse monétaire et du crédit. Elle procède
souvent de rigidités structurelles et de paramètres liés aux relations économiques et financières avec l'extérieur.
Si les politiques de stabilisation ont produit d'aussi faibles résultats,
c'est parce qu'elles reposent sur des élaborations théoriques complètement inappropriées ou insuffisantes.
4) Les limites théoriques des politiques d'ajustement
Tous les faits analysés ont montré très clairement que les politiques
d'ajustement ont échoué en Afrique de l'Ouest dans leur triple objectif
consistant à équilibrer la balance des paiements, à comprimer l'endettement en restaurant en même temps la solvabilité, à relancer la croissance
et le développement économique. Ces performances modestes s'accompagnent de graves et profondes dépréciations de la situation sociale. Des
théories et approches non pertinentes expliquent, pour une bonne part, ces
médiocres résultats.
La théorie néo-classique de la monnaie et des relations économiques
internationales qui inspire et éclaire la démarche des experts du FMI s'est
avérée incapable de donner une explication cohérente et acceptable des
phénomènes comme l'inflation et ses effets d'érosion des économies
faibles, l'échange inégal et son incidence sur l'accumulation productive des
pays sous-développés. L'inflation est saisie au simple niveau de sa conséquence immédiate: l'élévation des prix. En ne considérant que cet aspect,
l'effet est pris pour la cause. Les politiques anti-inflationnistes qui découlent
de ce fonds doctrinal comme par exemple la politique monétaire restrictive
des agrégats financiers, la politique budgétaire excessivement prudente et
la politique de réduction de la demande intérieure, n'ont nullement à
enrayer les tensions inflationnistes. Bien au contraire, ayant abouti à une
restriction de l'offre globale, ces politiques ont réussi à créer une pénurie
qui a entraîné une augmentation des prix.
Par ailleurs, la dévaluation s'est avérée une mesure inadéquate
puisqu'elle s'est traduite souvent par une dépréciation plus importante de
la balance commerciale. En effet, comme le reconnaissent d'ailleurs les
experts du Fonds, les prix à l'importation varient plus rapidement en termes
de monnaie locale que les prix à l'exportation. Pour qu'une dévaluation
améliore la balance commerciale, il faudrait non seulement que le taux de
change influence réellement les prix à l'importation et à l'exportation, mais
qu'il existe une élasticité du volume des échanges extérieurs par rapport
aux prix Ces conditions sont impossibles à réunir par un pays en voie de
83
développement qui n'a aucun moyen de contrôle sur le processus de
formation des prix internes et externes. Evaluant les politiques d'ajustement adoptées en Afrique, la Commission Economique pour l'Afrique
(CEA) observe que l'on continue à cc se poser la question de savoir si une
dévaluation opérée dans des pays tels que les pays d'Afrique en développement constitue l'instrument approprié pour amener un rapide rétablissement de la croissance et assurer l'amélioration souhaitée de la balance des
paiements »(11). Par ailleurs, il n'est pas facile de déterminer le taux de
change <c optimal » à retenir pour établir la structure souhaitable des prix
relatifs.
La théorie néo-classique des relations économiques et financières
internationales est également fortement contestée dans ses fondements
comme dans ses résultats. En effet, la théorie de la spécialisation à partir
des dotations naturelles qui postule que l'ouverture permet une meilleure
rémunération des facteurs internes de production repose sur des hypothèses inexactes comme /'immobilité des facteurs en flagrante contradiction avec l'ouverture extérieure, le caractère immuable de la dotation en
facteurs de production. Dès lors, on peut dire que cet ensemble d'hypothèses fragiles et non vérifiées ne peut conduire à une politique juste. De
plus, même si la théorie néo-classique postulant que le commerce sans
entraves est mutuellement avantageux aux partenaires, était exacte au
niveau de sa formulation abstraite, au plan des faits elle est complètement
prise à défaut. En effet la montée du protectionnisme, particulièrement
remarquable au niveau des pays développés, montre une certaine remise
en cause des règles du jeu de la spécialisation et de l'ouverture.
Enfin une dernière faiblesse de l'analyse réside dans la théorie des prix
et de leur processus de détermination. Il apparaît que si toutes les conditions d'une économie concurrencée sont réunies, les prix du marché se
présentent comme des instruments d'allocation des ressources, les
signaux en fonction desquels sont prises et coordonnées les décisions individuelles des agents économiques. En définitive, le système des prix, par
des ajustements incessants, assure la coordination des décisions individuelles. Mais cela suppose réunies toutes les hypothèses de la concurrence pure et parfaite, celles de la rationalité des agents et celles de
l'existence de marchés parfaits. Or de telles hypothèses ne sont vérifiées
dans aucun Etat africain. Il apparaît donc que le discours du FMI est porté
par des théories extrêmement fragiles à la fois dans leurs hypothèses
comme dans leur méthodologie et démarche.
Par ailleurs, la théorie néo-classique révèle d'autres lacunes dans
l'application: elle est incapable de rendre compte des particularités structurelles des pays en voie de développement. En effet, si abstraitement, l'on
considère cette théorie comme celle des rapports marchands, ainsi que
l'autorise le texte de Walras, on s'aperçoit que les catégories utilisées sont
peu pertinentes dans des pays qui sont à dominante non capitaliste. Une
(11) CEA-BAD, Rapport économique sur l'Afrique, Abidjan, 1984.
84
large part des échanges y sont non marchands, l'espace économique est
hétérogénisé par des cloisons et barrières rendant le marché totalement
imparfait. La croissance ne peut être auto-entretenue par suite de l'existence de multiples déséquilibres. Enfin, les régimes autoritaires qui prévalent ne connaissent pas de débats démocratiques donc de processus de
génération de choix collectifs par interaction des choix individuels.
Si en revanche, on confère à la théorie néo-classique une acceptation
systémique, pour en faire une théorie de l'équilibre stable d'un système
complexe, les catégories usuelles n'ont plus, ni la même signification, ni la
même portée analytique.
En conséquence, la théorie proposée est en porte-à-faux avec la réalité
qu'elle se propose de servir et de transformer. En cela, les propositions
des politiques d'ajustement comme la compression de la demande globale,
la croissance par allocation des ressources en faveur des secteurs productifs, la vérité des prix, la non intervention de l'Etat et la promotion de l'entreprise individuelle, se heurtent à des contraintes structurelles complexes et
souvent infranchissables. De telles propositions induisent des effets
pervers trop éloignés des résultats attendus.
Cette analyse établit que le modèle de développement qui a prévalu
jusqu'à maintenant en Afrique de l'Ouest a échoué dans la réalisation du
triple objectif des politiques économique et financière.
- Elever le niveau des forces productives matérielles et humaines et
faire de la croissance un phénomène irréversible.
- Construire des systèmes productifs polyvalents et capables d'autonomie vis-à-vis de la division internationale du travail.
- Améliorer le niveau culturel et le niveau de vie des populations laborieuses.
Ce modèle de développement a conduit les pays qui l'ont appliqué vers
des difficultés économiques et sociales dont l'endettement n'est qu'un effet
de surface.
Dans ce contexte, les politiques d'ajustement et de stabilisation ont une
double finalité: d'une part, ajuster davantage les systèmes productifs des
pays en voie de développement à la division internationale du travail et
d'autre part, tenter de restaurer la solvabilité par rétablissement des grands
équilibres financiers. De la sorte, on rassure la communauté financière
internationale pour qu'elle continue de mobiliser les ressources indispensables aux économies de l'endettement qui vont ainsi perpétuer leurs
déséquilibres internes. Quelles que soient les évaluations réalisées, les
politiques d'ajustement ont produit certains effets dont trois méritent d'être
soulignés:
- L'apparition d'une plus grande différenciation sociale par la formation et la consolidation d'une couche sociale liée aux secteurs exportateurs.
85
En effet, il est connu que certaines mesures des politiques d'ajustement, comme la dévaluation, opèrent des transferts de revenu réel en
faveur des opérateurs économiques liés aux activités exportatrices. Or, ces
opérateurs s'avèrent incapables de transformer le système productif dont
ils tirent de l'immobilisme des rentes de situation. Ils ne s'intéressent
qu'aux activités d'import-export et sont peu concernés par les politiques de
relance des investissements directement productifs. Leur domaine d'intervention les amène à ravaler les pays au rang de cc supermarché .. contribuant ainsi à la liquidation progressive des industries naissantes encore
fragiles pour soutenir une compétition avec l'extérieur.
- L'apparition de matrices culturelles et de modèles de comportement
extravertis des élites.
Ces matrices aux prétentions exclusivement technocratiques affichent
souvent un mépris pour les identités culturelles, assimilées à des systèmes
de valeurs archaïques et opposées à la philosophie du progrès et de la
technologie. Ces élites du pouvoir manipulant ce discours ésotérique ne se
sentent nullement concernées par la recherche d'identité alternative devant
aboutir à des institutions et modèles nouveaux, permettant l'instauration de
nouvelles formes d'Etat, de gestion de l'agriculture et de l'appareil industriel. De même, matière de technologie en vue du développement, aucun
effort ne sera entrepris pour une utilisation rationnelle des savoir-faire
locaux.
On n'a pas encore évalué avec exactitude le coût financier et social du
mimétisme. Cependant, on peut déjà observer qu'il constitue un facteur de
blocage et d'inefficacité qui empêche de chercher et d'utiliser des modes
d'organisation administrative, économique, sociale et technologique plus
appropriés et nécessairement moins coûteux. L'échec du développement
par décret provient principalement de l'absence de compréhension et
d'intériorisation des tâches et comportements économiques par les acteurs
du développement.
- La propagation du modèle de consommation fondé sur les biens
importés est un autre élément déterminant. Les politiques d'ajustement
opèrent souvent une redistribution des revenus favorables aux couches
sociales aisées et aux élites dont les consommations à fort contenu en
devises accroissent les importations et contribuent à creuser le déséquilibre de la balance commerciale. Ce modèle de consommation a tendance
à s'élargir par des effets conjugués de démonstration, d'imitation et d'urbanisation. Ce dernier phénomène est devenu essentiel car les tendances
lourdes à l'urbanisation font exploser la demande infrastructurelle et
alimentaire qui impose des charges financières insupportables par les
ressources internes. L'endettement devient le seul moyen pour financer
ces dépenses.
Toutes ces situations se déroulent sur un fond de stagnation, voire
même de régression économique et sociale. La croissance demeure
86
exceptionnelle et revêt toujours un caractère extraverti, entretenue de
l'extérieur par les institutions financières et les bailleurs de fonds. Dès lors,
dès que les crédits internationaux manquent tout est bloqué.
En somme, le développement se déroule dans un cercle vicieux: pour
rembourser la dette, il faut s'endetter pour animer la croissance. On
s'installe ainsi dans une sorte de mécanisme " d'une dette perpétuelle ..
pour reprendle la formule de H. Bourguinat avec des emprunts renouvelés
chaque fois qu'ils viennent à échéance. D'ailleurs, sans crédit, les PVD ne
seraient pas des clients pour les industries du système central. En effet, la
nature des crédits octroyés aux PVD - crédits exports garantis, crédits
financiers d'accompagnement et les contrats d'équipement - montre que
l'endettement a particulièrement renforcé les exportations des pays industrialisés vers le Sud. Il a donc permis d'élargir les débouchés extérieurs de
systèmes économiques menacés de crise de surproduction par suite du
développement de la production de masse.
Tout cela montre que les nouveaux experts ne sont pas porteurs de
remèdes infaillibles aux distorsions structurelles et au blocage du développement et l'aveu d'insuccès que vient de faire Eliot Berg dans son étude
sur l'expérience sénégalaise est de ce point de vue édifiant du temps
perdu et des sacrifices inutiles imposés aux populations. L'application des
politiques d'ajustement a souvent conduit à une augmentation de l'endettement et parfois à un mouvement tendanciel de régression sociale. Dans ce
contexte, les pays s'engagent dans l'engrenage d'un processus infernal
dans lequel le paiement d'une dette entraîne un endettement encore plus
important. Alors, on emprunte pour payer les emprunts. Les aires de liberté
et de choix économiques se réduisent à une peau de chagrin et le développement s'effectue sous tutelle dans les limites étroites fixées par les
bailleurs de fonds privés et publics. Selon le mot de H.A. d'Orfeuille,
"certains Etats sont ainsi soumis à deux, trois, quatre tuteurs qui prétendent imposer chacun ses conditionnalités .. (12).
Dans ces conditions, il faut changer de terrain et chercher des solutions
altematives globales et coordonnées qui permettent de sortir de l'économie
d'endettement et d'amorcer un autre développement qui libère les initiatives créatrices des populations et leur liberté d'entreprendre. Comme
l'observait J.M. Keynes" la difficulté n'est pas de comprendre les idées
nouvelles mais d'échapper aux idées anciennes qui ont poussé leurs ramifications dans tous les recoins de l'esprit des personnes .. (13).
Les résultats économiques et sociaux produits par les PAS appliquées
depuis les années soixante-dix doivent inciter à abandonner les idéologies
abruptes même si elles se veulent libérales. La crise économique et financière persistante impose de concevoir autrement le développement.
(12) H. Rouille d'Orfeuille, Le Tiers-Monde, Edit. La Découverte, Paris, 1987, p. 74.
(13) J.M. Keynes, Théorie générale, Edit Payot, p. 16.
87
CHAPITRE Il - LES AXES D'UNE AUTRE STRATEGIE DE
DEVELOPPEMENT
La crise s'est durablement installée en Afrique de l'Ouest imposant
dans la majeure partie des seize pays membres de la CEDEAO des politiques d'ajustement structurel et cela depuis le début des années 1980.
Les économies régressent partout avec des taux de croissance nuls,
parfois même négatifs. Les agricultures périclitent et n'arrivent pas à
couvrir les besoins alimentaires en expansion rapide du fait de l'accélération de l'urbanisation et de "explosion démographique. Les industries sont
en déclin faute de débouchés et de réorientations appropriées. La répartition des revenus est de plus en plus inégalitaire avec une majorité de la
population vivant dans la pauvreté absolue. La dépendance vis-à-vis de
l'extérieur s'est renforcée surtout au plan monétaire et financier. L'endettement s'accroît et entraîne des charges qui absorbent les maigres
ressources générées par les systèmes productifs.
Du côté de l'Etat, les choses ne vont guère mieux. La crise est si
profonde que partout le fait non gouvernemental s'impose: secteur
informel, démultiplication des organisations non gouvernementales, initiatives la base. L'instrument s'est détérioré dans plusieurs cas, au point de
faire dire à G. Challand qu'en Afrique les Etats sont à la dérive(14) car les
structures institutionnelles et administrative qu'ils ont sécrétées non seulement étaient inadaptées mais ont aussi manqué de fonctionnement démocratique.
Si bien que derrière les discours et les proclamations astucieuses, le
bilan économique, politique, social et culturel reste très décevant. L'Afrique
abrite les pays les plus pauvres du monde.
L'analyse montre qu'une décennie d'application scrupuleuse des politiques d'ajustement structurel conduites dans une parfaite logique de libéralisme, d'austérité et de rigueur ne débouche pas encore sur la relance
économique et la résorption des déséquilibres des finances publiques et
des balances de paiement. Bien au contraire, ces politiques ont souvent
conduit à une paralysie à la fois économique, politique et administrative
présentant alors toutes les caractéristiques d'une société bloquée minée
par des contradictions qui réunissent toutes les conditions d'une implosion
sociale. Cela apparaît dans les émeutes qui ont ébranlé certains Etats
Ouest africains: Nigéria, Sierra-Léone, Libéria, Sénégal, Côte-d'Ivoire,
Guinée, Niger, Togo, Mali, etc.
Dans le fond, ce qui est en cause, c'est le modèle de développement
dépendant et inadapté aux réalités locales ainsi que son système d'accumulation fondé sur la rente minière et agricole. Ce modèle, qu'il soit d'inspiration libérale ou socialiste, fonctionne par et pour l'économie mondiale
(14) G. Chaliand, L'enjeu africain: Géostratégies des puissances, Edit. Complexe, 1984,
p.24.
88
avec des structures administratives lourdes et coûteuses mais aussi inefficientes puisque totalement en inadéquation avec la base économique et la
réalité sociale. C'est cela qui explique "identité des phénomènes négatifs,
que les pays se réclament du libéralisme ou du socialisme : distorsions
sociales profondes entre une élite et la masse appauvrie, gabegies économiques avec extension de la corruption et pouvoirs coercitifs alors même
que le modèle d'administration importé ne peut fonctionner parfaitement
sans débat démocratique.
Par rapport à cette situation deux solutions sont en discussion: la solution libérale et la déconnexion.
La première solution est celle de l'ajustement structurel. Elle connaît en
ce moment un regain d'intérêt dans la théorie économique et politique.
Ainsi, les travaux de Guy Sorman sont de ce point de vue édifiants(15).
L'auteur, à l'issue d'une longue enquête de trois ans dans dix-huit pays du
Tiers-Monde sur les cinq continents, dresse un bilan sévère des résultats
économiques enregistrés par la plupart des PVD tout au long de ce dernier
quart de siècle.
Il s'emploie notamment à montrer que, contrairement aux idées reçues,
l'échec du développement dans le Tiers-Monde est dû, non pas au soidisant cc pillage organisé par les firmes multinationales et l'impérialisme ",
mais plutôt et essentiellement aux mauvaises stratégies et politiques de
développement internes appliquées par des gouvernements ce irresponsables " et obnubilés par le mythe de l'Etat entrepreneur et omnipotent,
modèles qui ont conduit à l'avènement de ce la politique de pauvreté de
masse ".
Apparaît alors, les causes de l'échec des politiques agricoles dans la
plupart des PVD (surtout en Afrique) qui tiennent, entre autres éléments:
- aux politiques de prix agricoles irréalistes qui découragent la production locale au profit des importations alimentaires;
- à l'inefficacité des structures parapubliques d'encadrement du
monde rural et de gestion du programme agricole;
- à un ensemble de facteurs exogènes défavorables: écologie, climat.
Quant au modèle industriel, ses faibles performances résident notamment dans:
-l'inefficacité de la politique de
ce
protection éducative" qui, contraire-
ment aux objectifs recherchés, a plutôt créé des rentes de situation préjudiciables à la concurrence, à la modernisation, à l'investissement, à l'Etat
(fiscalité) et à l'ensemble de la collectivité (consommateurs) ;
- l'insuffisance du développement des ressources humaines (formation appropriée, éducation, santé...) qui ne permet pas d'améliorer substantiellement les gains de productivité et de rendre le travail plus efficace.
(15) Guy Sorman, La Nouvelle Richesse des Nations, Edit. Fayard, 1987, 334 p.
Voir du même auteur: La solution libérale, Edit Fayard, 1984, 285 p. où il s'adresse à
tous les libéraux de toutes les formations politiques.
89
De manière générale, les partisans du libéralisme soulignent, après la
Banque Mondiale et le FMI,que les prix dans les pays africains ne reflètent
pas les raretés relatives des facteurs et des biens. C'est le cas notamment
du prix sur le marché des biens dont la formation est faussée par les interventions multiples de l'Etat, du salaire qui ne reflète pas l'excès d'offre de
main-d'œuvre sur la demande, des taux d'intérêts réels négatifs qui empêchent la formation d'une épargne indispensable et des taux de change
découlant de monnaies surévaluées qui encouragent les importations et
rendent peu compétitives les exportations.
Enfin, G. Sorman souligne l'importance du secteur informel dont le
dynamisme permet de tempérer les contre-performances économiques et
les soubresauts sociaux qui auraient dû en découler.
Logiquement, il en déduit avec un argument justifié par le relatif succès
du modèle Sud-Est asiatique (Corée du Sud, Taïwan, Hong-Kong et
Singapour) que la seule voie de sortie de l'ornière du « maI-développement .. pour le reste du Tiers-Monde demeure: la solution libérale,
nouvelle source d'enrichissement matériel et donc de développement des
nations pauvres.
Cette analyse contient beaucoup d'idées discutables qui autorisent de
douter sur la pertinence des recommandations pour une solution libérale
qui, comme une baguette magique serait la clef de tous les problèmes. En
effet, concernant par exemple la détérioration des termes de l'échange
(surtout pour les produits agricoles exportés par les PVD), malgré les
dénégations à savoir que les prix relatifs sont favorables aux produits
manufacturés des pays développés parce qu'ils incorporent à travers le
temps, un surcroît de progrès technique qui améliore la qualité et les
performances.
S'agissant de la politique de « protection éducative .. en matière
d'industrialisation, l'auteur la rejette systématiquement parce qu'il pose mal
le problème.
En effet, ce n'est pas l'esprit de la mesure qui est en cause (car la
« protection éducative .. représente simplement un moyen permettant de
porter les industries naissantes à maturité avant de les livrer à la concurrence), mais plutôt la manière dont elle a été appliquée et surtout la
mauvaise compréhension qu'en ont eue les industriels bénéficiaires. Il faut
simplement objecter ici à G. Sorman en citant l'exemple des ordinateurs
brésiliens qu'il a lui-même choisi à titre d'illustration, que le développement
industriel extraordinaire du Japon s'est au départ fondé sur cette
démarche.
Pour ce qui est des recommandations pressantes faites au reste des
PVD de suivre l'exemple des NPI (nouveaux pays industriels) comme les «
quatre sœurs d'Asie du Sud-Est ", il convient de remarquer que ce modèle
de développement fondé sur la conquête des marchés extérieurs n'a été
rendu possible dans les années 1960 que grâce à un environnement international favorable (marchés extérieurs porteurs, faible coût de l'énergie,
capitaux moins chers, relative stabilité monétaire internationale, faible
90
protectionnisme ...). De plus, ce résuhat a exigé un coût social si important
(57 heures hebdomadaires de travail à Taïwan et 66 heures en Corée du
Sud) que seuls des régimes dictatoriaux pouvaient facilement imposer. Ce
qui est plus difficilement acceptable dans des environnements démocratiques.
La recette libérale ne semble avoir réellement bénéficié qu'à quelques
pays d'Asie du Sud-Est dont il faut étudier avec minutie et scrupule le
processus historique d'édification de ce système. Tous les miracles hâtivement décrétés ont tourné en désillusion avec un cas pathologique: le Chili
des cc Chicago boys" qui ont réussi a installer un processus cumulatif de
récession à partir de 1981 avec une chute du PNB de 15,7 % (en 1982),
une diminution du pouvoir d'achat par tête d'habitant, une baisse des
salaires minimaux de 50 %, et un chômage affectant un tiers de la population.
Face à l'échec de certaines politiques libérales de recentrage, et eu
égard à la nature de l'actuelle division internationale du travail, une
seconde alternative est proposée par Sarmir Amin: la déconnexion.
La théorie de la déconnexion est aujourd'hui très connue. Elle est la
conclusion de l'analyse de S. Amin qui estime que cc si l'éclatement du
système mondial est la seule issue à l'impasse du monde contemporain, le
modèle de la transition à l'abolition des classes se présenterait comme
celui de la cc transition de l'Antiquité au féodalisme ", plutôt que comme
celui de la transition au capitalisme, qui a été un modèle de cc révolution ".
La déconnexion serait alors la condition d'une réponse populaire à l'intervention des superpuissances et de l'impérialisme qui cherchent à modifier
l'évolution en fonction de leurs objectifs propres. Elle serait le seul moyen
de recréer un espace d'autonomie propre à libérer le dynamisme des
conflits sociaux fondamentaux .. ( 16). L'auteur estime alors que cette
rupture avec l'économie mondiale relève d'une stratégie introduisant une
réorientation des modes de production, des priorités du développement, de
l'accumulation et des modes de consommation.
Cette théorie est discutable au plan de ses fondements comme à celui
de sa réalisation pratique. Sans rentrer dans une évaluation critique qui
nous amènerait à une incursion sur les analyses vastes et profondes de
Samir Amin, nous pouvons faire deux observations: la première est théorique et la seconde relève de la pratique. Il est théoriquement inconcevable
de considérer une déconnexion sans préciser les options de système, la
politique à mettre en place, la nature des classes sociales qui entreprennent la rupture et les structures institutionnelles de réalisation et de gestion
de l'ordre social. Si ces préalables ne sont pas réglés très clairement, la
déconnexion devient cc une véritable coquille creuse ". Sur le plan pratique,
la théorie de la déconnexion ne nous dit jamais comment les petits pays
comme ceux d'Afrique de l'Ouest (Gambie, Cap-Vert, Guinée Bissao,
(16) Samir Amin, La déconnexion, Edit. La Découverte, 1986. - Crise, socialisme et
nationalisme, in .. La crise, quelle crise? ", Edit. F. Maspéro, 1982, p. 164-239.
91
Mauritanie) confrontés à des handicaps naturels presque infranchissables
(étroitesse des marchés, absence de capitaux et bases technologiques
réduites) peuvent organiser une sortie, en isolement du système mondial.
Egalement, il n'est pas précisé les coûts économiques, financiers et
sociaux à supporter - et encore moins qui les supportera - du fait de
l'impossibilité d'une auto-suffisance dans les domaines agricole, industriel
et technologique. Enfin, les résultats de la tentative du Kamputchéa démocratique d'établir de 1975 à 1979 une déconnexion radicale ne militent pas
en faveur d'une rupture brutale avec la DIT. Elle s'est achevée par une
dictature extrêmement sanguinaire qui a liquidé plus du tiers de la population en quelques années et a imposé la famine et la misère à des millions
de Cambodgiens. Dans ce pays l'expérience de déconnexion n'a produit
que ruine et désolation.
Gunder Frank dans cette direction observe que cc le modèle d'une
déconnexion sans révolution socialiste préalable a échoué en grande
partie, avant même que les pressions croissantes des années récentes ne
jouent dans le sens de la reconnexion y compris pour les pays socialistes.
L'optimisme de Samir Amin sur la possibilité d'une déconnexion et de
l'autonomie semble donc peu réaliste .. (17).
Les intellectuels africains doivent être beaucoup plus imaginatifs et
comprendre que face aux problèmes inédits et complexes auxquels leurs
peuples sont confrontés, ils devront être leur propre maître et trouver de
nouvelles directions d'une pensée novatrice indépendante et féconde en
vue de formuler de nouvelles théories - au triple plan économique, politique et idéologique - pouvant aider l'élaboration de programmes alternatifs à la fois réalistes et cohérents.
En dehors des solutions radicales - libérale ou de déconnexion - il
existe un modèle alternatif capable de relancer l'économie à partir d'une
modification des politiques sectorielles (dans le sens d'une meilleure
exploitation des potentialités nationales,de l'instauration de nouvelles
règles en mesure de mobiliser tous les acteurs du développement en libérant leurs initiatives créatrices) et de mettre en place des structures institutionnelles plus appropriées aux réalités économiques et sociales locales
car c'est surtout à ce niveau que l'on peut le mieux appréhender tous les
problèmes qui se posent.
C'est en fixant les axes de ce modèle alternatif qu'il faudra analyser la
nature et l'ampleur des relations avec l'extérieur, plus précisément l'apport
du reste du monde au développement. Cela d'autant plus que les
Gouvernements, les Elites africaines et les spécialistes perçoivent les PAS
comme des politiques imposées et appliquées avec très peu de conviction.
Egalement, ils comprennent à l'expérience, que ces politiques manquent
encore d'efficacité. Dès lors, ils les appliquent moins par certitude que pour
simplement pouvoir bénéficier des ressources indispensables à leur survie.
Sous ce rapport, le plan de Lagos est un excellent point de départ dans
l'élaboration d'une autre stratégie de développement économique et social.
Après avoir constaté la dégradation économique et financière de l'Afrique
92
et observé les impasses des modèles de développement, il avait avancé
les thèses d'un développement endogène et autocentré au service des
besoins essentiels donc des consommations de développement. Il s'agit
alors d'analyser:
- au plan interne, les nouvelles approches de développement économique et social qui s'imposent au double niveau théorique et pratique;
- au plan externe, les propositions pour résoudre les problèmes de
l'endettement.
CHAPITRE III - LA SOLUTION INTERNE: LE CHANGEMENT DE
MODELE DE DEVELOPPEMENT ET D'ACCUMULATION
De nouvelles approches en matière de développement économique et
social s'imposent au double plan théorique et pratique. Le point de départ
obligé est la remise en question des théories économiques et sociales
ayant servi de support aux politiques économiques qui ont abouti au maldéveloppement de pays qui ne survivent désormais que grâce à la générosité et à la bonne volonté internationales. Le moment est, sans doute, venu
de couper avec l'intégrisme des PAS et les crispations autour des questions de l'équilibre financier à court terme qui occultent les vrais problèmes
du développement économique. La problématique véritable se situe dans
les changements à opérer au niveau de l'appareil de production, des
échanges et de l'organisation économique et sociale dans son ensemble.
L'élaboration du modèle de développement endogène et autocentré
appelle la détermination d'un certain nombre de priorités et la redéfinition
des politiques sectorielles avec de nouvelles options. Parallèlement, des
actions doivent être menées sur le plan international pour appuyer et
compléter les réformes internes. En effet, avec la crise actuelle de la
pensée du développement et en l'absence d'un paradigne convaincant, il
faut s'en tenir à des idées simples et cohérents.
a) Les prém Ices pour un développement endogène et autocentré
1) L'aspect Institutionnel:
Il est fondamental et constitue la première base sur laquelle doit
s'appuyer tout modèle de développement qui se veut réellement efficace et
démocratique.
A la suite du théorème de LAFFER affirmant que cc trop d'impôts tuent
l'impôt ", il est déduit que cc trop d'Etat tue l'Etat .. et qu'en conséquence, il
faut cc moins d'Etat et mieux d'Etat ". Dans la situation présente de crise
économique, de restructuration, de relance de la croissance et d'insertion
93
dans le système mondial par valorisation des crénaux porteurs. l'Etat
devient un instrument indispensable de régulation des politiques économiques et financières, de coordination des activités et d'organisation de
l'espace. Cependant, l'aggravation du déficit des finances publiques, l'accroissement de la dette extérieure et les mesures d'austérité et de rigueur
des programmes d'ajustement structurel perturbent les capacités de
gestion de l'Etat et menacent sa fonctionnalité économique et sociale.
Une réforme s'impose pour redonner autorité et confiance à l'instrument étatique, pour restaurer sa crédibilité et l'équité de ses différentes
procédures. Il faut alors créer un nouveau management public qui réalise
une parfaite compatibilité entre trois logiques spécifiques celle de
l'Administration, celle des Opérateurs économiques et celles de la Société
civile.
A ce niveau, la première grande réforme qu'il importe urgemment
d'entreprendre afin de redonner l'initiative aux populations et assurer ainsi
leur participation active et consciente à la construction nationale concerne
le redimensionnement de l'Etat sur un mode non administratif.
La restructuration de l'Etat dans la perspective de la mise en place d'un
cc Etat modeste .. passe par la redéfinition du rôle de celui-ci dans la nation
et son recentrage progressif sur ses activités traditionnelles que sont la
défense, la sécurité publique, l'éducation, la santé et la justice auxquelles il
faut ajouter un rôle nouveau d'impulsion et de coordination de l'activité
économique nationale. Cette réforme n'est donc pas synonyme d'un
désengagement précipité de la puissance publique dont la mission régulatrice est fortement indispensable surtout dans cette phase de restructuration économique qui impose une nouvelle donne économique avec de
nouvelles politiques sectorielles et une modification profonde des structures et des conditions de production. Dans ce domaine, il importe d'entreprendre un train de réformes devant aboutir à :
- un Etat dynamique parce que devenu souple dans ses interventions
et animé par un personnel administratif compétent, motivé et opérationnel;
- un Etat efficace car rationalisant tous ses choix et recherchant pour
un coût d'intervention minimum, la meilleure performance ou de façon
duale, la charge minimale possible pour un rendement donné;
- un Etat de plus en plus démocratique dans ses mécanismes de
promotion et dans la mise en place de structures de dialogue et de concertation avec tous ceux qui ont la charge de le faire fonctionner;
- un Etat de moins en moins parasitaire pour les finances publiques et
surtout moins paralysant pour l'activité économique car devenu moins
bureaucratique.
Quand à la réforme administrative, elle découle de la nécessité de
décongestionner l'Etat et devrait articuler à la fois une plus grande responsabilisation des communauté de base, le transfert de l'initiative du pouvoir
à la périphérie sans affaiblissement de l'unité et de la solidarité nationales.
94
Il faut aujourd'hui approfondir cet acquis que la démocratie ne soit plus
confisquée ni par l'élite urbaine numériquement minoritaire, ni par les
professionnels de la représentation populaire, mais par le peuple lui-même.
De la sorte, on débarrassera la démocratie de ses connotations jacobines par une revalorisation des pouvoirs locaux par le transfert de
certaines compétences et de moyens appropriés pour leur exercice réel.
Ainsi les droits des minorités, leurs différences ainsi que leurs identités
culturelles seront mieux préservées.
Cette décentralisation administrative doit s'accompagner de son
pendant économique dont elle favorisera du reste l'émergence, ce qui
devrait contribuer à fixer les populations dans leur terroir, équilibrer le
processus du développement sur le plan régional et limiter l'intervention de
l'Etat principalement et prioritairement aux impulsions et coordinations de
tout ce mouvement.
Le deuxième grand volet de la réforme institutionnelle devrait se
rapporter, dans la mouvance démocratique actuelle sur le continent, à la
mise en place d'institutions politiques et judiciaires plus adaptées au
contexte culturel et social africain et qui garantissent, du point de vue de
leur conception, les sacro-saints principes d'indépendance et d'équilibre
des pouvoirs. On remarquera ici que la force des démocraties occidentales
réside d'abord dans la mise en place et le renforcement d'un solide pouvoir
judiciaire d'arbitrage actionné par des juristes compétents, éclairés, véritablement indépendants et disposant de suffisamment d'autorité et de prérogatives étendues pour faire respecter la légalité sous toutes ses formes?
Dès lors, la consolidation de la démocratie en Afrique passera par l'instaurationn d'une magistrature indépendante vis à vis des autres pouvoirs. A
défaut, un réaménagement important des institutions politiques et judiciaires actuellement existantes doit être entrepris dans le sens du renforcement des principes sus-énoncés.
Il faut cependant reconnaître toute la complexité de cette nouvelle
démarche ainsi que celle des données en cause: la dynamique sociale,
l'anthropologie politique, le rôle de l'Etat moderne africain dans la perspective du développement au regard des véritables racines de cet appareil de
conception et de culture étrangères, etc...
Néanmoins cette nouvelle approche semble plus apte à éclairer la
problématique de la stratégie de développement à la base en tant qu'une
des alternatives à la crise africaine.
2) Les fondements d'une nouvelle logique d'accumulation productive
La crise du système étatique et de ses dépendances que connaît le
continent se révèle avant tout comme la résultante de la grave crise économique et financière subséquente à l'adoption d'un modèle inopérant qui a
amené un processus d'absorption des surplus à des fins non productives.
En effet, le reste du surplus généré, après le laminage du système des prix
95
internationaux, est improductivement utilisé dans des consommations
somptuaires, des investissements publics coûteux et impertinents et dans
l'entretien des populations urbaines qui forment la base sociale des
régimes politiques.
Par conséquent, la rupture fondamentale qu'il convient d'opérer sur le
plan économique, au regard de l'environnement international actuel,
concerne le changement progressif, quels qu'en soient par ailleurs les
coûts politiques et sociaux à court terme, d'un tel modèle d'accumulation. A
la place, il faudra envisager de substituer un modèle de développement
national et populaire (parce que justement démocratique) basé sur la satisfaction prioritaire des besoins essentiels des populations (nourriture, logement, santé, éducation ... ). Une telle modification de la stratégie de
développement en vue d'une totale implication et d'une large participation
des populations passe par la reformulation des politiques sectorielles, la
valorisation de l'initiative privée, une nouvelle politique de revenu, la modification des rapports villes/campagnes, enfin la rationalisation et la démocratisation de la consommation.
La reformulation des politiques sectorielles se conçoit aisément
puisque devant prendre en considération les mutations en cours sur l'échiquier international à savoir:
- l'épuisement des bases internes de la croissance (rente agricole et
minière) du fait de la saturation des marchés internationaux, la montée
fulgurante de substituts performants et l'évolution rapide des techniques de
production;
- le regain de protectionnisme dans les pays développés confrontés à
un chômage considérable croissant, ce qui sacrifie l'industrie manufacturière africaine (textiles, cuirs et peaux ...) fragile et peu compétitive;
- la réorientation des flux de capitaux au détriment de l'Afrique du fait
des bouleversements politiques récents survenus en Europe de l'Est et du
regain de dynamisme économique de l'Amérique Latine et de l'Asie du
Sud-Est.
Quant à la valorisation de l'initiative privée, elle découle de l'option
fondamentale d'Etat modeste, redimensionné et moins interventionniste,
mais également de "avènement du darwinisme économique. Elle doit
accompagner et soutenir la modification des politiques sectorielles, ellesmêmes résultant du changement du modèle d'accumulation et de la prise
en compte des mutations actuelles de l'économie mondiale.
Ce train de réformes doit intégrer une nouvelle politique de répartition
qui, dorénavant, rattache davantage le revenu au mérite, à la compétence
et à l'efficacité. En effet, les trop fortes inégalités de revenu, la formation
rapide de colossales fortunes sur la base de la corruption et des détournements de deniers publics sont des facteurs de blocage des progrès de la
démocratie. Car les hommes, s'ils sont égaux sur le plan politique, risquent
de ne point l'être au niveau économique et social. Cela pose incidemment
le problème de la sécurité sociale sans rapport avec le rendement réel de
96
certaines catégories socio-professionnelles semble constituer une prime à
l'immobilisme et aux comportements léthargiques.
Il faut aussi modifier les rapports entre la ville et la campagne subséquemment à la définition d'une nouvelle politique de répartition qui privilégie le producteur rural et sauvegarde ses intérêts, au besoin, au
détriment des consommateurs urbains. C'est la seule manière véritable
d'inverser les flux de l'exode rural, de relancer la production agricole et
d'arrêter l'urbanisation actuellement rapide, anarchique et chaotique en
Afrique.
Parallèlement, il importe de rationaliser et de démocratiser la consommation en cassant la logique du modèle basé sur la privilégiation des biens
de consommation importés. Ce qui suppose une réorientation effective de
la politique de développement qui mette l'accent sur la satisfaction prioritaire des besoins de base dont le contenu en importation est minime, favorisant ainsi la densification du tissu productif interne et la consolidation de
l'économie nationale.
Cette nouvelle politique économique, pour se réaliser, implique l'élaboration et la mise en œuvre d'une nouvelle politique sociale qui prenne les
allures d'une véritable cogérance sociale nationale basée sur la concertation, le dialogue, le consensus, en somme un véritable partenariat qui
rompe d'avec des schémas sociaux figés, fondés sur des conceptions
étroites,archaïques et surannées de luttes de classes.
C'est à ce niveau que la démocratie occidentale doit être améliorée car
elle ne comporte pas de dimension sociale et ignore superbement dans sa
mise en œuvre comme dans son fonctionnement les criantes inégalités
économiques. Si en Afrique, les expériences démocratiques en cours ne
prennent pas en charge les indispensables transformations sociales, elles
risquent de s'enfermer dans des caricatures de liberté et d'être condamnées à demeurer étrangères aux populations et surtout à une marginalisation des masses urbaines et rurales. En conséquence, elles resteront
fragiles et vulnérables tant qu'elles n'intégreront pas la dimension sociale
aggravée par le déséquilibre démographique et urbain. Au rythme actuel
de croissance des villes (entre 6 et 9 %) plus de 50 % des populations
vivent déjà dans des agglomérations bidonvillisées précaires, gangrenées
et explosives. Contrairement à l'Europe où l'industrialisation a pratiquement absorbé l'armée de réserve, dans les villes d'Afrique les populations
s'entassent et vivent de débrouille, de petits métiers, de délinquances et de
prostitution. Ce phénomène est selon le mot de Henri Rouillé d'Orfeuil cc un
cancer, le cancer d'une société qui a perdu le pouvoir de se réguler, de
gérer sa force de travail et son espace .. mais aussi et surtout la capacité
d'élaborer des politiques économiques efficientes. Car l'exode rural est le
produit des politiques agraires catastrophiques. Dès lors, les agglomérations urbaines, où les besoins sociaux sont immenses et insatisfaits du fait
(18) Ensemble d'auteurs, Science économique et développement endogène, UNESCO,
Paris, 1986, 271 p.
97
des déséquilibres des finances publiques, concentrent tous les manques et
les frustrations et peuvent exploser à la suite de n'importe quelle étincelle.
Pour faire aboutir le train de réformes économiques, politiques et institutionnelles et survivre dans la jungle économique d'aujourd'hui, les Etats
africains devront élaborer des chartes sociales nationales basées sur les
principes directeurs ci-après:
- une confiance réciproque entre le Patronat, les Syndicats et les
Pouvoirs publics;
- un plus grand réalisme de part et d'autre ;
- une volonté farouche de l'entreprise (patron et employé) d'amélioration continue des gains de productivité;
- une sécurité sociale consensuelle, variable et modulable en fonction
des spécificités du secteur d'activité et des vicissitudes de l'environnement
de l'unité de production.
C'est une manière de repenser les anciennes formes de syndicalisme
trop défensif qui formulent plus de refus que de propositions. Avec de telles
orientations, les syndicats participeraient mieux à l'amélioration de la capacité concurrentielle de l'entreprise, ce qui obligerait tous les partenaires à
un effort de réorganisation du travail et de répartition plus équitable des
surplus. Par ailleurs, dans un tel contexte, les travailleurs disposeront
d'espaces grandissants de libertés collectives et pourront alors jouer des
rôles plus déterminants dans la vie sociale.
Les politiques de croissance économique, là ou elles ont réussi à
élever le niveau des forces productives matérielles, se sont toujours
accompagnées de distorsions sociales comme l'accentuation des inégalités, la destruction de l'environnement physique et parfois humain, le
détournement du potentiel productif au profit d'une minorité tout en laissant
insatisfaits les besoins essentiels. Il en va ainsi parce que les finalités de la
croissance sont souvent obscures et ne visent pas clairement une diminution ou un recul de la famine et de la misère. Théoriquement d'ailleurs, le
processus est entraîné par le volume de la consommation ostentatoire des
minorités fortunées.
Dans ce contexte, l'indicateur de mesure des performances du système
économique est situé dans les éléments constitutifs du modèle de consommation des minorités privilégiées par les mécanismes de formation et de
répartition inégalitaires des revenus. Tout se passe alors comme si les
normes d'appréciation de la société résidaient plus dans l'enrichissement
des couches privilégiées que dans la misère qu'elle produit. L'accélération
de la pauvreté de masse, l'extension de l'aire de la misère sont des coûts
trop lourds qui peuvent et doivent être évités par une réorientation du
système productif.
L'approche du développement par les besoins est actuellement
présentée comme l'alternative aux politiques de croissance, aux finalités
imprécises et aux conséquences sociales lourdes et explosives. Si le développement signifie un processus progressif de satisfaction des besoins
98
humains, un partage équitable des fruits du travail, il faut soumettre la
production des biens et services, la technologie et la recherche dans les
différents secteurs, l'utilisation des ressources matérielles et financières à
l'objectif central de satisfaction des besoins. Ceux-ci vont de ce fait revêtir
une importance capitale au double plan des stratégie et des mécanismes
du développement économique et social.
Au niveau de la stratégie, la nouvelle approche du développement doit
organiser le processus productif interne, le modèle de consommation, les
formes de répartition et de gestion des ressources pour atteindre avec le
maximum d'efficience l'objectif de satisfaction des besoins.
Quant à l'approche du développement par les besoins elle implique que
soient repensés en conséquence les mécanismes et leviers économiques.
Les formes de régulation interne, les politiques fiscales, budgétaires,
monétaires de même que les relations avec l'extérieur sont à structurer
compte tenu des nouvelles orientations.
La recherche économique découvre aujourd'hui l'intérêt de cette
nouvelle approche des besoins de base ou encore des consommations de
développement qui permettent de conserver à l'intérieur du pays la plus
grande part du surplus. Le développement selon A. Debernis consiste
fondamentalement à élever le niveau de satisfaction des besoins de
chaque groupe social dans l'ordre et la hiérarchie de ces besoins et à
construire une base autonome d'accumulation. Dans ce sens Mc Namara,
président de la Banque mondiale déclarait que cc les gouvernements des
pays en voie de développement devraient se préoccuper davantage des
besoins humains essentiels. Cette stratégie appelle l'adoption de nouvelles
politiques et le redéploiement des ressources .. (19). Cette stratégie
présente au moins trois avantages:
- elle permet d'abord d'établir un ordre de priorités, des objectifscibles qui intéressent la population, donc l'attention du système productif
est portée vers le bas;
- elle permet ensuite de transcender les tendances à la compartimentalisation ;
- elle établit enfin un programme précis de développement prospectif.
Ainsi donc, le développement économique s'identifie au développement
de l'homme et à la lutte contre la pauvreté pour une autre utilisation et
répartition des ressources provenant des efforts productifs de la société
tout entière.
La littérature récente, par des polémiques multiples et multiformes,
tente de définir le contenu et la composition du concept de besoin(20). Au
(19) Mc Namara, Discours prononcé devant le Conseil des Gouvernements. Dans la
même ligne de pensée observe que" ceux qui pendant des siècles ont vécu dans la pauvreté
et dans le relatif isolement de leur village, finissent par s'accommoder de celte existence ... Ils
l'acceptent ". Cela confirme la boutade" dites-moi combien de misères matérielle et spirituelle vous avez, je vous dirai quel genre de société vous avez ".
(20) Ensemble d'auteurs, /1 faut manger pour vivre... controverses sur les besoins fondamentaux et le développement, PUF, Paris, 1980,324 p.
99
niveau du contenu, tout normalement, le concept recouvre à la fois la nourriture, l'habitat, la santé et l'éducation - c'est-à-dire des éléments dont la
possession est indispensable à l'épanouissement de l'homme. Bien sûr,
une société peut accorder la priorité à tel ou tel bien compte tenu des
carences, ou de son potentiel productif ou même de l'état de ses forces
productives. Ainsi, les pays sahéliens, depuis la grande sécheresse de
1973, ont donné la priorité à l'autosuffisance alimentaire car cette catastrophe a révélé que la crise alimentaire n'était pas seulement celle des
années de sécheresse mais qu'elle était permanente et générale. Elle
affecte la majorité des populations rurales. Pourtant, malgré son ampleur,
les moyens de la résoudre existent. En effet, la profondeur des conséquences de la sécheresse a entraîné des recherches poussées sur
l'ensemble des mécanismes producteurs de misère et de famine. On s'est
alors aperçu que:
- le système productif était extrêmement mal orienté en ce sens que
toutes les ressources matérielles, humaines et financières étaient utilisées
pour l'augmentation des taux de croissance économique;
- la répartition inégalitaire empêche les populations de disposer de
moyens de produire pour elles-mêmes ou d'acheter leur nourriture alors
que les consommations ostentatoires des élites fortunées étaient largement couvertes.
Il s'agit alors d'un détournement des ressources vers des objectifs
autres que la satisfaction des besoins des populations laborieuses. Pour
revenir à de telles orientations, il fallait :
- spécifier l'objectif central d'autosuffisance alimentaire;
- envisager toutes les implications économiques notamment les mutations à opérer au niveau de l'agriculture;
- envisager les transformations des structures socio-économiques et
politiques qui permettent la réalisation de l'objectif-cible.
Que l'approche comporte des limites et des pièges, cela est absolument indéniable. En effet, certaines réflexions ont attiré l'attention sur
quelques problèmes que soulève l'approche du développement par les
besoins fondamentaux, à savoir :
- qu'elle risque de relancer l'individualisme qui est la philosophie
ultime sur laquelle elle repose profondément;
- qu'elle connote le positivisme et le rationalisme, en conséquence,
elle va véhiculer certaines valeurs négatives;
- qu'elle risque d'imposer un style occidental de vie.
Ces problèmes ont certainement une grande portée et doivent être
considérés comme des contraintes possibles par les techniciens du développement qui, dans la détermination des politiques, chercheront à les
dépasser. Ainsi la préservation des formes communautaires de production
100
et d'existence sociale pourra faire obstacle à l'avènement de l'individualisme si tant est que ce phénomène est apprécié comme préjudiciable. Il en
va de même du style de vie européen qu'il ne s'agit pas de rejeter en bloc
d'autant plus que dans les pays sous-développés du Sahel, ceux qui ne
sont pas occidentalisés et qui n'ont aucune prétention de l'être forment la
majorité.
D'autres réflexions mettent l'accent sur le fait que l'approche par les
besoins risque d'occulter la façon dont la misère est produite et d'établir
une liste de prescription de ce qu'il faut faire pour pallier les effets de la
pauvreté. Là encore, dans le cas des pays ouest-africains les mécanismes
de la pauvreté de masse sont théoriquement et pratiquement bien circonscrits et contrairement aux idées émises par J.K. Galbraith, la pauvreté est
la contrepartie naturelle de la prospérité des riches(21). De même, l'élimination de la pauvreté ne saurait se cantonner à des prescriptions réductrices des rigueurs des conditions sociales des pauvres. Elle passe par des
politiques, c'est-à-dire une restructuration de l'ordre économique interne
dans tous les mécanismes générateurs de richesse.
Sur cette base, on peut dire que cette approche est une politique effective de libération car elle permet d'une part, de trouver les voies et moyens
pour garantir à tous les producteurs directs un niveau de vie décent et
d'autre part, de les faire participer effectivement à la répartition du produit
de ('effort collectif.
Cette stratégie autoriserait également:
-l'utilisation des ressources et du génie propre des populations;
- la confiance en sa propre capacité de développement;
- l'adaptation des moyens à l'environnement et aux ressources
locales;
- l'exercice d'un pouvoir interne décentralisé associant les populations
de base à la gestion de leurs propres affaires.
En conséquence, elle devrait permettre non seulement la réalisation
d'un développement économique et social optimal, mais aussi une large
participation populaire car l'individu se sentira directement impliqué et
concerné par les résultats des politiques appliquées. Un tel développement
pourrait être l'affaire des peuples, non des seuls bureaucrates, technocrates et gestionnaires. L'apport de ce personnel par ailleurs indispensable
se situera principalement au niveau technique c'est-à-dire la recherche des
moyens de réalisation d'une parfaite définition et qualification des besoins
ainsi que leur adaptation à la production.
Le développement endogène devra s'organiser en vue de la satisfaction des besoins fondamentaux de nourriture, d'habitat, de santé et
d'éducation. Pour ces éléments qui forment les consommations de développement, ce n'est pas réellement la pénurie des ressources (si insuffisantes qu'elles soient) qui explique la misère dans le Tiers-Monde, mais
(21) J.K. Galbraith, Théorie de la pauvreté de masse, Edit. Gallimard, Paris, 1980, 164 p.
101
plutôt leur distribution inégale, aggravée par l'imitation inconsidérée des
modèles de consommation des sociétés industrialisées. Ainsi le développement apparaîtra comme une totalité structurée qui intègre à la fois
plusieurs dimensions: sociale, culturelle, écologique, institutionnelle, administrative que l'économie uniformisera en prenant appui sur l'intégralité des
forces internes.
Le modèle de développement ainsi défini va alors reposer sur les
prémices suivants:
1) une modification progressive et modulée des relations avec la division internationale du travail, et une, réorientation du processus productif
interne vers la satisfaction des besoins fondamentaux de nourriture, de
santé, d'éducation et de logement;
2) une recherche systématique de la diversification de la production
agricole pour briser la monoproduction d'une spéculation destinée au
marché mondial;
3) la construction d'un système économique polyvalent, réellement
complémentaire qui s'appuie sur le développement prioritaire d'une agriculture fondamentalement transformée;
4) un choix technologique approprié par rapport aux structures économiques internes;
5) une prise en considération de l'environnement, et des cadres de vie
des hommes et de la société en général;
6) une intervention modulée de l'Etat pour coordonner les forces et
facteurs du développement, compenser toutes les infériorités relatives,
apporter les modifications structurelles opportunes et mobiliser tous les
acteurs du développement.
Une telle stratégie de développement endogène sera nécessairement
populaire car selon l'observation de Samir Amin « le développement extraverti dans toutes les phases de l'évolution du système bénéficie effectivement aux classes dominantes privilégiées qui se constituent en alliances
avec les monopoles. Inversement et complémentairement, un développement populaire ne peut être que national et autocentré »(22).
Toutes les articulations des politiques économiques doivent partir de
ces prémices et orientations qui servent d'infrastructure théorique. Ainsi la
croissance économique n'apparaîtra plus comme une fin en soi mais un
moyen qui se réaliserait par:
- une répartition des ressources financières et matérielles rationnelle
et conforme aux objectifs assignés aux divers secteurs;
- une gestion adéquate des ressources en devises et de tous les
facteurs de production rares;
(22) Samir Amin, L'impérialisme et le développement inégal, Edit. de Minuit, Paris, 1976,
193 p. Voir également du même auteur L'avenir du maoïsme, Edit. de Minuit, première partie
concernant. les trois modèles de développement n, p. 7-37.
102
- une priorité absolue à ('agriculture pour un approvisionnement vivrier
régulier et une bonne couverture des besoins alimentaires des villes.
Le développement endogène se déroulant dans un environnement
instable et souvent hostile impose beaucoup de rigueur dans la gestion des
ressources naturelles ainsi que dans leur allocation qui doit être impérativement optimale.
b) La réorganisation des politiques sectorielles
Il s'agit essentiellement de redéfinir d'autres politiques sectorielles qui
cadrent mieux avec les nouvelles préoccupations du développement
économique et social.
1) Au niveau de l'agriculture
L'agriculture est un secteur considéré dans tous les Etats comme prioritaire et décisif pour le développement économique et social. Or, abandonnée à elle-même, elle reproduit sa crise permanente (archaïsme des
rapports sociaux de production, faible croissance de la production et de la
productivité, dégradation des conditions d'existence et de travail des
producteurs, etc.) qui fait finalement de l'Afrique un continent vulnérable
aux pressions alimentaires. C'est cela qui explique les propos sévères de
René Dumont qui observe que" l'Afrique tropicale qui se suffisait en 1958
et importait 2 millions de tonnes de céréales en fait venir 13 ou 14 millions
en 1980. Ce qui n'empêche ni les famines spectaculaires du Sahel. .. , ni la
sous-alimentation chronique ... Agriculture déficitaire, économie ruinée, les
pays d'Afrique tropicale sont en faillite. En faillite donc en mendicité:
désormais, ils ne mangent et encore pas tous que s'ils tendent respectueusement la main .. (23). Il faut alors en toute urgence redéfinir une nouvelle
stratégie de développement agricole visant la réalisation de trois objectifs
que voici:
- l'autosuffisance alimentaire et la couverture des besoins vivriers en
augmentation rapide du fait de l'accroissement démographique et de
('accélération de l'urbanisation;
- l'accroissement des surplus pour nourrir les fonds d'accumulation
productive en vue du financement du développement;
- la croissance de la productivité du travail par actif rural et par
hectare cultivé, ce qui permettrait la libération d'une partie de la maind'œuvre pour d'autres secteurs.
Pour atteindre de tels objectifs il s'avère indispensable de réhabiliter
l'agriculture, de procéder à sa réorganisation systématique et à la réalloca(23) René Dumont, Impérialisme français et sous-développement africain, Petite
Collection F. Maspéro, p. 30.
103
tion des moyens matériels et financiers. Il s'agira alors de mettre en place
une toute autre stratégie de développement agricole qui fasse jouer au
secteur son rôle de principal foyer d'accumulation. Cette stratégie devrait
s'articuler autour de six propositions:
a) Une autre orientation de l'agriculture au double niveau des productions et de la réhabilitation des structures paysannes
La politique agraire doit développer en priorité les cultures vivrières
pour couvrir les besoins des larges masses parallèlement remettre en
cause les structures de production, les conditions de travail et le statut
même du paysan. En réalité, l'option en faveur des cultures de rente et des
activités exportatrices est la cause principale de la crise agro-alimentaire
dont la moindre des conséquences est certainement le déficit vivrier qui
absorbe une bonne part des devises.
b) L'organisation sur des bases claires et non bureaucratiques de la
coopération agricole
L'objet sera principalement de résoudre toutes les contradictions et
déséquilibres découlant des rapports sociaux dans les campagnes. En
effet, les sociétés rurales africaines sont profondément cc communaucratiques .. et solidaires. Elles s'accommodent difficilement aux formes salariales d'essence capitaliste. C'est pourquoi la coopération demeure le
mode d'organisation paysanne le plus approprié.
Cette coopération éloignée des modèles bureaucratiques obéit à quatre
principes:
- l'instauration des conditions d'une gestion démocratique de toutes
les coopératives, ce qui peut éviter le conflit avec les hiérarchies traditionnelles;
- la garantie permanante d'une adhésion libre;
- la mise en place et le respect strict de mécanismes clairs de formation et de répartition des revenus;
- le passage du simple au complexe dans les formes d'organisation et
ceci conformément aux différents contextes locaux.
c) La réalisation programmée d'une Infrastructure de base nécessaire
à l'expansion et à la diversification de la production agricole
Pour des pays où l'agriculture dépend très fortement des aléas climatiques, il faut briser au plus vite cette dépendance grâce à une politique
hydraulique adéquate qui passe par la réalisation de travaux d'irrigation.
104
Des évaluations précises doivent être faites des coûts et avantages
respectifs de la grande et de la petite irrigation et sur cette base, élaborer
et appliquer une politique cohérente et programmée de maîtrise de "eau
pour réduire les effets des calamités naturelles.
d) Une planification du perfectionnement des techniques, agricoles et
de l'utilisation généralisée des facteurs modernes de production agricole
Il est communément admis que l'intensification de la production agricole appelle la mise en place d'une politique technologique appropriée et
relativement complète qui exploite à la fois les savoirs-faire locaux et les
nouvelles technologies de la troisième révolution industrielle. Celles-ci sont
très économes en énergie grâce à un double progrès: la bioconversion et
la microbiologie. Cela est très important quand on sait que la révolution
verte était basée sur un modèle à consommation énergétique élevée. Par
ailleurs, ces nouvelles technologies sont plus productives du fait de l'utilisation de la mécanisation et du recours à la télédétection qui permet une
meilleure connaissance des sols et des climats et un choix plus approprié
des cultures.
La politique technologique devrait alors comprendre:
- la modernisation des procédés de culture et la rénovation permanente des instruments de travail;
- l'expérimentation scientifique, la diffusion et la vulgarisation de
nouvelle techniques;
- la formation de cadres hautement qualifiés de conception et
d'exécution, mais aussi le recyclage et la formation sur le tas de paysans
modèles.
Il faut observer que ce sont les paysans eux-mêmes qui devront être
les principaux artisans de la révolution technique de l'agriculture et non
point ces lourdes bureaucraties paternalistes, inefficaces et coûteuses
entretenues pour apporter et imposer sans préalable et du dehors des
modifications structurelles ou technologiques.
e) Une politique adéquate de crédit agricole
Une politique de crédit est d'une urgente nécessité pour le financement
des exploitations agricoles dont les besoins en capitaux tendent à
s'accroître. L'organisation du crédit doit procéder à la fois des acteurs du
développement agricole et de l'Etat. En plus, elle doit être structurée à telle
enseigne qu'elle permette aux petits agriculteurs surtout d'échapper aux
excès des usuriers. Son efficacité commande qu'elle règle les problèmes
d'encadrement des taux d'intérêt, de la durée des prêts, des rythmes de
remboursement et des garanties.
105
Faut-il sérieusement regretter que l'on ne soit revenu, nulle part sur les
structures bancaires d'économie de traite et de renforcement des distorsions structurelles caractéristiques du sous-développement ? La restructuration indispensable de l'économie rurale ainsi que la modernisation des
campagnes imposent de développer des marchés financiers ruraux en
parfaite harmonie avec le système bancaire national et les autres institutions financières.
f) Une politique de prix suffisamment Incitatrice pour les grands
produits agricoles
La désaffection des agriculteurs pour certaines productions s'explique
par l'absence d'une politique cohérente de commercialisation. Le fait, par
exemple, que les prix au producteur de certaines céréales varient moins
que proportionnellement à ceux de l'inflation courante, a entrainé une stagnation de la production. Le paysan cultive, tout logiquement ce qui lui est
nécessaire pour sa survie et celle de sa famille. Une politique incitatrice
s'impose. Elle permettrait d'accroître les revenus des producteurs ainsi que
leur degré d'indépendance et de sécurité. Les paysans démunis et pauvres
ne seront jamais en mesure d'opérer les révolutions et les mutations indipensables du milieu rural.
En définitive, la réhabilitation de l'agriculture par auto-promotion
paysanne passe fondamentalement par une amélioration des revenus qui
met les producteurs dans les conditions matérielles adéquates pour
instaurer des politiques d'autosuffisance alimentaire, améliorer la productivité du travail et des autres facteurs de production et accumuler pour
l'autofinancement. Cette politique de revenu doit s'accompagner systématiquement du développement d'une part des moyens de stockage pour la
constitution d'un stock régulateur et de sécurité alimentaire et d'autre part
une réorganisation des circuits de distribution et de commercialisation
souvent monopolisés par les usuriers et spéculateurs de toutes sortes.
Des efforts extrêmement importants devraient être consentis en direction de la modification du modèle de consommation extraverti. L'agriculture
pour se développer doit impérativement conquérir les marchés urbains par
une politique cohérente de promotion du cc consommer national .. et de
contrôle des importations de biens alimentaires.
Cette politique agraire dans la stratégie nationale de développement
est seule à même de produire une révolution agricole. C'est-à-dire l'introduction de mutations structurelles et comportementales qui garantissent
une croissance irréversible et régulière de la production et de la productivité.
Cependant, la capacité et la profondeur des réformes agricoles dépendent aussi d'une politique industrielle appropriée et cohérente. D'énormes
efforts financiers doivent être consentis. Au niveau de l'Afrique, une étude
106
de la FAO établit que pour atteindre l'autosuffisance alimentaire, il faut
investir environ 10,5 milliards de dollars pour la seule période 1985-1990.
Ce montant n'incluait pas les investissements dans les services de soutien
à "agriculture tels que la commercialisation, les transports, la recherche et
la formation de la main-d'œuvre.
2) Au niveau de l'Industrie
Il importe de prendre une autre orientation et de mettre en place une
structure industrielle cohérente dans laquelle les usines ne seront pas des
îlots faiblement articulés au reste de l'économie, mais des unités d'un
ensemble intégré d'activités. L'agriculture sera la base de cette stratégie.
En effet, elle peut animer trois catégories d'activités industrielles:
- celles permettant l'aménagement des barrages et autres infrastructures concemant l'irrigation;
- celles en amont pour la production des intrants et équipements agricoles;
- celles en aval pour la valorisation intégrale des produits de l'agriculture.
Les unités ainsi créées devront permettre le développement accéléré
de l'agriculture avec une haute efficience au niveau sous-régional grâce à
la réalisation des conditions véritables d'une révolution verte avec
semences sélectionnées, pesticides, produits phytosanitaires et un réseau
rationnel d'irrigation. Dans une telle organisation, l'industrie sera la fille de
l'agriculture. Cependant, cela ne sera pas sans poser des problèmes liés
notamment:
- au fait que l'utilisation systématique des facteurs modernes de
production peut ne point intéresser certaines cultures ou formes d'exploitation qui resteront alors en marge du processus de modernisation;
- à la faiblesse des revenus paysans ou à leur inégale répartition qui
peut être une limite importante à la généralisation de l'emploi des intrants
(la modernisation risquant de créer une différenciation sociale avec un
processus de « koulakisation ») ;
- au fait que la demande externe peut continuer d'exercer d'importantes fonctions locomotives. En effet, les agro-industries risquent d'être
bloquées par l'étroitesse des marchés internes ; il leur faut alors trouver
des débouchés externes en expansion pour assurer leur croissance.
En somme, cette stratégie de développement intégrée de "agriculture
et de l'industrie est la seule à même de conduire à l'indépendance économique et à l'autosuffisance alimentaire. L'indépendance économique est
recherchée pour :
- une plus grande maîtrise du système productif au niveau, des décisions techniques et productives;
107
- une maîtrise et un contrôle du modèle et des comportements de
consommation;
- le contrôle des surplus qui se forment et leur emploi interne plus
conforme aux besoins de la majorité de la population.
Quant à l'autosuffisance, elle concernera principalement les produits
alimentaires mais aussi les biens manufacturés de consommation et
d'équipement. Dans l'optique d'une lutte contre le sous-développement,
ces deux objectifs d'indépendance économique et d'autosuffisance ne sont
pas synonymes d'autarcie ou de rupture brutale avec la division internationale du travail. Il ne s'agit pas en effet d'un rejet absolu et sans discernement de toute théorie des avantages comparatifs. Il faut même les exploiter
au maximum au double niveau de la disposition de devises et du transfert
de technologie.
Cette stratégie doit procéder d'abord d'une volonté réelle de promouvoir un développement endogène et autocentré à partir d'un secteur agricole dynamique et d'un tissu industriel fonctionnant pour satisfaire les
besoins fondamentaux ainsi que la demande de biens de consommation
intermédiaires des autres secteurs de l'activité économique. Cette stratégie
doit appeler ensuite une gestion étatique rigoureuse qui doit veiller à ne
point installer une bureaucratie lourde, coûteuse, inefficace et paternaliste
tendant à se structurer dans la représentation officielle en une technocratie
prétentieuse qui méprise la couche sociale pour laquelle elle devrait
travailler.
Cette gestion étatique doit enfin éviter l'exercice, par la puissance
publique, de fonctions économiques exorbitantes qui pourrait anesthésier
l'initiative créatrice des acteurs économiques et entraîner un gaspillage de
ressources rares.
A ce niveau il faut préciser que ces derniers temps, avec la généralisation des politiques d'ajustement et du crédo libéral, on a eu des mots durs
pour l'Etat dont la faillite présumée devrait imposer d'impératives corrections de trajectoire. Dans cette ligne de pensée, on a redécouvert les
formules suggestives de Poujade : moins d'Etat et mieux d'Etat pour
traduire les nouvelles préoccupations de désengagement progressif de
l'Etat de la vie économique. On accumule partout des indices et des faits
pour établir la crise d'efficacité de l'Etat. Dans la foulée, on accuse le
secteur public et parapublic de perturber les lois harmonieuses du marché,
de bloquer la concurrence stimulante et de stériliser l'innovation et les
initiatives créatrices des individus (24).
Toutefois, ces questions sur le rôle de l'Etat dans le développement
sont trop importantes au double plan théorique et pratique pour être résolues par de simples métaphores et analogies. L'anti-étatisme affiché est en
porte-à-faux avec les réalités contemporaines qui placent l'Etat au rang
d'agent de la régulation et de l'accumulation. Partout l'Etat développe les
(24) Moustapha Kassé, L'Etat et le Secteur public, CREA, 1985, 305 p.
108
conditions de la mise en valeur du capital et met en place des politiques de
sorties de crise et de relance économique.Les expériences des Nouveaux
Pays Industrialisés d'Asie et d'Amérique Latine (NPI) mille fois exhumées
et opposées aux pays africains comme des exemples de succès, montrent
que l'Etat a rempli des fonctions économiques et politiques exorbitantes
par le biais d'un secteur public massif et d'une planification permanente.
Cette praxis s'appuie partout sur une philosophie et des dogmes d'un Etat
fort, centralisé et souvent autoritaire à même de réaliser la croissance dans
la stabilité.
Ces constats imposent de dépasser la controverse stérile Etat-Marché
considérés comme deux systèmes antagoniques d'affectation des
ressources et qui prétendument devraient conduire à deux modes opposés
de régulation: le libéralisme (marché) et le socialisme comme un interventionnisme étatique. Dans tous les systèmes sociaux, l'Etat se présente, en
permanence, comme un instrument irremplaçable dans l'organisation et le
fonctionnement d'une Société moderne. Les fonctions qui lui sont imparties
au triple niveau politique, social et idéologique (garant de la paix civile, du
référentiel culturel, du bien-être, etc.) lui confèrent nécessairement des
rôles économiques dont la réalisation n'est nullement incompatible avec
l'existence d'un marché ou d'un plan. Progressivement, on observe des
ruptures dans les fonctions de l'Etat si bien que, même dans les pays
socialistes de forte tradition interventionniste, le plan accomplit les tâches
que le marché ne peut réaliser et inversement.
L'État se doit de coordonner et d'impulser les activités dans les
domaines décisifs où il ne peut nullement gêner l'initiative des opérateurs
économiques nationaux. A chaque fois, l'intervention de l'Etat doit viser
des objectifs précis. Par exemple dans le développement agricole, l'Etat
peut créer des fermes - qui pourraient être des instruments d'appui et
d'aide aux forces productives dans l'agriculture. Toute forme d'expérimentation techno-agronomique pourrait être d'abord réalisée dans ces unités
pour être ensuite généralisée aux autres exploitations privées.
3) Au niveau des relations économiques Internationales
La problématique des relations économiques internationales a été
abordée sous plusieurs éclairages et chaque fois, on aboutit à la conclusion que dans leurs formes actuelles, elles contribuent à la ruine des
formations sous développées par le biais de mécanismes comme
l'échange inégal dont le baromètre réside dans la détérioration des termes
de l'échange. Ainsi, au cours de l'année 1986, l'Afrique a perdu environ
19 milliards de dollars du simple fait de la chute des produits de base.
Dans le même moment, les recettes d'exportation ont diminué de 50
milliards alors que les apports nets de capitaux manifestaient une nette
tendance à la baisse.
109
Les avantages annoncés par les théories néo-classiques ne se sont
pas encore produits dans les pays du Sahel les plus fortement articulés au
marché mondial par le biais des secteurs exportateurs de produits des
monocultures de rente prédominantes. Les relations économiques internationales n'ont pas compensé les infériorités relatives dans les dotations en
facteurs malgré l'existence d'une spécialisation poussée et d'un commerce
sans entraves. De plus, les chances de développement sont inégales et se
distribuent en fonction du poids économique des partenaires.
L'importance et le poids des activités exportatrices, de même que le
volume sans cesse grandissant des importations, commandent l'élaboration d'une stratégie des relations avec l'extérieur dans la double optique
d'une indépendance économique et l'établissement d'un commerce extérieur équilibré.
La première optique conditionne tout et postule que les pays d'Afrique
de l'Ouest doivent se fixer pour objectif la réalisation d'une moindre dépendance économique, ce qui passe par:
- le contrôle des principales ressources nationales. Cela permet d'une
part, de maîtriser le système productif interne notamment les surplus qu'il
crée et d'autre part, de l'orienter dans le sens de la réalisation des objectifs
majeurs;
- la réalisation de l'autosuffisance alimentaire. Ces objectifs sont à
inscrire dans un horizon temporel plus ou moins spécifié avec désignation
des moyens et délais de réalisation.
La seconde optique est liée à la recherche d'un commerce extérieur
équilibré consistant à organiser les rapports avec l'extérieur de sorte que
les exportations couvrent les importations ce qui implique :
- d'abord que l'on établisse le volume et la composition des importations incompressibles et vitales pour le fonctionnement du système interne
des forces productives;
- ensuite que l'on découvre et développe les secteurs exportateurs
susceptibles de procurer des devise nécessaires au financement des
importations. En somme, comme l'observe 1. Sachs, l'objectif en matière de
relations extérieures est cc de maximiser la capacité d'importer du pays par
la promotion des exportations ou de réduire sa dépendance en matière
d'importation : on choisira celle des deux solutions qui tire la meilleure
partie de l'investissement donné .. (25).
Dans tous les cas, les pays dans le cadre d'un développement endogène doivent repréciser, redéfinir la place des relations économiques internationales et les actions qu'il importe de prendre pour tirer les meilleurs
avantages de celles-ci.
(25) 1. Sachs, Pour une économie politique du développement, Edit. Flammarion, 307 p.
110
CHAPITRE IV NATIONAL
LES PROPOSITIONS D'ACTIONS AU NIVEAU INTER-
Deux types d'action pourraient être envisagés et les pouvoirs publics
devraient aider à leur réalisation effective pour mieux appuyer et compléter
les politiques intérieures.
1) A l'échelle Internationale
L'expérience montre qu'il est totalement impossible pour les pays du
Tiers-Monde de devoir à la fois supporter les charges de la dette et poursuivre le processus de croissance comme le laissent supposer les travaux
de Abrarnovic (26). Cet auteur a rendu célèbre l'analyse selon laquelle un
pays désireux de mettre en place, grâce à l'endettement, une structure
productive pouvant lui assurer une croissance satisfaisante doit traverser
trois phases.
La première phase est celle au cours de laquelle "investissement
domestique excède les possibilités d'épargne et l'endettement s'avère
nécessaire non seulement pour financer l'écart entre les deux variables,
mais aussi la charge de la dette. Les intérêts sont payés au moyen
d'emprunts porteurs d'intérêt à leur tour. Il en résulte un processus cumulatif d'endettement. Seulement, l'économie élève sa base productive ainsi
que la propension moyenne à épargner pour l'élimination à terme du
déficit.
La deuxième phase est celle qui voit l'épargne domestique atteindre le
niveau de l'investissement. Sans que cesse le recours à l'endettement
pour le financement de la charge de la dette, bien que sa croissance se
ralentisse. Cependant, l'épargl'le domestique s'élevant toujours, elle
parvient progressivement à combler le volume d'endettement.
La troisième phase est celle au cours de laquelle l'épargne intérieure
est suffisante pour financer l'investissement et le service de la dette.
En prenant alors les exportations comme variable déterminante de la
capacité de financement du servic~ de la dette, Abramovic met en
évidence des hypothès'es d'enclenchement du processus conduisant à la
troisième phase : exportations représentant 10 % du Revenu National et
augmentant au rythme annuel de 4 %, taux marginal d'épargne de 20 %.
Même en acceptant l'analyse dans son fond, les hypothèses sont extrêmement éloignées de la réalité du Tjers-Monde contemporain. D'abord les
exportations régressent en valeur du fait de la détérioration des prix internationaux selon les mécanismes bien connus de l'échange inégal(27).
(26) D. Abramovic, Economie growth and External Debt, J. Hopkins Press', 1964, p. 154192.
(27) Il faut se souvenir de l'analyse d'A. Emmanuel sur l'Echange inégal dont les théories
principales, nous dit l'auteur, sont formulées en termes de salaires: on n'est pas pauvre parce
qu'on vend bon marché: on vend bon marché parce qu'on est pauvre. Donc la seule norme du
prix international découle de la pauvreté des offreurs.
111
Ensuite l'épargne intérieure qui est fonction des faibles revenus provenant
pour l'essentiel des relations économiques et monétaires avec l'extérieur
est à son tour nulle ou de très faible niveau.
Tout cela indique que la dynamique interne de croissance à elle seule
ne réglera pas le problème de l'endettement. La preuve, les grands pays
endettés du Tiers-Monde, après des efforts gigantesques d'ajustement, ont
réussi certes à améliorer l'équilibre de leurs balances de paiement mais au
prix d'un endettement encore plus massif. A l'extrême, on peut dire que les
pays empruntent, non pas pour financer des investissements de relance
économique mais pour éponger leur dette. Il est donc impossible d'envisager que Jes emprunteurs se sortent de la dette par leurs propres efforts
internes.
D'un autre côté, il est impossible d'exiger des banques commerciales
qui détiennent les deux tiers des créances des pays du Tiers-Monde de
supporter un non remboursement. Cela ébranlerait les précaires équilibres
du système financier international et compromettrait les activités productives à l'échelle mondiale.
C'est dire que la solution de la dette passe impérativement par une
négociation globale et multilatérale qui préserve, autant que faire se peut,
les intérêts de toutes les parties concernées. Comme Je souligne H.
Bourguinat, cc il faudra bien concilier les inconciliables et que chaque catégorie prenne à sa charge une partie du fardeau »(28). Du côté des pays
débiteurs, il reviendra aux Etats de s'accorder autour d'une plateforme
techniquement élaborée et institutionnellement souple pour pouvoir
prendre en compte des points comme :
- l'annulation des dettes publiques;
- la consolidation des dettes privées ou la mise en p~ce de mécanismes de consolidation soit des arriérés, soit des paiements futurs;
- l'organisation de rééchelonnements appropriés à la situa~on économico-financière de chaque pays;
- la mise en place de nouveaux mécanismes qui permettent la mebilisation de nouvelles ressources financières.
La Déclaration sur la situation économique en Afrique adoptée par la
21" Session ordinaire de la Conférence des Chefs d'Etat et de
Gouvernement de l'Organisation de l'Unité Africaine (18-20 juillet 1985)
observe que la situation financière de l'Afrique est grave et qu'en 1985, les
pays d'Afrique vont rembourser plus qu'ils n'ont reçu du Fonds Monétaire
International. En conséquence, la Conférence a proposé entre autres:
- la réduction de l'élément cc devise» de la participation des pays aux
projets financés par les institutions financières internationales;
- le transfert massif de ressources financières à des conditions libéraies;
(28) H. Bourguinal, op. cit., p. 189.
112
- le rééchelonnement de la dette extérieure qui doit se faire sur
plusieurs années avec une période de grâce minimum de cinq ans.
Pour ce qui concerne la dette, de nombreuses recommandations sont
faites mais elles constituent pour l'essentiel des variantes des propositions
de la Commission Pearson de 1970 qui étaient les suivantes:
- définir les conditions d'allégement de la dette, de manière à éviter
les réaménagements répétés et fréquents:
- évaluer les besoins éventuels en aide extérieure à des conditions
favorables :
- considérer l'allégement de la dette comme une forme légitime
d'aide:
- assortir l'aide publique au développement de conditions appropriées.
En particulier, le taux d'intérêt ne devrait pas excéder 2% l'an tandis que la
durée des prêts s'étalerait de 25 à 40 ans et comporterait un délai de grâce
de 7 à 10 ans:
- inclure des clauses de dérogation temporaire dans les accords de
prêts, prévoyant sous certaines conditions, des allégements convenus
d'avance (différés de paiement au titre des amortissements et des intérêts,
exceptionnellement renonciation à de tels paiements) ;
- étendre le bénéfice de l'allègement de la dette non seulement aux
situations de crise, mais également à des cas bien précis, afin de maintenir
la capacité d'épargne ou d'importation des pays débiteurs, la consommation par tête d'habitant, de pallier une baisse des exportations ou une
rentabilité insuffisante des investissements, moyennant l'adoption de politiques correctives par les bénéficiaires:
- instituer un cadre multilatéral approprié pour la renégociation de la
dette et la mobilisation de nouveaux apports de capitaux, afin de garantir
un transfert net de ressources aux pays débiteurs, seul mécanisme
susceptible d'assurer un ajustement stable et harmonieux de ces économies:
- mettre en place un dispositif institutionnel pour le rééchelonnement
de la dette, fonctionnant selon des normes et des procédures bien définies,
pour éviter un traitement discriminatoire des pays débiteurs:
- inciter les pays débiteurs à modifier leurs politiques à très court
terme et adopter en leur faveur des modes de règlement plus appropriés à
leur situation financière et à leurs capacités réelles de remboursement.
L'application de ces diverses recommandations aurait à l'évidence
permis à la communauté internationale de réaliser l'économie d'une crise
de la dette des pays en développement. Mais les égoïsmes nationaux ont
prévalu sur la stabilité internationale et l'esprit de coopération mondiale. Il
aura fallu la crise des années 1970 pour faire retrouver les vertus de la
commission Pearson.
113
Lors de l'Assemblée Générale du FMI, en 1985, le trésorier américain
James Baker avait annoncé son plan en trois points:
- les banques commerciales devraient consentir une augmentation de
20 milliards de dollars sur trois ans aux quinze pays sélectionnés parmi les
plus endettés (Argentine, Brésil, Mexique, Venezuela, Pérou, Chili,
Equateur, Colombie, Uruguay, Bolivie, Côte d'Ivoire, Maroc, Nigéria,
Philippines et Yougoslavie) ;
- la Banque Mondiale et les autres banques de développement
devraient procéder elles aussi à une augmentation de 9 milliards de dollars
de leurs engagements;
- les pays bénéficiaires de ces nouveaux prêts devraient procéder à
des réformes économiques dans le sens de la promotion d'une économie
libérale soumise aux lois aveugles du marché.
Ce cc Plan Baker" ne suscita que des réponses décevantes. Les
banques multilatérales de développement ne disposaient pas de
ressources propres suffisantes pour fournir le financement nécessaire. De
même, la plupart des banques commerciales ne souhaitaient pas ouvrir de
nouveaux crédits à des pays déjà aux prises avec de graves difficultés. Au
total, seuls les cc prêts concertés" que les banques s'estimaient forcées de
consentir dans le cadre de mesures de réaménagement visant à éviter des
cessations de paiement, furent accordés.
A la suite de cet échec, le cc Groupe des Sept " réuni au Sommet de
Toronto en juin 1988 adopta un nouvel éventail d'options pour l'allégement
de la dette des pays endettés les plus pauvres, situés pour la plupart en
Afrique. Ces options, qui concernent exclusivement la dette officielle, se
rapportent à :
- la remise d'un tiers des versements de services échus et le rééchelonnement du reste;
- le prolongement des échéances existantes;
- la réduction de taux d'intérêt à des niveaux inférieurs à ceux du
marché.
Il faut dire que les économies que les pays bénéficiaires sont censé
réaliser sur leurs paiements dans le cadre du cc Plan de Toronto» sont insignifiantes (environ 0,7 % chaque année) par rapport à leur dette globale.
De plus, l'éligibilité au bénéfice de cc Toronto .. reste assujettie à la mise en
œuvre par les pays débiteurs de programmes d'ajustement du FMI et de la
Banque Mondiale.
Pour remédier à cette difficulté de la cc Stratégie de Toronto ", certains
pays créanciers ont pris de vigoureuses initiatives individuelles en vue
d'alléger substantiellement la dette des pays à faible revenu. C'est ainsi
que la France, les Etats-Unis, le Canada, la Belgique, la Finlande, la
Norvège, la Suède et la Grande-Bretagne ont converti en dons la plupart
de leurs prêts concessionnels de développement consentis aux pays
114
d'Afrique subsaharienne. Dans ce cadre, la France à elle seule, a annulé
purement et simplement toute les dettes d'aide au développement au profit
de trente-cinq Etats africains et correspondant à un montant de 2,5 milliards de dollars. Il n'empêche! A peine 2 % de la dette totale de l'Afrique
est touchée par ces mesures spectaculaires d'annulation. Il s'y ajoute
comme l'observe Adebayo Adedeji (Secrétaire Exécutif de la CEA) que
cc cet allégement est largement annulé par l'augmentation (externes de
stock) de la dette africaine intervenue au premier semestre de 1989 du
seul fait de la hausse des taux d'intérêt .. (29).
En avril 1989, et face à l'enlisement et l'impasse de la crise de la dette,
le Secrétaire au Trésor des Etats-Unis Nicholas Brady invite les banques:
- à passer aux cc pertes et profits .. une partie de la dette du TiersMonde, à faire profiter les débiteurs de la décote du marché secondaire;
- et à accorder des dérogations temporaires quant aux paiements
d'intérêts et aux remboursements de principal pendant une période
pouvant aller jusqu'à trois ans.
A la différence des plans précédents, le cc plan Brady .. confère au FMI
et à la Banque Mondiale un rôle beaucoup plus plus actif que dans le
passé en matière d'allégement de la dette et consistant à donner aux
banques commerciales des garanties quant aux futurs paiements de
service, de façon à inciter ces dernières à ouvrir de nouveaux financements.
A ce titre, le FMI et la BM promettent de fournir chacun 12 milliards de
dollars pendant les trois prochaines années. Cependant, à peine la moitié
de ce montant constituera un financement additionnel, le reste devant en
réalité provenir de réaffectations.
En outre, le Japon s'est engagé à mobiliser 10 milliards de dollars en
prêts parallèles pour ces opérations d'allégement, ainsi que d'autres fonds
destinés au financement du développement des pays endettés.
Globalement, l'initiative BRADY reprend donc, en les amplifiant, les
procédures et schémas précédents de traitement de la crise de la dette.
L'accent mis sur l'annulation partielle des créances commerciales va
engendrer un sacrifice très lourd pour les banques privées dont plusieurs
vont avoir des difficultés supplémentaires à surmonter. De même, l'implication croissante de financements multilatéraux nécessite un effort accru des
pays riches, c'est-à-dire en dernière instance, de leurs contribuables. Or, la
poursuite de politiques d'ajustement difficiles dans le contexte social et
politique actuel représente un prix trop élevé à payer par les pays surendettés. En théorie donc, le partage du fardeau de la dette devrait être équitable. Mais en pratique, les contraintes de chacune des parties prenantes,
parfois l'absence de volonté politique et surtout les rigueurs d'un environnement économique international fortement instable constituent autant
d'obstacles sur la voie d'un règlement concerté du problème de la dette.
(29) ONU: La dette: Crise pour le Développement, Département de l'Information, mars
1990, p. 41.
115
Le retard de la reprise économique dans les pays industrialisés, la
persistance des désordres monétaires, la poursuite de l'inflation et la détérioration des prix des matières premières montrent que les années qui
viennent seront marquées par un accroissement considérable des besoins
de financement du Tiers-Monde. Cette situation sera encore aggravée par
les déficiences des mécanismes des marchés financiers qui ne paraissent
plus en mesure d'assurer les financements risqués des pays du TiersMonde. Les milieux bancaires avec la montée des risques-pays sont réticents à tout accroissement de leurs engagements. Dans ces conditions, la
question se pose de savoir que faire pour résoudre les besoins financiers
du Tiers-Monde?
Dans tous les cas, les moyens proposés par le Plan Baker sont dérisoires et insignifiants par rapport aux besoins en ressources financières.
Les efforts attendus de la Communauté Internationale sont beaucoup plus
appréciables au double plan quantitatif et qualitatif et ils appellent la mise
en place de mécanismes financiers capables de mobiliser des ressources
importantes. Dans cette direction, il faudrait des interventions massives et
concertées des Etats et des Institutions financières internationales pour
apporter certaines garanties aux prêteurs contre les risques de non
remboursement des emprunteurs et pour la conservation ainsi que la
progression du pouvoir d'achat de leurs placements.
Ces garanties institutionnellement organisées devraient rétablir la
confiance des banques et autres prêteurs.
Cependant, les pays industrialisés de leur côté doivent promouvoir des
politiques économiques de relance qui puissent entraîner une nouvelle
baisse des taux d'intérêt, une expansion du commerce international, un
redressement des prix des matières premières et une plus grande stabilité
des marchés de change. De même, ces pays doivent accepter un déficit
commercial sans lequel il n'y aura d'issue ni à l'endettement ni au développement.
Après la Conférence de Trinité (septembre 1990), les accords conclus
avec la Pologne et l'Egypte (mai 1991) sont, à plus d'un titre exemplaire, et
indiquent la voie à suivre et à élargir à d'autres pays. En effet, le Groupe
des Sept se fondant sur des critères à la fois techniques (proportion trop
élevée de la dette au point de constituer une hypothèque pour la croissance) et politiques (avec la nécessité de soutenir la politique audacieuse
de transformation entreprise par la Pologne et le rôle de premier plan joué
par l'Egypte dans la Guerre du Golfe) avait recommandé une réduction
d'environ 50 % de la valeur nette actualisée de la dette exigible des deux
pays. Ces accords en contradiction avec les pratiques usuelles du Club de
Paris indiquent effectivement les mesures positives à prendre pour alléger
de manière substantielle la dette officielle des pays à revenus intermédiaires.
D'ailleurs, les Africains ne sont pas restés inactifs en matière de
recherches de solution au problème de la dette.
116
Le Plan d'action de Lagos comporte trois propositions fondamentales
en la matière. La première concerne la création d'un Fonds Monétaire
Africain (résolution 254 b) dont l'un des rôles consisterait à aider les pays
membres à mobiliser des prêts sur les marchés internationaux de capitaux
et à garantir ces prêts. La deuxième a trait à l'institution d'un Fonds africain
de garantie mutuelle et de solidarité, chargé de l'intermédiation sur les
marchés internationaux de capitaux (résolution 254 cl. La troisième recommande à la communauté internationale d'accroître son assistance financière et technique aux pays les moins avancés, selon des procédures et
des critères améliorés, tout en procédant à l'annulation de la dette de ces
pays (résolution 275 a).
De nombreuses autres recommandations du Plan d'action de Lagos,
visant à améliorer le financement des pays africains, contribueraient accessoirement à alléger leurs besoins d'endettement. Il s'agit notamment de la
mise en place de systèmes sous-régionaux de compensation et de paiements, regroupés plus tard en une union africaine de paiements, de la
création d'institutions sous-régionales de financement du développement,
de celle de marchés financiers à l'échelle nationale, sous-régionale et
régionale, de l'institution d'une Banque du Commerce Extérieur et d'investissement des pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (résolution
253). Le Plan d'action recommande également un renforcement des
ressources de la Banque Africaine de Développement (résolution 254 a),
une reforme fondamentale du système monétaire international, la mise en
place d'un cadre financier international adéquat pour soutenir les efforts de
développement des pays africains, un accroissement de l'assistance et de
l'aide financières à l'Afrique (résolution 255).
En matière d'énergie, il est proposé au profit des pays africains, l'octroi
de tarifs préférentiels et la création d'une caisse de compensation (résolution 289), de même que l'institution d'un Fonds africain pour le développement de l'énergie (résolution 294). Pour les pays les moins avancés, il est
recommandé l'adoption de mécanismes internationaux de financement de
leurs besoins en pétrole, leur assurant également une réduction des
charges correspondantes et leur garantissant des approvisionnements
réguliers (résolution 175 b).
2) Les améliorations du PAL: la contribution de la BAD
La Banque Africaine de Développement (BAD), lors de la 3 session
extraordinaire de l'OUA (30 novembre 1987) exclusivement consacrée à la
problématique de la dette, a émis, par la voix de son Président, une proposition de solution à la fois réaliste et techniquement bien conçue. L'idée de
base est qu'il faut trouver un mécanisme de refinancement qui soit de loin
préférable aux rééchelonnements qui constituent un engrenage coûteux
8
117
dont aucun pays débiteur ne peut se sortir véritablement. La réalisation de
ce refinancement passe par la reconversion de la dette extérieure en obligations à long terme (20 ans) avec un taux d'intérêt fixe. Dans ce cadre, le
paiement du service de la dette peut être soit négocié et fixé à des niveaux
compatibles avec les priorités et les objectifs de développement des pays
débiteurs. Ces obligations seront gérées par un Fonds d'Amortissement
qui jouera le rôle d'un organe d'encaissement des versements des pays
débiteurs émetteurs des obligations et de décaissement en faveur des
créanciers. Il devra alors générer des ressources propres lui permettant
d'apurer, à la fin de l'échéance, la dette du pays.
C'est pourquoi il établira un taux d'intérêt acceptable par toutes les
parties concernées. Enfin, le Fonds sera administré par un Comité de
gestion comprenant des représentants des pays créanciers et des pays
débiteurs ainsi que des membres de la communauté financière internationale. Il aura pour compétence d'abord l'évaluation des performances
économiques et financières réalisées par les pays endettés en vue de
proposer des mesures d'ajustement et ensuite la recherche et la mobilisation des ressources additionnelles pour les pays ayant de pressants
besoins financiers.
Egalement, la Session spéciale des Nations Unies (New-York 21-27
mars 86) consacrée au redressement et à l'endettement de l'Afrique SubSaharienne a élaboré une série de recommandations pertinentes à la
communauté internationale. Elles consistent à :
- l'acceptation du programme prioritaire qui s'articule autour de la
mise en œuvre accélérée du Plan de Lagos, l'amélioration de la situation
alimentaire et la réhabilitation de "agriculture, l'allégement du fardeau de la
dette, l'élaboration d'une plate-forme d'action commune aux niveaux sous
régional, régional et continental;
- l'amélioration des structures et du cadre de la coopération en particulier par la stabilisation des prix des produits de base, l'instauration de
prix rémunérateurs, l'abandon des politiques protectionnistes et de celles
qui sont défavorables aux exportations africaines;
-l'allégement du fardeau de la dette par une conversion de cette dette
en dons et en prêts remboursables à très long terme (40 ans) ; le réaménagement de la dette commerciale avec un abaissement des taux d'intérêt;
- la promotion et l'appui au secteur privé et à l'entreprise africaine.
La réalisation de ce plan de redressement qui relancerait le développement et la croissance, nécessite un financement annuel de 33 milliards de
dollars dont les 16 milliards serviraient à couvrir le service de la dette africaine.
On s'aperçoit que les idées originales ne manquent pas mais elles se
heurtent toujours au refus obstiné des pays créanciers et des institutions
financières internationales, donc de la communauté internationale.
118
3) Solution régionale: l'action essentielle doit être la concertation
pour l'Instauration d'une division régionale du travail
La restructuration de l'économie mondiale s'opère au moment où le
Continent Africain est confronté à une crise économique et financière d'une
rare profondeur qui va le marginaliser davantage pour en faire la périphérie
du Monde.
La Division Internationale du Travail met progressivement en place de
nouvelles modalités de fonctionnement. Les systèmes productifs nationaux
se réorganisent et se préparent, dans la perspective d'un monde multipolaire, à affronter les rudes batailles de l'économie mondiale caractérisée
par une compétition féroce qui ne donnera aucune chance aux faibles.
Face à ce darwinisme économique, l'Afrique devra s'intégrer ou périr. Ce
problème est maintenant parfaitement bien compris même si les solutions
d'intégration, en place depuis au moins deux décennies, ont produit de très
médiocres résultats.
Des initiatives neuves et d'une grande envergure doivent être prises
pour avancer résolument dans la voie de l'unité politique et économique de
la sous-région. En effet, il est aujourd'hui largement prouvé qu'aucun des
Etats africains, quelles que soient sa taille, ses ressources naturelles et sa
population ne constitue, en isolement, un cadre viable de développement
économique et social. Alors quelle sous-région ? En Afrique, l'intégration
doit être conçue comme des cc poupées de gigognes » dont l'ensemble
constitue une entité mais dont chacune prise individuellement représente
l'image réduite de l'entité décomposée. Il faut, en conséquence, définir un
espace sous-régional réalisable et efficient et lui affecter des responsabilités économiques, financières et politiques. Seulement, les schémas
d'intégration qui ont été appliqués en Afrique de l'Ouest, depuis la fin des
années soixante se sont avérés complètement inaptes à jeter les bases
d'une véritable économie sous-régionale. Les raisons tiennent à la fois à la
mauvaise qualité des modèles d'intégration qui ne rendent pas convergents les politiques économiques et sociales nationales, à l'inexistence de
mécanismes fiables de correction des inégalités et de partage des avantages, à l'absence d'une volonté politique effective devant se matérialiser
par un abandon réel de souveraineté.
Au niveau politique, le fédéralisme et le confédéralisme doivent être
relancés à la lumière des expériences historiques accumulées (Union
Ghana-Guinée, Fédération du Mali, Union Ghana-Guinée-Mali, Conseil de
l'Entente, Confédération sénégambienne, etc.). Cela devrait passer par la
création de formations politiques à dimension sous-régionale et la constitution d'un Parlement supranational où les membres seront répartis non par
nationalité mais par appartenance à des familles politiques (libéraux,
sociaux-démocrates, travaillistes, marxistes de toute chapelle, nationalistes, etc.).
119
Toutes ces structures supranationales prendraient en charge la
défense des intérêts de la sous-région et de ses différentes institutions et
pourraient soutenir et consolider les processus d'intégration.
Au plan économique, la tâche principale est de doter la sous-région
d'une stratégie communautaire de développement dans laquelle les Etats
renoncent à leur souveraineté en faveur de la Communauté dans les
secteurs agricole, industriel et tertiaire.
Ainsi, l'intégration se présenterait comme la seule forme qui permettrait
de briser les cadres étroits des nations ouest-africaines. La stratégie pour
un développement accéléré passerait, d'abord par l'élaboration d'une politique économique concertée établissant une Division Régionale du Travail
(DRT) articulée sur la création de pôles de développement diffusant des
effets d'entraînement sur les économies nationales, ensuite par une
spécialisation intersectorielle qui accorde la préférence aux activités
productives correspondant aux dotations factorielles naturelles des Etats et
enfin par une mise en place d'un système monétaire et de crédit au service
du financement du développement régional.
Ce processus intégrateur fera sauter les goulots d'étranglement constitués par l'espace étroit, la faiblesse des capitaux et des technologies et
autoriserait des politiques économiques optimales et efficientes(30).
L'autonomie collective qui est un besoin économique devient possible.
Dès lors, on peut avancer que l'intégration, quelle que soit sa forme, se
présente comme un processus dont la finalité est d'offrir aux Etats et aux
divers acteurs un espace qui permette de bénéficier des économies
d'échelle ainsi que d'une plus grande efficience en matière de production
et d'échange. Certaines tâches de développement auxquelles les pays ne
pouvaient faire face en isolement du fait de leurs handicaps naturels
deviennent réalisables. La mise en mouvement de ce processus d'intégration passe par:
- la création d'un ordre communautaire qui s'appuie sur une division
régionale du travail;
- la création d'un système monétaire régional qui oriente et réglemente les politiques monétaires et financières.
La création d'un ordre communautaire en Afrique de l'Ouest pourrait
avoir une double incidence: aider à l'organisation d'une autonomie collective pour le développement, offrir une alternative crédible au développement misérable de la périphérie et aux mécanismes de reproduction du
sous-développement.
L'ordre communautaire restructuré devrait déboucher sur:
- une uniformisation tendancielle des processus nationaux de production en partant de la création d'unités économiques communautaires dans
les secteurs vitaux pour les économies nationales;
(30) Moustapha Kassé, Le Développement par /'Intégration, Edit. NEAS, Dakar, 1991,
250 p.
120
- une uniformisation des rapports monétaires et financiers et de crédit
mettant progressivement en place les conditions d'une politique monétaire
communautaire;
- une uniformisation tendancielle des politiques économiques nationales pour la réalisation des objectifs du développement économique et la
résolution des contraintes et tensions sociales internes.
Un tel ordre pourrait alors se présenter schématiquement comme suit:
Uniformisation des
processus
r
r---~------.
Div[ston Régionale
1
d; prOductiol"-,1
l
Marché Régional
1
,...---------,
Commerce Extér[eur L
l""'"
du Travail
1
I...-
!
Système Monétaire
Région31
I~
Politiques Economiques
des Etats
----!.
La Division Régionale du Travail (DRT) devrait s'organiser autour de
trois axes:
- l'établissement d'un programme sous-régional sur la double base
des dotations factorielles naturelles et des impératifs de développement
accéléré des pays;
- la spécialisation des divers secteurs notamment industriels;
- le développement des investissements communs et de la coproduction.
Sur le premier axe, la DRT partirait de l'établissement d'un vaste
programme comportant des tâches à réaliser à court, moyen et long
termes. Il s'agit de fixer des priorités dans l'espace et dans le temps à
partir d'une négociation générale portant sur la répartition et la spécialisation des activités économiques.
L'établissement de ces priorités devrait tenir compte de deux impératifs
souvent contradictoires : la rationalité générale du développement sousrégional et les intérêts individuels des Etats.
Le second axe concerne la spécialisation. Il s'agit principalement
d'élaborer un modèle de spécialisation industrielle permettant de réaliser
des filières de valorisation de production agricole et minière et des économies d'échelle. Sur ce point on peut partir des industries existantes, bien
121
que certains auteurs estiment que leur existence doit être considérée
comme un phénomène néfaste et désintégrateur. A notre sens, ce fait ne
constitue point un handicap majeur et insurmontable car les capacités
industrielles actuellement installées restent bien en deçà des besoins
nationaux.
Le troisième axe se rapporte au développement des investissements
communs et à la coproduction. On peut partir de l'idée que l'investissement
commun est un placement en commun de fonds et peut en conséquence
s'effectuer sous des formes différentes: en moyens financiers, en équipements ou en nature. Il peut avoir plusieurs objets comme:
- la réalisation d'infrastructures en matière de communication et télécommunication reliant les pays entre eux, de grands travaux d'aménagement des bassins des fleuves, l'édification de barrages hydro-électriques;
- le développement d'une coproduction (de biens matériels. ou de
services) pour l'exploitation de certaines activités productives avantageuses pour les économies nationales.
Dans l'organisation de cette DRT, les politiques économiques des Etats
pourraient bénéficier des avantages liés aux économies d'échelle et à la
spécialisation. De même, elles permettraient, à partir des interdépendances techniques et des liaisons par les produits et les revenus, un élargissement et une expansion du marché. En fait, si la co-entreprise est une
coproduction, chaque pays devrait apporter en plus des moyens, un
marché actuel et potentiel. Cependant, de par le monde, les processus
d'intégration révèlent que l'infrastructure de transport de communication et
de télécommunication a exercé des fonctions motrices en créant un
espace interconnecté condition première de la libre circulation des biens,
des capitaux et des personnes. Ce problème est prioritaire en Afrique de
l'Ouest et doit recevoir un traitement choc par la mise en place et l'exécution d'un programme sectoriel intégré et réalisable dans les meilleurs
délais.
Qu'en est-il maintenant des rapports monétaires, financiers et de
crédit?
Les aspects monétaires des politiques économiques en Afrique de
l'Ouest ont été souvent occultés et traités dans des optiques technocratiques et d'orthodoxie de gestion financière dans laquelle la monnaie apparaît plus comme un fétiche que comme un instrument de développement.
Les experts recommandent toujours aux Etats des comportements frileux
vis-à-vis de la monnaie, une auto-défense permanente contre l'inflation et
toute sorte de déséqui~bre financier. Il importe alors de mettre un accent
particulier sur ces questions afin, d'une part, de dégager avec le maximum
de clarté, les politiques monétaires, et d'autre part, d'indiquer les lignes
directrices de création d'un ordre monétaire régional.
Les mécanismes monétaires. comme le rappelle R Nurske ne sont pas
créés pour eux-mêmes, ce sont des instruments destinés à faciliter la
122
production et les échanges. En conséquence, la monnaie doit refléter les
mécanismes productifs et s'y conformer.
Dans un processus d'intégration qui restructure le procès de production, la monnaie doit être au service des politiques économiques poursuivies et remplir alors deux fonctions : le financement des opérations
économiques communautaires et la facilitation des échanges multilatéraux
en conférant aux divers usagers l'utilisation d'un espace plus étendu pour
les transactions réelles et financières et une plus grande certitude pour ces
mêmes transactions.
La création d'un système monétaire en Afrique de l'Ouest devrait
présenter certains avantages par:
- l'organisation d'une zone de stabilité dans un ordre monétaire et
financier précaire et instable ;
- le changement du contexte de lutte contre la persistance de l'inflation, la variation erratique des taux d'intérêt et de l'endettement;
- l'instauration progressive d'une coopération monétaire et financière.
Dans le cadre de l'Afrique de l'Ouest comprenant plusieurs monnaies
et une pluralité de zones monétaires, la mise en place d'un système monétaire régional passe par :
- l'établissement d'un système de changes et l'organisation de règles
de stabilité qui permettront de définir une unité de monnaie composite dont
la valeur serait établie par un panier de toutes les monnaies des pays
membres;
- l'établissement et l'organisation de règles de convertibilité qui
permettent aux monnaies de se soutenir mutuellement par la mise en
œuvre de mécanismes de crédits réciproques;
- la mise en place d'un système de création monétaire et d'un Fonds
Monétaire Régional qui recevrait en dépôt les réserves de change des
pays membres et leur fournirait la monnaie régionale en contrepartie.
Il importe pour avancer dans cette direction de vaincre les préjugés
solidement établis pour mettre en place un système monétaire et financier
et pour organiser ses connexions. C'est de la sorte que l'on pourrait:
- promouvoir l'utilisation des monnaies des pays membres dans les
transactions commerciales;
- permettre une utilisation efficiente et optimale des réserves extérieures;
- stimuler la coopération et les consultations monétaires entre pays;
- prendre en charge collectivement les problèmes de l'endettement.
C'est dire que les pays ont tout à gagner à la construction immédiate
d'un SMR même s'il est bien connu qu'il n'est pas dans la nature de la
monnaie de régler tous les problèmes. Face aux restructurations du
système économique mondial et aux difficultés monétaires et budgétaires
123
grandissantes en Afrique de l'Ouest, le moment est venu de mettre en
place ce système monétaire Ouest-Africain qui participerait à la création
d'un espace de stabilité et d'autodéfense monétaire, de financement du
programme économique, de correction des déséquilibres macrofinanciers ;
et, en définitive, d'instauration d'une véritable politique monétaire. En attendant d'y arriver, la coopération, en ce domaine, revêt une grande urgence.
Elle passe par des paiements courants libres d'un pays à un autre, des
parités monétaires régionalement définies et réglementées, "harmonisation
des législations bancaires et la co-production de produits et d'instruments
bancaires et financiers.
En définitive, l'intégration ne se pose pas impérativement en termes
d'abolition des frontières nationales mais d'élargissement de la
Communauté d'intérêts. Quels pourraient être alors les domaines de réalisation de l'intégration ?
Le secteur le plus immédiatement concerné est l'agriculture. En la
matière, l'intégration doit viser principalement la promotion d'une agriculture capable de satisfaire les besoins alimentaires en expansion rapide et
d'accroître quantitativement et qualitativement les excédents.
La politique agraire communautaire pourrait s'articuler autour de la
création:
1) D'entreprises régionales de gestion de la politique hydraulique. Ces
unités doivent aider, par le contrôle de l'eau, à accroître les surfaces irriguées ce qui permet de lutter contre les effets néfastes de la sécheresse et
de diversifier la production agricole.
2) D'unités de production, de commercialisation et de distribution des
facteurs modernes de production agricole.
Ces facteurs constituent des consommations intermédiaires nécessaires pour l'intensification de l'agriculture et l'accroissement des rendements.
En Afrique, les Pouvoirs publics entreprennent la réforme des agricultures par la mise en place de PASA (Programme d'Ajustement du Secteur
Agricole) portant, d'une part sur la privatisation de la production, des mécanismes de financement et de la distribution, et d'autre part sur un ensemble
de mesures destinées à accroître la sensibilité des producteurs aux incitations économiques. Ces politiques doivent être intégrées et harmonisées
pour faciliter:
- la création d'un marché agricole sous-régional par la suppression
des taxes intérieures, l'harmonisation des protections et l'amélioration des
moyens de transport ;
- et la concertation sur les principales filières d'exportation destinées
aux marchés internationaux par la réduction des coûts, l'atténuation des
fluctuations des prix, l'amélioration de la productivité et la promotion de
techniques modernes de commercialisation.
124
Cependant, il convient de préciser que la politique régionale n'est pas
le substitut mais le complément indispensable des politiques agraires
nationales qui doivent fixer:
- la place de l'agriculture dans le développement économique et
social;
- la structure d'encadrement et de gestion de l'agriculture;
- les objectifs à attendre et les moyens à mobiliser;
- la politique des prix rémunérateurs et incitateurs.
L'industrie est un secteur qui devrait être structuré autrement dans le
processus intégrateur.
Les dotations et aptitudes naturelles de la région permettent d'entrevoir
au moins quatre unités communautaires en matière industrielle. Il s'agit:
-
de
de
de
de
la sidérurgie autour de l'exploitation du fer et du cuivre;
la bauxite ;
la construction navale;
l'industrie nucléaire à des fins non militaires.
Ces unités constitueront des pôles de développement qui s'organiseraient en vue d'une mise en valeur intégrale des principales ressources
minières disponibles au niveau des Etats.
L'énergie est devenue une variable stratégique, un paramètre essentiel
des politiques de développement économique et social. La crise pétrolière
a montré d'une part la trop grande dépendance de la plupart des pays
d'Afrique de l'Ouest vis-à-vis de leurs fournisseurs et d'autre part l'absence
de politique cohérente.
Il importe alors d'élaborer et de gérer un plan communautaire en
matière énergétique qui s'articulerait autour de la création:
1) d'une Agence Communautaire de l'Énergie.
Celle-ci pourrait prendre en gestion les coûteuses et lourdes prospections, former des cadres techniques et animer toutes les autres unités
intervenant dans le secteur.
2) d'une unité de raffinage;
3) d'une unité de distribution et de stockage.
Toutes ces initiatives seront parachevées par la mise sur pied d'une
Caisse Communautaire de Péréquation et de Stabilisation qui aurait pour
mission d'élaborer des politiques de compensation des intériorités relatives
et de prix.
La deuxième composante de la politique énergétique concernerait
l'énergie renouvelable qui devrait être développée par une double action
de régionalisation de la recherche et de la production.
La réalisation de l'intégration passe aussi par le secteur tertiaire. Il faut
insister particulièrement sur le tourisme dont les incidences socio-écono125
miques sont très importantes et les investissements particulièrement
lourds. La politiques communautaire présenterait un triple avantage:
-
de centralisation des ressources financières;
de développement d'un tourisme intra-régional ;
de promotion d'une carte touristique relativement diversifiée.
Sur cette base. on pourrait envisager de créer les unités communautaires suivantes :
-
un Office communautaire de développement touristique;
une Agence régionale de voyages et de promotion touristique.
Ce programme économique, techniquement mis en forme dans un Plan
Sous-Régional qui définirait les objectifs à réaliser, les moyens à mobiliser,
les délais de réalisation et les différentes articulations avec les Plans nationaux, devrait être pris en charge par une communauté Rénovée des Etats
d'Afrique de l'Ouest. Ce lie-ci serait dirigée par une Haute Autorité dotée de
fonctions exécutives et de compétences suffisamment larges pour réaliser
une meilleure exécution de l'ensemble de la politique économique et financière sous-régionale.
Une Assemblée Parlementaire, devrait être mise en place et exercer un
contrôle démocratique sur les activités politiques, économiques et sociales
assumées par toutes les institutions d'intégration. Toutes ces structures
économiques et politiques devront être complétées par la création d'une
Cour de justice chargée de régler les éventuels différends inter-étatiques.
Au demeurant, le succès de ce processus d'intégration dépend d'abord
de l'existence d'une volonté politique inébranlable mais aussi de l'application scrupuleuse des décisions, des accords et des programmes de la
Communauté. Il est vrai que l'émergence d'une figure politique charismatique de dimension régionale ou d'un Etat organisé pouvant jouer le rôle de
locomotive peuvent contribuer à l'accélération du mouvement d'intégration.
La cadence sera fonction de la qualité des schémas unitaires et de l'adhésion des populations.
126
Conclusion générale
Au fil de cette réflexion, il nous est apparu que l'endettement de plus en
plus massif de l'Afrique de l'Ouest et du Continent prend des allures inquiétantes et soulève des questions sur son processus de formation, ses incidences et enfin ses perspectives de solution. La plupart des pays sont
dans une crise latente d'insolvabilité ou en cessation de paiement à un
moment où leurs besoins en ressources financières deviennent énormes
pour relancer la croissance par l'investissement productif. Cette situation
critique est évoquée dans toutes les rencontres internationales sans
qu'une solution véritable et satisfaisante, pour tous les acteurs, soit
trouvée. Les actes sont encore bien en deçà des intentions affirmées.
Tout au long des pages de cette recherche, nous avons été habité par
une double interrogation à savoir;
1) Comment la dette en Afrique de l'Ouest s'est-elle aussi rapidement
massifiée?
2) Quelles sont les solutions à cette crise?
Sur la première question, nos analyses révèlent que plusieurs facteurs
très importants ont contribué à des degrés différents à l'accumulation d'une
dette qui hypothèque aujourd'hui très lourdement le développement des
pays du tiers-monde et d'Afrique de l'Ouest en particulier à telle enseigne
que le Continent se trouve dans l'incapacité d'assurer à la fois son développement et le paiement de sa dette. Manifestement, si des facteurs
variés comme le double déficit de la balance des paiements et des
finances publiques, les chocs pétroliers, les achats d'armes, la fuite des
capitaux, les intérêts de la dette, sont à la base de l'accroissement de
l'endettement, ils nous permettent de formuler trois observations importantes dans la recherche de solutions décisives à la crise actuelle :
127
- La première observation concerne l'existence d'une co-responsabilité des créanciers et des débiteurs dans l'envolée de l'endettement. Tous
les acteurs de la dette ont chacun une part, plus ou moins grande responsabilité, dans la formation et la progression de celle-ci.
D'abord, la responsabilité la plus lourde est, certainement, celle des
pays débiteurs qui ont appliqué des modèles de développement et conduit
de façon inconséquente la gestion de leur développement avec des choix
d'investissement impertinents qui sont à la base de l'utilisation inefficiente
des capitaux empruntés. Ensuite, les Gouvernements des pays créanciers
assument aussi une grande responsabilité dans la mesure où ils ont
poussé leurs opérateurs économiques, comme les banques privées, à
prendre des engagements, sur certains pays, souvent sur la base de
critères plus politiques qu'économiques. Enfin, les banques commerciales
ont commis de graves imprudences et des fautes d'appréciations des
risques en se lançant dans des politiques laxistes de prêts. Même les organismes multilatéraux ne sont pas en reste avec les politiques souples et
ajustables de mobilisation de leurs ressources.
De ce point de vue, Lionel Stoleru dans son excellent ouvrage
cc L'Ambition internationale" raconte l'histoire du mari dont le sommeil
agité et perturbé par une dette lourde le fait tourner et retourner dans le lit
au point de finir par réveiller sa femme. Celle-ci lui demande ce qui lui
arrive, et il répond : cc Tu sais bien que je dois rembourser demain matin
100 000 francs à notre voisin M. Dupont, et que je n'en ai pas le premier
sou! " La femme se lève alors, ouvre la fenêtre en grand et crie à tue-tête:
cc Monsieur Dupont! Mon mari n'a pas un sou pour vous rembourser
demain matin! " après quoi, elle referme la fenêtre, se remet au lit et dit à
son mari: cc Allons! Tu peux dormir. Maintenant c'est lui qui ne dort plus. "
La responsabilité collective de l'endettement commande la nécessité
de rechercher systématiquement une solution globale et concertée impliquant toutes les parties concernées: les pays débiteurs, les créanciers, les
bailleurs de fonds et les institutions financières multilatérales. Selon le mot
de Susan George cc nous sommes tous des passagers d'un même train,
même si certain d'entre nous voyagent en première ".
La seconde observation est que les pays d'Afrique de l'Ouest, comme
ceux du Continent, ont plusieurs fois payé leurs dettes par des transferts
réguliers ou occultes. En additionnant les différents transferts vers les pays
créanciers sous forme de fuite de capitaux, d'achats d'actifs, de paiement
d'intérêts de la dette et surtout de transfert de surplus par le système des
prix internationaux, on aboutit à des décaissements de ressources financières qui excèdent de loin les encaissements de capitaux. Ces problèmes
sont maintenant assez bien maîtrisés, même celui très discuté et très
complexe du système international des prix, qui selon G. Debernis,
empêche l'accumulation de part importante du surplus qui resterait éventuellement disponible dans le pays. Il est maintenant unanimement admis
que le capital international qui surfacture ses équipements, vend cher ses
128
services d'assistance technique, sous-rémunère les produits du TiersMonde, capte, par ces divers biais, une part très substantielle des surplus.
C'est sans doute pour cette raison que cc les pays qui ont voulu se donner
les conditions de leur développement (accumulation nationale autonome,
modernisation) aient dû se libérer de la contrainte du système des prix
mondiaux, en se dotant d'un tarif douanier permettant la mise en place
d'un système de prix relatifs favorable au développement des capacités
productives ".
La troisième observation est que les politiques conventionnelles de la
dette s'avèrent complètement incapables de promouvoir le développement
et d'assurer le remboursement. Un dirigeant du Tiers-Monde observait à la
fois avec amertume et clairvoyance que cc plus nous voulons, et nous ne
pouvons le faire que si nous vendons nos produits à des prix rémunérateurs, plus nos créanciers ferment leurs marchés ou nous imposent des
baisses de prix qui nous empêchent de rembourser ...
Sans amélioration sensible de ses recettes en devises, on ne voit pas,
selon le mot de Philippe Engelhard, comment l'Afrique financera son développement. Dès lors, quoiqu'on dise et quoiqU'on fasse, il faudra bien qu'on
réduise le poids de la dette des pays africains et qu'on trouve les moyens
de soutenir les cours des matières premières de base qu'ils exportent. Il ne
serait certes pas souhaitable de les inciter à produire des marchandises
dont la demande décline ou stagne sur le marché mondial. Pendant une
période de transition plus ou moins longue, il faudra tout de même qu'on se
décide à subventionner d'une façon ou d'une autre leur agriculture. Il n'est
que grand temps de mettre en pratique des options et de nouveaux instruments de gestion de l'endettement: moratoire, remise de dette, swap de la
dette ou d'actif, capitalisation des intérêts, mobiliérisation de la dette et
rachat par le débiteur. De toutes ces solutions, celle qui nous semble la
meilleure est, sans doute, cc la remise à zéro des compteurs .. par l'effacement pur et simple de la dette. Cependant, cette solution serait inefficace si
elle n'est pas accompagnée par de profondes réformes économiques et
sociales.
En définitive, il apparaît clairement que l'endettement est la conséquence d'un modèle de développement extraverti, coûteux en ressources
et insoutenable. Ce modèle appliqué en Afrique de l'Ouest depuis les
années soixante est rentré dans une crise grave qui se manifeste dans la
baisse de la production par tête d'habitant, la détérioration des revenus et
du pouvoir d'achat, la diminution de l'emploi rémunéré et l'élargissement
du chômage, l'approfondissement des déficits alimentaires. Parallèlement,
les indicateurs sociaux se détériorent par suite de la baisse de la part
moyenne des dépenses d'éducation, de santé et de la culture dans les
budgets nationaux. La généralisation des Programmes d'Ajustement
Structurel depuis plus d'une bonne décennie n'a pas encore réussi à
arrêter ce processus de déclin économique et social ainsi que le cycle
infernal dans lequel le paiement d'une dette entraîne la formation d'une
autre plus volumineuse.
129
Tous ces faits et évolutions ont pris à défaut les théories économiques
notamment celles d'inspiration néo-classique qui n'ont pas su expliquer,
encore moins prévoir les crises que connaissent les pays en voie de développement comme elles n'ont pu offrir des stratégies et des politiques
appropriées, justes et efficaces. En effet, les faibles performances des politiques d'ajustement apportent la preuve des limites des théories économiques libérales et conservatrices. La réthorique des institutions
internationales qui se fonde sur un plaidoyer en faveur de la libéralisation
des économies, l'apologie du retour à la vérité des prix et aux vertus des
mécanismes du marché, la critique acharnée de l'intervention de l'Etat
dans l'économie et le vigoureux réquisitoire contre les entreprises
publiques, s'avèrent insuffisants à l'explication et à l'action. Dès lors, il
semble que la vertu essentielle de ce discours libéral est de rassurer les
créanciers sur l'ordre économique et sa capacité à permettre le recouvrement des dettes.
Au demeurant, et cela introduit la deuxième question sur les solutions,
en l'absence d'un paradigme pertinent et convaincant, nous avons alors
formulé des axes de nouvelles politiques sectorielles d'abord en nous
fondant sur un ensemble d'idées simples mais cohérentes et ensuite en
nous gardant de tout fétichisme économique.
Cette direction d'analyse permet de trouver un modèle alternatif aux
Programmes d'Ajustement Structurel qui se fonde sur un développement
endogène, décentralisé, démocratique et durable. Il s'agit, tout en reconnaissant l'apport décisif de la concertation à l'échelle externe (régionale et
internationale), de promouvoir un développement national, de dégager de
nouvelles politiques d'accumulation, de réformer les structures et de
renverser toutes les tendances régressives. L'endettement dans une
économie ainsi assainie devient inoffensif.
Les propositions contenues dans le Plan de Lagos améliorées par le
CARPAS (Cadre Africain de Référence pour les Programmes
d'Ajustement) récemment élaboré par l'intelligentsia africaine sous l'égide
de la Commission Economique pour l'Afrique (CEA), recentrent le débat
autour de la stratégie du développement endogène et de l'intégration africaine qui seule peut faire que l'avenir de l'Afrique appartienne véritablement aux africains. Cette stratégie s'appuiera sur l'utilisation des
ressources et du génie propre des pays, la confiance aux populations et en
leur capacité d'organisation et de développement et enfin dans la définition
d'objectifs socio-économiques en rapport avec les ressources disponibles
et l'environnement. Un tel développement concernera et en conséquence
mobilisera le plus grand nombre d'acteurs sociaux qui seront associés à la
définition des options et des objectifs de la société. En ce sens, ce sera un
développement populaire et démocratique.
Les mutations et les changements intervenus au niveau de "économie
mondiale, les progrès prodigieux de la révolution scientifique et technique
et l'universalisation des régimes démocratiques révèlent que l'humanité est
maintenant en mesure de soutenir un développement solidaire et de créer
130
un space économique capable d'accroître la production et d'améliorer le
niveau de vie de l'ensemble de la population mondiale. Dans la mouvance
de la nouvelle donne économique et politique, il faudra lever, pour l'Afrique,
l'hypothèque de la dette afin de lui permettre d'opérer dans les meilleures
conditions la restructuration de son environnement économique (ajustement structurel et changement de modèle) et politique (amorce d'une transition démocratique qui a besoin de paix sociale et de sérénité
économique), la redéfinition de son modèle culturel (valeurs et identités) et
la réalisation de son intégration pour faire face à l'émergence des
nouveaux blocs du monde multipolaire et à l'impérative compétition pour
équilibrer les comptes extérieurs.
131
TABLE DES MATIERES
Introduction
Première partie: L'état de l'endettement en Afrique de l'Ouest
Chapitre 1- La montée de l'endettement en Afrique de l'Ouest et
dans l'UMOA
1) L'ampleur de l'endettement.......................................
2) Les caractéristiques principales de la dette.................................
3) L'endettement commercial et la situation relative des Etats ... .........
7
19
22
23
28
30
Chapitre Il - Les explications de la massification de l'endettement en
Afrique de l'Ouest
1) La précarité des modèles d'accumulation et de développement en
Afrique de l'Ouest fondés sur la rente minière ou agricole.................
2) Le recours au système financier international pour la résorption des
déséquilibres physico-financiers intenes
3) Le rôle des banques privées dans l'accélération de l'endettement
33
34
Deuxième partie: Facteurs d'accélération et mécanisme de propagation
de l'endettement.....................................................................
39
Chapitre 1- Les facteurs internes d'aggravation de l'endettement......
1) Les modèles de développement
2) Les politiques inefficientes de gestion de la dette et d'allocation de
ressources
3) La fuite de capitaux
4) Les autres facteurs internes d'aggravation de la dette..................
Chapitre 11- Les facteurs externes d'aggravation de l'endettement....
1) L'environnement économique international.................................
2) Les politiques monétaires restrictives, l'augmentation des taux
et la surévaluation du dollar
3) Les échanges internationaux et la détérioration des recettes des
exportations...... ...... ...... ...... ...... ...... ... ... ...... ...... ...... ...... ...... ....
Chapitre III - La nature de la crise de l'endettement: crise de liquidité
ou crise d'insolvabilité..............................
31
32
43
44
46
47
48
50
50
52
54
58
133
Troisième partie: Politiques d'ajustement ou changement de modèle de
développement......
..
Chapitre 1- Les modèles d'ajustament et de stabilisation préconisés
par les institutions financières internationales.................................
1) Les politiques d'ajustement et de stabilisation préconisés par les
institutions financières internationales......
2) Les politiques d'ajustement et de stabilisation préconisées par
le FMI....................................................................................
3) Les limites pratiques des politiques d'ajustement...... ......
a) Les coûts économiques et sociaux des politiques d'ajutement
b) Les résultats économiques des politiques d'ajustement
4) Les limites théoriques des politiques d'ajustement............
70
77
78
81
83
Chapitre Il -
88
Les axes d'une autre stratégie de développement.........
Chapitre III - La solution interne: le changement de modèle de développement et d'accumulation......
a) Les prémisses pour un développement endogène et autocentré
1) L'aspect institutionnel............................................................
2) Les fondements d'une nouvelle logique d'accumulation productive..
b) La réorganisation des politiques sectorielles
1) Au niveau de l'agriculture.........
a) Une autre orientation de l'agriculture au double niveau des productions et des structures
b) L'organisation sur des bases claires et non bureaucratiques de la
coopération agricole..................................................................
c) La réalisation programmée d'une insfractructure de base nécessaire
à l'expansion et à la diversification de la production agricole......... .....
d) Une planification du perfectionnement des techniques agricoles et
de l'utilisation généralisée des facteurs modernes de production
agricole......
.
e) Une politique adéquate de crédit agricole
f) Une politique de prix suffisamment incitatrice pour les grands produits agricoles
2) Au niveau de l'industrie........................
3) Au niveau des relations économiques internationales
Chapitre IV - Les propositions d'action au niveau international...
1) A l'échelle internationale............
2) Les améliorations du PAL: la contribution de la BAD
3) Solution régionale: l'action essentielle doit être la concertation pour
l'instauration d'une division régionale du travail... ......... ...... ........ .....
Conclusion générale
134
63
65
69
93
93
93
95
103
103
104
104
104
105
105
106
107
109
111
111
117
119
127
Impressions DUMAS - 42100 SAINT-ÉTIENNE
Dépôt légal: 4' trimestre 1992
N° d'imprimeur: J 1152
/1111'1';11,1 l'II FrmlCe
ENDETIEMENT ET POLITIQUE ECONOMIQUE
EN AFRIQUE DE L'OUEST
L'endettement est dans la turbulence et les désordres actuels du
système économique et financier mondial, un sujet complexe de
controverse, de désarroi et d'alarme pour les théoriciens du développement. les experts, les débiteurs et les divers créanciers.
Bien que la dette africaine n'atteigne pas encore des proportions
impressionnantes, ni même l'acuité de celle de l'Amérique Latine
elle n'en demeure pas moins spectaculaire par sa croissance exponentielle, ses changements remarquables de structure et les perspectives incidentes d'insolvabilité qu'elle annonce.
A partir du cadre de l'Afrique de l'Ouest, ce livre évalue la
montée rapide de l'économie d'endettement, analyse les facteurs et
les mécanismes d'accélération et d'aggravation de la dette et
apprécie les diverses propositions de solution. La généralisation du
recours à l'emprunt pour le remboursement de l'emprunt a fait
progressivement entrer la quasi totalité des Etats africains dans le
dispositif de tutelle des institutions financières internationales et des
bailleurs de fonds qui ont partout poussé à la mise en place de
programmes d'ajustement imposant une éprouvante austérité pour
rembourser la dette extérieure par la relance de la production et de
la croissance. Après plus d'une décennie de politique d'ajustement,
il devient important de s'interroger sur les performances des
programmes appliqués et sur leur capacité à relancer la croissance
et à générer des ressources permettant aux pays d'honorer leurs
engagements.
Cet ouvrage n'est donc pas un bilan clos de l'endettement,
encore moins un catalogue de solutions prétentieuses, il est le
produit d'une recherche qui soulève des questions et apporte
quelques débuts de réponses concernant les solutions alternatives
à l'endettement.
Moustapha Kassé est professeur agrégé d'Economie à l'Université
Cheikh Anta Diop où il a dirigé, pendant plus d'une décennie. le
Département des Sciences Economiques. Il enseigne dans plusieurs
universités africaines et européennes et il est, actuellement. Directeur du
Centre de Recherches Economiques Appliquées (CREA). Il a publié
plusieurs ouvrages sur les économies africaines, dont le dernier en date
est" Crise économique et Ajustement structurel au Sénégal
>J.
ISBN:
2·87693-018·8