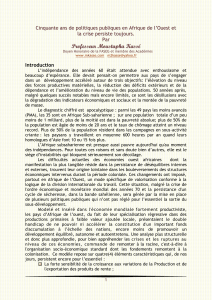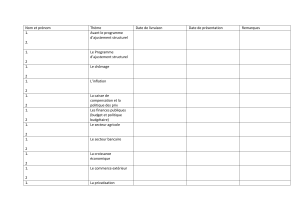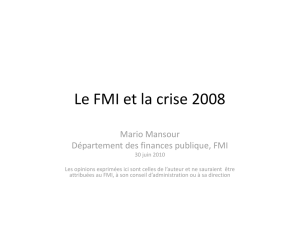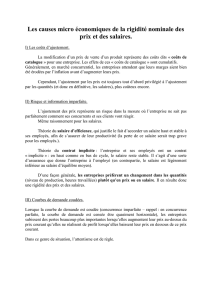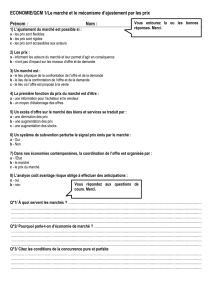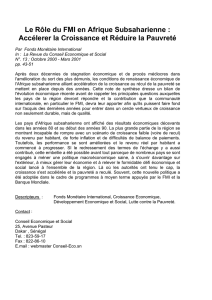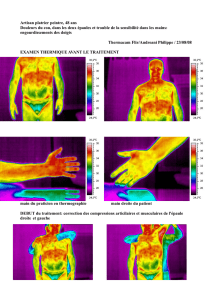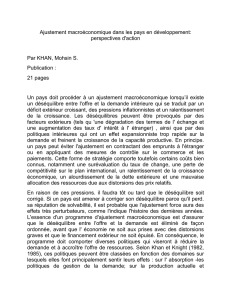C i n q

1
C
Ci
in
nq
qu
ua
an
nt
te
e
a
an
ns
s
d
de
e
p
po
ol
li
it
ti
iq
qu
ue
es
s
p
pu
ub
bl
li
iq
qu
ue
es
s
e
en
n
A
Af
fr
ri
iq
qu
ue
e
d
de
e
l
l’
’O
Ou
ue
es
st
t
e
et
t
l
la
a
c
cr
ri
is
se
e
p
pe
er
rs
si
is
st
te
e
t
to
ou
uj
jo
ou
ur
rs
s.
.
P
Pa
ar
r
P
Pr
ro
of
fe
es
ss
se
eu
ur
r
M
Mo
ou
us
st
ta
ap
ph
ha
a
K
Ka
as
ss
sé
é
Doyen Honoraire de la FASEG et membre des Académies
www.mkasse.com m2kasse@yahoo.fr
Introduction
L’indépendance des années 60 était attendue avec enthousiasme et
beaucoup d’espérance. Elle devait pensait-on permettre aux pays de s’engager
dans un développement accéléré autour de trois objectifs: l’élévation du niveau
des forces productives matérielles, la réduction des déficits extérieurs et de la
dépendance et l’amélioration du niveau de vie des populations. 50 années après,
malgré quelques succès notables mais encore limités, ce sont les désillusions avec
la dégradation des indicateurs économiques et sociaux et la montée de la pauvreté
de masse.
Le diagnostic chiffré est apocalyptique : parmi les 49 pays les moins avancés
(PMA), les 35 sont en Afrique Sub-saharienne ; sur une population totale d’un peu
moins de 1 milliard, plus de la moitié est dans la pauvreté absolue; plus de 50% de
la population est âgée de moins de 20 ans et le taux de chômage atteint un niveau
record. Plus de 50% de la population résident dans les campagnes en sous-activité
criante : les paysans y travaillent en moyenne 600 heures par an quand leurs
homologues d’Asie font 10 ou 15 fois plus.
L’Afrique subsaharienne est presque aussi pauvre aujourd'hui qu'au moment
des indépendances. Pour toutes ces raisons et sans doute bien d’autres, elle est le
siège d’instabilités qui bloquent sérieusement son décollage.
Les difficultés actuelles des économies ouest africaines dont la
manifestation la plus tangible réside dans la persistance de déséquilibres internes
et externes, trouvent leur origine lointaine dans les bouleversements des structures
économiques intervenus durant la période coloniale. Ces changements ont imposé,
partout en Afrique de l’Ouest, un mode spécifique de valorisation conforme à la
logique de la division internationale du travail. Cette situation, malgré la crise de
l'ordre économique et monétaire mondial des années 70 et la persistance d'un
cycle de sécheresse, dans la bande sahélienne, sera gérée par la mise en place
de plusieurs politiques publiques qui n’ont pas réglé pour l’essentiel la sortie du
sous-développement.
Modelé et inséré dans l'économie mondiale fortement productiviste,
les pays d’Afrique de l’ouest, du fait de leur spécialisation régressive dans des
productions primaires à faible valeur ajoutée locale, présentaient le double
handicap de ne pouvoir ni accélérer la constitution d'un important fonds
d'accumulation à l’échelle des nations, encore moins de promouvoir un
développement équilibré, autonome et autoentretenu. Une analyse plus structurelle
et donc plus approfondie, pour bien appréhender les crises et les ruptures au
niveau de ces économies, commande de remonter à la racine, c'est-à-dire à
l'organisation socio-économique standard dont les fondements remontent à la
colonisation. Ce modèle repose sur quatre(4) éléments caractéristiques qui, de nos
jours, persistent encore pour l’essentiel :
La forte sensibilité de la croissance aux variations de la Production et de
l'exportation des produits de rente ;

2
L’utilisation insuffisamment productive des ressources tirées de la rente
agricole et minière et des apports extérieurs (Aide Publique au
Développement) ;
La répartition fortement inégalitaire des revenus au profit des élites et
des hyper consommations urbaines ;
L’extrême vulnérabilité des économies à l’égard des variables exogènes
comme les variations erratiques du climat qui conditionnent l’instabilité
des productions physiques, des cours mondiaux des matières premières
qui déterminent le niveau de la rente agricole et minière et les
turbulences du système monétaire international qui commande les
évolutions des taux d’intérêt.
Cette organisation sociale produit une double extraversion structurelle qui
caractérise les économies ouest africaines contemporaines : l'extraversion du
système productif essentiellement orienté vers la satisfaction prioritaire de la
demande extérieure et celle de la structure de consommation marquée par des
importations massives et couteuses de produits alimentaires et de biens
manufacturés non localement fabriqués. Il en découle une distorsion entre
capacités de production et capacités de consommation. Sur le plan monétaire,
concernant les pays francophones, cette logique économique a été
accompagnée par la surévaluation structurelle du franc CFA. Dès lors,
l'ensemble de la zone africaine francophone étaient artificiellement soustraite de
la concurrence que les autres pays industrialisés économiquement plus performants
pouvaient éventuellement livrer à la France sur ces marchés captifs.
Subséquemment, ces derniers servaient de débouchés relativement faciles pour les
exportations industrielles françaises.
Quelles sont les politiques publiques qui ont été appliquées depuis 50 ans ?
I/ La gestion du développement et les pol itiques
publiques au lendemain des indépendances.
En accédant à l’indépendance en 1960, la plupart des pays francophones
d’Afrique de l’Ouest comptabilisait plus d’un siècle de domination coloniale directe
qui les marquait politiquement, économiquement, socialement et culturellement.
Ils ont hérité de la colonisation d’une agriculture spécialisée dans la production des
cultures de rente et des cultures vivrières exsangues, d’un tissu industriel
encore embryonnaire et d’un secteur tertiaire (commerce, assurance, banques,
transports) contrôlé essentiellement par le capital privé étranger. Les
infrastructures de base étaient nettement insuffisantes et les cadres
nationaux peu nombreux. Devant l'immensité des tâches de construction
d'une nation jeune et nouvellement indépendante, et tenant compte du très
faible niveau de développement des forces productives matérielles et humaines,
de l’inexistence d’un secteur privé et d’une bourgeoisie nationale, l'Etat décida de
prendre en charge la promotion du développement, occupant progressivement une
position stratégique dominante dans toutes les sphères de l’économie nationale.
C'était le début de la mise en place des institutions de "l'Etat développeur".
La planification fut adoptée comme devant être l’instrument qui définit les
tâches et objectifs du développement ainsi que les moyens de les réaliser. Elle doit
fixer les ressources à mobiliser et déterminer les délais de réalisation des

3
objectifs ; elle devient un instrument essentiel de régulation et de direction de la
vie économique et sociale.
Les objectif déclarés et poursuivis par les politiques publiques étaient: 1)
d'élever rapidement et substantiellement le niveau des forces productives
matérielles et humaines en récupérant le surplus économique jusque-là accaparé
par le capital étranger et en le réinvestissant ; 2) d'élargir la base productive
interne. Il devait théoriquement en résulter l'amorce d'un processus cumulatif et
irréversible d'accumulation productive et de développement soutenu de
l'économie.
1°) La gestion du développement par l’Etat développeur
La majorité des dirigeants ouest africains avaient opté pour des stratégies du
développement qui s’inspiraient des grandes idéologies de l’époque : l’option
capitaliste libérale (Côte d’Ivoire), l’option socialiste (Mali, Guinée et Ghana) et le
socialisme africain(Sénégal). Toutefois, ils étaient tous d’accord pour des
politiques publiques endogènes ; autocentrées et auto entretenues qui devraient
engendrer un processus soutenu de croissance économique.
Quelle que soit la nature des options, l'Etat était amené à occuper des
fonctions exorbitantes et à jouer les premiers rôles au plan administratif,
économique et social, même s'il n'en avait manifestement pas ni les traditions, ni
les moyens matériels et humains. Cette intervention massive dans le double
appareil technico-économique et politico-administratif était justifiée par six séries
de raisons à savoir :
le souci d'un meilleur contrôle sur les grands services d'utilité publique en
vue de rendre fluide et transparent le jeu des mécanismes économiques
et monétaires ;
la main mise grandissante sur les secteurs clés de l'économie d'abord pour
améliorer leur fonctionnement et ensuite pour en faire des instruments
d'accumulation productive pour le financement du développement et des
facteurs sociaux ;
la volonté de disposer d'instruments opérants d'action et de gestion de la
stratégie du développement ;
la volonté de promouvoir et de contrôler la réalisation de certains projets
importants pour l'ensemble de l'économie nationale mais dont le
financement n'est pas 'à la portée du secteur privé et de l'initiative
individuelle ;
le contrôle de certains établissements bancaires et financiers en vue
d'orienter le crédit et sa répartition en fonction des priorités retenues
dans la politique de développement;
le contrôle des secteurs d'importation et de commercialisation des
denrées alimentaires pour éviter les pénuries et la spéculation.
La réalisation de ces tâches économiques avait fini par entrainer la
constitution d'un vaste secteur public et para-public dont la gestion s’est avérée,
par la suite, désastreuse pour les ressources financières de l'Etat. Ainsi, on a
observé, dans la période 1970-1980, des faillites retentissantes d'entreprises
publiques entrainant des conséquences financières et sociales très lourdes et des
déficits qui ont été couverts par des subventions budgétaires.

4
Ces charges sont venues se greffer au déficit croissant de la balance
commerciale découlant d'une part de l'élévation des dépenses d'importation de
produits vivriers et pétroliers et d'autre part de la baisse de valeur des exportations
par suite d'une détérioration des cours et d'une baisse de production.
2°) Les politiques sectorielles ont été à la fois mal conçues et
inappropriées.
Les politiques agricoles mises en œuvre depuis 1960, aggravées par le poids
de divers facteurs exogènes (fluctuations pluviométriques, attaques biologiques),
ont installé, partout en Afrique, une crise agro-alimentaire dans les campagnes.
L'exode rural qui s'en est suivi a contribué à vider les zones rurales de leurs bras
valides. Or, au même moment, les faibles performances enregistrées au niveau du
secteur industriel n'ont pas permis de résorber cette main-d’œuvre additionnelle
issue du milieu rural. Il ne restait plus à celle-ci que la seule possibilité d'un
reversement direct (et sans transition) dans le tertiaire, généralement informel,
spontané et non structuré.
Dans le secteur industriel, l'option d'une politique d'industrialisation
substitutive aux importations juxtaposée à la création d’enclaves
industrielles que constituent les exploitations minières, n'a pas favorisé la
mise en place d'un véritable tissu industriel suffisamment intégré au reste
de l'économie nationale.
Quant au secteur tertiaire, son hypertrophie anormale attestait
particulièrement de l'incapacité des deux premiers secteurs à absorber
efficacement le flux additionnel de main d'œuvre qu'implique la croissance
démographique.
Enfin, au niveau du quaternaire, si d'appréciables efforts ont été
réalisés en matière d'éducation, de formation et de santé, d'énormes
besoins restaient encore à satisfaire et seront de plus en plus limités dans
leur réalisation par les contraintes budgétaires draconiennes auxquelles
les pays devraient faire face.
En effet, toutes les caractéristiques défavorables ci-dessus
énumérées et amplifiées par le dérèglement économique et monétaire
international du début des années 70, précipiteront les pays d’Afrique de
l’Ouest dans un cycle ininterrompu de déficits et de déséquilibres de
divers ordres dont le caractère éminemment structurel commence à être
de mieux en mieux perçu.
La persistance de ces déséquilibres économiques et financiers et
particulièrement le double déficit de la balance des paiements et des
finances publiques, débouche inéluctablement sur la montée de
l'endettement extérieur qui sera amplifié par l'utilisation peu efficiente
des emprunts conjuguée à un durcissement des conditions d'emprunt. Cette
situation ouvre la double problématique de la crise de paiements et de
solvabilité.
II/ Crise mondiale, montée des déséquilibres et ajustement
structurel.
La fin des années 60 coïncide avec l'effritement tendanciel du modèle

5
économique de type "fordien" et se manifeste notamment par:
la baisse continue des gains de productivité au niveau de l'activité
économique ;
l'accroissement soutenu de la part du travail improductif ;
et l’épuisement de la norme de consommation de masse axée pour
l'essentiel, dans les pays développés, autour de l'automobile,
l'immobilier et les appareils électroménagers.
1°) De la crise mondiale à l’essoufflement des économies de
rente : l’ajustement à la division internationale du travail.
Cet essoufflement de la croissance "fordienne" s'accompagne, au début des
années 70, de deux événements majeurs : d'une part, la suppression de la
convertibilité illimitée du dollar US en or, à partir du 15 août 1971, qui met ainsi
fin à 26 ans de stabilité monétaire internationale, et d'autre part, l'avènement du
premier "choc pétrolier" qui s'est manifesté sous la forme d’un relèvement massif
et inattendu du prix du baril de pétrole par les pays membres de l'OPEP en
octobre 1973.
Cet éclatement de la crise économique mondiale des années 70-80, en
déréglant le système économico-financier international, viendra extérioriser toutes
les faiblesses structurelles des économies ouest africaines, notamment :
la non émergence d'une agriculture performante capable de satisfaire
une demande alimentaire fortement croissante et d'améliorer le pouvoir
d'achat du monde rural ;
la persistance d'une industrie mono polaire peu compétitive et fortement
protégée ;
l'avènement d'un sous-emploi de plus en plus massif qui a ffe cte
pa rticulière ment les jeune s et p rogressivement va
s’é tendre au x diplô me s du systè me d’e nseigne ment
sup érieur et de formation ;
l'hypertrophie du secteur public et parapublic caractérisée par les
pesanteurs d'une bureaucratie lourde et paralysante ayant une forte
propension à élargir ses privilèges en contribuant ainsi à accentuer les
déficits chroniques et cumulatifs des finances publiques et de la
balance des paiements.
Dans ce contexte, les pays d’Afrique de l’Ouest frisent la catastrophe en
traversant une triple crise économico-financière, agro-alimentaire et
d’endettement ; cela va alors entrainer une détérioration de la situation politique
et sociale et une fragilisation des Etats.
Les Institutions Financières Internationales (FMI, Banque mondiale) devenues
les principaux bailleurs de fonds des pays d’Afrique vont intervenir massivement
dans le débat sur le développement en dédoublant leur pouvoir financier par un
pouvoir intellectuel servi par une très forte concentration d’experts autour d’une
épure qui forme le fameux « consensus de Washington » fondement des fameux
programmes d’ajustement structurel (PAS) qui seront imposés à tous les pays sans
aucune exception.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
1
/
11
100%