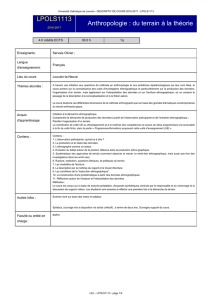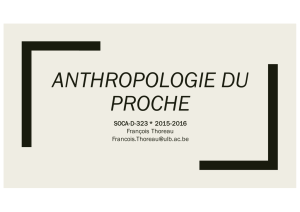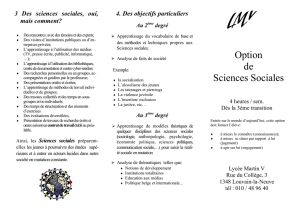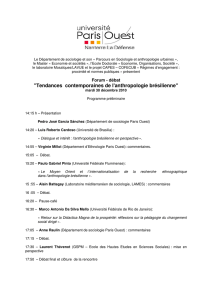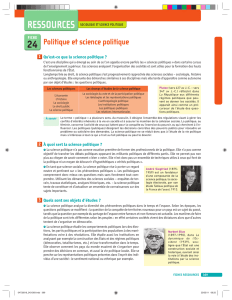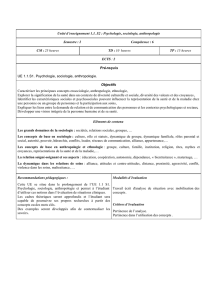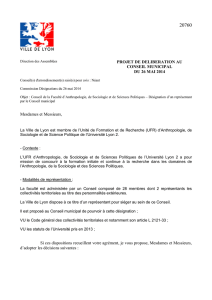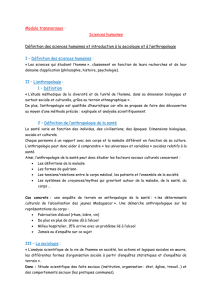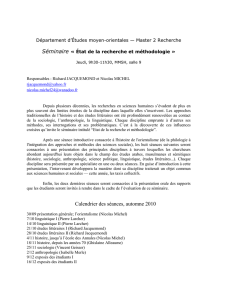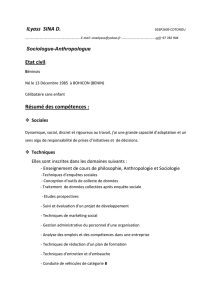l`observation comme forme d`objectivation

Master 1 SLEC – Méthodes et techniques d’enquête – Nicolas Lefèvre
L’OBSERVATION COMME FORME D’OBJECTIVATION
I) INTRODUCTION :
Lorsque l’on parle ici d’observation, il ne faut pas se tromper : s’il s’agit de réhabiliter
l’ensemble des sens comme moyen empirique de saisir la réalité du monde, mais il ne s’agit
surtout pas de prendre vos sens pour la réalité.
Tout comme l’entretien : se garder de tout ethnocentrisme, objectiver sa propre position pour
pouvoir produire un regard neutre de tout jugement de valeur. Et deuxièmement l’observation
faites des pratiques doit elle aussi être objectivée par rapport à la place que les individus
observés occupe dans la réalité sociale.
L’objectivation de l’observateur et des conditions d’observation fait partie de la construction
de la preuve (scientifique)
Tout comme l’entretien, l’observation demande un certain nombre de précautions dans
l’emploi et un certains nombre « normes » implicites
NB : HISTORIQUE : La sociologie urbaine des américains.
L’observation renvoie à une tradition anthropologique (2type d’anthropologie : -
L’anthropologie sociale et culturelle ; - l’anthropologie biologique, physique, c’est à dire
l’étude des crânes, préhistoire etc). Au niveau théorique, on distinguera trois paradigmes,
chacun renvoyant à une manière particulière de concevoir et conduire sa recherche.
Anthropologie (étude de l’homme en général, universalisation de l’homme, aspect plus
théorique, volonté de théoriser).
Ethnologie (synthèse localisée, par exemple peut être plus régionale, spécificité d’une culture
régionale etc., pas de volonté d’universelle)
Ethnographie (locale, observation de « petite unité », de petit groupe spécifique ).
Ce courant d’observation ethnographique a connu sont fondement au EtatsUnis à l’aube de la
1ère Guerre Mondiale et dans les années 20, notamment avec Robert Park fondateur de ce
qu’on appellera « l’école de Chicago ». Naît alors ce qu’on appel « l’écologie urbaine », ce
qui se traduit au niveau de la sociologie comme la naissance de « la sociologie empirique
moderne » A cette époque où jusqu’alors la sociologie mobilisait davantage des données
statistiques et historiques, (et se rapprochait par moment des méthodes des sciences
expérimentales) l’école américaine a posé ses fondements de recherche dans l’immersion,
dans le terrain même. Les sociologues de l’école de Chicago seront les fondateurs et les
défenseurs d’une méthode qualitative, privilégiant les études de cas et recourant aux
techniques de l’observation in situ et des récits de vie. Le contexte social des E.U à l’époque à
favoriser cette émergence. Nombreux étaient les immigrés qui venaient s’installer dans les
grandes villes des E.U, et on voyait alors se construire des quartiers avec des spécificités
culturelle propres, et posant par là aussi le problème de coexistence et d’existence des
minorités ethniques, et de la structuration des communautés. Ainsi, pour étudier ses

Master 1 SLEC – Méthodes et techniques d’enquête – Nicolas Lefèvre
communautés, l’immersion semblait être un des moyens les plus malléable et les plus efficace
pour cerner la réalité sociale de ces groupes sociaux particuliers. Ce courant écologique
débouche quelques dizaines d’années plus tard (dans les année 50 et 60) sur 2 paradigmes
principaux, reprenant ce type de méthode de recherche, que sont l’interactionnisme
symbolique, notamment avec E.Goffman (Asiles. Études sur la condition sociale des malades
, Paris : Éditions de Minuit, 1979) et H. Becker (Outsider. Etudes de sociologie de la
déviance, Paris : Métaillé, 1985), ou encore Anselm Strauss, tous de l’école de Chicago, et qui
cherchent à comprendre au travers des divers enquêtes réalisées des processus en jeu dans les
comportements (la déviance pour Becker, la construction des carrières pour E.Hugues etc.),
processus qui ne peuvent se saisir dans une enquête quantitative ; et avec l’ethnométhodologie
(traduit notamment par P.Berger et T.Luckman, La construction sociale de la réalité, Paris :
Armand Colin, 1996) qui cherche à problématiser le social, en cherchant aussi à comprendre
les « allant de soi » de la vie courante, les routines de tous les jours etc., qui eux aussi sont
difficilement saisissables par le quantitatif.
Donc historiquement le qualitatif et l’observation (participante ou non) se sont peu à peu
développés pour comprendre certaines réalités sociales que ne pouvait saisir le quantitatif.
Ainsi l’observation convient particulièrement pour la compréhension de processus où l’aspect
non verbal des choses (donc le pratique elle même) est révélateur de la réalité social. Par
exemple : les codes institués et les codes comportementaux, le rapport au corps, les modes de
vie et les traits culturels dominants, l’organisation d’un groupe etc…
II) Les différents types d’observation.
- Observation directe (non participante) = position d’extériorité (expérience partagée)
- Observation participante = position d’intériorité. Difficulté : retrouver une position
d’extériorité, donc de se distancier par rapport à son objet et en même temps de s’en
rapprocher au plus près pour le comprendre. Sorte d’acculturation.
III) Les opérations d’observation.
¾ Qu’est ce que l’observation ?
Plusieurs points :
1) L’observation relève d’un triple travail de perception, de mémorisation et de notation.
Ces trois activités sont en interaction et s’améliorent en même temps. Tout le monde observe
et on passe notre vie à observer sans le savoir. C’est cette capacité sociale à observer qui doit
servir de terreau pour développer votre capacité ethnographique à observer.
* Percevoir dans le cadre d’une observation ethnographique c’est rendre familier ce qui
est étranger et rendre étranger ce qui est familier. Deux cas : la position d’étrangeté au terrain
(1ère forme d’objectivation) permet davantage d’observer de manière à s’approprier au fur et à
mesure l’environnement et ce qui ne nous est pas familier. Et deuxième cas, lorsque les
observations se passent dans un environnement familier, l’observation doit rendre étranger ce
qui vous est familier, aller contre les « allant de soi ». Avoir une autre vision de sa propre
réalité lorsque l’on est dans le monde observé. Noter une observation permet dans un premier
temps de garder des traces écrites de ce qui nous a semblé le plus important et pourra donc

Master 1 SLEC – Méthodes et techniques d’enquête – Nicolas Lefèvre
être ré-exploité plus tard. La mémorisation seule est insuffisante. La notation n’est pas de la
littérature (notation sans forme, notation par rapport au points dominant de ce qui est observé,
et par rapport à ce qu’on recherche).
2) Tout comme l’acte d’entretien, l’observation est structurée par nos objectifs de
recherche, par nos hypothèses. On ne peut pas tout observer, et notre regard s’arrête
forcément sur un aspect de la réalité. Cet aspect n’est pas neutre, il est guidé par nos idées,
hypothèses, problématique. On n’observe pas sans références, sans points de repères.
En début d’enquête peu de points de repères, pas forcément de problématique etc. ici
même situation que les entretiens. Les observations permettront alors de dégager certaines
pistes de réflexion. On tente d’observer par rapport à certaines prénotions que l’on peut avoir
sur le terrain ou par rapport à des premières lectures qui nous ont orienté. Peut être aussi
intéressant pour prendre des contacts, ou se faire repérer par le milieu d’enquête, et se
familiariser avec ce milieu.
3) L’observation évolue elle aussi avec nos questions et les informations extérieures que
l’on peut récolter. On n’observe pas forcément de la même façon une même scène, une même
interaction en début de recherche qu’en fin de recherche. A ces deux moments différents
s’attachent peut être deux types d’observation différentes avec chacune leur spécificité dans
les critères d’observation. L’observation est un outil de découverte mais aussi un outil de
vérification.
4) Attention à l’observation pure. Peut-être source de malentendu, de déformation de la
réalité de votre part à partir de mauvaise interprétation. Il est toujours intéressant et préférable
de combiner l’observation avec des points de vue des individus sur la situation par exemple.
En mettant l’observation en relation avec le discours des individus, deux points de vue se
confronte : celui du chercheur (qui normalement traduit une objectivité) et celui des individus
(qui traduit une certaine subjectivité propre à l’appartenance même au terrain).
¾ Quoi qu’observer ?
1) Les événements ou les cérémonies : (réunions publiques, assemblés générales etc.)
• Négocier sa place : événements payants / événements non payants (justifier votre statut,
votre légitimité, justifier d’une connaissance : « Mr X est au courant »). Taille de
l’événements à prendre en compte
• Plusieurs étapes dans l’observation :
1. Avant l’observation : noter les conditions d’accès à l’événement, les organisateurs, les
lieux, les heures etc. En fait nombre de données objectives dont on peut avoir
connaissance avant l’événement même.
2. Sur place : percevoir et mémoriser.
- Les notes in situ : Prendre de notes donne un statut particulier (aspect de rendre des
comptes). Tout événement ne permet pas de prendre des notes, et ceci peut être perçu
différemment selon les situations.
- les photos : pareil que prise de note. Toutefois dans certains cas peut sembler plus banal
(garder un souvenir de la situation par exemple). Photo peut être un bon aide mémoire et
bonne illustration des pratiques. Se négocie aussi.
- « Documents indigènes » (les documents écrits, programmes, textes distribués etc.). Permet
de garder des traces de leur utilisation, à qui sont-ils destinés ? ; certaines formes de trace de
la « culture »

Master 1 SLEC – Méthodes et techniques d’enquête – Nicolas Lefèvre
- La mémorisation : qu’est ce que remarquer ? On remarque par rapport à des questions
qu’on se pose mais on remarque aussi les détails, tous ce qui choque (positivement ou
négativement). Si une chose touche c’est qu’elle a une signification. Noter sur le coût.
Analyse a posteriori. Etait-ce important ou non ? Quelle signification par rapport à la situation
d’ensemble ? etc.
- La mémorisation : repérages spatio-temporelle : Choisir une bonne place d’observation (en
changer peut être intéressant), repérer les lieux (faire schéma par exemple), le déroulement
temporelle de l’événement, les mots qui peuvent être associés à certains espaces par les
individus, ou par les organisateurs pour désigner les différentes personnes en présence etc.
Tout ça sont des clés de mémorisation dans un premier temps et pourront peut être servir
dans l’analyse pour comprendre certaines interactions etc.
3. Après l’observation : un fois sortie de l’événement, revenir sur ses observations pour les
compléter, les affiner. Ecrire de façon plus « littéraire » pour expliquer l’événement.
2) Les interactions :
Principe de base est le même. Mais à la différence de la cérémonie par exemple les
interactions sont dans un premier temps quelque chose de beaucoup plus informelle ; dans un
deuxième temps ça n’a pas de nom. Isoler cette interaction et la nommer. Ce sont souvent des
moments particuliers comme par exemple une interaction dans une pratique de travail
(nommer ce moment), une interaction dans une pratique sportive (à un entraînement par
exemple) etc.
Ce genre d’interaction pose la question : a quel titre le chercheur est admis à observer ?
Répondre à cette question permet de se situer et d’objectiver aussi sa propre situation
d’observateur.
Remarque : la position d’observateur (surtout quand elle est passive) peut être assimilée à
celle du contrôleur, c’est le rôle assigné à celui qui ne fait rien.
Situation d’interaction est une alternance entre engagement (prise de parti, faire réagir) et
distanciation (notamment par la prise de note comme forme d’objectivation).
Les interactions sont beaucoup plus fréquentes dans les enquêtes. Sélection à opérer.
Ce que l’on vient d’observer, de vivre comme interaction est-il vraiment important pour
l’enquête ?
NB : nommer les personnes est important. Donner un statut de personne, on connaît
(=qualitatif), ≠ statut d’individu, on ne connaît pas (= quantitatif).
3) Les lieux, les objets :
Tout l’un ou tout l’autre : soit on voit rien, soit on décrit trop de façon littéraire.
Pas facile de décrire un lieu seulement. Ici pas de chronologie à respecter par exemple.
Il faut cependant s’attacher à nommer ce lieu, qui utilise ce nom ? Est-ce un nom propre, un
nom commun ? A quoi renvoi-t-il ? Quel usage est fait de ce nom ? Par qui ce lieu est
fréquenté ? Pourquoi ?
Réfléchir à l’histoire du lieu aussi (dans la mesure du possible).

Master 1 SLEC – Méthodes et techniques d’enquête – Nicolas Lefèvre
NB : Pas nécessaire avec l’ensemble des lieux de l’enquête mais peut être intéressant avec un
lieu spécifique sur lequel se déroule l’enquête par exemple, comme un club, une association
etc.
Les lieux et les objets sont à la fois le cadre et le produit d’interactions sociales, ils ont des
producteurs et des usagers.
Particularité des lieux et des objets : ils font toujours partie des événements et des
interactions. On les retrouve tout le temps.
¾ Conclusion :
- La distinction entre ces trois types d’observation est analytique. Chacun renvoie aux
deux autres.
- Ensuite il faut retenir que l’observation doit toujours être accompagné d’entretiens.
Plus efficace et évite les mauvaises interprétations.
1
/
5
100%