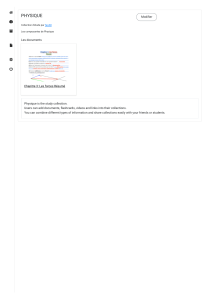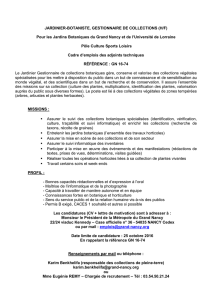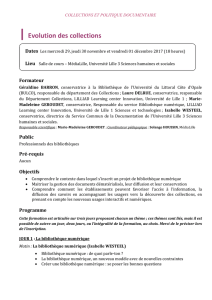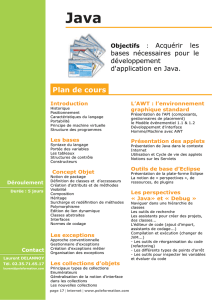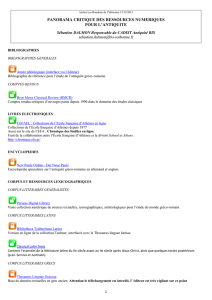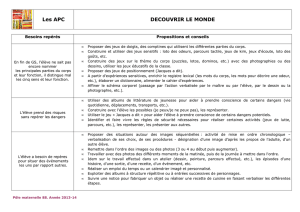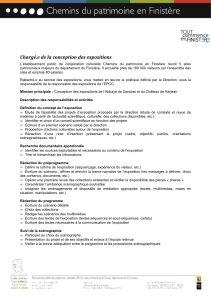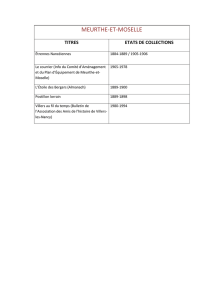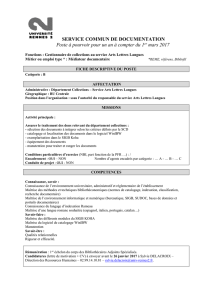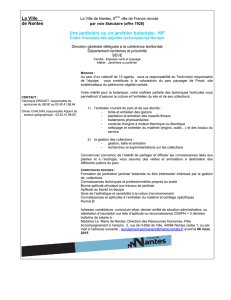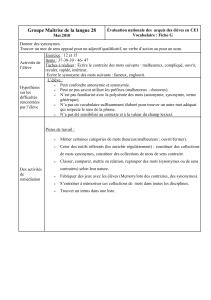Conservation préventive et restauration des collections de l’Université

1
Conservation préventive
et
restauration des collections de l’Université
Le Musée d’ethnographie de l’Université Bordeaux Segalen détient environ
cinq mille objets dont la prise en charge, lors de la rénovation des locaux,
fut globale. Rassemblés dans les bâtiments du 24 rue Broca, ils furent
regroupés par types, lieux de provenance et collecteurs afin d’en faciliter
l’identification progressive. Une série de catalogues scientifiques fut établie
et un inventaire complet lancé, assurant la base d’un travail appelé
« chantier des collections » dont l’organisation et la réalisation ont fait du
MEB un lieu d’expérimentation et une institution pilote en la matière.
Différents collaborateurs et prestataires y ont participé selon des modalités
qui furent toujours conçues au plus près des contraintes budgétaires et des
besoins spécifiques de la collection tout en accentuant la vocation
pédagogique de l’institution.
Une préfiguration générale, réalisée en 2006, permit { l’Université de
négocier une subvention spécifique (116 000€) au titre du Contrat
d’établissement 2007-2010. Ce lourd travail préparait l’organisation,
parallèlement { l’aménagement des nouveaux locaux, du « chantier des
collections ».
Le « chantier des collections » du MEB a été conçu comme un ensemble de
tâches techniques successives dont les étapes furent confiées à des
prestataires spécialistes que le personnel du musée accompagna dans leurs
missions spécifiques. La préoccupation initiale du musée était de coupler au
déménagement des collections les opérations permettant, dans le futur, des
conditions de conservation optimales pour des collections fragilisées par le
temps et une histoire parfois chaotique. Des prestataires spécialistes en
conservation préventive furent recrutés sur appel d’offre pour piloter et
réaliser le chantier avec notre équipe. Concertation et constat d’état de la

2
collection établirent des spécificités de l’opération ainsi que ses contraintes
et ses besoins précis. En septembre 2009 commençaient les ateliers de
travail : chaque objet fut dépoussiéré, consolidé si besoin, conditionné dans
un emballage adapté { une conservation durable. L’ensemble fut colisé, le
conditionnement et les listings établis devant permettre une réinstallation
économique en temps et en moyens dans les nouveaux locaux. Les
collections ainsi préparées furent transportées en trois lots vers les
nouveaux bâtiments, où elles subirent une décontamination avant de
gagner les réserves où espaces et mobilier appropriés à leur conservation
ont été préparés.
L’ensemble de ces actions s’inscrit dans notre programme de conservation
préventive. Ce dernier vise, au moyen d’une prévention attentive aux
spécificités de chaque objet, sa préservation de dégradations
supplémentaires. Il englobe le contrôle du climat et un aménagement
adapté des réserves où le redéploiement des collections est en cours.
La collection des maquettes de jonques a bénéficié d’une prise en charge
spéciale du fait de son intérêt particulier, mais aussi d’un état général
préoccupant. Il a alors semblé opportun de coupler une exposition de ces
jonques à un programme de conservation/restauration plus abouti. Le
ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche a financé
l’essentiel du projet (28 000 €), permettant d’associer diffusion de la
culture scientifique, valorisation du patrimoine universitaire et soins des
collections. Dans ce cadre, des mesures de conservation curative et des
restaurations partielles ont pu compléter les soins de conservation
préventive initialement projetés. La grande vitrine de cette salle présente
les différents aspects d’interventions qui modifient davantage l’aspect, mais
aussi parfois la structure même des objets. Dans le cas de nos maquettes, A.
Gailhbaud, une restauratrice spécialiste des techniques mixtes, a été
recrutée par l’Université. Une première campagne (constat d’état,
documentation scientifique et mesures conservatoires) a précédé le
conditionnement et le transport des maquettes. Ici, les mesures de
conservation préventive ont été complétées par de la conservation curative
(traitement des corrosions, fixation des pigments, consolidation des

3
voiles…). La seconde campagne visait { restituer aux maquettes, via des
opérations de restauration, une part de leur éclat et une forme de lisibilité
permettant de comprendre ce que leur réalisation donnait initialement à
voir (aménagements internes et disposition des éléments mobiles, montage
des gréements…). Dans certains cas, des lacunes ont été comblées, comme
le montrera aux visiteurs intéressés la consultation du rapport scientifique.
Ce document précise, pour chaque maquette, les choix techniques, le lieu et
l’étendue des interventions de la restauratrice. Ce volet du travail a permis
d’intégrer pour un mois { notre équipe E. Masse, stagiaire en restauration à
l’Institut National du Patrimoine (Paris).
Historique
Conservées dans les bâtiments de la rue Broca durant plus d’une décennie,
les collections du MEB étaient exposées à de brutaux changements de
température et d’humidité. En outre, elles ne disposaient pas d’un espace de
rangement suffisant. A l’occasion du chantier de rénovation du musée, le
déplacement des collections dans des réserves spécialement aménagées a
donc été préparé et pris en charge par le MEB assisté d’une équipe de
restaurateurs diplômés en conservation préventive : Marie-Josèphe
Arrestays, Pascale Girard, Alain Renard, Cédric Lelièvre, Raphaëlle Ternois.
A cette occasion, les membres du service (Gaëlle Cartault, Anaïs Rouyer et
Solenn Nieto) ont été sensibilisées et formées à la manipulation, au
rangement des collections et à leur conservation.
Le chantier a été rendu possible par un long travail d’inventaire
préalablement réalisé par Olivier Thomas assisté de Bérengère Sansamat.
Un travail d’analyse globale des besoins avait par ailleurs été réalisé en
2006 par Marie-Dominique Parchas (stagiaire MST Paris1). Il avait
débouché sur une évaluation financière { partir de laquelle l’Université
négocia les crédits nécessaires auprès du ministère de l’Enseignement
Supérieur et de la R
i
echerche.

4
Un constat d’état a d’abord été réalisé pour chacune des pièces. Cette
première étape a permis de classer l’ensemble des objets en fonction du
type de matériaux (métaux, céramiques, bois et matériaux composites…)
tout en déterminant leur quantité, leur volume et les modalités
d’intervention (urgence, étendue, moyens techniques). Cette approche
générale a permis de distinguer dans l’ensemble ceux qui, plus fragiles ou
plus dégradés, ont nécessité une prise en charge particulière.
Enfin, cette étape du chantier a défini les besoins quant au conditionnement
et au stockage des collections dans les nouvelles réserves.

5
Le dépoussiérage
L’atelier des restaurateurs était composé de deux pôles d’activité : le
dépoussiérage des objets d’abord, leur conditionnement ensuite en vue du
transfert vers les nouvelles réserves.
Lors du constat d’état, les objets avaient été classés selon leur niveau
d’empoussièrement et leurs matériaux. La technique et les outils employés
ont été déterminés à partir de cette typologie. Ainsi, l’équipe avait { sa
disposition des aspirateurs à intensité variable munis de petites brosses,
des mini- compresseurs, des pinceaux, des chiffons adaptés... Les
techniques de dépoussiérage adoptées sont très douces. Elles ont permis de
débarrasser les objets des microparticules (suies, sels et autres poussières
issus de la pollution, spores et autres micro organismes…) néfastes {
l’intégrité des surfaces, et plus généralement, de matériaux fragilisés par le
temps. Minutie et dextérité étaient de mise.
Pour les textiles, le dépoussiérage a souvent été accompagné du travail plus
délicat d’élimination des cocons de mites { la pince { épiler.
Le dépoussiérage était une étape indispensable du chantier car il est la
condition d’une bonne conservation des objets.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
1
/
11
100%