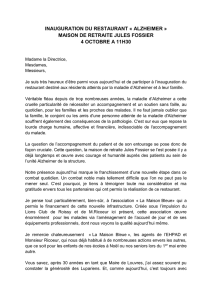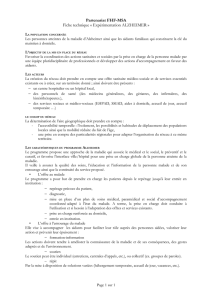I Neuroprotection et maladie d’Alzheimer É

La Lettre du Pharmacologue - vol. 20 - n° 4 - octobre-novembre-décembre 2006
Éditorial
Éditorial
100
Neuroprotection
et maladie d’Alzheimer
Neuroprotection and Alzheimer’s disease
Il y a encore 15 ans, lorsque le clinicien faisait le dia-
gnostic de maladie d’Alzheimer, il n’avait aucune
solution thérapeutique à proposer au patient qu’il
avait en face de lui. La mise sur le marché des inhibiteurs
de l’acétylcholinestérase a été un progrès pour les patients
et leurs familles. Si certaines études longitudinales, comme
l’étude AD2000, ont permis de souligner le chemin qu’il
reste à parcourir pour aboutir à un traitement optimal des
patients, la communauté médicale s’accorde pour recon-
naître que cette mise sur le marché a non seulement permis
d’améliorer l’état cognitif des patients atteints de la mala-
die d’Alzheimer, mais aussi contribué à la structuration des
filières de soins et à la poursuite des efforts de recherche
dans le domaine. Cela a conduit à la mise sur le marché
de la mémantine, un antagoniste des récepteurs NMDA,
médicament ayant un autre mécanisme d’action que les
inhibiteurs de l’acétylcholinestérase. L’évaluation pré- ou
post-AMM des traitements symptomatiques, qu’il s’agisse
des inhiteurs de l’acétylcholinestérase ou de l’antagoniste
des récepteurs NMDA, a permis de mieux appréhender leur
application aux différents stades de la maladie d’Alzheimer,
mais aussi dans les autres formes de démence, conduisant
à l’individualisation d’une nouvelle classe : les stimulants
de la cognition. La mise en évidence de la complémentarité
pharmacologique des approches thérapeutiques permet de
proposer à un nombre important de malades atteints de
maladie d’Alzheimer une bithérapie dont la supériorité en
termes de gain thérapeutique a été montrée.
Compte tenu de cette évolution, certains pourraient être
tentés d’arrêter là les efforts de recherche. En effet, dans
beaucoup de pathologies, le traitement repose sur des
associations de traitements symptomatiques. Néanmoins,
pour beaucoup, la recherche de nouveaux traitements
apparaît nécessaire. Si cette nécessaire recherche n’est
pas spécifique à la maladie d’Alzheimer mais concerne de
nombreux champs pathologiques de la médecine, il n’en
demeure pas moins que le problème est particulièrement
aigu dans le cas de la maladie d’Alzheimer compte tenu du
contexte épidémiologique de cette affection. Il y a également
des raisons humaines, dans la mesure où cette affection
neurodégénérative touche l’homme dans les fonctions qui le
distinguent le plus du reste du règne animal : la mémoire, le
jugement, le langage… Les symptômes cognitifs retentissent
sur la vie du patient et de son entourage. À titre d’exemple,
la perte de la reconnaissance des visages familiers (la
prosopagnosie) constitue toujours un traumatisme majeur
pour l’entourage du patient et souvent, pour le patient lui-
même, l’un des tournants vers la perte d’autonomie.
Les progrès thérapeutiques dans la maladie d’Alzheimer
peuvent être attendus dans plusieurs directions : optimisation
et diversification des traitements symptomatiques ;
caractérisation et évaluation de stratégies préventives ;
recherche d’agents neuroprotecteurs.
La première piste pour mieux traiter les patients est
d’améliorer le traitement symptomatique. L’étude AD2000
(Courtney C et al., Lancet 2004;363:2105-15), évaluant l’effet
à long terme d’un des inhibiteurs de l’acétylcholinestérase,
bien que méthodologiquement critiquable, a eu le mérite de
montrer que le traitement symptomatique de la maladie
d’Alzheimer doit être encore optimisé. La possibilité
d’utiliser une bithérapie est déjà un progrès important.
La poursuite des recherches sur la physiopathologie des
signes cognitifs et psycho-comportementaux de la maladie
d’Alzheimer offre des perspectives. De nouvelles pistes
pharmacologiques existent pour envisager la mise au point
de nouveaux stimulants de la cognition : noradrénaline,
GABA, récepteur GABA-B, neuropeptides (somatostatine,
leptine), neurostéroïdes... Les traitements actuels peuvent
aussi révéler des effets qui vont au-delà de ce qui avait été
montré lors de leur enregistrement. À titre d’exemple, la
galantamine a montré son efficacité sur les troubles psycho-
comportementaux, parallèlement à sa propriété reconnue
d’agoniste allostérique des récepteurs nicotiniques,
dont les interactions avec plusieurs fonctions cérébrales
(apprentissage, attention…) sont démontrées. L’optimisation
des traitements symptomatiques passe également par
celle de leur profil pK/pD, notamment par l’amélioration
de la galénique. Avec les formes retard, la diminution de
la concentration maximale au pic plasmatique contribue
à diminuer les effets indésirables du traitement. Mais
l’amélioration du profil pharmacocinétique peut également
contribuer à améliorer le profil pharmacodynamique

La Lettre du Pharmacologue - vol. 20 - n° 4 - octobre-novembre-décembre 2006
Éditorial
Éditorial
101
des traitements. Étant donné l’existence d’un rythme
physiologique nycthéméral de libération de l’acétylcholine,
avec une libération principalement diurne, et compte
tenu du fait que des taux d’acétylcholine trop élevés la
nuit altèrent les processus de consolidation mnésique, un
profil d’inhibition de l’acétylcholinestérase parallèle au
rythme de libération de l’acétylcholine – ce que permet
maintenant la forme retard de la galantamine grâce à son
profil pharmacocinétique – favorise l’adéquation avec le
rythme physiologique de la transmission cholinergique.
La deuxième piste thérapeutique est celle de la prévention
de la maladie d’Alzheimer. En dehors des formes génétiques
autosomiques, qui ne concernent qu’une fraction infime
des patients atteints de maladie d’Alzheimer (environ
1 000 ma-lades en France), la maladie d’Alzheimer
sporadique est probablement plurifactorielle, les facteurs
de risque constituant autant de cibles sur lesquelles
pourrait agir une stratégie de prévention. On sait que
l’isolement social et l’absence de stimulation cognitive
contribuent à une apparition plus précoce des symptômes
de la maladie d’Alzheimer, expliquant l’intérêt d’une
stimulation cognitive “préventive”, qui sera poursuivie
même après l’installation des symptômes. D’autres facteurs
de risque sont accessibles à un traitement préventif, en
particulier l’hypertension artérielle, qui est un facteur de
risque important. Des liens avec le syndrome métabolique
et l’insulinorésistance semblent exister mais demandent à
être mieux explorés. En revanche, le traitement hormonal
substitutif, la prise au long cours d’anti-inflammatoires ou
les statines n’ont pas atteint un niveau de preuve suffisant
pour démontrer leur efficacité préventive. Ce relatif échec
de la prévention explique la troisième piste représentée par
la neuroprotection, dont l’objectif est de ralentir l’évolution
d’une maladie d’Alzheimer identifiée le plus précocement
possible, voire au stade présymptomatique.
Cette troisième piste, même si elle est semée d’embûches,
est de trouver des médicaments neuroprotecteurs dont la
caractérisation répond à une double condition : avoir une
vision intégrée des différentes cibles pharmacologiques qui
peuvent être modulées ; mener une réflexion sur l’évaluation
clinique de ces agents neuroprotecteurs, qui doit être
articulée avec l’évaluation préclinique. C’est le mérite des
Laboratoires Janssen-Cilag d’avoir réuni un certain nombre
de spécialistes pour réfléchir à cette question et d’avoir voulu
prolonger cette confrontation d’idées par ce numéro de La
Lettre du Pharmacologue consacré à la neuroprotection.
Ce dernier vise à mieux appréhender les deux conditions
précitées, puisqu’il comporte deux parties : les principales
stratégies potentielles de neuroprotection et l’évaluation
clinique de ces agents neuroprotecteurs. Dans la première
partie, l’article de André Nieoullon fait une synthèse
très documentée des différentes stratégies susceptibles
d’induire une neuroprotection effective dans les maladies
neurodégénératives et montre bien la nécessité de les
intégrer à l’arsenal thérapeutique pour aboutir à une réelle
efficacité clinique. Cet article explique également le principe
de l’immunothérapie vis-à-vis de la protéine bêta-amyloïde,
stratégie qui est actuellement relancée par plusieurs
groupes industriels s’appuyant sur les enseignements tirés
de la première évaluation clinique de cette approche. Les
trois autres articles éclairent des stratégies particulières :
les potentialités de la stratégie antioxydante pour
l’article de Élodie Descamps et al. ; l’intérêt des facteurs
neurotrophiques par Brigitte Onténiente ; le rôle possible des
neurostéroïdes dans la neuroprotection par Yvette Akwa.
Dans l’article de Hervé Allain et al. est posé le problème de
l’évaluation clinique des agents neuroprotecteurs en termes
de méthodologie des essais cliniques, de choix des critères
de substitution et d’intérêt de la neuro-imagerie. Dans un
deuxième article, Hugo Geerts livre quelques réflexions
sur la méthodologie de ces essais en approfondissant
l’analyse des échelles fonctionnelles et des biomarqueurs
pour juger de l’effet neuroprotecteur. Enfin, dans un dernier
article, Martine Vercelletto et Hervé Allain font une
synthèse critique de tous les essais cliniques réalisés avec
des traitements potentiellement neuroprotecteurs dans la
maladie d’Alzheimer.
Ce numéro de La Lettre du Pharmacologue, qui fait le
point sur la question de la neuroprotection dans la maladie
d’Alzheimer et plus généralement dans les maladies
neurologiques, devrait ouvrir de nouvelles pistes de
réflexion et de recherche et montrer l’implication d’équipes
françaises dans ce domaine.
R. Bordet, département de pharmacologie,
CHU de Lille et faculté de médecine – université Lille 2,
50045 Lille Cedex
1
/
2
100%