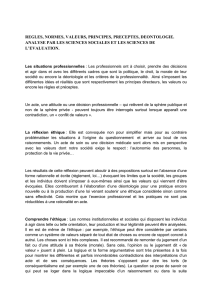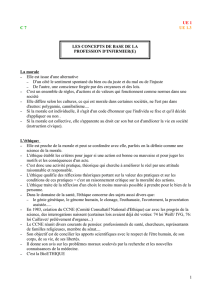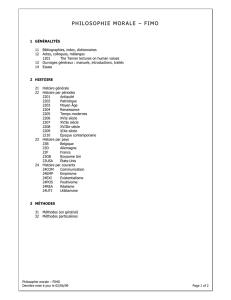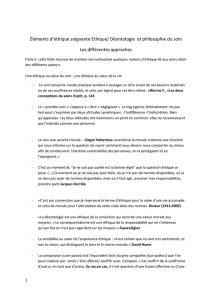La déferlante animalière - 3e-ANNEE-2012-2013

La déferlante animalière
Nicolas Journet
In Sciences Humaines, décembre 2012
Mis à jour le 12/12/2012
Tout ce que l’homme fait à l’animal est devenu, en l’espace de
quelques années, un sujet de préoccupation morale.
« A-t-on jamais songé à ce que signifie le fait de manger des animaux ? L’habitude, la banalité
de cette consommation ont éteint en nous toute réflexion à ce propos », écrit Florence Burgat
dans son dernier livre, Une autre existence (Albin Michel, 2011). Mais l’inquiétude, elle, ne
cesse de gagner du terrain. La vague de publications sur l’animal qui, depuis plusieurs années,
n’a cessé de croître déferle aujourd’hui : philosophes, juristes, éthologues, sociologues, et
même historiens s’emparent de l’animal non plus comme d’un objet à décrire ou à étudier,
mais comme d’un problème. Un problème de frontières en pleine révision d’abord. La biologie,
l’éthologie et la psychologie ne cessent de produire des données qui troublent les tranquilles
assertions de l’humanisme : il y a de l’intelligence et de la culture chez l’animal et sa
subjectivité n’est pas aussi évanescente que cela, et il y a de l’animal chez l’homme, plus
qu’on le pensait, ne serait-ce que par le massif patrimoine génétique qui nous lie aux grands
singes. Un problème éthique ensuite, qui secoue les bases de l’histoire humaine : de quel droit,
sinon biblique, l’homme peut-il bien se réclamer pour tuer, manger, exploiter, torturer toutes
sortes d’animaux, alors même qu’il s’interdit tous ces actes quand il s’agit de lui-même ? Ces
deux problèmes ne sont pas étrangers l’un à l’autre, même s’ils ne visent pas les mêmes
espèces. Les horrifiantes révélations sur les pratiques d’élevage et d’abattage des bêtes de
rente invitent à comparer le mal fait à l’animal au mal fait à l’homme : l’historien Charles
Patterson intitule, en 2008, son livre Un éternel Treblinka (Calmann-Lévy) et établit des liens
objectifs entre le traitement industriel de la viande et l’holocauste nazi. Il cite Theodor Adorno :
« Auschwitz commence quand quelqu’un regarde un abattoir et pense : ce ne sont que des
animaux. » Toutefois, comparaison n’est pas raison. Et les philosophes qui s’attaquent à ce
problème entendent le résoudre dans les règles de l’art et au regard des traditions existantes,
comme le montre Jean-Baptiste Jeangène Vilmer dans son Éthique animale (Puf, 2008). On
citera pour mémoire le philosophe Peter Singer qui, dans son livre fondateur (La Libération
animale, rééd. Payot, 2012), soulignait le poids moral de la souffrance animale, mesurable au
même titre que les « plaisirs et les peines » des humains. À partir de là, deux conséquences
pouvaient être tirées : soit on se limite à exiger que les bêtes vivent et meurent sans souffrir
(welfarism), soit on y ajoute l’argument antispéciste, qui dénonce la discrimination entre les
espèces au même titre qu’entre les races, les ethnies, les genres. Si la règle est que l’on
n’assassine pas les humains pour les manger, la même s’appliquera aux bêtes sensibles : on
ne les tuera pas pour exploiter leur corps et le végétarisme est une pratique morale, pas un
régime.
Les animaux veulent vivre
L’œuvre de Florence Burgat s’appuie sur une argumentation distincte. Elle souligne d’abord
que toutes les conjectures concernant les différences essentielles entre humains et animaux (le
langage, la conscience de soi) sont des prétextes. Les observateurs des bêtes de laboratoire et
d’élevage savent à quel point elles sont sujettes à la peur, l’angoisse et l’ennui. Ce ne sont
donc pas des espèces auxquelles on a affaire mais à des individus qui, à défaut d’être des
« sujets de leur vie », sont pleinement des « sujets de leur expérience » : les animaux, écrit-
elle, « veulent vivre », même s’ils ne font pas de projets comme les humains. Leur existence a
donc une valeur, que l’on ne tiendra pas pour négligeable. Et elle conclut qu’au bout du

compte, il n’y a pas d’autre idéal éthique que de mettre fin à l’exploitation systématique des
animaux.
Sur ce point, elle tombe d’accord avec le raisonnement juridique développé par Marcela Iacub
dans ses Confessions d'une mangeuse de viande (Fayard, 2011). M. Iacub met le doigt sur un
paradoxe : bien que les animaux soient protégés en droit contre les mauvais traitements, ils
peuvent être privés de vie pour n’importe quel motif, comme avoir été abandonnés par leur
maître. C’est, à ses yeux, la preuve d’une incohérence totale qui ne peut être résolue que par
l’abandon du régime carnivore.
Contre l'animalisme
Il faut bien reconnaître que cette déferlante animalière, même si elle reste sans grand effet,
capte d’autant plus d’audience que ses bonnes intentions s’imposent. Pourtant, la critique
existe. Trois exemples, au moins, méritent d’être relevés. D’abord, la posture de Jocelyne
Porcher, agrobiologiste qui, faisant l’éloge de l’élevage traditionnel contre l’industriel, fustige
l’antispécisme et le végétarisme éthique. Pour elle, les animaux de rente ont droit à une
existence conforme à leurs besoins spécifiques, mais n’en ont pas moins vocation à mourir
pour être mangés : c’est la condition de survie de leur espèce.
Dominique Lestel, philosophe, conteste aussi l’évidence éthique du végétarisme, mais pour des
raisons autres. Dans son Apologie du carnivore (Fayard, 2011), il proclame la commune
animalité de l’homme et du reste du vivant, et relève cette loi universelle que les espèces se
tuent et se mangent entre elles. La règle morale qui voudrait que l’homme s’abstienne de le
faire serait donc une exception, puisque l’on ne peut attendre des animaux qu’ils observent
une telle règle. Donc, le végétarisme instaure une supériorité morale de l’homme sur l’animal
et restaure un humanisme que les antispécistes prétendent abolir : il y a contradiction dans les
termes. L’argument a été contesté par un antispéciste, Pierre Sigler, comme simplement
rhétorique.
Étienne Bimbenet, lui, s’y prend de manière plus classique : il nie d’une part que l’être humain
soit encore un animal, car capable de porter une « attention métaphysique et désintéressée au
monde qui l'entoure ». Cela justifie que tout autre espèce apparaisse à l’homme comme
« autre », et cela suffit à l’exclure du statut de « sujet de droit », qui relève de
l’anthropomorphisme et du « zèle égalitariste ». En revanche, É. Bimbenet reprend à Jacques
Derrida l’idée que l’on peut « prendre soin de ce qui est au-delà de la frontière ». Autrement dit
qu’il est très possible de formuler des normes limitant la souffrance des animaux. Mais il reste
l’adversaire convaincu de toute formule qui, peu ou prou, proclamerait que l’animal est « un
humain comme les autres ».
1
/
2
100%