PDF du numéro

Editorial Les C@hiers de Psychologie Politique :
ciseler des paroles sur du virtuel est-il un défi bien raisonnable?
Articles La psychologie politique :
le retour d'une discipline inattendue
LA DÉMOCRATIE, LA CITOYENNETÉ ET L'ARGENT
MULTICULTURALISME ET COMMUNAUTARISME
RATIONALITÉ ET MANIPULATION
Connaissance des passions politiques
Platon, Machiavel, Tocqueville
Communications
brèves
CONSIDERATIONS PSYCHO-POLITIQUES SUR UNE
ACTUALITE DE CRISE :
LE 11 SEPTEMBRE 2001
Entretiens et
débats LANCER UN DEBAT : La fragmentation des sciences humaines et
l'absence d'un projet de société
La norme d’internalité, un concept de psychologie sociale libérale ?
Chronique des
livres Traité de la servitude libérale
de Jean Léon Beauvois
In memoriam Rodolphe Ghiglione et la politique

Les C@hiers de Psychologie Politique :
ciseler des paroles sur du virtuel est-il un défi
bien raisonnable?
Je ne présente pas ici l'aboutissement d'un projet éditorial, mais l'idée d'un renouveau
transdisciplinaire à la recherche des paradigmes nouveaux et perdus de surcroît. C'est
une initiative où la forme et le fond s'épaulent réciproquement. L'électronique est une
bien étrange chose. Que penser d'une revue sans l'odeur d'encre et sans le craquement
du papier ? Et encore, presque sans intermédiaires. Revue ouverte, mais dans le cadre
d'une démarche universitaire rigoureuse. D'où un comité de lecture (en aveugle) discret
et exigeant et un comité de rédaction pluriel, voire bigarré.
Car il s'agit de ciseler des paroles renaissantes sur du virtuel !
C'est un choix. Choix économique? Pas forcément. Mais choix communicatif. Il s'agit
de brasser par-delà nos frontières géographiques et disciplinaires. D'où un comité
scientifique international composé des figures appartenant à des cultures diverses.
Qu'ils soient tous et toutes remerciés. Choix d'ouverture à des disciplines qui depuis un
temps ne font que se croiser sans se parler, trop occupées à protéger leurs champs
privés de réflexion et à produire des micro-théories auto-satisfaissantes, dont l'effet
pervers est d'éloigner les unes des autres. Eclatement des grands paradigmes
fédérateurs. Fuite en avant qui ressemble plus à une dérive de la connaissance qu'à une
exploration des nouveaux mondes tout azimut. Fragmentation donc.
Finalement, il y a le choix d'une universalité concrète et d'une science moins
technicienne et plus humaine. Renoncer au scientisme sans sacraliser la science ni
tomber dans la tentation romantique. Regarder les yeux grands ouverts.
Car le temps nous est compté : la vie individuellement est trop courte et les tâches trop
urgentes. Je pense qu'une revue électronique peut nous aider à faire œuvre utile, à
condition de ne pas démissionner ni prendre nos désirs pour la réalité.
Alexandre DORNA
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
 52
52
 53
53
 54
54
 55
55
 56
56
 57
57
 58
58
 59
59
 60
60
 61
61
 62
62
 63
63
 64
64
 65
65
 66
66
 67
67
 68
68
 69
69
 70
70
 71
71
 72
72
 73
73
 74
74
 75
75
 76
76
 77
77
 78
78
 79
79
 80
80
 81
81
 82
82
 83
83
 84
84
 85
85
1
/
85
100%





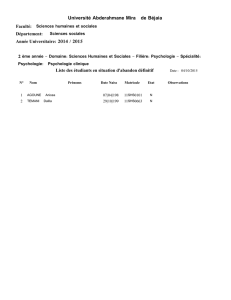

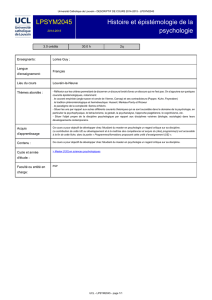
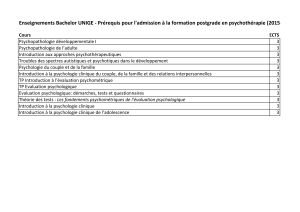
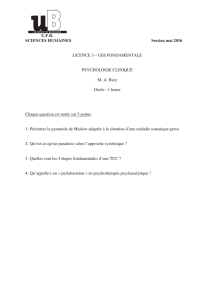
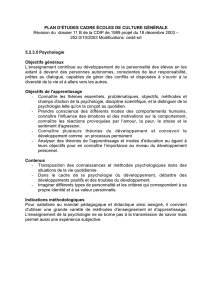
![Fiche projet n 2 [ PDF - 370 Ko ]](http://s1.studylibfr.com/store/data/008469253_1-179f3cc09c20e1657d654cc261bce6c5-300x300.png)