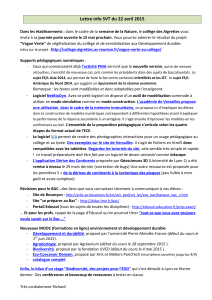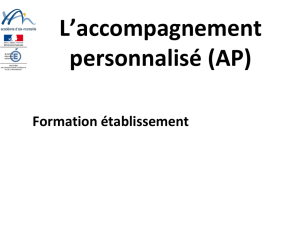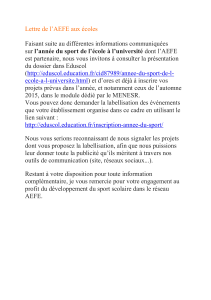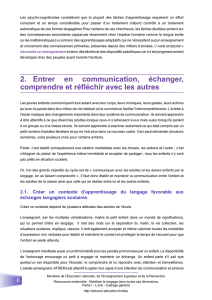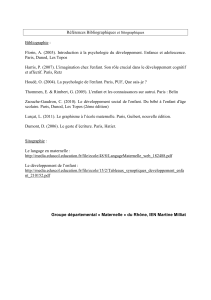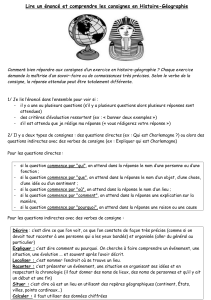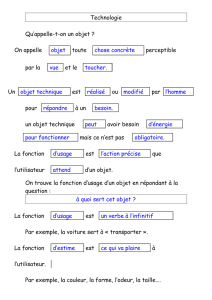Ress_c1_langage_cadrage (PDF-482.41 Ko-Nouvelle fenêtre)

Ressources maternelle
Mobiliser le langage
dans toutes ses dimensions
Cadrage général
éduscol
Retrouvez eduscol sur :
Septembre 2015


Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche
Ressources maternelle - Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions
Cadrage général
http://eduscol.education.fr/ressources-maternelle
33
Table des matières
1. Langue et langage à l’école maternelle 4
La langue 5
La langue de l’école vs la ou les langue(s) de la maison 5
Le langage 6
Le langage de la maison vs le langage de l’école 7
2. Les fonctions du langage à l’école 8
Le langage, instrument de la communication 8
Le langage, un instrument du développement et de la construction de soi 9
Le langage, un instrument de représentation du monde 10
Le langage, pivot des apprentissages et de la vie de l’école 10
3. Le langage dans toutes ses dimensions 12
Tableau d’indicateurs - Échanges langagiers dans la classe 13

Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche
Ressources maternelle - Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions
Cadrage général
http://eduscol.education.fr/ressources-maternelle
44
Le mot « langage » désigne un ensemble d’activités mises en œuvre par un individu lorsqu’il parle,
écoute, réfléchit, essaie de comprendre et, progressivement, lit et écrit. L’école maternelle permet à tous
les enfants de mettre en œuvre ces activités en mobilisant simultanément les deux composantes du
langage :
- le langage oral : utilisé dans les interactions, en production et en réception, il permet aux enfants de
communiquer, de comprendre, d’apprendre et de réfléchir. C’est le moyen de découvrir les caractéristiques
de la langue française et d’écouter d’autres langues parlées.
- le langage écrit : présenté aux enfants progressivement jusqu’à ce qu’ils commencent à l’utiliser, il les
habitue à une forme de communication dont ils découvriront les spécificités et le rôle pour garder trace,
réfléchir, anticiper, s’adresser à un destinataire absent. Il prépare les enfants à l’apprentissage de l’écrire-
lire au cycle 2. (Programme 2015)
Le programme de 2015 « réaffirme la place primordiale du langage à l’école maternelle comme condition
essentielle de la réussite de toutes et de tous. »
Le domaine « Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions » met en avant les deux objectifs prioritaires
de l’école maternelle : « la stimulation et la structuration du langage oral » et « l’entrée progressive
dans la culture de l’écrit ». Si une place déterminante est reconnue au langage dans les objectifs et les
pratiques de l’école maternelle, c’est parce qu’il est attesté que les inégalités scolaires et les difficultés
ultérieures de nombre d’élèves ont leurs principales sources dans le maniement du langage et de la
langue. L’école maternelle joue pleinement son rôle dans la prévention de l’échec scolaire en accordant
à ce domaine toute l’attention qu’il requiert sans précipiter les acquisitions ; ce faisant, elle concourt à
donner à chacun plus de chances d’épanouissement de sa personnalité, plus de chances aussi de faire
reconnaître toutes ses capacités.
1. Langue et langage à l’école maternelle
À l’école, le langage recouvre deux caractéristiques :
• le langage est essentiel pour le développement de l’enfant et pour tous ses apprentissages puisque
c’est une dimension, un outil et une condition de l’acquisition de nombreuses autres compétences ;
• il est aussi mobilisé en permanence, intégré à toutes les activités et à la vie de l’enfant dans
l’école parce qu’il s’acquiert en situation. Cette priorité ne se conçoit pas aux dépens des autres
domaines d’activité mais à partir d’eux.
C’est en s’appropriant progressivement les différents usages et les différentes fonctions du
langage que l’enfant acquiert une langue.

Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche
Ressources maternelle - Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions
Cadrage général
http://eduscol.education.fr/ressources-maternelle
55
La langue
La langue est un produit social et culturel. Convention adoptée par une communauté linguistique, elle
constitue un système complexe régi par des régularités que l’on peut observer, objectiver. Tout locuteur
d’une langue a une connaissance intuitive de ses règles en dehors de tout apprentissage explicite. Une
langue n’est pas un objet figé ; c’est une construction humaine qui évolue dans le temps et s’enrichit de
croisements et d’emprunts.
L’usage spontané que nous faisons de notre langue maternelle nous masque qu’elle organise le monde,
les données de l’expérience, d’une certaine façon qui est relative et non universelle. L’apprentissage des
langues étrangères nous en fait prendre conscience ; par exemple, là où le français utilise le même mot
(mouton ou veau) pour désigner l’animal et la viande que l’on achète chez le boucher, l’anglais distingue
les deux réalités en utilisant des mots différents (mutton/sheep ; calf/veal). De même les Inuits établissent
des distinctions subtiles entre divers types de glace. Le mot générique siku est enrichi de plusieurs
autres exprimant des nuances : « première couche de glace mince », « glace fabriquée », « glace sur les
végétaux », « glace fissurée », etc. C’est dire qu’en apprenant à parler dans une langue, nous apprenons
à voir le monde d’une certaine façon, à en catégoriser les composantes, et, inversement, en explorant le
monde par l’action, l’expérimentation ou la lecture, nous apprenons notre langue et ses différents usages,
plus ou moins normés. La langue ne constitue pas une nomenclature qui ferait correspondre des mots
à une liste stable et universelle d’objets et de concepts ; il n’y a pas de correspondance stricte entre les
langues.
La langue de l’école vs la ou les langue(s) de la maison
On naît dans une langue ; les enfants, même les plus petits et ceux qui ne parlent pas encore ou ne
s’expriment pas de manière intelligible, sont imprégnés par cette langue depuis leur naissance, de sa
« musique » avant même leur naissance.
De nombreux enfants sont nés et ont commencé à grandir dans une autre langue : leurs acquis nombreux
et souvent non visibles – sensibilité à la prosodie et à la phonologie de leur langue, premières phrases
comprises et énoncées, etc. – sont en décalage quand ils arrivent dans le monde francophone de l’école.
Leurs repères sont comme annulés, parfois même avec leur prénom qui, prononcé à la française, ne
ressemble plus à ce qu’ils ont l’habitude d’entendre. Une partie des jeunes Français arrivant à l’école
maternelle disposent déjà de nombreuses connaissances de l’organisation formelle de leur langue qui est
celle de l’école, même s’il s’agit de connaissances encore « passives » qu’ils ne sont pas en mesure de
mobiliser en production et d’expliciter. Pour d’autres enfants, que le français soit leur langue maternelle
ou pas, l’expérience scolaire qui commence à l’école maternelle les introduit dans une langue nouvelle
qu’ils ont pu entendre dans leur entourage ou à la télévision, sans qu’elle leur ait jamais été adressée
personnellement. Ils vont devoir découvrir les agencements propres à la langue d’enseignement ; tant
qu’ils ne l’auront pas fait, la perception, la compréhension et la production du français resteront pour eux
plus coûteuses, et aussi plus risquées. (Consulter la fiche-repère N°3 Les enfants allophones)
Le programme de 2015 prévoie également un « éveil à la diversité linguistique », par des situations
ludiques et dans le cadre d’un enseignement programmé. Cet éveil, de fait, est déjà vécu par les enfants
allophones mais ils vont découvrir encore d’autres langues – étrangères, régionales ou la langue des
signes française –, différentes de celles dont ils ont connaissance. Les enfants monolingues dont la
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
1
/
17
100%