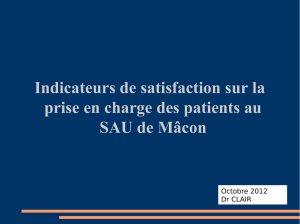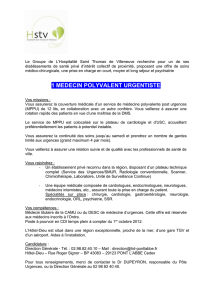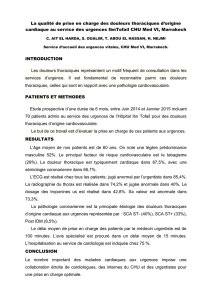article Morine

!
Coordination des soins en urgence. Le point de vue des médecins
généralistes.
Introduction
En France, la loi organisant la permanence de soins ambulatoires (PDSA) (16 avril 2013) et
le parcours de santé du patient « loi du médecin traitant » (13 aout 2004) ou plus récemment
(21juillet 2009) la loi Hôpital Patient Santé Territoire (HSPT) ont défini la médecine générale
(MG) comme acteur de soins primaires. Le référentiel métier de 2009 a explicité les
compétences d’un MG et son rôle de coordination1. En 2013, voulait « a ministre des affaires
sociales et de la santé, Madame Marisol Touraine, voulait « …replacer l’individu au cœur du
système de soins. Cela commence par la fin de l’opposition et du cloisonnement entre les
soins ambulatoires et l’hôpital ».
Quand un patient présente une urgence vraie ou ressentie, il peut soit consulter son MG en
urgence, soit faire appel à la permanence de soins (dont les formes sont variées), soit se
rendre directement dans un service d’urgence2. Le MG peut adresser le patient aux
urgences et dans ce cas doit coordonner les soins. Le médecin urgentiste (MU) qui reçoit un
patient peut faire appel au MG pour plus de renseignements, et à la sortie du patient, il doit
rédiger un courrier (articles R 4127-59 et R 4127-64 du code de santé publique).
Selon le code de déontologie médicale, une prise en charge urgente, globale, centrée sur le
patient, nécessite une coordination dépendante d’une communication de qualité
interprofessionnelle. La démographie médicale actuelle, confère aux MG, une charge de
travail de plus en plus importante3. Le nombre de consultations aux urgences augmente
chaque année4. La surcharge de travail dans ces deux corps de métier contribue à une
augmentation du nombre de syndrome d’épuisement professionnel rendant parfois les
relations difficiles5.
L’objectif principal de cette étude était de recueillir les différentes visions des MG quant à
leur rôle dans la coordination des soins en urgence. L’objectif secondaire était décrire les
relations entre MG et MU et d’identifier les facteurs d’amélioration, gage d’une meilleure
coordination au service du patient.

!
Méthode
Une étude qualitative, a été réalisée à l’aide d’entretiens semi-dirigés auprès de MG.
Le choix de la méthode qualitative a été fait pour rester au plus près dans la description du
vécu des MG, et ouvrir au maximum le champs des problématiques et des solutions
abordées, qui n'aurait pu être obtenu par un questionnaire fermé réalisé à priori.
Dans un premier temps, une revue bibliographique a été menée à l'aide de plusieurs
moteurs de recherches (Cismef, Sudoc, Google Scholar, PUBMED) avec les mots « relation
interprofessionnelle», « peer relation», « médecins généralistes », « general practice »,
« physician emergengy departement », « service d’urgence », « permanence de soins »,
« out of hours primary care ».
Un guide d’entretien a été réalisé à partir de la revue bibliographique, et a été modifié au
cours des entretiens, en fonction des thèmes abordés par les MG (annexe1). Ce guide a
abordé le rôle du MG, la permanence de soins et le parcours de soins coordonné, les
relations interprofessionnelles entre MG et médecins urgentistes, les outils de
communication, et les améliorations possibles de la coordination.
Les entretiens semi-dirigés ont été réalisés par l'auteur auprès de MG installés dans le
bassin Stéphanois (Saint-Étienne, vallées de l’Ondaine et du Gier), à leur cabinet.
Les MG ont été choisis par relation de proximité et effet boule de neige. Un échantillonnage
raisonné a été effectué en recherche de variation maximale, selon les critères suivants : âge,
lieu et ancienneté d’installation, exercice en maison médicale, avec associés ou seul,
participation aux gardes ou astreintes dans le cadre de la permanence d’accès aux soins,
diplômes complémentaires (capacité de médecine d’urgence ou le diplôme inter-universitaire
d’urgences ou autres) et travail régulier en établissement hospitalier.
Les entretiens ont été enregistrés, après consentement avec un dictaphone numérique, puis
dactylographié intégralement, grâce au logiciel de traitement de texte WORD ® et
anonymisés.
Les entretiens n'étaient pas limités dans le temps et la durée, mais fonction du MG
interviewé. Le nombre d'entretiens a été déterminé par l'obtention de la saturation des
données. La saturation des données était considérée comme obtenue lorsqu’au cours d’un
entretien, aucune nouvelle donnée n’apparaissait.
Dans un premier temps, une analyse thématique de chaque entretien, a permis de dégager
les thèmes abordés par les MG, puis une synthèse de ces thèmes a été réalisée pour la
présentation des résultats. Pour limiter la subjectivité de l’encodage, et de l'analyse
thématique une triangulation a été réalisée par l'auteur, et son directeur de thèse.
!
!
!
!
!
!
!

!
Résultats
16 MG, 10 hommes et 6 femmes, exerçant majoritairement en ville et en groupe, depuis 18
ans en moyenne, ont été interviewés entre Novembre 2012 et Février 2013 (annexe2). Les
entretiens (E) ont duré en moyenne près de 17 minutes, variant de 7 à 33 minutes. La
saturation des données a été atteinte au quatorzième entretien, et confirmée par les deux
derniers entretiens.
Représentation du rôle des MG dans le parcours du patient en urgence
Tous les MG interrogés ont défini leur profession comme une médecine de « soins
primaires ». Cet accord fort s’est illustré par les termes de « pivot central » (E3), de
« médecin de famille » (E3) ou encore de « premier recours » (E3, E7, E10), parfois en
urgence : « J’appelle le 15, et j’essaie d’y aller rapidement » (E11). Des limites à la continuité
des soins ont été soulignées : J’essaie d’être assez disponible
[
…
]
dans la mesure où je suis
là » (E6).
Les MG se sont tous reconnus une compétence de coordination des soins « On est au
centre de la coordination » (E9), et particulièrement en urgence, même si le mot n’était pas
prononcé : « Déceler le caractère urgent et diriger le patient » (E8).
La plupart des MG essayait d’éviter une hospitalisation : « J’essaie de garder au maximum
les gens à la maison » (E1). Cet évitement a été encore plus marqué pour l’hospitalisation
aux urgences décrites comme « surchargées », en privilégiant une hospitalisation directe
dans un service spécifique : « Je me débrouille plutôt avec la spécialité concernée, et
j'essaie de faire passer le moins possible mes patients au urgences » (E7), « j'essaie de leur
trouver une place
[
…
]
plutôt que de les laisser attendre aux urgence » (E12). La majorité des
MG ont dit orienter en dernier recours leurs patients dans les services d’accueil des
urgences : « Globalement, on utilise très peu les urgences » (E15).
Certains MG ont parlé d’ « éducation ». « Avant de se présenter spontanément aux
urgences, le patient devrait avoir le réflexe d'appeler le médecin de famille pour savoir ce
qu'il doit faire" (E3). Cette éducation a semblé nécessaire aux yeux des MG puisque « la loi
du médecin traitant n’a absolument rien changé », avec des patients « manquants
d’informations » (E1, E4, E10, E12).
Pendant la PDSA, la régulation du centre 15, l’ouverture des « maisons médicales de
gardes (MMG) » (E3, E4, E6, E11, E15), ou encore le système de « SOS médecin » (E4) en
ville, ont été jugés imparfaits : « Il y a toujours des patients qui consultent directement les
urgences sans passer par toi » (E6).
Pour désengorger les services d’urgences, la moitié des MG interrogés a imaginé un tri des
patients à l’entrée des urgences, avec « le droit pour les médecins urgentistes de réorienter
directement " (E3), et parallèlement « un accueil permanent de médecine générale " (E7),
autrement dit : " Un accueil des urgences bipolaire avec une régulation » (E14’). Certains ont
repris l’idée « d’une unité d’urgence spécifique aux personnes âgées, proposée par le Pr
Gonthier » (E7). Les deux systèmes, gériatrique et médecine générale, pourraient mieux
prendre en charge « tout le côté psycho-social » (E15).
Plusieurs MG ont identifié des limites à la modification de l’organisation du service des
urgences : « Les consultations rapides sont un apport financier important pour l’hôpital »
(E7). Un MG (E14) évoque « les déserts médicaux » dans certaines régions. Le problème du
coût de la consultation, surtout en garde a clairement été décrit : « Il reste un frein à la
maison médicale, il faut payer » (E6), « aux urgences, ils ne paient pas » (E15).

!
Vécu des relations MG-MU
Les relations des MG avec les MU étaient très hétérogènes oscillant entre l’excellence :
"Très bonnes
[
…
]
souvent amicales, le plus souvent cordiales " (E1) et « l’absence de
relation » (E10, E13, E14, E15). La notion de relations « assez restreintes" (E6) est illustrée
par un adjectif fort : « Anonymes, relations anonymes » (E4). La majorité des MG a décrit
des relations parfois tendues : "Ça m'est arrivé de me faire jeter » (E6), « j’ai été parfois pas
insultée, mais pas bien loin » (E7).
La remise en question de l’indication de l’hospitalisation du patient par le MU a pu être
source de conflits : « Vous pensez vraiment que c'est une urgence votre patient ? » (E13).
« L’approche globale » biomédicale, mais aussi psycho-sociale, du patient est parfois mal
comprise par le MU. L’admission en urgence des personnes âgées illustrent ce problème
pour les MG : « Des fois, les mamies ce n'est pas des vraies urgences mais si on les envoie
c'est qu'on ne peux plus les gérer à la maison » (E2), « les personnes âgées sont très mal
reçues » (E7).
Cette incompréhension donne parfois l’impression d’un jugement du MG par le MU : « Des
fois c'est un peu dur, les médecins urgentistes ne comprennent pas du tout ce qu'on fait, ils
n'ont peut être jamais vu de la médecine de campagne… un œil un peu critique comme si on
était mauvais » (E2).
La « courtoisie » (E6) a été retrouvée comme un gage de « qualité de prise en charge des
patients » (E6). Pour la moitié des MG, les difficultés relationnelles avec les MU étaient « un
problème de communication " (E3). Plusieurs MG ont souligné l’importance de l’humilité :
« Rester modeste
[
…
]
on a besoin de tout le monde, c'est compliqué l'urgence
[
…
]
l'arbre
peut cacher la forêt
[
…
]
ne pas se prendre pour le grand YAKA qui sait tout " (E8). Pour
mieux se comprendre et garantir cette modestie, des échanges sont proposés : "Il faut que
chacun se mette à la place des autres " (E1), « certains urgentistes, qui ont la grosse tête,
devraient passer une fois dans leur vie dans les cabinets de médecine générale … si ils
avaient été à notre place, ils auraient fait exactement pareil " (E2) et inversement, un MG a «
envie d’y aller de temps en temps, une après-midi, de bosser avec eux » (E11). Des
« enseignements post-universitaires (EPU) » (E11), des « réunions » (E15) sont aussi
envisagés. À l’inverse, un MG (ancien urgentiste) ne ressent pas le besoin d’améliorer la
coordination des soins entre MG et MU, car il en est très « satisfait » (E10).
La moitié des MG interrogés a décrit cette hétérogénéité relationnelle comme « personnels-
dépendants et urgences-dépendantes » (E9). Les urgences des cliniques privées et des
centres hospitaliers généraux (CHG), sont préférées aux urgences du centre hospitalo-
universitaire (CHU) : « Relations plus simples avec les urgentistes de cliniques » (E14), « à
St Chamond, les relations se passent très bien,
[
…
]
au CHU c'est différent
[
…
]
ils sont un
peu en décalage avec notre pratique » (E9), « À Firminy,
[
…
]
ils sont plutôt bien reçus et
gentiment si c'est urgent, alors qu'à Nord, ils sont odieux" (E7). Pour certains MG, si on
connaît personnellement le MU, les relations sont meilleures : « Je connais tous les vieux et
tous les vieux me connaissent
[
…
]
espèce de solidarité " (E14’), « moi, c'est biaisé, car je les
connais tous à Firminy » (E1). Enfin, certains ont noté une « évolution positive » (E11),
puisqu’avant il y avait un « vrai mur entre les urgences et le cabinet de médecine générale »
(E3).
Améliorer la coordination et la communication par des outils
Lorsqu’ils adressent un patient aux urgences, la quasi-totalité des MG a déclaré rédiger des
courriers, qu’ils donnent au patient ou aux ambulanciers : « Les patients partent tout le
temps avec un courrier dans les poches » (E13). Le contenu des courriers a été décrit
comme « suffisamment explicatif » (E3), « détaillé » (E4), reprenant les antécédents, les
allergies, le traitement, la clinique mais aussi formulant des hypothèses diagnostiques. Un
MG a fait part de sa peur « d‘induire en erreur » (E8) et s’abstient donc d’hypothèses

!
diagnostiques. Certains ont déclaré utiliser leur « logiciel informatique qui reprend les
antécédents » (E3). Le dossier médical partagé (DMP) ou l’uniformisation des logiciels
médicaux sont retrouvés comme outils facilitateurs. Le domicile et le fait de ne pas être
informatisé (pour un MG) a imposé la forme manuscrite : dans ces situations, les MG
insistent sur la lisibilité : « J’essaie de ne pas faire des torchons » (E6). Peu de MG ont
évoqué la rédaction d’un courriel et de ses inconvénients : « On pourrait faire un mail, mais il
va retomber où ? » (E4).
L’appel téléphonique a été retrouvé en fonction du degré d’urgence : « Quand il doit être pris
en charge rapidement » (E15), ou du contexte psycho-social : « Contexte particulier » (E13).
Les MG ont appelé plus facilement les cliniques ou les CHG du fait de l’accessibilité des MU
et ont déploré l’absence de présentation de l’interlocuteur, « les gens qu’on a au téléphone
ne se présentent jamais». Certains MG ont souligné que la différence entre les secteurs
public et privé, les poussent à appeler la clinique : « À l’hôpital, on sait qu’ils vont se
débrouiller pour le prendre en charge… service public
[
…
]
à la clinique, on va se méfier…»
(E4). Peu de MG (E3, E4, E9, E15) ont déclaré téléphoner systématiquement aux urgences
le plus souvent par « manque de temps » (E4, E11). Certains MG se sont déclarés
« disponibles » si les MU les rappellent pour des informations complémentaires (E3, E6). Un
MG passait directement dans le service d’urgences concerné : « Souvent je vais aux
urgences le soir voir mes patients, et pour expliquer » (E11).
Un accord fort s’est dégagé pour regretter l’absence, ou le retard de compte-rendu
d’hospitalisation, en particulier quand le patient s’est rendu seul aux urgences : « Ils n'aiment
pas recevoir de patients sans courrier, mais nous, on n'aime pas que les patients retournent
chez eux sans savoir ce qui s'est passé" (E13). Un MG a trouvé « certains courriers
inutiles » (E10). Là encore les MG ont noté une différence entre les cliniques, les CHG et le
CHU : « Jamais de retour avec le CHU » (E9). Pour plusieurs MG « ça s’est amélioré »
(E14) ; au contraire un MG a trouvé que la situation « s’est dégradée avec les années
[
…
]
c’est désolant » (E13).
Le compte-rendu, quand il existe, était soit « remis aux patients » (E4) soit reçu au cabinet et
les MG le décrivaient comme « succinct » (E14) sous la forme d’une petite « fiche de
transmission » (E3), avec « les résultats des examens complémentaires » (E10). Les MG
décrivaient aussi « un vrai courrier, si le patient est resté plus longtemps » (E2).
Ce compte rendu a été souhaité « systématique » (E5) et « très rapide, voire automatisé »
(E4), il pourrait prendre la forme d’un courrier, mais « le fax, le téléphone et le courriel »
(E11) ont été évoqués : « L’important, c'est de savoir ce qu'ils pensent du patient » (E5).
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
1
/
13
100%