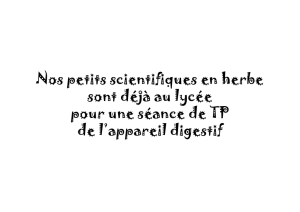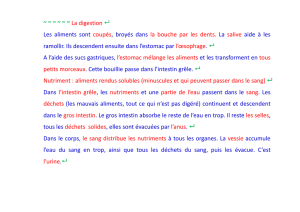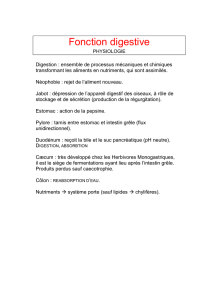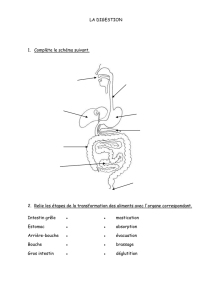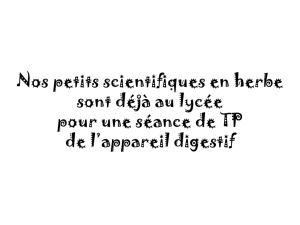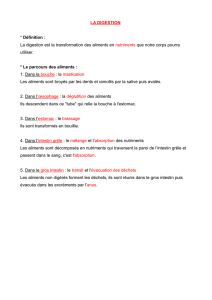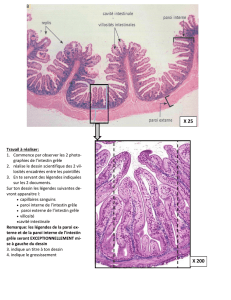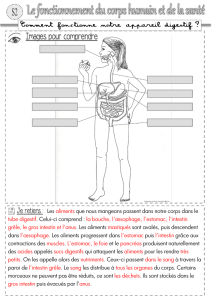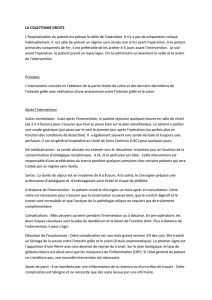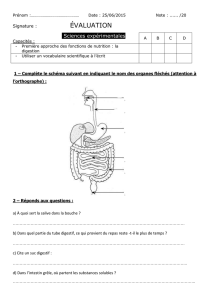Adénocarcinome de l`intestin grêle

338 | La Lettre du Cancérologue • Vol. XVIII - n° 7 - septembre 2009
MISE AU POINT
Adénocarcinome de l’intestin
grêle : mise en place
d’un observatoire français
Small bowel adenocarcinoma
P. Afchain *, A. Zaanan*, N. Carrere**, T. Aparicio***
* Service d’oncologie, hôpital Saint-
Antoine, Paris.
** Service de chirurgie digestive,
hôpital Purpan, Toulouse.
*** Service de gastroentérologie,
hôpital Avicenne, Bobigny.
Épidémiologie
Incidence
Les adénocarcinomes de l’intestin grêle (AIG) sont
des cancers rares. Ils représentent moins de 2 % de
l’ensemble des tumeurs digestives (1), mais sont la
première cause de tumeurs malignes de l’intestin
grêle, devant les tumeurs endocrines, les lymphomes
et les tumeurs stromales.
Une étude réalisée à partir du registre américain
National Cancer Data Base a recensé 14 253 tumeurs
de l’intestin grêle durant la période 1985-1995 (2).
Le type histologique le plus fréquent était l’adéno-
carcinome (35 % des tumeurs) suivi des tumeurs
carcinoïdes (28 %), des lymphomes (21 %) et des
sarcomes (10 %). Parmi les 4 995 AIG, la localisa-
tion duodénale était la plus fréquente (55 % des
cas), suivie des localisations jéjunale (18 %) et
iléale (13 %). L’AIG est un peu plus fréquent chez
l’homme (53 % versus 47 % chez la femme) ; l’âge
moyen au diagnostic était de 65,4 ans. Dans cette
étude comme dans d’autres grandes cohortes améri-
caines, une augmentation de l’incidence des AIG
est observée, notamment entre les périodes 1985-
1990 et 1991-1995 (2 174 nouveaux cas versus 2 821),
en partie du fait de l’augmentation de l’incidence
des tumeurs du duodénum (3). Aux États-Unis, on
compte approximativement 5 300 nouveaux cas et
1 100 décès par an (4).
En France, les mêmes tendances sont observées :
augmentation de l’incidence de tous les types de
tumeurs de l’intestin grêle (346 cas à partir du
registre des cancers digestifs de la Côte-d’Or [Bour-
gogne]) [5]. Les tumeurs les plus fréquentes sont les
adénocarcinomes (40 % des tumeurs), suivis des
tumeurs endocrines (31 %), des lymphomes (20 %)
et des sarcomes (9 %). L’âge moyen au diagnostic est
de 63,5 ans chez les hommes, plus souvent atteints,
et 69,5 chez les femmes. L’incidence annuelle
rapportée sur les AIG pour la période 1989-2001
était de 0,31/100 000 habitants chez l’homme
et de 0,23/100 000 habitants chez la femme. En
France, l’incidence annuelle peut donc être estimée
entre 100 et 200 cas.
Facteurs étiologiques
La différence importante de fréquence entre les AIG
et les adénocarcinomes colo-rectaux suggère des
variations dans les processus de carcinogenèse. Les
hypothèses se rapportent à la différence de fonc-
tion entre l’intestin grêle et le côlon, où le temps de
contact entre les cellules intestinales et les xéno-
biotiques ou les aliments cancérigènes est plus
court en raison de leur transit rapide au niveau du
grêle, d’un équipement cellulaire enzymatique diffé-
rent, de l’absence de bactéries dans le grêle dimi-
nuant potentiellement la production de composés
cancérigènes, et, vraisemblablement, d’un taux de
folates (au rôle protecteur) plus élevé. L’incidence
de certains facteurs environnementaux, profession-
nels (travail dans le textile ou dans l’agriculture)
ou comportementaux (consommation de tabac,
de bière et d’alcool fort) a été rapportée à partir de
certains registres (6, 7). D’autres études suggèrent
que la consommation de certains aliments comme la

La Lettre du Cancérologue • Vol. XVIII - n° 7 - septembre 2009 | 339
Résumé
Les adénocarcinomes de l’intestin grêle sont des tumeurs rares. Les études sur cette pathologie sont peu nombreuses,
hétérogènes et souvent anciennes. La localisation la plus fréquente est le duodénum. Leur survenue est le plus
souvent sporadique, mais il existe des pathologies prédisposantes (maladie de Crohn, syndrome génétique, plus
rarement maladie cœliaque). Les symptômes sont peu spécifiques et leur exploration reste difficile, bien que d’im-
portants progrès aient été faits récemment en matière d’explorations radiologiques et endoscopiques. Le traitement
princeps reste l’exérèse chirurgicale. Mais l’existence d’un envahissement ganglionnaire s’avère être le principal
facteur pronostique et pose donc la question du traitement adjuvant. L’efficacité des chimiothérapies n’a cependant
jamais été démontrée par des études randomisées, même en situation métastatique, bien que celles comportant des
sels de platine semblent les plus efficaces. Aucune étude prospective n’a évalué le bénéfice d’une chimiothérapie
adjuvante. D’où l’intérêt du regroupement des données sous la forme d’un observatoire, qui permettra une analyse
prospective des données thérapeutiques et épidémiologiques, afin de pouvoir proposer une référence thérapeutique.
Mots-clés
Tumeur rare
Carcinogenèse
Syndrome HNPCC
Facteurs pronostiques
Chimiothérapie
Observatoire
Highlights
Small bowel adenocarci-
nomas are rare tumours. The
more frequent primary site
is duodenum. These tumours
are most often sporadic, but
there are some predisposing
diseases (Crohn disease,
genetic syndrome and, rarely,
celiac disease). Series collecting
data about small bowel cancer
are rare, heterogeneous and
spread across long periods
of time. Clinical symptoms of
small bowel tumours are not
specific. Investigations for diag-
nosis are difficult but signifi-
cant improvements have been
made recently in radiological
and endoscopic investigation.
The main treatment is surgical
resection. The main prognosis
factor is nodes invasion. The
efficacy of chemotherapy has
never been established by
randomised trials. Chemo-
therapy with platinum salts
seems to be the more efficient
for metastatic tumour treat-
ment. No prospective study
has evaluated the benefit of
adjuvant chemotherapy. An
observatory gathering data will
therefore be useful to optimize
therapy.
Keywords
Rare tumour
Carcinogenesis
HNPCC
Prognosis factor
Chemotherapy
Observatory
viande rouge, le sucre ou les féculents augmenterait
le risque de cancer de l’intestin grêle, alors que la
consommation de fibres, fruits, légumes et poisson
réduirait ce risque (8-10).
Enfin, on connaît de mieux en mieux l’incidence de
certaines altérations génétiques, notamment dans
la carcinogenèse colo-rectale (11). Les AIG partagent
avec leurs homologues du côlon beaucoup d’aspects,
en particulier celui de la séquence adénome-adéno-
carcinome. On retrouve aussi des mutations du gène
APC ou des gènes de réparation des altérations de
l’ADN responsables du phénotype RER avec instabi-
lité microsatellite. Les AIG peuvent aussi compliquer
les maladies inflammatoires du grêle, et en particu-
lier la maladie de Crohn, après 15 à 20 ans d’évo-
lution. Ces similitudes plaident pour une parenté
génétique entre les deux types d’adénocarcinomes.
Les altérations génétiques des AIG sont résumées
dans le tableau I. Il est intéressant de noter que
les mutations de K-ras et APC semblent plus rares
dans les cancers de l’intestin grêle que dans ceux
du côlon, ce qui suggère qu’il pourrait exister une
carcinogenèse ne suivant pas la séquence adénome-
adénocarcinome, alors que ce mécanisme est majo-
ritaire dans la genèse des cancers du côlon (13).
Enfin, dans la série de M. Planck et al. (15) portant
sur 89 adénocarcinomes du grêle, une instabilité
microsatellite a été retrouvée dans 17 % des cas,
comme dans les cancers du côlon, mais qui n’était
en rapport avec une extinction de la protéine hMLH1
que dans la moitié des cas. Dans cette série, chez
les patients de moins de 60 ans, l’extinction de la
protéine hMSH2 était aussi fréquemment retrouvée
que l’extinction de hMLH1. À côté des maladies avec
altérations génétiques favorisantes, on distingue
des pathologies digestives prédisposantes, comme
certaines polyposes (polypose adénomateuse fami-
liale [PAF], syndrome de Peutz-Jeghers), le syndrome
HNPCC (cancer du côlon héréditaire sans polypose),
la maladie de Crohn, ou encore la maladie cœliaque.
La PAF est caractérisée par l’existence de centaines
de polypes adénomateux au niveau du côlon et du
rectum. Leur potentiel de dégénérescence passant
par la séquence adénome-adénocarcinome est lié
à une mutation sur le gène APC. Dans une série de
1 255 patients atteints de PAF regroupant plusieurs
registres, 57 patients (4,5 %) ont développé un
adénocarcinome du tractus digestif haut. Parmi
ceux-ci, il y avait 29 adénocarcinomes du duodénum
(51 %), 10 ampullomes (18 %) et 7 adénocarcinomes
gastriques (12 %). Le jéjunum et l’iléon correspon-
daient respectivement à 5 (8,8 %) et 1 (1,8 %) des
localisations tumorales (19). Il n’y a pas d’aug-
mentation significative du risque de développer
un adénocarcinome du jéjunum ou de l’iléon chez
ces patients (20). Par comparaison avec la popu-
lation générale, le risque relatif d’avoir un adéno-
carcinome duodénal est de 330 (IC
95
: 132-681 ;
p < 0,001), et celui d’avoir un ampullome de 123
(IC95 : 33-316 ; p < 0,001) [19]. Environ 90 % des
patients atteints de PAF développeront des polypes
duodénaux avec un risque de dégénérescence ;
Tableau I. Principales anomalies génétiques rapportées dans les adénocarcinomes de l’intestin grêle.
Études n Mutations
de p53 (%)
Mutations
de K-ras (%)
Mutations
d’APC (%)
MSI
(phénotype RER) [%]
Blaker et al.
(12)
17 – – 18 12
Arai et al.
(13)
15 27 – 20 -
Wheeler et al.
(14)
21 24 – 0 5
Planck et al.
(15)
89 – – – 18
Nishyama et al.
(16)
35 40 6 – –
Scarpa et al.
(17)
12 67 42 60 25
Svrcek et al
(18)
27 52 – – 7
Taux de mutation attendu
dans les cancers du côlon
– 40-80 40-80 40-60 15-20

340 | La Lettre du Cancérologue • Vol. XVIII - n° 7 - septembre 2009
Adénocarcinome de l’intestin grêle : mise en place d’un observatoire français
MISE AU POINT
4 % d’entre eux auront un adénocarcinome du
duodénum avant l’âge de 70 ans, ce dernier repré-
sentant la cause principale de décès chez les
patients ayant eu une coloproctectomie (22, 23).
Un dépistage systématique des polypes duodénaux
et ampullaires est donc aujourd’hui recommandé
chez les patients atteints de PAF. Cependant, la
dégénérescence des AIG est un phénomène relati-
vement lent. En 4 ans, environ un tiers d’entre eux
se multiplieront et 10 à 15 % verront leur grade
histologique augmenter, ce taux de progression
étant de 73 % à 11 ans pour les adénomes ampul-
laires (21, 24). La classification des adénomes duodé-
naux d’A.D. Spigelman (25) permet de définir la
stratégie de surveillance (tableau II) : elle repose sur
le nombre, la taille, le type histologique et le degré
de dysplasie des polypes. On distingue les polyposes
mineures (stade I/II) et majeures (stade III/ IV), ces
dernières ayant quatre fois plus de risque de dégé-
nérer (26, 27). Les polypes découverts en endoscopie
de dépistage doivent être tous traités, par exérèse
locale endoscopique s’ils sont bénins, ou par exérèse
chirurgicale en cas de dégénérescence. Le risque de
récidive est important (21, 23, 28) et justifie parfois,
en cas de polypose sévère, une duodénopancréatec-
tomie chirurgicale préventive, avec ou sans conser-
vation du pylore, pour précéder le développement
de cancers duodénaux (29-31).
Le syndrome de Peutz-Jeghers, de transmission auto-
somique dominante, est caractérisé par la présence
d’une hyperpigmentation cutanéo-muqueuse, seule
ou associée à des polypes intestinaux hamartoma-
teux. Sa prévalence est de 1/200 000. Les mutations
du gène suppresseur de tumeur LKB1 (alias STK11)
[50 à 90 %] sont impliquées dans ce syndrome (32).
Les polypes hamartomateux apparaissent à l’ado-
lescence et sont le plus souvent localisés dans l’in-
testin grêle, mais ils peuvent exister à tous les étages
intestinaux. Une étude regroupant 6 publications a
estimé le risque relatif d’AIG à 520 (IC
95
: 220-1 306)
par comparaison avec la population générale (33).
Le syndrome HNPCC est associé à une mutation
au niveau d’un des gènes de réparation de l’ADN
responsable d’une instabilité microsatellite (hMSH2,
hMLH1, hMSH6, etc.). La publication de P. Watson
et H.T. Lynch rapportait que le risque relatif s’éle-
vait à 25 (34). Cependant, selon l’étude du registre
néerlandais, le risque relatif de développer un AIG
s’élevait à 291 (IC95 : 71-681) en cas de mutation
hMLH1, et à 103 (IC95 : 14-729) en cas de mutation
hMSH2 (35). Néanmoins, selon une étude de registre
finlandaise, le risque cumulatif au cours de la vie reste
faible, de l’ordre de 1 % (36). Il n’est pas recommandé
d’effectuer un dépistage systématique des AIG chez
les patients atteints de syndrome HNPCC. Mais la
question se pose et est de plus en plus d’actualité
grâce aux performances accrues des nouvelles tech-
niques d’exploration que sont la capsule endosco-
pique et l’entéroscopie à double ballon, notamment,
proposées par les auteurs d’une méta-analyse sur
les cancers de l’intestin grêle dans le syndrome de
Lynch au-delà de 50 ans (37). Enfin, en dehors d’une
prédisposition génétique, les AIG de grande taille
avec contingent villeux ou de localisation périam-
pullaire présentent également un risque de dégé-
nérescence (38).
Dès 10 ans d’évolution, la maladie de Crohn est
associée à un risque d’AIG (39). Le risque relatif
est de l’ordre de 20 (40, 41). Une étude française a
montré que la principale localisation était l’iléon, et
que l’éventuel AIG apparaissait plus tôt (quatrième
décennie) que chez les patients sans pathologie
prédisposante, mais avec un pronostic équivalent.
L’AIG survient le plus souvent dans une zone atteinte
par la maladie de Crohn. Le risque cumulé est de 0,2 %
à 10 ans et de 2,2 % après 25 ans d’évolution (42).
Une autre étude française récente suggère que les
patients ayant eu une résection de l’intestin grêle
ou un traitement prolongé par les dérivés salicylés
auraient un risque plus faible de développer un AIG
après une même durée d’évolution de la maladie (43).
La maladie cœliaque augmente le risque de tumeurs
de l’intestin grêle, en particulier en cas de mauvaise
observance du régime sans gluten. Dans une
enquête portant sur 395 cas de cancer de l’intestin
grêle (107 lymphomes, 175 adénocarcinomes, et
79 carcinoïdes), une maladie cœliaque préexistait
dans 13 % des cas d’adénocarcinomes et 39 % des
cas de lymphomes. Le siège des adénocarcinomes
était surtout jéjunal (44). Chez les patients avec
maladie cœliaque, le risque relatif était évalué à 10
(8 cas sur 11 000 patients) dans une étude de registre
suédoise avec un suivi moyen de 9,8 ans (45).
Tableau II. Polypose duodénale, classification de Spigelman (25).
Critères Score
1 point 2 points 3 points
Polypes (n) 1-4 5-20 > 20
Taille des polypes (mm) 1-4 5-10 > 10
Histologie Tubuleux Tubulo-villeux Villeux
Dysplasie Bas grade Bas grade Haut grade
1-4 points : stade I; 4-6 points : stade II; 7-8 points: stade III; 9-12 points : stade IV

342 | La Lettre du Cancérologue • Vol. XVIII - n° 7 - septembre 2009
Adénocarcinome de l’intestin grêle : mise en place d’un observatoire français
MISE AU POINT
Diagnostic
Circonstances et moyens diagnostiques
Les symptômes sont peu spécifiques. Il peut s’agir de
vagues douleurs abdominales, de troubles digestifs
à type de dysgueusie, de dyspepsie ou de lenteur
à la digestion, ou encore de troubles plus suspects
car plus francs, devant notamment faire évoquer un
syndrome de König (douleurs abdominales aiguës
cédant spontanément avec des bruits hydro-aériques,
des nausées ou des vomissements) en rapport une
obstruction incomplète de l’intestin grêle. Dans
une série du MD Anderson Cancer Center, 66 %
des 217 patients atteints d’AIG présentaient au
moment du diagnostic des douleurs abdominales,
notamment une occlusion (40 %), qui compliquait
plus souvent les tumeurs jéjunales ou iléales que les
tumeurs duodénales (47 % versus 34 % ; p = 0,06)
ou une hémorragie (24 %) [46]. Dans cette série,
les principales explorations contributives étaient
l’endoscopie haute (28 %) et la chirurgie (26 %).
Le saignement peut aussi être occulte. Ainsi, devant
toute hémorragie digestive ou anémie d’origine
digestive probable non expliquée par les examens
endoscopiques classiques (endoscopie œso-gastro-
duodénale et coloscopie totale), une exploration de
l’intestin grêle doit être réalisée. Jusque récemment, il
convenait d’effectuer une tomodensitométrie (TDM)
abdominopelvienne (47, 48) et/ou un transit de l’in-
testin grêle, mais leur sensibilité est de l’ordre de
50 % seulement. L’entéroscanner, la vidéocapsule ou
l’entéroscopie sont plus performants. L’entéroscanner
combine les avantages de la TDM spiralée et ceux du
double contraste au niveau du grêle, qui est rempli
d’eau par entéroclyse et dont la paroi est rehaussée
par l’injection de produit de contraste vasculaire. Il
a une sensibilité de 85 à 95 % et une spécificité de
90 à 96 % pour le diagnostic de tumeur de l’intestin
grêle (49, 50). La vidéocapsule endoscopique (VCE)
permet une exploration non invasive, en ambulatoire,
de l’intestin grêle sans anesthésie. Elle est contre-
indiquée en cas de syndrome obstructif (complet
ou non) en raison du risque d’occlusion. L’indication
principale de cet examen est donc l’exploration d’un
saignement digestif inexpliqué après gastroscopie et
iléocoloscopie. Une étude multicentrique européenne
analysant les résultats de l’exploration par VCE
quelle que soit l’indication a montré qu’un cancer
de l’intestin grêle était diagnostiqué chez 2,4 % des
patients explorés (51). Dans cette série, la VCE a été
bloquée chez 9,8 % des patients présentant une
tumeur de l’intestin grêle. La rentabilité diagnostique
de la VCE est supérieure à celle de l’entéroscopie
et du transit du grêle (52). Deux études ont évalué
sa sensibilité à 88,9 % et 95 %, et sa spécificité
à 95 % et 75 % pour le diagnostic de tumeur du
grêle dans le cadre de l’exploration d’un saignement
intestinal inexpliqué (53, 54). Enfin, l’entéroscopie
permet l’exploration du jéjunum et de l’iléon, mais
incomplètement dans la majorité des cas. Le déve-
loppement récent de l’entéroscopie à double ballon
a considérablement amélioré les performances de
cet examen, qui peut explorer la totalité de l’intestin
grêle dans presque 100 % des cas où une lésion n’em-
pêche pas la progression (55-57). Une étude chinoise
rapporte que, dans le cadre de l’investigation d’un
saignement inexpliqué, l’entéroscopie a permis de
mettre en évidence une cause de saignement dans
75 % des cas, laquelle était une tumeur de l’intestin
grêle dans 39 % des cas (55). La tolérance de cet
examen est bonne et les complications sont peu
fréquentes ; néanmoins, il est moins bien accepté que
la VCE et devrait donc être réservé à de potentielles
manœuvres endoscopiques (biopsie, polypectomie,
tatouage préopératoire) [56-57]. Enfin, l’entéro-
scopie à double ballon permet parfois le diagnostic
d’un AIG non vu par la VCE (57).
Le stade au diagnostic est le plus souvent avancé.
Dans la série de M.S. Talamonti et al., 38 % des
patients ont des métastases synchrones et 38 %
un envahissement ganglionnaire (58). Dans la série
étudiée au MD Anderson Cancer Center, la même
répartition par stade était retrouvée : 35 % de
patients avec métastases et 39 % de patients avec
envahissement ganglionnaire (46).
Bilan préthérapeutique
Il faut toujours considérer les deux temps explora-
toires : celui de l’extension de la maladie tumorale
(locale ou métastatique), et celui du terrain, qui doit
être compatible avec le traitement adéquat, et doit
permettre de détecter un facteur prédisposant à
prendre en compte dans le cadre de la surveillance.
Dans le cadre du bilan d’extension, selon les recom-
mandations du Thésaurus national de cancérologie
digestive 2009 (www.tncd.org), et comme pour toute
prise en charge de lésion tumorale, il est recommandé
de réaliser un examen clinique complet (évaluation
de l’état nutritionnel, recherche d’une adénopathie
de Troisier, d’un foie tumoral ou d’une carcinose). Les
examens paracliniques comporteront un scanner
thoraco-abdomino-pelvien – pour préciser l’exten-
sion locale de la tumeur et sa résécabilité, et pour

La Lettre du Cancérologue • Vol. XVIII - n° 7 - septembre 2009 | 343
MISE AU POINT
rechercher des métastases et des endoscopies diges-
tives (au moins gastrique et colique) qui recherchent
les lésions associées à une pathologie prédisposante.
Le dosage de l’ACE (et, en cas de normalité, le dosage
du CA 19-9), lorsqu’il est élevé au diagnostic, permet
une surveillance évolutive sous traitement. Pour
les localisations duodénales, une écho-endoscopie
digestive haute peut être réalisée pour mieux préciser
la résécabilité tumorale en l’absence de métastases.
En cas de pathologie prédisposant à des localisations
multiples sur l’intestin grêle, l’exploration de celui-ci
par entéroscopie, entéroscanner ou vidéocapsule (en
l’absence de lésion sténosante) doit être discutée.
La recherche ou le diagnostic d’une maladie prédis-
posante se fait souvent via des examens endosco-
piques digestifs et sanguins : le diagnostic de PAF,
comme celui de syndrome de Peutz-Jeghers, sera
suspecté à la coloscopie devant de nombreux
polypes adénomateux et complété par une consul-
tation de génétique. Pour dépister un syndrome
HNPCC, l’interrogatoire recherchera les antécé-
dents familiaux de cancers (côlon, rectum, estomac,
endomètre, ovaire, intestin grêle, uretère ou cavités
excrétrices rénales). Une instabilité microsatellite
sera recherchée sur la pièce opératoire pour tous
les patients de moins de 60 ans, ou quel que soit
l’âge en cas d’antécédent personnel ou familial au
premier degré d’un autre cancer du spectre HNPCC.
Une consultation d’oncogénétique sera proposée à
tout patient ayant deux parents atteints, dont un
avant l’âge de 50 ans, d’un cancer de ce spectre, à
tout patient ayant développé un cancer de ce spectre
avant l’âge de 40 ans, à tout patient de moins de
60 ans ayant une instabilité microsatellite, et à tout
patient, quel que soit l’âge, ayant un antécédent de
premier degré de cancer de ce spectre.
Enfin, pour dépister une maladie cœliaque, des biop-
sies duodénales recherchent une atrophie villositaire
ou une hyperlymphocytose intra-épithéliale. Un
dosage des anticorps antitransglutaminases (IgA
et IgG) et antiendomysium (IgG) et des immuno-
globulines est recommandé afin d’écarter un déficit
en IgA. En cas d’antécédent familial de maladie de
Crohn ou de symptomatologie clinique évocatrice,
un examen morphologique de l’intestin grêle et un
examen proctologique sont recommandés.
Pronostic
L’AIG est un cancer de mauvais pronostic, avec une
survie à 5 ans tous stades confondus inférieure à
30 % et une survie médiane de 19 mois (2). Le trai-
tement chirurgical reste le seul traitement poten-
tiellement curatif, bien que 40 % des patients
récidivent (58). La classification des tumeurs dépend
de l’extension en profondeur dans la paroi intestinale
et de l’envahissement, ganglionnaire ou à distance
(tableau III).
L’un des principaux facteurs pronostiques est le stade
TNM : la survie à 5 ans est de 65, 48, 35 et 4 % pour
les stades I, II, III et IV respectivement (2). En cas
d’envahissement ganglionnaire, la survie à 5 ans
est mauvaise (32 % dans l’étude de B.S. Dabaja
et al., et 28 % dans l’étude de M.S. Talamonti et
al.), ce qui rend licite la question d’un traitement
adjuvant, et nécessaire sa détermination comme
traitement efficace (46, 58). Le caractère complet
de la résection chirurgicale est également un facteur
pronostique (58).
Tableau III. Classification TNM (UICC 2002 – applicable uniquement aux adénocarcinomes).
Tx Renseignements insuffisants pour classer la tumeur primitive
T0 Pas de signe de tumeur primitive
Tis Carcinome in situ
T1 Invasion de la
lamina propria
ou de la sous-muqueuse
T2 Invasion de la musculeuse
T3 Invasion de la sous-séreuse ou extension au tissu périmusculaire extrapéritonéale ≤ 2 cm
(mésentère dans le cas du jéjunum ou de l’iléon ou rétropéritoine dans le cas du duodénum)
T4 Perforation du péritoine viscérale ou atteinte d’un organe de voisinage (autre anse intes-
tinale, mésentère, rétropéritoine > 2 cm ou paroi abdominale au travers de la séreuse et,
pour le duodénum, invasion du pancréas)
Nx Ganglions non évalués
N0 Pas de métastase ganglionnaire
N1 Atteinte des ganglions lymphatiques régionaux.
L’examen de 6 ganglions régionaux est nécessaire pour l’évaluation du statut ganglion-
naire. Cependant, en l’absence d’envahissement ganglionnaire, même si le nombre de
ganglions habituellement examinés n’est pas atteint, la tumeur sera classée pN0.
Mx Renseignements insuffisants pour classer les métastases à distance
M0 Pas de métastase à distance
M1 Métastases à distance (dont ganglions sus-claviculaires)
Classification par stades
Stade 0 pTisN0M0
Stade I pT1-T2N0M0
Stade II pT3-T4N0M0
Stade III Tous T N1M0
Stade IV Tous T tous N M1
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
1
/
9
100%