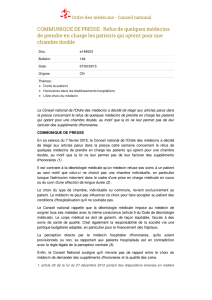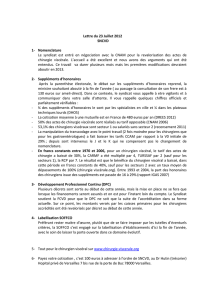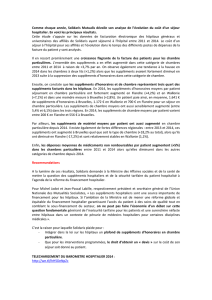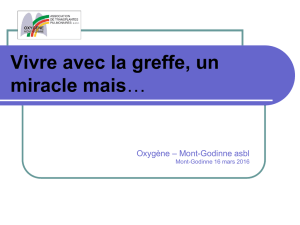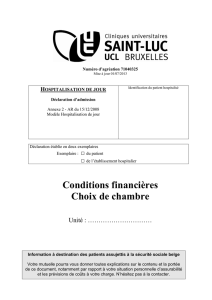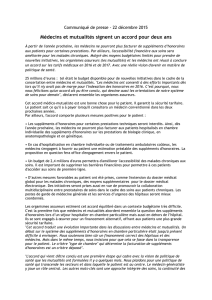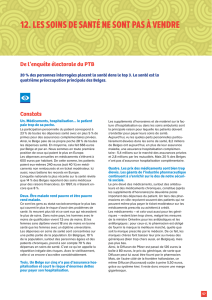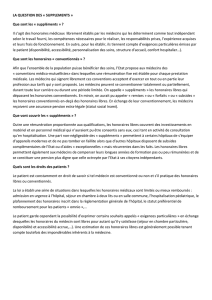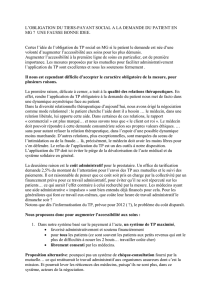MC-Informations Analyses et points de vue 251 50 ans de l’ASSI

MC-Informations
Analyses et points de vue
Périodique trimestriel de l’Alliance nationale des Mutualités chrétiennes 251
mars 2013
L’Agence InterMutualiste a soufé ses 10bougies
L’Agence InterMutualiste (AIM) existe depuis dix ans. Le 18décembre2012,
les mutualités ont célébré cet anniversaire par un séminaire. Conjointement
avec ses partenaires, l’AIM a dressé le bilan mais s’est également tournée
vers l’avenir et a débattu de la protection de la vie privée des prestataires
de soins face au droit à l’information pour le patient.
50 ans de l’ASSI
Les médias sociaux et les progrès tech-
nologiques changent déjà très concrète-
ment la relation des utilisateurs de soins
avec le système de santé. Peter Hinssen
est sans doute la gure la plus médiatique
de ces évolutions, à travers ses présenta-
tions et son livre au titre ambitieux : ‘The
new normal’. Les possibilités offertes par
les télécommunications (smartphone) et la
disponibilité de prols génétiques ne sont
que deux exemples de ce qui va changer la
façon dont les soins seront dispensés dans
un futur pas très éloigné
Evolution des dépenses et du budget des soins de santé sur la période
2005-2013 (en millions d’euros, données en prix 2013)
194 196 212 218 211 209 220 219 165 167 186 191 186 188 199 199
486 481 459 478 431 427 346 328 178 175 145 135 119 110 92 80
556 560 594 621 633 656 741 765
19 19 18 14 14
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
Coût moyen à charge du patient en euro
Tickets modérateurs
Suppléments matériels,
chambres et autres
Suppléments d'honoraires
1312 1308
1292
1275
1317
1264
1237
1236
361 361 348 343 319 312 305 295
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
chambre individuelle chambre double ou commune
17 15 16
Evolution du coût moyen par admission, par type de chambre (hospitalisation classique, prix 2011)
Objectifs budgétaires Dépenses
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Objectifs budgétaires Dépenses
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
La
solidarité,
c’est bon pour la santé.
MUTUALITE
CHRETIENNE

2
Éditorial
La loi du 9 août 1963 sur l’assurance soins de santé et invalidité
constitue la base de notre système d’assurance maladie actuel.
Lorsque vous devez consulter un médecin, une bonne part des
frais vous est remboursée. Si vous ne pouvez travailler durant
une longue période pour des raisons de santé, vous recevez
une indemnité. Cette loi fête cette année ses 50 ans.
Elle marque un tournant dans l’histoire de notre système de
santé. Elle a jeté les bases de l’extension de l’assurance pour
les salariés à de nouveaux groupes de travailleurs, tels que les
indépendants et les fonctionnaires. Aujourd’hui, la totalité de la
population belge est couverte par notre système d’assurance
soins de santé obligatoire. Par ailleurs, elle a fait en sorte que
prestataires de soins et mutualités négocient les tarifs que
vous payez chez le médecin, le dentiste, le pharmacien, etc. La
liberté de choix est un autre pilier de cette loi.
Les fondements de cette loi démontrent toute son utilité.
L’objectif est de proposer des soins de santé de qualité à un
prix honnête et accessible. Il s’agit d’une assurance : vous
contribuez et, si vous tombez malade, elle intervient. C’est
une assurance qui est sociale : celui qui gagne moins doit y
participer moins. Enn, le système est basé sur la concertation
permanente entre prestataires de soins et mutualités. Le
ciment de tout cet édice est la solidarité. C’est la force de
notre système qui a rendu les soins de santé accessibles au
cours des 50 dernières années, pour des millions de Belges
confrontés à des problèmes de santé. Notre système constitue
un exemple pour de nombreux pays. La preuve en est que de
nombreux étrangers viennent l’étudier et demandent des avis
pour améliorer leur propre système.
MC-Informations ne peut rester indifférent aux 50 ans de
ce jalon historique. Avec ce premier numéro et durant
toute l’année, nous consacrerons une série d’articles aux
différents secteurs de notre système de santé, comme la
nomenclature, l’incapacité de travail et l’invalidité, la première
ligne, les hôpitaux, les médicaments, les malades chroniques,
les personnes âgées et la responsabilité nancière. Nous
aborderons l’angle historique, la situation actuelle et les dés
pour l’avenir. De plus, nous mènerons une vaste enquête qui
visera à connaître la satisfaction de nos membres par rapport
au système actuel. Les résultats seront abordés en détail dans
notre revue.
Les 50 ans de l’assurance soins de santé ne passeront donc
pas inaperçus dans le MC-Informations.
Dr. Michiel Callens
Directeur de département Recherche et Développement
MC-Informations 251 • mars 2013
2

50 ans de l’ASSI
La qualité des soins en milieu hospitalier :
un monde bouillonnant en changement
Dr. Xavier de Béthune, Département R&D, ANMC
Résumé
La qualité des soins est considérée depuis toujours comme la responsabilité quasi exclusive des professionnels
de la santé. Depuis la publication d’une étude sur les événements indésirables aux USA en 1999, la prise
de conscience de tous les acteurs du système de santé permet des avancées importantes pour garantir
et développer l’amélioration continue de la qualité. Nous tentons de décrire ici le panorama des acteurs
qui interviennent dans ce domaine et leurs rôles respectifs. L’accréditation des hôpitaux et la diffusion
d’indicateurs sur les ressources, les processus et les résultats des soins de santé vont signicativement
faire évoluer le paysage de la qualité des soins et de la sécurité des patients en milieu hospitalier dans les
années qui viennent.
1. Un réveil brutal
Il y a un peu plus de dix ans, l’Institute of Medicine (IOM) aux
USA forçait brutalement la prise de conscience des systèmes
de santé avec son rapport ‘To err is human. Building a safer
health system’1. Ce rapport quantie ce que tout le monde
savait, mais ce dont l’ampleur restait inconnue : les hôpitaux
et les systèmes de soins de santé en général font des erreurs,
parfois graves, et évitables dans un nombre substantiel de cas.2
La performance du système de santé belge a pourtant tout
pour rassurer ses utilisateurs3. La satisfaction des patients en
Belgique est d’ailleurs particulièrement élevée, surtout vis-
à-vis des médecins généralistes, comme le conrme encore
récemment un rapport conjoint du Centre d’Expertise fédéral
(KCE), de l’Institut de Santé Publique (ISP) et de l’Inami4.
Cependant, la sécurité du patient n’est pas mieux garantie
en Belgique qu’aux USA. L’analyse des données du Résumé
Clinique Minimum, réalisée en 2006 par Van Heede et al.
conrme que le problème existe bien en Belgique aussi5.
Le rapport américain a bien mis les choses en perspective.
D’une part, il a révélé l’ampleur du problème en le comparant à
deux Boeing 747 écrasés par semaine aux USA. D’autre part, il a
expliqué que les professionnels impliqués dans les événements
indésirables, n’en portaient pas l’unique responsabilité. C’est
en effet souvent une chaîne de causes et de réactions qui
amène tel médecin, inrmier ou secrétaire à commettre une
erreur involontaire. James Reason a démontré que ‘remplacer
le coupable’ ne prévient pas la survenue de l’erreur suivante,
puisque les causes sous-jacentes perdurent6.
2. Une dénition utile
Les conclusions pratiques du rapport ont fait l’objet d’un autre
livre phare. Dans ce nouvel ouvrage, l’IOM nous propose une
dénition de la qualité des soins qui nous permet de nous
orienter correctement et de savoir si nous nous approchons du
but7. Selon les auteurs, des soins de qualité sont :
1 Kohn L., Corrigan J. & Donaldson M., Eds. (1999) To Err Is Human: Building a Safer Health System. Washington, DC: National Academies Press. http://www.nap.
edu/openbook.php?isbn=0309068371
2 de Béthune X (2009) L’hôpital est-il dangereux ? Hospitals.be, 2009, 26-30. http://www.hospitals.be/pdf/vol7n2p19.pdf
3 Health Consumer Powerhouse (2012) La Belgique grimpe au classement européen des soins de santé. Véritable amélioration ou meilleure collecte des
informations ? http://www.healthpowerhouse.com/les/ehci-2012-press-belgium.pdf
4 Vrijens F et al. (2013) La performance du système de santé belge. Rapport 2012. KCE Rapport 196B. Bruxelles, 180 pp. https://kce.fgov.be/sites/default/les/
page_documents/KCE_196B_performance_systeme_sante_belge_Synthese.pdf
5 Van den Heede K., Sermeus W., Diya L., Lesaffre E. & Vleugels (2006) Adverse outcomes in Belgian acute hospitals: retrospective analysis of the national
hospital discharge dataset. International Journal for Quality in Health Care 18 : 211-219.
6
Reason J (2001) Understanding adverse events: the human factor. In: Vincent C. Ed. Clinical Risk Management. Enhancing Patient Safety. London, BMJ Books, 9 30.
7 Richardson WC et al. (2001) Crossing the quality chasm. A New Health System for the 21st Century. Washington, DC: National Academies Press.
http://www.nap.edu/openbook.php?isbn=0309072808
MC-Informations 251 • mars 2013 3

• Efcaces:ils guérissent desgenset réduisent leurssouf-
frances.
• Efcients:ilsnecoûtentpaspluscherqued’autressoinsqui
ont la même efcacité.
• Sûrs:ilsn’ontpastropd’effetssecondairesetsontdélivrés
de façon sure pour le patient.
• Centréssurlepatient:ilstiennentcomptedesattenteset
expériences des patients plus que de celles des profession-
nels et des institutions.
• Aubonmoment:lessoinssuiventuneséquenceéprouvéeet
sont administrés aux personnes au moment adéquat lors de
leur problème de santé et de leur vie.
• Equitables:lessoinsappropriéssontaccessiblesetutilisés
par tous.
3. Où en est la Belgique ?
La Belgique est caractérisée en même temps par une structure
complexe et par une culture de la concertation profondément
ancrée dans les institutions du pays. Même si l’évaluation
interne et externe font partie des arrêtés royaux qui régissent
l’offre de soins médicaux et inrmiers, les modalités de ces
évaluations ont majoritairement été laissées à l’appréciation
des professionnels de la santé et des institutions de soins.
Les conditions d’accès à la pratique de l’art de guérir sont
régulées et contrôlées. Les inspections ultérieures par les
différentes autorités du pays mettent toutefois aujourd’hui
encore un accent disproportionné sur la vérication des seules
ressources mises en œuvre. La prise en compte des processus
est surtout le fait des visitaties mises en place par l’agence Zorg
& Gezondheid de la Communauté amande8 dans la dernière
décennie. Bien que la situation évolue depuis un an ou deux,
la mesure systématique, l’analyse et le feedback des résultats
restent des phénomènes marginaux par rapport au reste.
Des normes d’organisation et des recueils systématiques de
données ont été mis en place par divers arrêtés royaux. Plusieurs
pathologies et activités de soins bénécient de programmes
formels. Les responsabilités du département inrmier des
hôpitaux p. ex. sont dénies dans des textes législatifs.
Plusieurs acteurs ont été sollicités pour encadrer la recherche
d’une plus grande qualité par les professionnels eux-mêmes.
Les Collèges de Médecins9 puisent dans le vivier des
associations scientiques et professionnelles pour constituer
des groupes spécialisés qui identient les recommandations
les plus valides et développent des indicateurs pertinents.
Deux conseils s’intéressent de près à la qualité des soins. Le
Conseil Fédéral pour la Qualité de l’Activité Inrmière10 (CFQAI)
dépend du SPF Santé Publique et développe un programme
sur plusieurs années pour améliorer les pratiques et mesurer
les progrès en matière de prise en charge des escarres, de la
dénutrition, des contentions et de la douleur. Depuis un peu plus
de dix ans, le Conseil National pour la Promotion de la Qualité11
(CNPQ), qui dépend quant à lui de l’Inami, est le pendant
médical du précédent. Il se focalise plus sur la médecine
générale que spécialisée et promeut l’échange d’expériences
entre médecins, décerne un prix à des projets efcaces
et encourage l’utilisation des recommandations de bonne
pratique. La plateforme fédérale d’hygiène hospitalière12 prend
de l’ampleur ces dernières années grâce à ses campagnes
d’hygiène des mains médiatisées, mais fournit surtout un
travail de fond remarquable dans la motivation des équipes
soignantes. Enn, parfois indépendamment des Collèges de
Médecins, des registres sont mis en place pour garantir la
continuité de l’information et contribuer à terme à l’évaluation
des pratiques. C’est le cas en oncologie, cardiologie, gastro-
entérologie et orthopédie, p. ex.
Ces initiatives valables restent toutefois assez séparées les
unes des autres, ce qui résulte au sein des institutions en des
surcharges de travail parfois non négligeables.
4. Un sérieux coup d’accélérateur
Le SPF Santé publique a lancé en 2007 une dynamique
importante dans le domaine de la qualité des soins et de la
sécurité du patient. En collaboration étroite avec le secteur
hospitalier, l’équipe QS – pour Qualité-Sécurité – développe
des plans pluriannuels qui sont déclinés en contrats annuels
à l’attention des hôpitaux intéressés. En échange de l’atteinte
d’objectifs assez précis, les hôpitaux reçoivent un subside
modéré et un appui, principalement des outils et des formations,
pour les innovations à introduire. Le succès est très important
avec seulement un ou deux hôpitaux aigus non inscrits selon
les années et plus de 97% des lits hospitaliers couverts.
Jusqu’en 2012, l’accent était mis sur le développement d’un
système de gestion de la sécurité et surtout de la notication
systématique des événements indésirables. La gestion des
processus, y compris transmuraux, était le deuxième axe
prioritaire. Deux enquêtes sur la culture de la sécurité dans
tous les hôpitaux du pays ont permis d’identier les forces
(le travail en équipe en première place) et les faiblesses des
institutions (les transferts de patients et la communication
entre les équipes et les institutions surtout)13.
8 http://www.vlaanderen.be/nl/contact/adressengids/beleidsdomein-welzijn-volksgezondheid-en-gezin-wvg/vlaams-agentschap-zorg-en-gezondheid-zg
9
http://www.sante.belgique.be/eportal/Healthcare/Consultativebodies/Doctorscolleges/684650_FR?ie2Term=non-prot%20akkoorden&ie2section=9126&fodnlang=fr
10
www.cfqai.be
11
http://www.inami.fgov.be/care/fr/doctors/promotion-quality/cnpqnrkp/index.htm
12
www.hicplatform.be
13 Vlayen A et al (2012) A nationwide Hospital Survey on Patient Safety Culture in Belgian hospitals: setting priorities at the launch of a 5-year patient safety plan.
BMJ Qual Saf 21 760-767 doi:10.1136/bmjqs-2011-051607
MC-Informations 251 • mars 2013
4

Depuis cette année, le plan pluriannuel 2013-2017 propose
de développer des projets dans des domaines prioritaires de
l’accréditation des hôpitaux. La démarche suit la logique de
l’amélioration continue de la qualité, avec une auto-évaluation
des pratiques en 2013, la planication des améliorations en 2014
et l’exécution des plans les trois années suivantes. Des objectifs
sont dénis pour chacune des priorités pour 2017 et plusieurs
activités menées indépendamment des contrats QS jusque là
(transfusion, safe surgery14, care bundles15) sont maintenant
intégrées dans le plan. Le SPF Santé Publique anticipe qu’en
2017 la toute grande majorité des institutions aura parcouru
ou sera engagée dans un trajet d’accréditation. Les activités
proposées dans le plan pluriannuel ont pour objectif d’aider les
hôpitaux à s’y préparer.
Le schéma général du plan pluriannuel 2013-2017 se trouve à
la gure 1.
14 http://whqlibdoc.who.int/publications/2009/9789241598552_eng.pdf et http://www.health.belgium.be/eportal/Healthcare/Healthcarefacilities/Patientsafety/
SafeSurgery/index.htm
15 http://www.ihi.org/explore/vap/pages/default.aspx
16 www.jacie.org
17 http://www.fanc.fgov.be/GED/00000000/2800/2827.pdf
18
www.mwq.be
19
www.bbest.be
20
www.efqm.org
Figure 1 : Plan pluriannuel Qualité-Sécurité 2013-2017 du SPF SPSCAE
5. L’accréditation : le coup de pouce dénitif ?
D’autres initiatives se mettent en place à côté des contrats QS.
Plusieurs agences nationales et internationales demandent des
accréditations spéciques de leurs domaines de compétence.
Les laboratoires de biologie clinique et d’anatomo-pathologie
sont certiés, p. ex. sur la base des normes ISO, depuis
quelques années. La procréation médicalement assistée et
les laboratoires de cellules souches (JACIE16) font l’objet
d’évaluations externes spécialisées. Plus récemment, l’Agence
Fédérale du Contrôle Nucléaire a demandé aux services de
médecine nucléaire de se soumettre à une évaluation externe
uniforme, qui porte le nom de B-Quanum17. Les services de
radiothérapie et de radiologie sont prévus à plus ou moins
courte échéance.
Les modèles industriels sont aussi utilisés. Le Mouvement
Wallon pour la Qualité18 et Bbest19 accompagnent aussi certains
hôpitaux dans des démarches d’évaluation externe qui reposent
sur le modèle de l’European Forum for Quality Management20.
L’hôpital Vincent Van Gogh de Charleroi est engagé depuis
plusieurs années dans une démarche de certication ISO.
MC-Informations 251 • mars 2013 5
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
1
/
32
100%