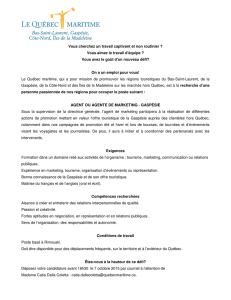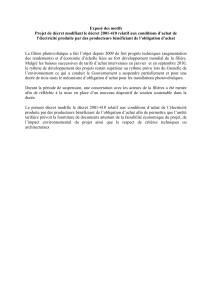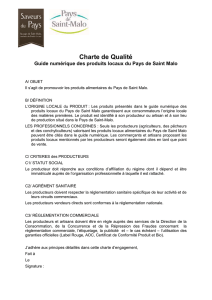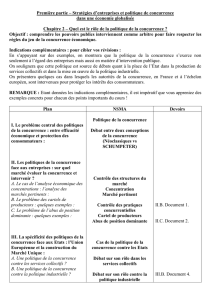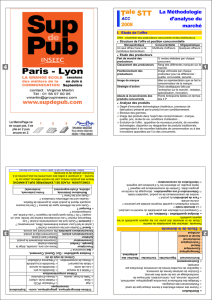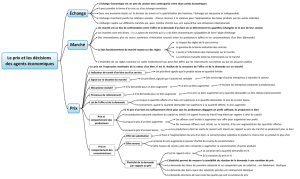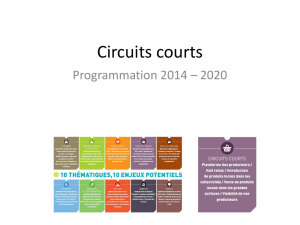RAPPORT DE RECHERCHE DE L’ Matériaux pour préparer l’avenir François L’Italien

RAPPORT DE RECHERCHE DE L’
Institut de recherche en économie contemporaine
www.irec.net / secretariat@irec.net
L’agriculture et la foresterie dans l’Est-du-Québec
Matériaux pour préparer l’avenir
François L’Ita lien
David Dupont
Robert Laplante
AVRIL 2017

ii
Notices biographiques
Chercheur à l’IRÉC, François L’Italien détient un doctorat en sociologie de
l’Université Laval, où il est professeur associé. Il a réalisé un stage d’études docto-
rales en économie des institutions à l’Université de Toulouse-I. Il a publié plusieurs
articles et ouvrages sur la nanciarisation de l’économie, ainsi que sur l’économie
politique de l’agriculture et des ressources naturelles au Québec. Il codirige, avec
Frédéric Hanin, la collection Vie économique aux Presses de l’Université Laval.
Chercheur à l’IRÉC, David Dupont est doctorant au département de sociologie à
l’Université Laval et l’auteur du livre Une brève histoire de l’agriculture au Québec.
De la conquête du sol à la mondialisation paru en 2009 aux éditions Fides.
Directeur général de l’IRÉC, Robert Laplante détient un doctorat en sciences
sociales (sociologie) à l’École normale supérieure de Cachan (Paris). Il a publié de
nombreux travaux scientiques, en particulier dans le domaine des études coopé-
ratives. Il s’intéresse plus particulièrement à l’économie politique de l’exploitation
forestière et aux questions relatives au développement régional. Robert Laplante a
publié plusieurs livres dont L’expérience coopérative de Guyenne.
Ce rapport de recherche a été réalisé pour le compte de l’Union des producteurs
agricoles (UPA).
© Institut de recherche en économie contemporaine
ISBN 978-2-923203-66-9(version imprimée)
ISBN 978-2-923203-67-6(PDF)
Dépôt légal —Bibliothèque nationale du Québec, 2017
Dépôt légal —Bibliothèque nationale du Canada, 2017
IRÉC, 1030, rue Beaubien Est, bureau103, Montréal (Québec)H2S 1T4

iii
Faits saillants
Constats sur les facteurs territoriaux de développement de l’agriculture et de la
foresterie dans l’Est-du-Québec
• Pour dresser un portrait économique réaliste des domaines agricole et forestier
dans le Bas-Saint-Laurent et la Gaspésie, l’analyse des facteurs sectoriels est insuf-
sante. Elle doit être complétée par l’examen des facteurs territoriaux, qui pèsent
de plus en plus lourdement sur le développement des productions dans ces régions.
• Parmi ces facteurs, la décroissance démographique et la dévitalisation sont parmi
les plus importants. Ces dynamiques induisent des eets déstructurants sur les
fondements du modèle agricole et forestier privilégié dans l’Est-du-Québec, basé
sur les fermes tenues par les propriétaires-exploitants. Ce modèle a été au cœur des
politiques publiques en matière de soutien à l’agriculture et à la foresterie privée
depuis les années 1950.
• Depuis au moins deux décennies, les deux régions de l’Est-du-Québec étudiées
ici achent un déclin démographique marqué. Entre 1997 et 2015, la population
du Bas-Saint-Laurent a diminué de 4 %, alors que la population de la Gaspésie a
connu une importante chute de 13 %. Or, la population totale du Québec a aug-
menté de 14% au cours de la même période, érodant du coup le poids démogra-
phique relatif de ces deux régions.
Constats généraux sur l’agriculture dans l’Est-du-Québec
• Ces dynamiques démographiques, couplées aux aléas des marchés ainsi qu’à la
timidité des interventions gouvernementales en matière de soutien à l’agriculture
et à la foresterie privée, ont soumis les producteurs de l’Est-du-Québec à de fortes
pressions. Depuis 2002, le déclin du nombre d’exploitations dans les deux régions
s’eectue à un rythme qui s’est accéléré. Leur nombre a diminué de 9 % au Bas-
Saint-Laurent et de 15 % en Gaspésie, alors que cette diminution était d’un peu
plus de 3 % au Québec.
• Si l’évolution du PIB agricole des deux régions est en hausse et indique que l’éco-
nomie agricole se porte bien dans l’Est-du-Québec, une analyse plus approfon-
die apporte d’importantes nuances à ce tableau. D’une part, l’économie agricole
gaspésienne présente une trajectoire ponctuée par d’importantes variations, qui
peuvent notamment s’expliquer par la diminution du nombre de fermes. Ainsi,
si les fermes gaspésiennes ont été performantes malgré cette diminution, cela a

iv
vraisemblablement entraîné une vulnérabilité accrue de la région aux chocs ressen-
tis dans certaines productions.
• Quant au Bas-Saint-Laurent, l’augmentation plus stable de son PIB agricole ne
doit pas éclipser le fait qu’elle est inférieure à celle du PIB agricole du Québec.
Cette performance peut laisser voir que le potentiel agricole de la région pourrait
être encore plus valorisé. L’une des conditions nécessaires à cela est l’accès à des
ressources favorisant l’innovation dans les procédés, le type de produits et la mise
en marché, accès facilité par la présence d’une masse critique de producteurs.
• Enn, les chires indiquent que les régions du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie
ne tirent pas toute la valeur de ce que livrent les producteurs. Ces régions se trouvent
à exporter leurs produits de base, sans transformer les denrées à la hauteur de ce
que pourrait leur permettre leur agriculture. Ces régions accusent, pour ainsi dire,
un décit de valeur ajoutée.
Prols de production
• La région du Bas-Saint-Laurent présente un prol de production diversié malgré
le rétrécissement du tissu agricole régional. Les quatre principales productions en
regard des revenus de marché que l’on retrouve dans la région sont la production
laitière (51 %), acéricole (14 %), bovine (10 %) et porcine (8 %).
• Les producteurs de lait jouent un rôle de premier plan dans le développement local,
l’utilisation des aires cultivées et l’habitation du territoire, alors que les producteurs
acéricoles sont parmi les plus dynamiques du Québec. Les productions bovine et
porcine ont traversé des conditions de marché diciles au cours des deux dernières
décennies, ce qui, couplé à la faiblesse des politiques agricoles structurante pour
ces domaines, a mené à la diminution du nombre d’établissements dans la région.
Quant à la production ovine, l’une des plus importantes au Québec, elle s’organise
autour de noyaux de producteurs qui sont présents un peu partout sur le territoire.
• Sur le plan des recettes monétaires, trois productions se démarquent en Gaspésie :
la production laitière (26 %), l’acériculture (14%) et la production bovine (17 %).
La production agricole régionale se signale particulièrement en ce qui a trait à la
certication biologique : 21 % des recettes en provenance du marché découlent de
la vente de produits portant cette certication. Le coût relativement faible des terres
et les supercies disponibles pour des projets de production font de la Gaspésie une
région au fort potentiel de développement dans les prochaines années.

v
Constats généraux sur la foresterie privée dans l’Est-du-Québec
• Il existe dans les régions de l’Est-du-Québec, en particulier dans le Bas-Saint-Laurent,
une importante tradition de mobilisation sociale visant à donner aux propriétaires-ex-
ploitants et aux collectivités locales les outils nécessaires à leur développement.
• Si ces mobilisations ont porté leurs fruits sur la consolidation du secteur (par l’im-
plantation de plans conjoints et d’usines de transformation, principalement), elles n’ont
cependant pas trouvé de réponses gouvernementales satisfaisantes concernant le déve-
loppement à long terme des établissements détenus par des propriétaires-exploitants de
lots ni des collectivités situées dans l’arrière-pays. L’enjeu de l’installation de nouveaux
propriétaires-exploitants est plus important que jamais, alors que plusieurs villages de
l’arrière-pays sont aux prises avec des problèmes de dévitalisation.
• Les producteurs forestiers de l’Est-du-Québec sont performants et livrent, en particulier
dans le Bas-Saint-Laurent, d’importants volumes de bois en usine. Bien qu’ils disposent
de plans conjoints, ils restent fortement exposés aux aléas des marchés nord-américains.
La crise qu’a traversée cette industrie dans les années 2000 a durement aecté les pro-
ducteurs de bois dans les deux régions qui, comme dans le reste du Québec, ont vu
diminuer leurs revenus pour les bois mis en marché.
• La fragilisation de la situation de producteurs forestiers depuis 2005 a mené à la révision
des modèles d’aaires an d’augmenter leur productivité et de diversier les sources de
revenus. La lière acéricole a représenté une véritable base de redéploiement pour cer-
tains producteurs aectés par la crise de l’industrie. De 2002 à 2015, alors que la valeur
totale de la vente des bois livrés aux usines de produits forestiers au Québec a connu une
baisse, la valeur de la vente de sirop d’érable a augmenté de 11 %.
• Soulignons enn que des transformations sont survenues au cours des dernières années
dans la structure de propriété des lots forestiers. L’identité des propriétaires de ces lots
a changé, mais aussi le type de modèle économique privilégié pour tirer des revenus de
la forêt. La consolidation des entreprises forestières et l’intérêt grandissant des investis-
seurs pour les terres forestières ont vraisemblablement contribué à modier le portrait.
Propositions pour le redéploiement de l’agriculture et la foresterie dans l’Est-
du-Québec
• Le rapport avance quelques propositions susceptibles de contribuer à la mise en
place d’un plan d’ensemble pour le redéploiement de l’agriculture et de la foresterie
privée dans l’Est-du-Québec. Ce plan d’ensemble, qui se fait toujours attendre,
pourrait être enchâssé dans la future politique agricole du Québec. Ces propositions
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
 52
52
 53
53
 54
54
 55
55
 56
56
 57
57
 58
58
 59
59
 60
60
 61
61
 62
62
 63
63
 64
64
 65
65
 66
66
 67
67
 68
68
 69
69
 70
70
 71
71
 72
72
 73
73
 74
74
 75
75
 76
76
 77
77
 78
78
 79
79
 80
80
 81
81
 82
82
 83
83
 84
84
 85
85
 86
86
 87
87
 88
88
 89
89
 90
90
 91
91
 92
92
 93
93
 94
94
 95
95
 96
96
 97
97
 98
98
 99
99
 100
100
 101
101
 102
102
 103
103
 104
104
 105
105
 106
106
 107
107
 108
108
 109
109
 110
110
 111
111
 112
112
 113
113
 114
114
 115
115
 116
116
 117
117
 118
118
 119
119
 120
120
 121
121
 122
122
 123
123
 124
124
1
/
124
100%