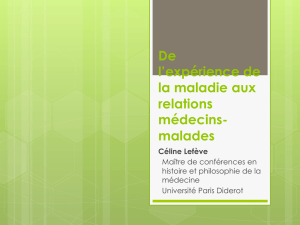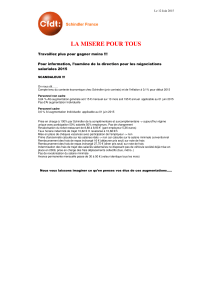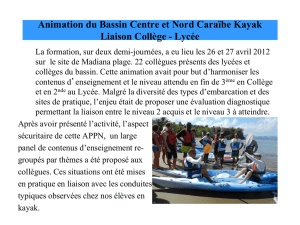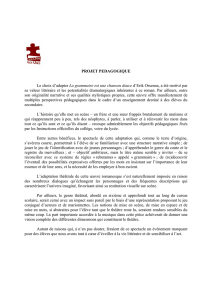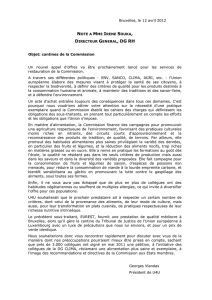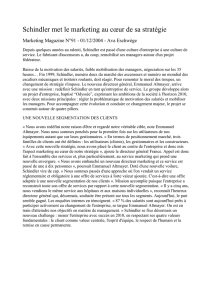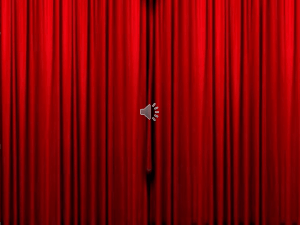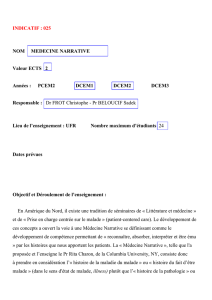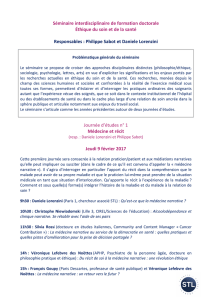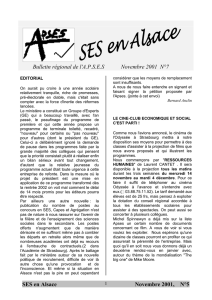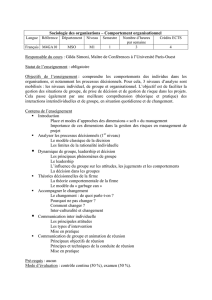8b_Proposition Melanie Schindler

Colloque fondateur du Réseau international de
Sociologie Clinique – Paris, 8-9-10 avril 2015
Proposition de communication
Thème 3 – Clinique narrative
La tache aveugle du soin: huit « collègues » à l'épreuve
du normal et du pathologique
Mélinée Schindler
A Genève a eu lieu une rencontre, à la fois organisée et imprévue dans son après-coup, de
huit « collègues », trois médecins, une infirmière, trois psychologues et un pédagogue, tous
apparentés aux pratiques de l'Éducation Thérapeutique du Patient. A l'initiative d'Aline Lasserre
Moutet, et sous la direction de Christophe Niewiadomski, trois séances d'épreuves biographiques
ont confronté ces volontaires au récit de vie et de santé par le biais de l'écriture, du génogramme, de
la trajectoire de vie et du dessin. Une sociologue, Mélinée Schindler, s'est entretenue avec chacun
des huit professionnels, puis a analysé thématiquement les verbatim recueillis afin de provoquer un
focus group. La surprise, de l'aveu même de ces professionnels chevronnés, provient du retour dans
sa forme la plus profane de la question: qu'est-ce que la santé? Ici et maintenant, en lien ou non
avec mon passé, ma famille, mes maladies physiques ou psychiques, qu'ai-je à dire à mes collègues
des traumatismes (ou de leur dépassement) qui n'ont peut-être pas lieu d'être ainsi exposés?
L'épreuve de la narration de soi entraîne pour chacun dans le groupe une émotion déroutante. C'est
avec ce qui leur tombe dessus ensemble (au sens littéral du mot « sym-ptôme ») que se tissent des
liens qui transforment le groupe en une « communauté de cicatrices », selon le dire d'une
participante. Le groupe se ritualise, au sens de la sociologie sacrée de Georges Bataille (1979) ou de
l'anthropologie de Mary Douglas (2005). Comment transposer une telle expérience au patient lui-
même, lorsque le professionnel reconnaît qu'il est redevenu cette personne pathétique qui précède la
médecine clinique ?
Au regard des nombreuses disciplines pratiquées par ces huit « collègues » (pneumologie,
cardiologie, pédagogie, psychologie, psychanalyse, analyse transactionnelle, hypnose, éducation
thérapeutique, clinique narrative, méditation, écriture, théâtre, sport), on ne peut que penser au
carrefour épistémique inauguré par Canguilhem (1943) avec ses Essais sur quelques problèmes
concernant le normal et le pathologique. Ce philosophe médecin renverse l'opposition héritée de la
physiopathologie en faisant du « pathos » éprouvé par le malade la condition même de l'existence
de l'art médical. Cette préséance de la maladie du malade en tant que forme de vie ouvre le chantier
de l'expérience biographique, qu'elle soit philosophique avec le « souci de soi » de Foucault (2001)
et le « prendre soin » de Stiegler (2010), ou sociologique dans la forme socratique de l'entretien
pratiqué par Bourdieu (1993). De ce chantier semble émerger peu à peu une nouvelle conception de
la relation de soin et de l'empathie, dont Barrier (2010) témoigne à travers le récit du dépassement
de son insulino-dépendance. La santé est maintenant reconnue et éprouvée comme la capacité à
tomber malade et à s'en relever. La maladie est une autre allure de la vie. Du coup, l'ancien rituel du
soignant au chevet du malade s'effondre et laisse place à une relation symétrique déstabilisante où
l'un et l'autre acteur doivent faire face, ensemble, à ce que nous appellerons avec Barrier « la tache
aveugle du soin ».

Bibliographie indicative
Barrier, P., 2010, La blessure et la force. La maladie et la relation de soin à l'épreuve de l'auto-
normativité, Paris, PUF.
Bataille, G. et al., 1979 [1937], Le Collège de sociologie, textes réunis par D. Hollier, Paris,
Gallimard.
Bourdieu, P. et al., 1993, La misère du monde, Paris, Seuil.
Canguilhem, G., 2011 [1943], Le normal et le pathologique, Paris, PUF.
Douglas, M., 2005 [1967], De la souillure. Essais sur les notions de pollution et de tabou, Paris, La
Découverte.
Foucault, M., 2001 [1984], « L'éthique du souci de soi comme pratique de la liberté » in Dits et
écrits II, Paris, Gallimard.
Niewiadomski, C., 2012, Recherche biographique et clinique narrative. Entendre et écouter le Sujet
contemporain, Toulouse, érès.
Schindler, M., 2014, « Le diabète philosophe » in Ni malades, ni en bonne santé, Socio-
anthropologie, N° 29.
Stiegler, B., 2010, « Préface » à Barrier P., La blessure et la force, Paris, PUF.
1
/
2
100%