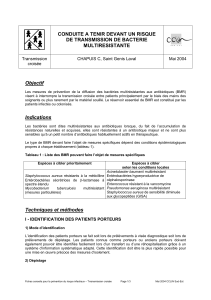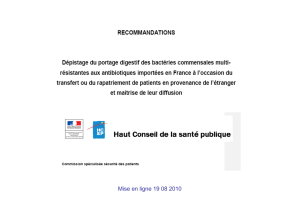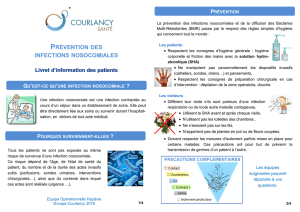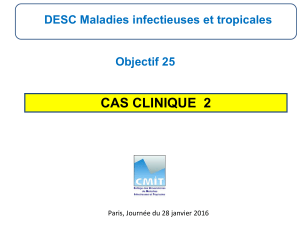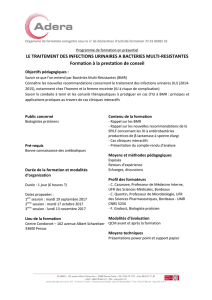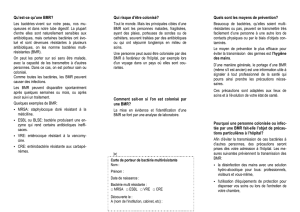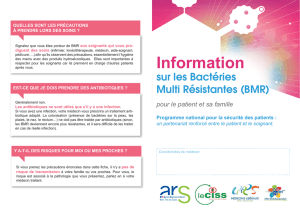Le dépistage des patients à risque d`infection - CClin Sud-Est

352 HYGIENES - 1997 - VOLUME V - N°6
HYGIENE ET PRÉVENTION DES INFECTIONS DANS LES ÉTABLISSEMENTS DE SOINS POUR PERSONNES AGÉES
LA PRISE EN CHARGE DU PATIENT INFECTÉ
LE DÉPISTAGE DES PATIENTS À RISQUE d’infection no-
socomiale ou de portage de bactéries multi-
résistantes Les personnes âgées sont parti-
culièrement exposées aux infections nosocomiales
et ceci d’autant plus qu’elles sont dans un état de
dépendance. Lors d’enquêtes de prévalence (1),
les taux d’infections nosocomiales sont par exemple
de 2,9 % chez les patients non dépendants, de
8,8 % lors de dépendance moyenne, de 38,2 %
lors de dépendance importante, de 50 % lors de
dépendance totale.
Ces infections nosocomiales évoluent sur des
modes endémique ou épidémique : il s’agit soit
d’infections d’origine endogène, liées à des bacté-
ries sélectionnées à partir de la flore résidente, soit
d’infections d’origine exogène, liées à des bacté-
ries le plus souvent manuportées.
La prévalence des bactéries multirésistantes
(BMR) dans les infections nosocomiales fait de
certains établissements de moyen et long sé-
jour ou de rééducation, de véritables réservoirs
de BMR, réservoirs constitués par des sujets in-
fectés, colonisés* ou porteurs*.
Une politique de prévention des infections no-
socomiales dans des services de patients dépen-
dants nécessite un dépistage des sujets à risque. Il
s’agit :
•d’identifier les patients particulièrement à risque
d’acquérir une infection nosocomiale
•d’identifier les patients susceptibles « d’hé-
berger » des bactéries multirésistantes.
Les objectifs d’un tel dépistage sont la préven-
tion de l’infection et la prévention de la dissé-
mination des BMR.
Qui dépister ?
De nombreuses études (1,2,3,4) ont permis
l’identification des facteurs de risque d’infections no-
socomiales et des facteurs de risque de colonisa-
tion* par des BMR. Il convient de dépister donc de
dépister les patients porteurs de ces facteurs de
risque (Tableau XIV).
WINGARD (3) a étudié pendant deux ans les
risques de colonisation par des bacilles à Gram né-
gatif résistants, chez des personnes âgées en ins-
titution, à partir de prélèvements d’urine, de peau,
du périnée et des mains du personnel ; les facteurs
de risque de colonisation sont le statut « non am-
bulatoire », le niveau de dépendance élevé, la pré-
sence d’une sonde urinaire, la durée de séjour su-
périeure à un an. Les facteurs de risque de
colonisation croisée au sein de l’établissement par
ces bactéries sont le degré de dépendance, la pré-
sence d’une sonde urinaire, le statut « non ambu-
latoire », l’incontinence fécale et/ou urinaire.
Quelques soient les BMR, des facteurs de risque
communs sont retrouvés chez la plupart des pa-
tients ; certaines bactéries sont cependant plus
spécifiques de tel ou tel site : bacilles à gram négatif
(entérobactéries ßLSE,
Acinetobacter, P. aerugi-
nosa
) dans les infections urinaires tandis que
Sta-
phylococcus aureus
résistant à la méticilline (SARM)
prédomine dans les infections cutanées.
3.1
Le dépistage des patients à
risque d’infection
nosocomiale ou de portage
de bactéries multirésistantes
Risques liés à l’hôte
•sévérité de la pathologie sous-jacente (néoplasie,
chirurgie lourde, diabète, dénutrition...),
•présence de matériel invasif : cathéter veineux,
sonde urinaire, sonde gastrique, trachéotomie,
jejunostomie, colostomie...),
•antibiothérapie à large spectre antérieure,
•âge élevé.
Risques liés à une probabilité accrue de
contacts contaminants et de gestes invasifs
•patients dépendants et/ou grabataires,
•incontinence urinaire et ou fécale,
•durée du séjour élevée,
Risques liés au contexte épidémique
•patient venant d’un service endémique pour une
BMR (réanimation, service de brûlés, chirurgie,
maison de retraite ou autre service selon l’épidé-
miologie locale),
•patient antérieurement porteur d’une BMR,
•voisin de chambre d’un patient infecté, colonisé
ou porteur,
•sujet contact voire tous les patients du service si
situation endémique dans le service.
Tableau XIV - Patients
à risque d’acquisition
de bactéries
multirésistantes.

353
HYGIENES - 1997 - VOLUME V - N°6
LE DÉPISTAGE DES PATIENTS À RISQUE D’INFECTION NOSOCOMIALE OU DE PORTAGE DE BACTÉRIES MULTIRÉSISTANTES
Quand dépister ?
◆L’identification d’un patient à risque d’infection
nosocomiale se fait dès l’entrée par l’histoire du
patient et l’examen clinique (5). Elle impose la prise
des mesures de prévention et l’application stricte
des règles d’hygiène de base.
◆L’identification d’un patient susceptible d’hé-
berger une bactérie multirésistante est plus com-
plexe. Dans une situation de prévalence élevée,
l’idéal pour la prévention de la dissémination des
BMR est le dépistage de chaque entrant et son iso-
lement en attendant les résultats. Les contraintes
de l’architecture hospitalière (absence ou nombre in-
suffisant de chambres seules) et les contraintes
économiques imposent de cibler les patients.
◆Si on se réfère aux données de la littérature, on
peut proposer un dépistage systématique à
l’entrée pour certains patients, tandis que le dé-
pistage se fera au cours du séjour pour les
autres selon les risques individuel ou collectif
(Tableau XV).
Le rythme de la réalisation des prélèvements
bactériologiques est très discuté et n’a pas fait
l’objet d’un consensus. Le portage* d’une BMR
peut être très long (plusieurs mois) ou intermittent.
Un malade dont les prélèvements se sont appa-
remment négativés, peut redevenir colonisé
quelques jours ou semaines plus tard. Il est donc pri-
mordial de maintenir l’information du personnel par
la signalisation des antécédents de BMR sur le
dossier du patient.
On peut proposer l’attitude suivante :
•pour un patient porteur d’une BMR, il est impératif
d’avoir deux prélèvements négatifs à 72 heures
d’intervalle avant de lever l’isolement. Le suivi ul-
térieur du statut bactériologique devra être réa-
lisé à un rythme à adapter au cas par cas, par
exemple hebdomadaire pendant un mois puis
mensuel afin de dépister précocement une reco-
lonisation.
•en cas de persistance d’une situation endémique
dans un service, un dépistage systématique plus
fréquent de tous les patients peut être justifié.
Comment dépister ?
Le dépistage des patients infectés, colonisés ou
porteurs se fait par des prélèvements bactériolo-
giques ciblés. Dans un souci de cohérence, d’éco-
nomie et d’efficacité, il est indispensable de
connaître les réservoirs naturels humains des BMR
(Tableau XVI) et d’organiser ce dépistage en colla-
boration avec le bactériologiste afin cibler les re-
cherches et d’adapter les milieux de culture utili-
sés au laboratoire. Dans tous les cas, il faut chercher
le portage au niveau du réservoir principal, recher-
cher des colonisations asymptomatiques au niveau
de réservoirs secondaires (urines, plaies) et éven-
tuellement rechercher des infections en fonction
des signes cliniques.
Dépistage du SARM
•le portage doit être es-
sentiellement recher-
ché au niveau nasal.
L’écouvillonnage nasal
permet l’identification
de 60 à 85 % des por-
teurs. Une amélioration
de la sensibilité peut se
faire en associant des
prélèvements au niveau
du périnée.
•des plaies (plaie opéra-
toire, escarres), peuvent
constituer un réservoir :
leur prélèvement doit
être systématique.
•une colonisation par du
SARM est éventuelle-
ment à rechercher au
niveau des urines (ban-
delettes urinaires posi-
tives, patient sondé) ou
dans les expectorations
(surinfection bronchique ou de trachéotomie).
•une infection par du SARM est à rechercher au ni-
veau des sites infectés en fonction de la clinique.
Dépistage des entérobactéries
roductrices de ßLSE
Le portage doit être recherché par une bacté-
riologie des selles et/ou un écouvillonnage rectal.
Une colonisation peut être recherchée au niveau
des urines (bandelette urinaire positive, patient
sondé), au niveau des crachats (en cas de surin-
fection bronchique ou de trachéotomie) ou au ni-
veau des plaies (escarres, plaie opératoire).
Une infection est à rechercher au niveau des
sites infectés en fonction de la clinique.
Bibliographie
1 - MULIN B, TALON D, VIEL JF,
et al
. Risk factors for noso-
comial colonisation with multiresistant
Acinetobacter bau-
mannii
. Eur. J. Clin. Microbiol. Inf. Dis. 1995, 14: 569-
576.
2 - CAIRE J, LEMOINE D, BLIT JN,
et al
. Les leçons d’une en-
quête de prévalence des infections nosocomiales et des
escarres dans un centre de long séjour. Hygiènes 1995,
11, 32-34.
3 - WINGARD E, SHLAES JH, MORTIMER EA,
et al
. Colonisation
and cross-colonization of nursing home patients with tri-
methoprim-resistant gram negative bacilli. Clin. Inf. Dis.
1993, 16, 75-81.
4 - LEISTEYUO T, OSTEBLAD M, TOIVONEN P,
et al
. Colonization
of resistant faecal aerobic gram negative bacillii among
geriatric patients in hospital and the community. J. Anti-
microb. Chemother 1996, 37, 169-173.
5 - EDMOND M, WENZEL R, PASCULLE W.Vancomycin-resis-
tant
Staphylococcus aureus
: perspectives on measures
needed for control. Ann. Intern. Med 1996, 124, 329-334.
Tableau XVI -
Réservoirs de BMR :
SARM et entéro-
bactéries sécrétrices
de ßLSE.
Tableau XV -
Propositions de
dépistage des
patients susceptibles
d’être infectés,
colonisés ou porteurs
de BMR.
Dépistage dès l’entrée
•patient venant d’un service à risque, d’un service
endémique,
•patient antérieurement porteur, colonisé ou in-
fecté par une BMR,
•patient présentant un risque élevé : présence de
plaie, escarre, sonde urinaire, trachéotomie, mul-
tiples antibiothérapies antérieures,
•politique du service : dans le cas d’épidémie ou
de forte endémie.
Dépistage durant le séjour
•signes cliniques ou paracliniques d’infection,
•voisin de chambre d’un sujet infecté, colonisé ou
porteur,
•sujets de chambres adjacentes si deux cas sont
reconnus chez des patients proches sur le plan
géographique,
•ensemble de patients présents dans l’unité si plus
de deux cas sont identifiés ou si deux cas survien-
nent chez des patients hospitalisés dans des
chambres éloignées,
•patient ayant des antécédents de colonisation ou
portage de BMR.
SARM
•Muqueuses :
nez, périnée ++
•Peau : aisselles
++
•Plaies, escarres
++
•Urines
Entérobactéries
productrices de
ßLSE
•Tube digestif ++
•Urines ++
•Périnée ++
•Escarres, plaies

364 HYGIENES - 1997 - VOLUME V - N°6
HYGIENE ET PRÉVENTION DES INFECTIONS DANS LES ÉTABLISSEMENTS DE SOINS POUR PERSONNES AGÉES
AFNOR
Association Française de Normalisation.
Association ayant pour mission de coordonner
les programmes de normalisation en France et d’en-
courager la diffusion et l’application des normes.
antisepsie
Opération au résultat momentané permettant,
au niveau des tissus vivants, dans la limite de leur
tolérance, d’éliminer ou de tuer les micro-orga-
nismes et/ou d’inactiver les virus, en fonction des
objectifs fixés. Le résultat de cette opération est li-
mité aux micro-organismes présents au moment
de l’opération (AFNOR NF T 72 101).
antiseptique
Selon AFNOR NF T 72 101, un antiseptique est
un produit ou un procédé utilisé pour l’antisepsie
dans des conditions définies. Si le produit ou le pro-
cédé sont sélectifs, cela doit être précisé. Ainsi, un
antiseptique ayant une action limitée aux champi-
gnons est un antiseptique à action fongicide.
bactéricide
Produit ou procédé ayant la propriété de tuer les
bactéries dans des conditions définies (AFNOR,
Comité Européen de Normalisation).
bactériostatique
Produit ou procédé ayant la propriété d’inhiber
momentanément les bactéries dans des conditions
définies (AFNOR).
biocontamination
Contamination d’une surface (biologique ou
inerte) ou d’un fluide par des micro-organismes vé-
hiculés par l’air (contamination aéroportée ou aé-
robiocontamination), par des êtres vivants (la conta-
mination par contact avec les mains en est la
modalité majeure) ou par les objets. (Association
pour la Prévention et l’Étude de la Contamination)
biofilm
Ensemble de micro-organismes et de leurs sé-
crétions macromoléculaires qui sont présents sur la
surface d’un matériau (Association pour la Préven-
tion et l’Étude de la Contamination).
bionettoyage
Procédé de nettoyage, applicable dans une zone
à risques, destiné à réduire momentanément la bio-
contamination d’une surface. Il est obtenu par la
combinaison appropriée d’un nettoyage, d’une éva-
cuation des produits utilisés et des salissures à éli-
miner, de l’application d’un désinfectant.
cas acquis
Le caractère acquis d’une bactérie multirésis-
tante peut être affirmé si un dépistage systéma-
tique à l’entrée dans un service a été réalisé et si
celui-ci est négatif. La découverte d’une telle bac-
térie au cours du séjour plus de 48 à 72 heures
après l’admission chez un patient antérieurement
négatif laisse présumer que la bactérie a été ac-
quise par transmission au cours du séjour.
cas importé
Le caractère importé depuis un autre établisse-
ment d’une bactérie multirésistante peut être af-
firmé si un dépistage systématique à l’entrée du
patient dans le service a été réalisé et si celui-ci est
positif. La découverte d’une telle bactérie chez un
patient moins de 48 à 72 heures après l’admission
laisse présumer que la bactérie a été transmise an-
térieurement par rapport au séjour actuel.
colonisation (colonisé)
Présence d’une bactérie dans un site qui en est
normalement exempt, mais cette bactérie n’est
responsable d’aucun symptôme local ou général
d’infection ; exemple : présence d’une bactériurie
isolée à Staphylococcus aureus dans les urines sans
aucun signe d’infection urinaire.
Lexique

365
HYGIENES - 1997 - VOLUME V - N°6
désinfectant
Produit ou procédé utilisé pour la désinfection,
dans des conditions définies. Si le produit ou le pro-
cédé est sélectif, ceci doit être précisé. Ainsi, un
désinfectant ayant une action limitée aux champi-
gnons est désigné par : désinfectant à action fon-
gicide (AFNOR NFT 72 101).
désinfection
◆Opération au résultat momentané permettant
d’éliminer ou de tuer les micro-organismes et/ou
d’inactiver les virus indésirables portés par des mi-
lieux inertes contaminés, en fonction des objec-
tifs fixés. Le résultat de cette opération est li-
mité aux micro-organismes présents au moment
de l’opération (AFNOR NFT 72 101). L’usage du
terme « désinfection » en synonyme de « dé-
contamination » est prohibé.
◆Terme générique désignant toute action à visée
antimicrobienne, quel que soit le niveau de ré-
sultat, et utilisant un produit pouvant justifier
in
vitro
des propriétés autorisant à le qualifier de
désinfectant ou d’antiseptique. Il devrait logi-
quement toujours être accompagné d’un qualifi-
catif et l’on devrait ainsi parler de :
•désinfection des dispositifs médicaux (= du
matériel médical)
•désinfection des sols,
•désinfection des surfaces par voie aérienne,
•et même désinfection des mains ou d’une plaie
(Société Française d’Hygiène Hospitalière et
Comité Européen de Normalisation).
◆Élimination dirigée de germes destinée à empê-
cher la transmission de certains micro-organismes
indésirables, en altérant leur structure ou leur
métabolisme indépendamment de leur état phy-
siologique (CEN)
nettoyage
Opération d’élimination des salissures (particu-
laires, biologiques, liquide,...) avec un procédé fai-
sant appel dans des proportions variables les unes
par rapport aux autres, aux facteurs suivants : action
chimique, action mécanique, temps d’action de ces
deux paramètres et température.
nettoyage-désinfectant
Produit présentant la double propriété de déter-
gence et de désinfection (Société Française d’Hy-
giène Hospitalière).
porteur (portage)
Présence d’une bactérie dans un site où sa pré-
sence est habituelle sans qu’elle soit responsable
d’infection ; exemple : présence de Staphylococ-
cus aureus dans les narines ou dans d’entérobac-
téries dans les selles.
précautions standard
Ensemble des précautions d’hygiène qui s’ap-
pliquent à tout patient sans tenir compte de l’exis-
tence d’une éventuelle infection. Ces précautions
intègrent la protection du personnel vis à vis des li-
quides biologiques, la prévention des accidents
d’exposition au sang et les bonnes pratiques d’hy-
giène visant à limiter la transmission des micro-or-
ganismes hospitaliers lors des soins. Les précau-
tions standard concernent l’hygiène des mains, les
techniques de soins, le nettoyage et la désinfec-
tion du matériel de soins, l’entretien des locaux ,
de la vaisselle et du linge, la prévention des acci-
dents d’exposition aux liquides biologiques dont le
sang. L’application des précautions standard est in-
dispensable à l’efficacité d’une politique de contrôle
des infections nosocomiales.
1
/
4
100%