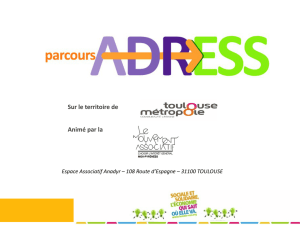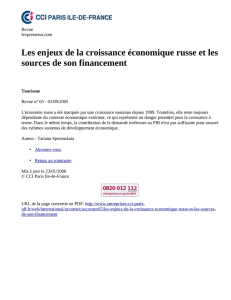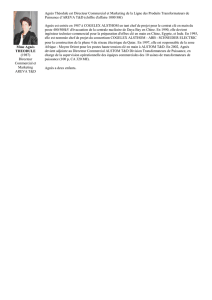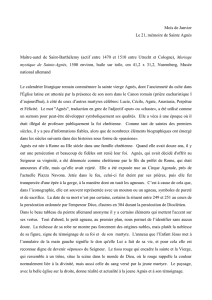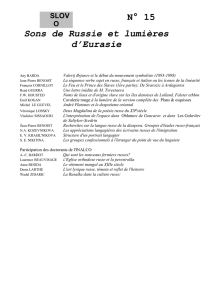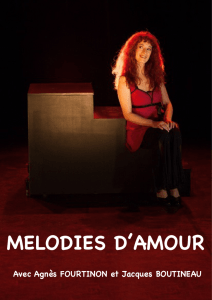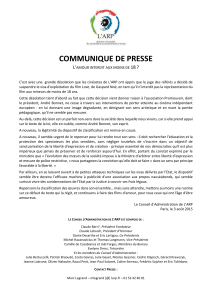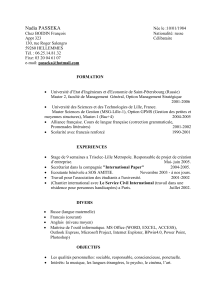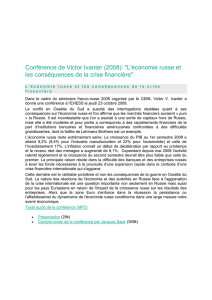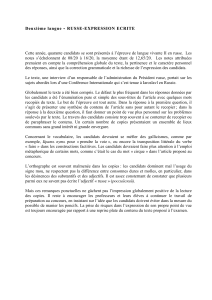Conférence inaugurale d`Agnès Desarthe - CRL Midi

Journée d’étude interprofessionnelle
Le dialogue entre les cultures à travers la traduction
9 juin 2016 à Narbonne
CONFERENCE INAUGURALE D’AGNES DESARTHE
Absente de la journée professionnelle "Le dialogue des cultures à travers la traduction qui a eu lieu le
9 juin 2016 à Narbonne, Agnès Desarthe a transmis le texte de sa conférence inaugurale. Santiago
Artozqui, traducteur et président d'ATLAS, a lu ce texte.
***
"Bonjour.
Je ne suis pas Agnès Desarthe.
Je m’appelle Santiago Artozqui.
Agnès Desarthe, qui devrait être face à vous pour la conférence inaugurale de cette journée de
réflexion, n’a pas pu venir, à cause des grèves de train, à cause d’obligations radiophoniques, à cause
d’une douleur persistante à la hanche qui l’empêche de sauter d’un moyen de transport à l’autre
comme un cabri.
Bref, elle n’est pas là et j’y suis.
Je vais être sa voix. Je vais lentement devenir elle. Me dépouiller de ma couleur de peau, de mon sexe
(pas le plus difficile, bizarrement), de la couleur de mes yeux, prendre un peu de poids sans doute et
quelques années. On croirait un film de Cronenberg, un film d’horreur, mais n’ayez pas peur. Vous allez
voir, c’est beaucoup plus immédiat et indolore qu’il y paraît, car nous, les traducteurs, on fait ça tous
les jours, devenir un autre, se substituer à lui ou plutôt le laisser se substituer à nous, le laisser nous
hanter, nous habiter, accueillir sa voix, qu’il ou elle soit homme ou femme, blanc, noir, vert ou rouge.
Quand ça marche, c’est un tour de magie. Le lecteur oublie que nous sommes deux, deux à écrire, deux
voix qui se superposent. Le lecteur l’oublie car, quand le travail est bien fait, cela ne se voit pas, il n’y
a qu’une écriture, il n’y a qu’une voix.

Quand j’ai lu l’intitulé de cette journée, j’ai tout de suite pensé à mes grands-mères.
(Vous voyez, ça marche, je suis devenu Agnès Desarthe pendant le paragraphe précédent, à partir de
maintenant, c’est elle qui parle par ma bouche. Nous pratiquons la ventriloquie à distance).
J’ai donc pensé à mes grand-mères, Bouba et Tsila. Et là vous vous dites « pas banals ces noms. On est
en plein dedans, dans le dialogue des cultures. Mais quid de la traduction ? »
Ma grand-mère Bouba est née en Libye il y a très longtemps. Elle est morte à Paris en 1982, vingt ans
après son arrivée en France, sans parler un mot de français. Je l’ai toujours connue s’exprimant dans
un dialecte Judéo-arabe, un idiome guttural, pauvre en vocabulaire. L’indigence lexicale obligeait les
locuteurs à accueillir des mots étrangers. Par exemple, pour parler de quelque chose qui n’était pas
cher, Bouba disait « zoz ouash ». Zoz signifie 2 en arabe, mais « ouash », qu’est-ce que ça veut dire ? Y
a-t-il un arabisant dans la salle ?
Ce n’est que très tardivement, devenu adulte en fait, que mon père, parfaitement bilingue lui, a
compris, en interrogeant ses frères aînés, ce que signifiait cet olni (objet linguistique non identifié).
Bouba, durant la seconde guerre mondiale faisait toutes sortes de petits boulots pour élever ses huit
enfants (mais peut-être étaient-ils sept, les enfants mourraient beaucoup à l’époque). Elle était veuve
et gagnait mal sa vie en lavant les chemises des soldats américains. Un Ouash (O-U-A-S-H), c’était un
fait un Wash (W-A-S-H), un lavage, ou plutôt le prix dérisoire qu’on la payait pour une lessive d’où le
« zoz ouash » pour dire « une misère ».
Que fais-je quand je traduis zoz ouash par misère ?
Parlons maintenant de Tsila, mon autre grand-mère, la mère de ma mère. Elle aussi est née il y a très
longtemps, je ne sais plus trop où, disons quelque part du côté de Kiev. Elle est morte en 1994. Elle
parlait un français joliment accentué, métissée par le Yiddish, mais, enfant, je pensais que c’était par
le russe, une langue qu’elle parlait aussi. Le charme venait de sa façon de prononcer les « u » qui se
transformaient systématiquement en « i » . Une bûche devenait une biche. Je n’ose imaginer ce
qu’aurait donné un « uluberlu ». Cela nous faisait beaucoup rire, nous, les enfants, nous qui étions
entourés d’adultes parlant des langues étrangères.
Ma grand-mère était une excellente pâtissière, elle se passionnait pour l’échange de recettes et je me
souviens d’elle avec ses amies discutant autour d’une tasse de thé : cela donnait quelque chose comme
(bon courage Santiago) : nie biouliet da niejou khardonie piechou nadarnoï patachou. Pardon pour les
russophones, ceci n’est pas du russe, mais du yaourt. Vous remarquez cependant la présence de
patachou en fin de phrase, qui pourrait passer pour un verbe russe comme un autre, un verbe du
premier groupe : infinitif en « at » et première personne du singulier en « ou », comme par exemple
le verbe écrire « Pissat » et qui donne « Ia pichou » (j’écris). Patachou pourrait ainsi être la première
personne du verbe patachat. Mais non, patachou, c’était pâte à choux, cette invention culinaire
française pour laquelle même une pâtissière de génie, par le fait qu’elle était russo-yid, n’avait pas de
mot.
Que devient « patachou » s’il l’on traduit la « phrase » de ma grand-mère en anglais (par exemple) ?
« puff pastry ». Le problème c’est que puff pastry ne pourra jamais passer pour un verbe russe à la

première personne du singulier, comme le faisait si bien patachou, ce syntagme français habilement
déguisé en verbe russe.
Peut-être vous demandez-vous pourquoi je commence par des exemples si tordus, si marginaux, alors
qu’il serait tellement plus simple de vous parler des romans concernant le baseball et des adaptations
que cela nécessite, ou encore de la merveilleuse sensation de savoir parler chinois que l’on éprouve
parfois quand on lit un beau roman écrit en mandarin et magnifiquement traduit (par Sylvie Gentil, par
exemple).
Pourquoi ne pas commencer par dire : « Oui, le dialogue des cultures est favorisé par la traduction,
c’est même à ça qu’elle sert. Sans elle, point de dialogue, sans la traduction autarcie et solipsisme,
enfermement sur soi et absence à l’autre. » Oui, pourquoi ne pas faire ainsi ?
Parce que la traduction est la science la plus molle qui soit, la plus subjective et que je ne me sens pas
de vous parler d’elle sans vous dire d’où je viens, d’où vient ma passion pour elle. J’ai grandi dans la
traduction, mais j’ai aussi grandi dans un dialogue impossible entre les cultures, dans une cacophonie
pas possible. Mes deux grand-mères qui se croisaient parfois n’ont jamais pu se parler (et pas
seulement faute d’interprète).
Fin de l’épisode autobiographique. Plongée dans la théorie.
Attention, prenez une grande inspiration, on va aller nager chez George Steiner.
Je cite dans Poésie de la pensée chez Gallimard à la page 48 :
« De quels tumultes, de quelles célébrations, mais aussi de quels revers de la conscience a dû
s’accompagner le constat réellement mystérieux que le langage peut tout dire, sans jamais épuiser
l’intégrité existentielle de son référent ? Quand Beckett nous invite à rater, à « rater encore », mais à
« rater mieux », il repère la synapse à laquelle s’engrènent pensée et poésie, doxa et littérature. « C’est
le départ qui est difficile. »
Dans ce paragraphe, Steiner ne parle pas de traduction. Il parle du langage en général, mais si l’on
considère que le langage est une forme de traduction des percepts (et de tout un tas d’autres trucs)
alors ça colle. Et puis de toute façon, moi, quand j’ai lu ces phrases, j’ai tout de suite trouvé que ça
parlait de traduction. « rater encore », « rater mieux », c’est exactement ce qu’on fait quand on
traduit. « C’est le départ qui est difficile », là aussi je me retrouve, dans cet exil linguistique, quitter
l’anglais pour atterrir dans le français, se détacher du texte d’origine, s’éloigner. C’est vrai que c’est
difficile. Quant à l’épuisement de l’intégrité existentielle du référent, c’est tout à fait cela, le cœur de
l’affaire, un des noyaux sur lesquels le traducteur se casse les dents.
Je vais vous donner un exemple, parce que la théorie, c’est bien joli, mais sans images, on n’y comprend
rien.
Alors voilà, c’est Bernard Hoepffner (traducteur anglais-français dans les deux sens) qui parle à Agnès
Desarthe. Il lui demande :
- C’est quoi, selon toi, le mot le plus difficile à traduire de l’anglais vers le français.
Agnès se gratte le menton, la tête, elle cherche, puis propose :
- Longing ?
Bernard secoue la tête.

- Buoyant ?
Bernard s’esclaffe.
A chaque proposition, c’est non.
- Je donne ma langue au chat, finit par dire Desarthe.
- C’est table (prononcer teïbl, avec l’accent anglais, donc) ! s’exclame Bernard d’un ton triomphal.
- Tu te fiches de moi, Teïbl, c’est table, c’est facile, ça s’écrit pareil, c’est sans mystère.
- Mais non, ma jolie (Bernard est très flatteur avec les femmes). Teïbl, c’est en acajou, c’est rond, ça a
un pied unique et central et c’est recouvert d’une nappe qui tombe jusqu’au sol. Alors que table, c’est
en pin, c’est carré, ça a quatre pieds et c’est recouvert d’une nappe qui ressemble à une minijupe pour
meuble.
Fin du dialogue, fin de l’exemple, commentaire :
C’est plus ou moins ce que voulait dire Walter Benjamin quand il expliquait que
traduireBrodt par Pain est une erreur - même si ces deux termes semblent se correspondre
parfaitement, même si l’on ne trouvera jamais mieux - parce que Brodt c’est carré, légèrement humide
et noir, alors que Pain est blond dehors, blanc à l’intérieur et croustillant.
On n’est pas sorti de l’auberge. On n’est même pas sorti de la cuisine, à vrai dire.
La traduction peine à transmettre l’intégrité du référent. Elle permet le passage d’une langue à l’autre,
mais pas d’une culture à l’autre. Le dialogue entre les cultures serait-il alors, malgré la traduction, voire
à cause d’elle, un dialogue de sourds ?
Allons voir du côté des poètes. Ces gens-là trouvent bien souvent des solutions là où la langue défaille.
Je pense à Marina Tsvetaeva et à la magnifique lettre qu’elle adressa à André Gide pour le convaincre
de publier sa traduction des poèmes de Pouchkine en français. Dans son exposé, reproduit au sein du
très beau livre que lui consacre Tzvetan Todorov intitulé Vivre dans le feu, Tsvetaeva plaide pour un
écart salutaire.
Elle cite une strophe dans laquelle au mot olive elle substitue celui d’orange.
Tu me disais : demain mon ange,
Là-bas , au bout de l’horizon,
Sous l’oranger chargé d’oranges
Nos cœurs et lèvres se joindront.
Et elle explique :
« Pouchkine parle d’oliviers, ce qui, pour un nordique signifie Grèce et Italie. Mais moi qui écris en
français, pour des français, dois compter avec la France, pour laquelle l’olivier est Provence (voire
Mireille !) Que veux-je ? Donner l’image du Midi, d’un midi lointain, d’un midi étranger. Donc, je
dirai oranger et orange. (…) Encore un détail : l’oranger, comme le citronnier, n’existe pas en russe en
un seul mot : on dit l’arbre oranger, l’arbre citronnier. (…) Donc Pouchkine n’a pas eu le choix et a pris
le mot étranger « Olivier » qu’il a transformé en russe « Oliva ». Si l’oranger avait existé, il aurait
sûrement pris l’oranger. »
C’est un pari audacieux que fait la poétesse. Plutôt que de « rater mieux », elle choisit de réussir.
Sachez que Gide refusa de la publier, comme il refusa de publier Proust. Quel flair il avait, ce type, tout
de même…
Passons.

La difficulté du dialogue réside donc en partie dans la difficulté du départ, « c’est le départ qui est
difficile », disait Beckett.
Mais comme nous allons le voir, l’arrivée n’est pas beaucoup plus aisée.
Je pense à ce qui se passe quand un concept se heurte à des préconceptions ou à des préjugés dans la
langue d’arrivée. C’est de l’histoire ancienne me direz-vous car je vais piocher dans l’ancien testament,
chez Homère et chez Aristote, mais je vous assure que le genre de malentendus que je vais vous
dévoiler persistent et qu’ils sont aussi bien liés à l’inconscient collectif d’un peuple qu’à l’inconscient
privé du traducteur.
Dans le Cantique des cantique, la jeune fille déclare dans nombre de traductions françaises faites à
partir de la traduction latine : « Je suis noire, mais je suis belle. » Le latin a choisi de traduire le « vav »,
conjonction de coordination hébreue pas forcément oppositive, par un « sed » qui lui est
univoquement adversatif. Autrement dit, pour les latins, être noir(e) est un défaut. La traduction est
le miroir d’une pensée, d’une façon de voir le monde.
Chez Homère (Chant 1 de l’Odyssée, vers de 251 à 257) lorsque Télémaque évoque son père disparu il
utilise le terme apotmotatos, adjectif formé à partir du a privatif et de potmos(destin). En anglais, cela
a été traduit par « unknown death and silence are the fate of him », autrement dit, il est ici question
d’une mort incertaine, d’une mort inconnue. En français, Télémaque parle d’Ulysse en disant qu’il
est infortuné. Or ce qui fait clairement souffrir le fils, ce n’est pas que son père ait été malheureux,
c’est de ne pas même savoir si son père est mort, et si oui, où, et quand c’est arrivé, ainsi que
l’expriment les vers précédents dans lesquels Télémaque regrette de ne pas être le fils d’un homme
qui serait « mort dans ses domaines ».
Chez Aristote (Physique, livre IV), la même phrase donne en anglais : “The theory that the void exists
involves the existence of place: for one would define void as place bereft of body. The consideration
then would lead us to suppose that place is something distinct from bodies, and that every sensible
body is in place » Ce qui, retraduit en français donnerait quelque chose comme : « La théorie selon
laquelle le vide existe implique l’existence d’un lieu : car on peut définir le vide comme un endroit
dénué de corps. Cette considération nous mène alors à supposer que le lieu est distinct des corps et
que chaque corps sensible est en un lieu » Dans la totalité des traductions françaises à ce jour, on
trouve : « De plus, si le vide, quand on en admet l’existence, est quelque chose comme l’espace privé
de corps, on peut se demander dans quelle direction sera porté le corps qu’on y suppose placé. »
Vous êtes perdus ?
Moi aussi.
Et en plus, je ne parle pas grec.
Mais on voit bien que la version anglaise est pragmatique, presque empirique quand la version
française est conceptuelle, autrement dit obscure.
Ainsi traduirait-on dans une langue, comme on pense dans cette langue. Le dialogue aurait donc lieu,
ce dialogue entre les cultures que les traducteurs appellent de leurs vœux, mais ce serait l’occasion
d’une joute idéologique, d’un affrontement métaphysique.
Avançons encore dans la discordance et retournons à mes grand-mères, si vous le voulez bien.
 6
6
1
/
6
100%