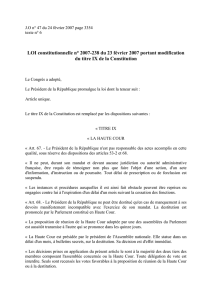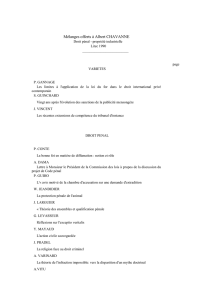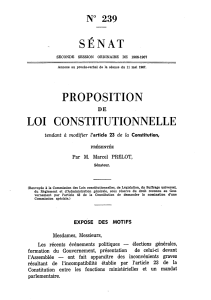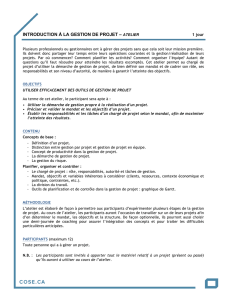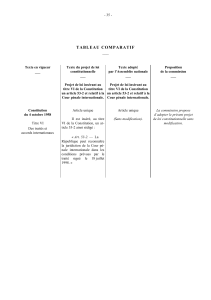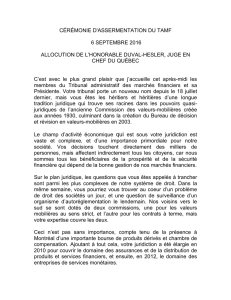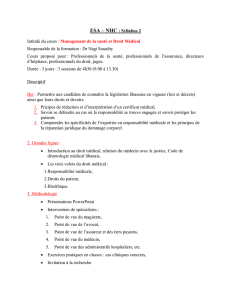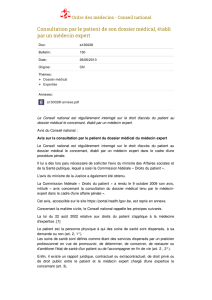Chronique législative

1
Version pré-print – pour citer cet article :
La loi constitutionnelle n°2007-238 du 23 février 2007 portant modification du titre IX de la
Constitution : une clarification du régime de responsabilité du président de la République »,
Revue de science criminelle et de droit pénal comparé, 2007-2, p. 343
CHRONIQUE LEGISLATIVE
Etienne Vergès,
Professeur à l’Université Pierre Mendès-France
Grenoble II
□2. Loi constitutionnelle n° 2007-238 du 23 février 2007 portant modification du titre IX
de la Constitution : une clarification du régime de responsabilité du Président de la
République.
La responsabilité pénale du Président de la République a donné lieu à de vifs débats
doctrinaux ainsi qu’à une importante controverse au sommet de la hiérarchie juridictionnelle
française. Aussi, la loi constitutionnelle promulguée le 23 février 2007 était-elle attendue
depuis le début du quinquennat présidentiel. En effet, la question de la responsabilité pénale
du chef de l’Etat avait rejailli à la fin des années 90 et le Président en fonction, alors candidat
à sa réélection, s’était engagé en mars 2002, alors que la campagne battait son plein, à
réformer sur ce point la Constitution. Une commission fut nommée dès le mois de juillet 2002
pour proposer un nouveau statut au Président ; mais il fallu attendre près de cinq années pour
que lesdites propositions soit consacrées par le pouvoir constituant.
L’affaire n’était pas simple. Au-delà de son aspect purement médiatique (le Président
avait fait l’objet d’une tentative de mise en cause devant une juridiction d’instruction), les
constitutionnalistes et les pénalistes s’affrontaient sur l’interprétation à donner aux textes en
vigueur et sur la manière de les réformer (J.-H. Robert, Le chef de l’Etat, point de vue du
pénaliste, RPDP, 2004-1, p. 147).
Au-delà des divergences, un consensus s’est dessiné sur la nécessité de prévoir un statut
dérogatoire au profit du Président de la République. Ce dernier ne peut être regardé comme un
citoyen ordinaire en raison de la fonction qu’il occupe. Cette fonction lui confère le statut de
représentant de l’Etat et lui donne pour mission de garantir la continuité de l’Etat. Mettre en
cause sa responsabilité devant une juridiction risquerait de mettre en péril tout à la fois la
fonction, mais encore la mission qui lui a été confiée (cf. le rapport de la Commission de
réflexion sur le statut pénal du Président de la République présidée par P. Avril, 12 déc.
2002). Un constitutionnaliste explique ainsi que l’immunité du chef de l’Etat trouve son
fondement dans la théorie du mandat et que cette immunité permet à l’homme d’exercer sa
fonction « à l’abri des pressions » (G. Carcassonne, Le statut pénal du chef de l’Etat, le point
de vue du constitutionnaliste, RPDP, 2004-1, p. 139). Par ailleurs, d’un point de vue purement
pratique, la responsabilité pénale du Président de la République ne va pas sans poser des
difficultés d’application. Comment imaginer, en effet, que le Président puisse être poursuivi
par le ministère public, alors que le magistrat du parquet est soumis à la hiérarchie du pouvoir
exécutif, et donc indirectement à celle du chef de l’Etat ?
La Constitution de 1958 n’avait pas ignoré la responsabilité du chef de l’Etat, mais elle
avait opéré une confusion entre responsabilités juridique et politique, soumettant ce justiciable
à la compétence d’une Haute Cour de justice, composée de parlementaires et compétente
uniquement pour statuer sur le cas de haute trahison (article 68 de la Constitution ancienne

2
version). La haute trahison ne constituait pas une véritable infraction, puisqu’elle n’était pas
prévue par le Code pénal, ne faisait l’objet d’aucune définition, et n’était assortie d’aucune
peine. Le principe de légalité criminelle interdisait, dés lors, que l’on donne à la haute
trahison, le qualificatif d’incrimination. Par ailleurs, la doctrine était divisée. D’un côté,
certains auteurs estimaient que le privilège de juridiction institué à propos de la haute trahison
ne faisait pas obstacle à l’exercice de poursuites pour les autres infractions commises par le
chef de l’Etat. D’autres considéraient, au contraire, que ce dernier ne pouvait être poursuivi
que pour haute trahison et seulement devant la Haute Cour de justice (cf. sur ce débat, Ph.
Houillon, Rapport fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, n°3537, p. 11).
Les hautes juridictions ont été saisies de ces différentes questions et y ont répondu
partiellement en utilisant des fondements distincts. Le 22 janvier 1999, dans une décision 98-
408 DC, le Conseil constitutionnel a considéré que le Président de la République bénéficiait
d’une immunité pour les actes accomplis dans l’exercice de ses fonctions, et « qu’au
surplus », sa responsabilité pénale ne pouvait être engagée que devant la Haute Cour de
justice pendant la durée de ses fonctions. La Cour de cassation a pris une position
partiellement conforme à celle du Conseil constitutionnel dans un arrêt d’assemblée plénière
du 10 octobre 2001 (JCP G, II, 10024, note C. Franck ; voir aussi, F. Hamon, A propos du
statut pénal du chef de l’Etat : convergences et divergences entre le Conseil constitutionnel et
la Cour de cassation, RSC 2002-1, p. 58). La juridiction judiciaire a confirmé l’immunité du
chef de l’Etat, précisant que ce dernier ne pouvait être poursuivi ni cité à comparaître comme
témoin durant son mandat. Dans le même temps, elle a limité la compétence de la Haute Cour
de justice au seul cas de haute trahison, conférant aux juridictions pénales la compétence pour
statuer sur les infractions commises par le Président ; toute procédure étant toutefois reportée
à l’issue du mandat présidentiel (à l’aide d’un mécanisme de suspension de la prescription de
l’action publique).
La responsabilité du Président avait été un peu défrichée, mais des zones d’ombre et des
contradictions subsistaient, de sorte qu’il était souhaitable qu’un texte fut adopté pour mettre
fin aux incertitudes. La loi constitutionnelle du 23 février 2007 établit ainsi une distinction
très nette entre la responsabilité juridique (I) et la responsabilité politique (II) du Président de
la République. Cet éclaircissement peut être accueilli positivement. Pour autant, la réforme de
la Constitution n’est pas totalement satisfaisante, en ce qu’elle manque de précision, non
seulement quant à son domaine d’application mais aussi quand à la définition des actes
susceptibles d’entrer dans le champ de l’immunité.
I) La responsabilité juridique du chef de l’Etat
Le Président de la République bénéficie d’un double régime de protection. Il jouit d’une
irresponsabilité juridique permanente s’agissant des actes commis en sa qualité (A). Pour les
actes accomplis à titre personnel, il profite seulement d’une inviolabilité temporaire (B).
A) L’irresponsabilité juridique permanente pour les actes accomplis en qualité de
chef de l’Etat
L’article 67 de la Constitution dispose que « le Président de la République n'est pas
responsable des actes accomplis en cette qualité, sous réserve des dispositions des articles
53-2 et 68 ». Cette irresponsabilité juridique correspond à la conception classique de
l’immunité ; laquelle empêche la personne d’être poursuivie devant une juridiction pénale
pour un acte qui présente le caractère d’une infraction. A titre de comparaison, les
parlementaires jouissent de cette immunité pour les opinions et votes qu’ils émettent dans
l’exercice de leurs fonctions (article 26 de la Constitution).
La difficulté réside dans la définition du champ de l’immunité. A l’évidence, le
Président de la République est irresponsable uniquement des actes accomplis durant l’exercice

3
de son mandat. Mais au cours de ce mandat, il faut encore distinguer entre les actes accomplis
es qualité et ceux qui relèvent de la vie privée du Président. L’ancienne version de la
Constitution excluait la responsabilité du Président pour les actes accomplis « dans l’exercice
de sa fonction ». Le changement de formule a été initié par la commission de réflexion sur le
statut pénal du chef de l’Etat (dite « commission Avril). L’auteur du rapport s’en explique en
estimant que la seconde formule (« en cette qualité ») est plus précise que la première (« dans
l’exercice de sa fonction »). Rien n’est moins sûr. L’exercice de la fonction est très proche,
pour ne pas dire synonyme de l’acte accompli es qualité. Plusieurs critères peuvent être
retenus pour identifier l’acte rattachable aux fonctions : le critère temporel, le critère matériel
ou encore celui fondé sur l’intention de l’auteur (cf. J.-H. Robert. article précit. p. 150).
Aucun de ces critères n’a été préféré par le constituant, laissant subsister un doute sur
l’éventuelle distinction entre l’acte rattachable à la qualité présidentielle et celui détachable de
cette qualité. L’exposé des motifs n’a d’ailleurs pas évacué l’ambigüité, usant successivement
des deux expressions : il distingue les actes accomplis en qualité de chef de l’Etat et ceux
« antérieurs à ses fonctions », ou encore accomplis « dans l’exercice de ses fonctions ».
Pourtant, le critère de distinction est tout à fait essentiel. Si l’on s’en tient, par exemple, à
l’idée selon laquelle la fonction présidentielle ne cesse pas pendant toute la durée du mandat
(G. Carcassonne, article précit. p.142), on admettra corrélativement que l’irresponsabilité
juridique est totale durant cette période. Si l’on s’aligne, au contraire sur la jurisprudence
administrative relative à la faute de l’agent public, on aura tendance à distinguer entre la faute
personnelle du Président, qui engage sa responsabilité, et la faute de fonction, pour laquelle il
est protégé.
Quel que soit le critère retenu, l’immunité juridique cesse lorsque le Président de la
République a commis un acte susceptible d’engager sa responsabilité pénale devant la Cour
pénale internationale (un crime contre l’humanité par exemple). L’article 67 de la
Constitution renvoie alors à l’article 53-2 du même texte, qui met en conformité la
Constitution française avec les statuts de la CPI adoptés sous la forme d’un traité le 18 juillet
1998. Par ailleurs, l’article 67 prévoit une autre dérogation, qui ne concerne pas la
responsabilité juridique, mais politique du Président (cf. infra sur la procédure de destitution).
De façon synthétique, les actes accomplis par le Président de la République en cette
qualité ne sont pas susceptibles d’engager sa responsabilité (qu’elle soit pénale ou civile). A
contrario, une juridiction pourrait se déclarer compétente pour juger le chef de l’Etat pour un
acte personnel accompli avant ou pendant l’exercice de son mandat. La juridiction serait alors
tenue de respecter l’inviolabilité présidentielle temporaire.
B) L’inviolabilité temporaire pour les actes détachables de la fonction
L’inviolabilité correspond à la situation d’une personne pénalement responsable, mais
qui, temporairement, ne peut faire l’objet de poursuites ou de mesures de contrainte. A titre
d’exemple, une telle inviolabilité bénéficie aux parlementaires et peut être levée par leur
assemblée ou le bureau de cette assemblée (article 26 de la Constitution). L’inviolabilité
pénale du Président de la République a été clairement établie par l’arrêt de la Cour de
cassation du 10 octobre 2001. La haute juridiction a ainsi affirmé que le Président ne pouvait
être poursuivi ou entendu comme témoin devant une juridiction pénale de droit commun. Elle
en a déduit que toute action exercée contre le chef de l’Etat devant une juridiction répressive
était irrecevable (certains auteurs préfèrent parler d’exception dilatoire à cet égard. Cf. J.-H
Robert, article précit. p. 154).
L’article 67 al 2 de la Constitution (issu de la loi commentée) reprend ce système en
élargissant sa portée. La disposition prévoit ainsi que le Président « ne peut, durant son
mandat et devant aucune juridiction ou autorité administrative française, être requis de
témoigner non plus que faire l'objet d'une action, d'un acte d'information, d'instruction ou de

4
poursuite ». Le champ de l’inviolabilité présidentielle est donc très large. La protection
s’étend à toutes les formes de responsabilité (civile, pénale, administrato-répressive). Mais le
texte va plus loin. En interdisant toute « action », il empêche le Président de la République
d’être attrait devant un juge pour quelque cause que ce soit. Un créancier du chef de l’Etat ne
pourra obtenir paiement de sa créance. L’épouse battue ou trompée du Président ne pourra
obtenir ni le divorce, ni même une ordonnance de non-conciliation pendant la durée du ou des
mandat(s) (cf. M.-L. Rassat, De la responsabilité pénale du Président de la République,
propos d’un pénaliste, Mélanges Dupichot, Bruylant, 2004, p. 437). Le titulaire d’un droit de
passage sur la propriété privée du chef de l’Etat devra attendre la fin de la charge
présidentielle pour demander l’exécution de la servitude. On mesure, avec ces quelques
exemples de la vie quotidienne l’incohérence d’un mécanisme d’inviolabilité totale, qui
prétend protéger la fonction présidentielle en niant les droits les plus élémentaires des autres
citoyens. On aurait pu imaginer au contraire, s’agissant d’action portant sur des droits civils,
que la représentation du Président de la République puisse être assurée par un mandataire
contre lequel les actions seraient dirigées. Le chef de l’Etat n’aurait pas été inquiété et les
droits des tiers auraient été préservés. Par ailleurs, l’inviolabilité aurait dû tout simplement
être écartée pour les actions d’Etat (divorce, filiation…). La commission Avril et le pouvoir
constituant qui a repris ses propositions, ont confondu la mise en œuvre de la responsabilité
pénale du Président de la République avec l’exercice d’actions en justice qui ne remettent en
cause ni la fonction présidentielle ni la continuité de l’Etat. La portée de cette inviolabilité est
d’autant plus grande qu’elle couvre tous les actes détachables de la fonction commis pendant
la durée du mandat, mais encore tous les actes accomplis avant l’entrée en fonction du
Président.
Plusieurs atténuations ont été proposées pour palier les effets de l’inviolabilité
présidentielle. La première réside dans la suspension des délais de prescription ou de
forclusion des actions susceptibles d’être exercées contre le chef de l’Etat. L’article 67 al. 3 de
la Constitution énonce que « les instances et procédures auxquelles il est ainsi fait obstacle
peuvent être reprises ou engagées contre lui à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la
cessation des fonctions ». Le délai d’un mois correspond à une période de transition entre la
fin des fonctions présidentielles et le retour à la qualité de citoyen ordinaire.
Par ailleurs, la commission Avril a proposé la mise en place, dans une loi organique,
d’un mécanisme assurantiel qui permettrait de garantir l’indemnisation des dommages causés
aux tiers durant l’exercice du mandat présidentiel. Il a encore été suggéré de transférer à un
tiers les contrats de travail que le Président aurait pu conclure, en tant qu’employeur,
antérieurement à son entrée en fonction. On pourrait enfin imaginer, pour les actes les plus
graves, de mettre en œuvre la procédure de destitution (cf. infra sur cette procédure)
permettant au Président de retrouver sa qualité de citoyen ordinaire.
Le problème essentiel réside dans le fait que la preuve d’un acte susceptible d’entrainer
la destitution sera, en pratique, impossible à rapporter. Aucun acte coercitif de recherche de la
preuve (civile ou pénale) ne pourra être engagé contre le chef de l’Etat. Le mécanisme
d’inviolabilité bloque ainsi, non seulement les actions en justice, mais encore le mécanisme de
responsabilité politique qui a été mis en place par la loi constitutionnelle du 23 février 2007.
II) La responsabilité politique du chef de l’Etat
L’étude de cette responsabilité déborde le cadre d’une chronique législative de droit
pénal, mais il est difficile de scinder artificiellement deux mécanismes qui sont, en réalité,
complémentaires. Notre commentaire sera toutefois plus retreint et, à l’évidence, moins averti.
La commission Avril écrivait dans son rapport : « il a donc paru plus sain, à la fois
pour la justice et pour la politique, de distinguer les deux registres et de situer d’abord la
responsabilité du chef de l’Etat dans le registre politique ». Les propositions ont été reprises

5
par le constituant sous la forme d’une procédure de destitution mise en œuvre au sein du
pouvoir législatif.
L’article 68 de la Constitution prévoit désormais : « le Président de la République ne
peut être destitué qu'en cas de manquement à ses devoirs manifestement incompatible avec
l'exercice de son mandat. La destitution est prononcée par le Parlement constitué en Haute
Cour ». Deux précisions terminologiques s’imposent. En premier lieu, l’autorité qui prononce
la destitution n’est plus un organe juridictionnel puisque la Haute Cour a perdu son
qualificatif « de justice » qu’elle possédait dans l’ancienne version de l’article 68. La
modification est importante car elle souligne que le processus de destitution relève
uniquement d’un organe politique (cf. B. Mathieu, Les propositions de la " commission Avril
" relatives au statut juridictionnel du Président de la République, JCP 2003, act. 18). En
second lieu, la haute trahison du chef de l’Etat a été remplacée par le « manquement à ses
devoirs manifestement incompatible avec l'exercice de son mandat ». Le champ d’application
de la faute susceptible d’engager la responsabilité politique a donc été sensiblement élargi.
L’existence d’un tel manquement devra être constatée par le Parlement constitué en Haute
Cour à la majorité des deux tiers des membres. Le Président de la République est ainsi protégé
contre les risques d’un Parlement hostile dans une improbable hypothèse de cohabitation. A
l’inverse, un Président soutenu par sa majorité devra commettre un acte particulièrement
grave susceptible d’entrainer une perte de confiance au sein même de sa famille politique.
Compte tenu de la concomitance entre les élections présidentielle et législative, la procédure
de destitution devrait avoir, en pratique, un caractère très exceptionnel (la commission Avril
avait d’ailleurs simplement proposé un vote à la majorité des membres, analogue à la mise en
œuvre de la responsabilité du gouvernement).
Compte tenu de ce caractère exceptionnel, il y a fort à croire, que la faute politique
devrait revêtir un caractère pénal pour provoquer une procédure de destitution. Si une
dissolution imprudente ou un référendum perdu ne devrait pas suffire à engager la
responsabilité politique du Président, il pourrait en être autrement s’il advenait que le chef de
l’Etat ait commis un meurtre ou qu’il ait accompli des actes de torture au cours d’un conflit
passé (cf. G. Carcassonne article précit. p. 144). A ce titre, le texte constitutionnel n’établit
aucune distinction selon que le manquement aux devoirs du Président résulte d’un acte
commis antérieurement au mandat présidentiel ou au cours de ce mandat.
Il n’en reste pas moins que le constituant a ignoré le problème essentiel de la preuve du
manquement. D’abord, l’inviolabilité du Président fait obstacle à toute enquête policière ou
judiciaire à caractère contraignant. Ensuite, aucune procédure d’enquête parlementaire n’a été
prévue par la réforme constitutionnelle pour établir la preuve des faits reprochés. Enfin, les
délais mis en place pour réunir la Haute Cour (quinze jours à compter de la décision de la
première assemblée) et pour rendre une décision (un mois à compter de la décision de
réunion) sont tout à fait incompatibles avec la conduite d’une enquête sérieuse. La destitution
du Président de la République est, à l’évidence, une décision grave. Bien que cette sanction
relève d’un processus purement politique, le constituant semble avoir ignoré tout à la fois la
nécessité d’une enquête permettant d’éclairer la Haute Cour sur la réalité des faits, et le
nécessaire respect des droits de la défense dont devrait bénéficier le chef de l’Etat en de telles
circonstances.
La loi constitutionnelle du 23 février a donc le mérite de clarifier le régime de
responsabilité du Président de la République mais le travail salutaire ainsi réalisé n’est pas
irréprochable. En souhaitant distinguer responsabilités pénale et politique, le constituant a
placé le chef de l’Etat hors de la catégorie des citoyens soumis au droit. Par ailleurs, en
instituant une procédure de destitution purement politique, la loi constitutionnelle présente des
 6
6
1
/
6
100%