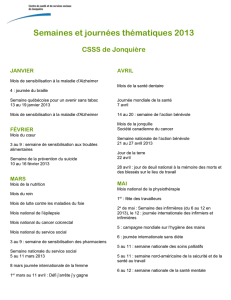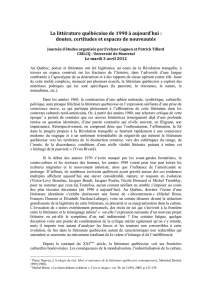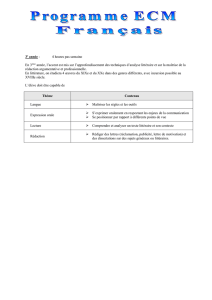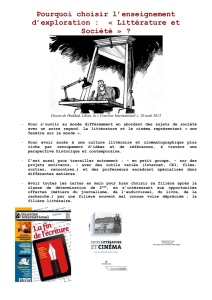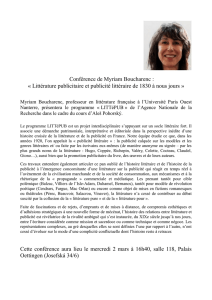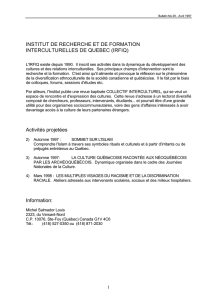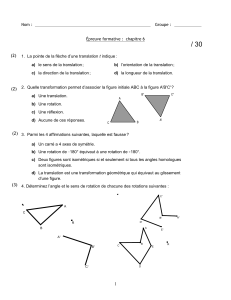Traduction de Las malas juntas de José Leandro Urbina suivi de La

Traduction de Las malas juntas de José Leandro Urbina
suivi de
La littérature latino-canadienne en traduction : zones de contact, zones de tension
par Julie Turcotte
Département de langue et littérature françaises
Université McGill, Montréal
Mémoire soumis à l’Université McGill en vue de l’obtention du grade de M.A. en
langue et littérature françaises
Décembre 2012
©Julie Turcotte, 2012

i
Remerciements
Pour son soutien inconditionnel, pour la confiance inébranlable qu’elle m’a témoignée,
pour ses nombreuses relectures toujours attentives et ses commentaires éclairants, pour sa
présence et ses encouragements tout au long de mes études en lettres et traduction, je
tiens à remercier sincèrement ma directrice, Annick Chapdelaine.
Pour m’avoir accueillie et reçue dans sa famille au Chili, pour son immense générosité à
mon égard, pour m’avoir permis de découvrir son pays et sa ville et aidée à mieux
comprendre les histoires de Las malas juntas, pour toutes les discussions passionnantes et
les moments inoubliables, je remercie du fond du cœur José Leandro Urbina.
Pour l’aide financière qu’ils m’ont accordée au cours de mes années de maîtrise, je
remercie le Conseil de recherche en sciences humaines du Canada (CRSH), le Fonds
québécois de recherche sur la société et la culture (FQRSC), le DLLF et l’Université
McGill.
Pour avoir pris le temps de lire mes traductions et de me faire part de ses commentaires et
suggestions, qui ont grandement contribué à rehausser la qualité des nouvelles en
français, mes remerciements les plus sincères vont à Christian Altamirano. Merci
également à Joey Grégoire pour sa relecture et ses remarques avisées.
Et finalement, pour m’avoir accordé la permission de traduire et de reproduire ici les
nouvelles de Las malas juntas, j’adresse tous mes remerciements à la maison d’édition
LOM.

ii
Résumé
La première partie de ce mémoire consiste en une traduction de l’espagnol au français
d’environ la moitié des textes du recueil de nouvelles Las malas juntas, de l’écrivain
chileno-canadien José Leandro Urbina. Cette œuvre importante d’un auteur renommé au
Chili mais peu connu au Canada, parue pour la première fois en 1978 à Ottawa, n’avait
jamais été traduite en français.
La seconde partie du mémoire adopte une approche postcoloniale pour examiner dans un
premier temps le rôle et la place de la traduction dans la production et la diffusion d’une
littérature en espagnol au Québec et au Canada, et la façon dont cette littérature bouscule
certains présupposés des théories traditionnelles de la traduction. Dans un deuxième
temps, l’insertion problématique des œuvres latino-québécoise dans le corpus littéraire du
Québec est examinée sous l’angle des défis que posent ces œuvres en traduction pour la
définition des frontières de la littérature québécoise contemporaine.

iii
Abstract
The first part of this thesis consists of a translation from Spanish to French of
approximately half of the short stories in the book Las malas juntas, by Chilean-Canadian
writer José Leandro Urbina. This important book, by a writer renowned in Chile but little
known in Canada, was first published in Ottawa in 1978; up to this day, it had not been
translated into French.
The second part of this thesis takes a postcolonial approach to study the role and
importance of translation in the production and dissemination of a Spanish-language
literature in both Quebec and Canada, and to describe how this literature calls into
question some traditional concepts of translation theory. We then examine the
problematic insertion of latino-québécois writers in the literary field of Quebec, by
looking at how these books in translation challenge the delimitation of contemporary
Quebecois literature.

TABLE DES MATIÈRES
Introduction ....................................................................................................................... 1
MAUVAISES FRÉQUENTATIONS ................................................................................ 5
Le dernier rendez-vous ................................................................................................... 5
En attendant Godot ......................................................................................................... 6
Elle .................................................................................................................................. 7
Réunion de famille .......................................................................................................... 8
L’amulette ..................................................................................................................... 11
Notre Père qui est aux cieux ......................................................................................... 17
Deux minutes pour s’endormir ..................................................................................... 17
La distribution de pain .................................................................................................. 25
Nuit de chiens ............................................................................................................... 26
Les mauvaises fréquentations ....................................................................................... 31
Portrait d’une dame ....................................................................................................... 38
Le fleuve ....................................................................................................................... 38
Inopportun ..................................................................................................................... 46
La séduction .................................................................................................................. 47
Ornithologie .................................................................................................................. 48
Rage .............................................................................................................................. 54
Immolation .................................................................................................................... 55
Relations ....................................................................................................................... 55
Le retour à la maison ..................................................................................................... 56
Dernière question .......................................................................................................... 69
La littérature latino-canadienne en traduction : zones de contact, zones de tension ... 71
I. Zones de contact ........................................................................................................ 74
1.1 Naissance d’une littérature en espagnol au Québec et au Canada ...................... 74
1.2 Dynamique de la zone de contact ....................................................................... 76
1.3 Zone de contact / de traduction ........................................................................... 80
1.4 Postcolonialisme des lettres latino-canadiennes ................................................. 84
II. Zones de tension ....................................................................................................... 89
2.1 Une littérature (latino-)québécoise? .................................................................... 89
2.2 Des périphéries et des centres ............................................................................. 91
2.3 Des écritures migrantes au Québec ..................................................................... 94
2.4 Traduction et conflictualité ................................................................................. 98
Conclusion .................................................................................................................. 102
BIBLIOGRAPHIE ........................................................................................................ 105
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
 52
52
 53
53
 54
54
 55
55
 56
56
 57
57
 58
58
 59
59
 60
60
 61
61
 62
62
 63
63
 64
64
 65
65
 66
66
 67
67
 68
68
 69
69
 70
70
 71
71
 72
72
 73
73
 74
74
 75
75
 76
76
 77
77
 78
78
 79
79
 80
80
 81
81
 82
82
 83
83
 84
84
 85
85
 86
86
 87
87
 88
88
 89
89
 90
90
 91
91
 92
92
 93
93
 94
94
 95
95
 96
96
 97
97
 98
98
 99
99
 100
100
 101
101
 102
102
 103
103
 104
104
 105
105
 106
106
 107
107
 108
108
 109
109
 110
110
 111
111
 112
112
 113
113
 114
114
1
/
114
100%