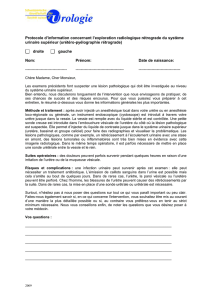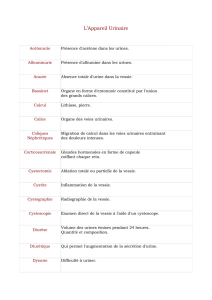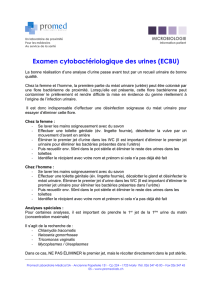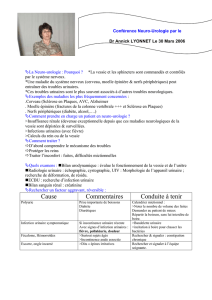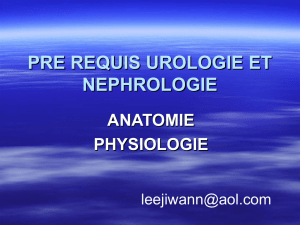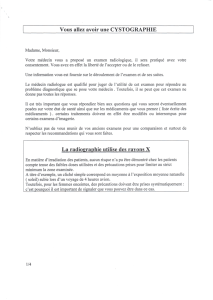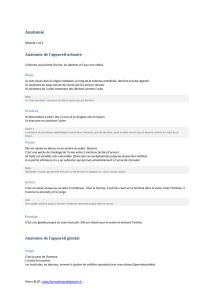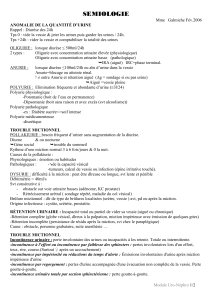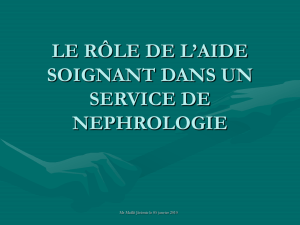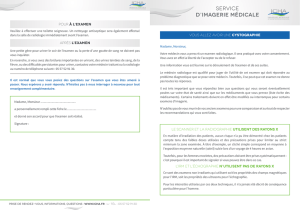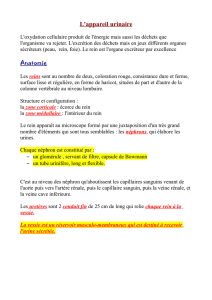dossier - Edimark

© Joubert/Phanie
© CMEABG-UCBL/Phanie
P
etit rappel : l’appareil urinaire
est constitué des organes qui
sécrètent l’urine (les deux
reins), le canal qui conduit l’urine
(l’uretère) jusqu’au réservoir (la vessie
et son canal évacuateur (l’urètre).
Classiquement, on divise l’appareil uri-
naire en deux unités fonctionnelles :
- le haut appareil urinaire qui com-
prend le rein et l’uretère ;
- le bas appareil urinaire qui corres-
pond à la vessie et à l’urètre.
Les reins
Les reins assurent l’équilibre des diffé-
rents secteurs corporels en relation
permanente avec l’environnement
comportemental et physique ; l’excré-
tion calculée des substances inuti-
lisables provenant du métabolisme
endogène ; la fourniture d’hormones
indispensables à la régulation de
différentes fonctions adaptatives.
Le parenchyme rénal est constitué de
500 000 unités fonctionnelles ou
néphrons (1 million pour les deux
reins). Le néphron est l’unité de fabri-
cation de l’urine. Il se compose du glo-
mérule qui fait partie du système vas-
culaire et qui est issu de l’artériole
afférente. Il est situé au niveau du cor-
tex (interface sang/urine, par l’inter-
médiaire d’une membrane semi-
perméable). Le tube urinaire situé au
niveau de la médullaire est décrit par
différents segments : proximal, anse
de Henle, distal. Le néphron est noyé
dans un tissu interstitiel. Un quart de
chaque rein travaille en permanence,
et en cas de perte d’un rein, l’autre
développe une hypertrophie compen-
satrice (devient plus gros mais com-
porte un même nombre de néphrons).
Recevant normalement le quart du
débit cardiaque par minute, le rein est
irrigué chaque jour par plus de
1 700 litres de sang, soit environ
900 litres de plasma. Sur ces 900 litres
de plasma, 20 % sont filtrés au niveau
des glomérules pour former 180 litres
d’urine primitive, lesquels sont ensuite
modifiés dans le passage tubulaire et
aboutissent à 1 à 2 litres d’urines défi-
nitives. Dans ce système artériel, les
capillaires glomérulaires revêtent une
importance primordiale puisqu’ils per-
mettent la filtration dans la chambre
glomérulaire de 120 à 130 ml de
plasma à chaque minute.
La filtration de l’urine primitive est un
phénomène passif, principalement dû
au gradient de pression qui existe
entre l’artère glomérulaire (pression
Néphro-urologie
Comment maîtriser les équilibres
Professions Santé Infirmier Infirmière N° 54 • avril 2004
Sommaire
•Les infections urinaires
•Les infections urinaires nosocomiales (IUN)
•Les incontinences
•Les hématuries
•La rétention aiguë d’urine
•Hypertrophie bénigne de la prostate (HBP)
•Cancers
•Insuffisance rénale chronique (IRC)
•Lithiase urinaire
>>
>> DOSSIER
Un patient admis en service de néphrologie ou d’urologie
peut être hospitalisé pour un bilan programmé de sa mala-
die rénale chronique (ou une chirurgie programmée) ou
hospitalisé en urgence pour le traitement d’une pathologie
aiguë ou pour la prise en charge d’une aggravation de sa
pathologie chronique. De l’accueil en phase aiguë aux
soins pour les patients atteints de maladies chroniques,
comme ceux admis en dialyse, ou dans les services d’im-
plantation rénale, le rôle infirmier s’avère prépondérant.
Préparer, rassurer le patient, expliquer les soins simple-
ment alors que le système est complexe.
NÉPHRO-UROLOGIE 17
Dossier 19/04/04 16:09 Page 17

>> DOSSIER
artérielle) et le glomérule lui-même
(pression voie excrétrice supérieure).
Cette urine primitive, véritable filtrat,
chemine dans le tube contourné dis-
tal, l’anse de Henle et le tube
contourné proximal.
Les tubes du système urinaire sont le
lieu de profondes modifications de
l’urine primitive grâce à la réabsorp-
tion (transferts d’eau et de sub-
stances dissoutes de l’urine vers le
sang) - ou la sécrétion (transferts du
sang péritubulaire vers l’urine). C’est
pendant ce cheminement que, par
des mécanismes de sécrétion et de
réabsorption, est constituée l’urine
définitive. L’urine filtrée est réabsor-
bée à 99 % (concentration des
déchets à éliminer). Les tubes
contournés distaux se jettent dans
les tubes collecteurs qui s’abouchent
au sommet des papilles. Sur celles-ci
est ventousée la voie excrétrice intra-
rénale qui comprend des petits
calices.
La voie excrétrice supérieure est for-
mée par les cavités urétéro-pyélo-
calicielles dont le rôle est d’acheminer
les urines produites en continu par le
rein vers la vessie. Ces cavités sont
entourées d’une musculature lisse qui
se contracte régulièrement. Cette onde
de pression péristaltique, véritable sys-
tole, naît à intervalles réguliers à partir
du bassinet (nœud sinusal) pour che-
miner vers le bas uretère en propulsant
de manière active l’urine vers la vessie.
Cette onde de pression croît au fur et à
mesure qu’elle se rapproche de la ves-
sie. L’uretère, après avoir traversé le
muscle vésical, chemine sous la
muqueuse vésicale pendant quelques
millimètres avant le méat urétéral. Ce
trajet sous-muqueux évite le reflux des
urines vers le haut appareil lors de la
miction, et protège ainsi celui-ci
comme une valve anti-reflux.
La vessie
La vessie est un muscle lisse, creux,
qui stocke les urines entre deux mic-
tions. Pendant la phase de remplis-
sage, le muscle vésical se relâche
adaptant avec précision son volume
(contenant) au volume d’urine
(contenu), maintenant ainsi une
pression intravésicale basse (protec-
tion du haut appareil). Le sphincter
est contracté pendant cette phase.
Lors de la miction, le muscle vésical
se contracte, alors que le sphincter se
relâche (synergie vésico-sphincté-
rienne), permettant ainsi l’expulsion
complète des urines vésicales vers
l’extérieur, via l’urètre. La puissance
du jet urinaire est la résultante de
deux forces, la contraction vésicale
(force active dynamique) à laquelle
s’oppose la résistance urétrale (force
passive).
Professions Santé Infirmier Infirmière N° 54 • avril 2004
DOSSIER
18
>>
L’urètre
L’anatomie de l’urètre de la femme est dif-
férente de celle de l’urètre de l’homme.
Chez la femme, c’est un bref conduit de
3 cm qui fait suite au col vésical. Il contourne
le bord inférieur du pubis puis rejoint la paroi
antérieure du vagin sur laquelle il s’applique
étroitement. Ce conduit s’ouvre à l’extérieur
par le méat urétral au niveau de la vulve, à
2 cm en dessous et en arrière du clitoris,
immédiatement avant l’hymen et l’orifice
vaginal. Il est constitué d’une muqueuse de
type urothélial. Les moyens de fixité de
l’urètre sont le col vésical en haut, la paroi
antérieure du vagin en arrière, et les liga-
ments pubo-urétraux en avant.
L’urètre masculin sert à excréter l’urine
mais aussi le sperme. Il est plus long
que chez la femme (14 cm en moyenne)
et traverse successivement la pros-
tate
(urètre prostatique), l’aponévrose
moyenne
du périnée (urètre membra-
neux) et le corps spongieux (urètre
spongieux). Sa structure est également
différente de celle de l’urètre féminin.
Chez l’homme, l’urètre est constitué
d’un épithélium transitionnel. On dis-
tingue la musculature lisse et la muscu-
lature striée. La première est disposée
autour de l’urètre prostatique, réalisant
un anneau musculaire (sphincter pré-
prostatique) qui s’oppose à l’éjaculation
rétrograde. Sa commande est involon-
taire. La seconde réalise le sphincter uré-
tral externe, de commande volontaire.
Chez la femme, la partie proximale de
l’urètre est bordée par un épithélium transi-
tionnel qui change distalement et devient
un
épithélium squameux non kératinisé.
Cependant, la musculature lisse est iden-
tique à celle de l’homme. La musculature
striée entoure la portion moyenne de l’urètre
sur une hauteur de 2 cm et forme, au des-
sous, un arceau à concavité postérieure.
ALP
Focus ...
Créatinine et urée
L’augmentation de
la créatinimémie au
cours de la
progression de l’insuf-
fisance rénale est due
à une diminution de
la quantité filtrée par
baisse du DFG. (débit
de filtration
glomérulaire).
La quantité d’urée
dépend de l’apport
protéique alimentaire,
de la production
hépatique d’urée et
du catabolisme
protéique endogène.
La concentration
d’urée dans les
liquides de
l’organisme dépend
des capacités
d’excrétion rénale du
DFG et de l’état
d’hydratation des
sujets.
Le rôle du rein est essentiel dans le maintien de l’équilibre hydroélectroly-
tique. Il préserve les compartiments liquidiens de l’organisme : les liquides
intra- (LIC) et extracellulaires (LEC), différents quant aux concentrations
des substances dissoutes, sont d’osmolarités identiques ; le sodium, élé-
ment prépondérant des LEC, doit y avoir une concentration telle que l’osmo-
larité de ce secteur s’équilibre avec celle des LIC.
Le rein intervient également pour équilibrer le bilan hydrique. Il sert à l’équi-
libre et l’excrétion du sodium, de l’eau et de l’urée et des autres électrolytes,
tels que le potassium, le calcium, les phosphates.
Il intervient aussi dans le maintien de l’équilibre acido-basique en agissant
sur la réabsorption des bicarbonates et la régénération tubulaire d’ions
bicarbonates.
Dans l’excrétion des substances organiques, le rein est capable de réabsor-
ber des substances énergétiques (glucose, amino-acides, protéines...) et
de se débarrasser, dans l’urine, de métabolites inactifs comme la créati-
nine, l’urée et l’acide urique.
Rôles du rein
Le rein et les hormones
Le rein est un organe cible pour les
hormones vasoactives, qui agis-
sent sur l’hémodynamique rénale,
et les hormones à action tubulaire,
qui modifient les transferts hydro-
électrolytiques. Le rein est aussi
un organe endocrine sécrétant
des hormones qui ont une action
sur d’autres systèmes, telles que
l’érythropoïétine et le (1,25)-dihy-
droxycholécalciférol.
Dossier 19/04/04 16:09 Page 18

Professions Santé Infirmier Infirmière N° 54 • avril 2004
E
ntre 20 et 50 ans, les infec-
tions sont 50 fois plus fré-
quentes chez la femme, mais
après 50 ans l’incidence chez l’homme
croît nettement du fait de l’augmenta-
tion des maladies prostatiques. La fré-
quence des infections est inférieure à
5 % dans la population féminine en
moyenne et inférieure à 0,1 % chez
les hommes. Mais elle augmente pro-
gressivement avec l’âge.
Les mécanismes de l’infection
Une infection survient quand un
micro-organisme, habituellement une
bactérie provenant du tube digestif,
pénètre dans l’urètre puis dans la ves-
sie et commence à se multiplier. La
plupart des infections sont liées à
Escherichia coli (E. Coli), qui vit nor-
malement dans le côlon, mais on
retrouve également : Proteus, staphy-
locoque, streptocoque, klebsielle, etc.
D’autres germes, comme le Chlamydia
et le mycoplasme, peuvent égale-
ment causer des infections chez
l’homme et la femme, habituellement
limitées à l’urètre et aux organes géni-
taux. Par contre, l’infection par
Chlamydia ou mycoplasme peut être
vénérienne.
Les causes
Chez la femme, l’infection urinaire est
favorisée par la faible longueur de
l’urètre, la modification de l’acidité
vaginale, la diminution des estrogènes
et des sécrétions vaginales – normale
après la ménopause –, certaines
douches vaginales avec des produits
qui déséquilibrent la flore bactérienne
habituelle du vagin et qui facilitent la
colonisation de ce dernier et de
l’urètre par des bactéries d’origine
digestive.
L’infection est surtout favorisée par les
rapports sexuels et, souvent, la pre-
mière infection coïncide avec le début
de l’activité sexuelle. L’utilisation de gel
spermicide est un facteur favorisant.
Les prolapsus de l’utérus et de la ves-
sie, qui entraînent une mauvaise
vidange de la vessie, favorisent égale-
ment l’infection de même que la gros-
sesse, à cause de la compression par
l’utérus, qui entraîne une dilatation,
voire une certaine obstruction des
uretères.
Chez l’homme jeune, la longueur de
l’urètre et les sécrétions prostatiques
acides expliquent en partie la rareté
des infections. Chez l’homme plus
âgé, la diminution de ces sécrétions,
l’augmentation du volume prostatique
et, surtout, la mauvaise vidange vési-
cale liée à l’obstacle prostatique favori-
sent la survenue des infections.
Cependant, chez l’homme comme
chez la femme, le diabète et les mala-
dies neurologiques sont des facteurs
favorisant l’infection urinaire.
Diagnostic
Certaines infections urinaires peuvent
être sans fièvre, limitées à l’urètre
(urétrite) et à la vessie (cystite),
gênantes mais bénignes. D’autres
accompagnées de fièvre, touchant les
reins (pyélonéphrite aiguë), la pros-
tate (prostatite aiguë), le testicule
(orchite) ou l’épididyme (épididy-
mite) peuvent être graves. La fièvre
est liée au passage du germe dans le
sang (bactériémie). Le risque est l’ag-
gravation de l’infection jusqu’à la sep-
ticémie.
D’autres infections sont des complica-
tions survenant après une interven-
tion, en cas d’obstruction (adénome
de la prostate, anomalie anatomique,
vessie neurologique, calcul, sondage...),
ou dans un contexte particulier
(ménopause, diabète...).
Les symptômes dépendent de l’âge,
du sexe, et de la portion de l’appareil
urinaire qui est infectée. Le risque
essentiel est la remontée de l’infec-
tion et l’apparition de fièvre en cas
d’atteinte de la prostate (prostatite)
ou des reins (pyélonéphrite).
Le diagnostic d’infection urinaire
repose sur l’examen bactériologique
(ECBU), avec la mise en évidence de
la bactérie responsable dans les
urines, et l’étude de la sensibilité du
germe à différents antibiotiques (anti-
biogramme). Le prélèvement des
urines doit être fait dans des condi-
tions d’hygiène qui évitent la contami-
nation accidentelle du prélèvement.
La mise en culture doit être effectuée
dans l’heure, sinon le prélèvement
doit être gardé à 4 °C. Quelquefois le
sondage est nécessaire.
Identification du germe
L’identification du germe repose sur sa
présence à l’examen direct des urines,
sa culture et l’antibiogramme.
L’examen permet d’affirmer l’infection
urinaire quand il montre la présence
d’une bactériurie monomicrobienne
(une seule espèce de bactérie) avec
un nombre de colonies supérieur à
105/ml, associée à une leucocyturie
(présence de globules blancs dans les
urines) > 10 000/ml ou une pyurie
(pus dans les urines).
La présence de plusieurs espèces de
germes chez un patient, en particulier
en l’absence de symptômes, est
habituellement liée à une contamina-
tion du prélèvement. Le seuil de
100 000 colonies/ml est utilisé habi-
tuellement. Il n’est pas formel et un
nombre de colonies inférieur n’exclut
pas totalement une infection, en
fonction du contexte clinique.
Si le nombre de germes est inférieur
à
10 000/ml, on considère qu’il n’y
a
pas d’infection. La présence de germes
sans augmentation du nombre de
>>
>> DOSSIER
NÉPHRO-UROLOGIE 19
Les infections urinaires
Les troubles les plus fréquents
Normalement, l’urine est stérile. Elle ne contient ni microbe,
ni virus, ni champignon. Cependant, les infections uri-
naires sont les plus fréquentes de toutes les infections
bactériennes, quel que soit l’âge. D’autant que l’urine n’a
aucune propriété pour résister aux germes.
Dossier 19/04/04 16:09 Page 19

globules blancs correspond générale-
ment à une contamination acciden-
telle des urines lors du prélèvement,
mais pas à une réelle infection.
Certains agents infectieux fréquents
de l’urètre (Chlamydia, Ureaplasma
urealyticum, Gardnerella vaginalis)
nécessitent des techniques d’identifi-
cation spéciales. Des bandelettes
réactives sont souvent utilisées en
urgence, ou en première intention.
Elles détectent la présence de glo-
bules blancs dans les urines, et sont
très utiles pour éliminer rapidement le
diagnostic d’infection.
Les cystites
La cystite est un état inflammatoire
aigu ou chronique d’origine infec-
tieuse, atteignant la vessie et respon-
sable de brûlures mictionnelles, de
pollakiurie, et de présence de pus
dans les urines.
Le diagnostic de cystite simple est cli-
nique, et l’ECBU est habituellement
inutile dans ce cas précis. Chez la
femme, un traitement antibiotique de
3 jours est habituellement suffisant,
alors qu’une prise unique d’un antibio-
tique, l’est souvent. En cas d’infection
survenant chez une patiente diabé-
tique, ou enceinte, ou en cas de symp-
tômes ayant duré plus d’une semaine,
le traitement est de 7 à 14 jours.
La cystite récidivante est définie par la
survenue de quatre épisodes par an
ou plus. L’infection qui récidive malgré
la stérilisation des urines par un traite-
ment antibiotique efficace doit faire
évoquer l’existence d’un “réservoir”
bactérien (calcul, corps étranger,
tumeur de vessie, malformation…).
Dans ces cas, une échographie rénale
et/ou une cystoscopie sont souvent
utiles, en fonction du contexte et de
l’âge de la patiente. Une infection réci-
divante avec une sensation d’uriner
de l’eau gazeuse suggère la présence
d’une fistule entre l’intestin et la ves-
sie. Souvent, les cystites récidivantes
chez la femme sont déclenchées par
les rapports sexuels. En fonction de
l’interrogatoire sur les circonstances
de survenue des infections, on peut
alors simplement conseiller à la
patiente de veiller à uriner après le
rapport et de prendre un comprimé
anti-microbien le soir des rapports.
Chez la femme âgée, la cystite est sou-
vent favorisée par l’atrophie de la
muqueuse vaginale qui apparaît après
la ménopause, et qui entraîne une
diminution des sécrétions vaginales. Le
traitement anti-microbien doit donc être
associé à un traitement local par des
ovules vaginaux pour favoriser le retour
de sécrétions vaginales satisfaisantes.
L’urétrite
L’urétrite est une infection bactérienne
de l’urètre qui survient quand des
microbes viennent coloniser de façon
aiguë ou chronique les glandes
situées le long de l’urètre masculin ou
féminin. Le Chlamydia, le gonocoque
et l’herpès sont des causes fréquentes
d’infection urétrale chez l’homme et la
femme.
L’infection vaginale par une mycose
(Candida albicans), un parasite (Tri-
chomonas) ou une bactérie peut
entraîner un syndrome urétral aigu.
La difficulté à uriner est due à l’in-
flammation vaginale locale, même
quand l’examen d’urine ne montre
pas d’infection.
Professions Santé Infirmier Infirmière N° 54 • avril 2004
L’infection de l’urètre chez l’homme
entraîne une difficulté à uriner, une
douleur à l’écoulement de l’urine
et, généralement, un écoulement
urétral. Le plus souvent lié à
Chlamydia trachomatis, à un myco-
plasme (écoulement clair), ou à
Neisseria gonor
rhoeae (écoule-
ment jaunâtre d’aspect
purulent,
typique du gonocoque). Les autres
agents infectieux en cause peuvent
être Ureaplasma urealyticum,
Trichomonas vaginalis, Candida
albicans. Les germes sont souvent
associés. Chez l’homme, l’urétrite
non traitée correctement expose au
risque ultérieur de rétrécissement
de l’urètre.
Les atteintes du rein
Les infections urinaires sont ascen-
dantes et atteignent quelquefois les
reins. Ainsi, la pyélonéphrite peut sur-
venir simplement du fait de la remon-
tée des microbes de la vessie vers les
reins lors d’une cystite initialement
banale. La pyélonéphrite désigne une
infection bactérienne du rein (elle ne
Infos ...
Chez l’enfant
Chez le jeune enfant,
il est parfois difficile de
faire le diagnostic
d’infection urinaire car
l’enfant ne peut décrire
ses troubles, et
les symptômes sont
souvent atypiques et
sans rapport direct avec
l’appareil urinaire :
nausées, vomissements,
altération de l’état
général… Parfois,
la survenue de fuites
urinaires ou une
mauvaise odeur
des urines peut attirer
l’attention. On estime
que 3 % des filles et
1 % des garçons ont eu
une infection urinaire
avant l’âge de 11 ans.
Et une infection urinaire
est plus souvent en rap-
port avec une anomalie
du système urinaire.
DOSSIER
20
>>
>> DOSSIER
Ces examens ne sont pas tous obligatoires dans tous les cas :
✓Une radiographie simple de l’arbre urinaire recherche un calcul
éventuel.
✓Une échographie des reins recherche une dilatation des cavités rénales,
un calcul.
✓Une urographie intraveineuse (UIV) permet de voir la sécrétion des
urines par les reins et de rechercher un obstacle.
✓Un scanner rénal, en cas d’infection grave, recherche un abcès du rein ;
✓Une urétrocystographie rétrograde est effectuée si l’on suspecte un
reflux vésico-urétéral, en particulier en cas de pyélonéphrite récidivante ou
d’infection urinaire fébrile chez l’enfant. L’examen consiste à remplir la ves-
sie avec un liquide opaque aux rayons X, et à voir si ce liquide remonte
dans l’uretère. L’examen doit être fait 2-3 mois après l’épisode infectieux
aigu (car l’infection peut créer un reflux transitoire) ;
✓Une scintigraphie rénale permet, après injection intraveineuse d’une
substance légèrement radioactive, de mesurer la fonction respective de
chaque rein en plaçant le patient sous une gamma-caméra. On utilise sur-
tout cet examen chez l’enfant et/ou quand il existe des séquelles rénales
d’infection.
Focus ...
En cas de pyélonéphrite aiguë
Dossier 19/04/04 16:09 Page 20

Professions Santé Infirmier Infirmière N° 54 • avril 2004
doit pas être confondue avec la glo-
mérulonéphrite, qui est une affection
inflammatoire des cellules filtrantes
du rein). Elle se traduit par de la fièvre,
souvent des frissons, une douleur
lombaire unilatérale, et souvent des
envies d’uriner fréquentes et des brû-
lures en urinant. L’examen des urines
montre une infection avec un germe
et du pus (pyurie), et il existe souvent
une bactériémie.
La pyélonéphrite chronique est
définie par la présence d’une cica-
trice du tissu rénal avec une rétrac-
tion de la cavité urinaire adjacente.
Cela correspond à un aspect radio-
logique montrant des reins bosse-
lés avec une déformation des cavi-
tés et une cicatrice du tissu rénal.
Classiquement secondaire à une
infection microbienne chronique
du rein, elle est souvent bilatérale.
La pyélonéphrite chronique sur-
vient le plus souvent chez des
patients ayant des anomalies ana-
tomiques obstructives, des calculs
responsables d’infection chronique
ou un reflux vésico-urétéral.
La prostatite
La prostatite est l’infection de la
prostate par une bactérie. S’il n’y a
pas de rapport entre prostatite et
cancer de la prostate, la prostatite
augmente souvent le taux de PSA
dont le dosage doit être revu
3 mois après l’épisode infectieux
en cas d’augmentation initiale du
taux de PSA. L’infection peut être
aiguë, avec un début souvent bru-
tal, comportant fièvre, frissons,
troubles urinaires, pesanteur et/ou
gêne dans le bas-ventre, douleur
lombaire, sang dans les urines, éja-
culation douloureuse. La notion de
troubles urinaires d’apparition
récente avec fièvre suffit à faire évo-
quer le diagnostic de prostatite. La
prostate est généralement doulou-
reuse au toucher rectal. L’ECBU
montre le plus souvent des germes
(colibacille en général), avec du
pus dans les urines. Les prostatites
sont plus souvent à Chlamydia
chez les patients de moins de
35 ans, et plus souvent à colibacille
chez les patients plus âgés.
L’écho-
graphie vésico-prostatique permet
d’évaluer le volume prostatique et
la vidange vésicale. Éventuellement,
en cas de prostatite récidivante, on
fait une fibros-copie de l’urètre et
de la vessie, ou une urétrographie à
la recherche d’un rétrécissement
urétral.
L’infection récidivante de la pros-
tate est la cause la plus fréquente
d’infection urinaire récidivante chez
l’homme du fait de la réintroduc-
tion du germe dans la vessie à par-
tir des glandes prostatiques infec-
tées. Cette prostatite chronique
peut s’accompagner d’une fièvre
minime ou d’une gêne pelvienne.
Le diagnostic de prostatite ne
repose pas sur une image échogra-
phique. Des calcifications prosta-
tiques visibles en échographie sont
fréquentes, même chez des sujets
normaux, et sont souvent signalées
par les radiologues. Cependant, ces
images sont tout à fait aspéci-
fiques, elles ne constituent en
aucune manière le signe d’une
prostatite évolutive, et ne nécessi-
tent aucun traitement particulier.
Parfois, une hémospermie révèle
l’infection intra-prostatique. La pré-
sence de sang dans le sperme, sou-
vent inquiétante pour le patient, est
généralement le signe d’une infec-
tion et non pas un signe de cancer
de la prostate.
Quant au terme de prostadynie, il
est employé pour une affection qui
a tous les symptômes d’une prosta-
tite, mais sans qu’aucun microbe
ne soit trouvé à l’examen de l’urine
et du sperme non plus aucun glo-
bule blanc. La cause de cette affec-
tion est inconnue et aucun traite-
ment n’est réellement efficace.
Orchite et épididymie
L’épididyme est le canal dans lequel
passent les spermatozoïdes à la
sortie du testicule. L’épididyme se
continue par le canal déférent. Les
infections de l’épididyme et du tes-
ticule sont souvent associées, réali-
sant alors une orchi-épididymite.
Elle peut être aiguë et se traduit par
une augmentation du volume de
l’épididyme, une douleur de la
bourse, avec des troubles urinaires
variables, de la fièvre et la présence
inconstante de germes dans les
urines. Le risque, en l’absence de
traitement, est la sténose de la voie
génitale et l’infertilité.
L’orchite aiguë se traduit par une
augmentation du testicule, une
douleur de la bourse, avec des
troubles urinaires variables, de la
fièvre et la présence inconstante de
germes dans les urines. L’infection
est généralement unilatérale. Chez
l’enfant, toute douleur au niveau
des bourses doit faire évoquer
avant tout une torsion du testicule,
qui nécessite un traitement chirurgi-
cal en urgence. En cas d’infection
urinaire avec fièvre importante,
s’accompagnant de frissons et
d’une altération de l’état général,
une hospitalisation est nécessaire
car un traitement efficace par voie
intraveineuse est recommandé.
Le principe général est de traiter
avant le résultat des prélèvements,
et d’adapter ensuite les antibio-
tiques en fonction du résultat de
l’antibiogramme (étude de la sensi-
bilité des germes). Le traitement
initial intraveineux est poursuivi jus-
qu’à 48 heures après la disparition
de la fièvre. Le relais est ensuite
pris par un traitement par voie orale
qui sera prolongé 3 à 4 semaines. Il
ne faut pas arrêter le traitement
prématurément, même en cas de
disparition des symptômes après
quelques jours, car le risque de
rechute est alors important. Dans
tous les cas, il faut traiter si néces-
saire une éventuelle obstruction,
(montée de sonde urétérale, drai-
nage percutané du rein…).
ALP
>> DOSSIER
NÉPHRO-UROLOGIE 21
Tuberculose urogénitale
La maladie est causée par le
bacille de la tuberculose qui,
après une infection pulmo-
naire initiale, migre vers le rein
et/ou la prostate. La présence
de pus et de bacilles dans la
voie excrétrice entraîne les
symptômes, essentiellement
une irritation vésicale (envies
d'uriner fréquentes, brûlures
en urinant).
Dossier 19/04/04 16:09 Page 21
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
1
/
16
100%