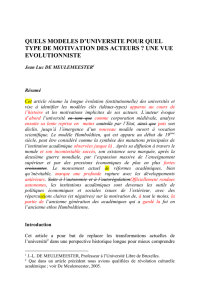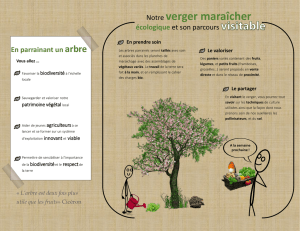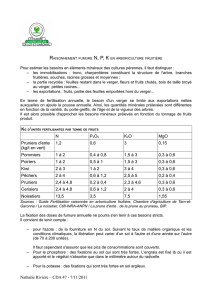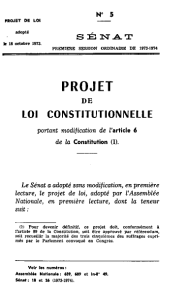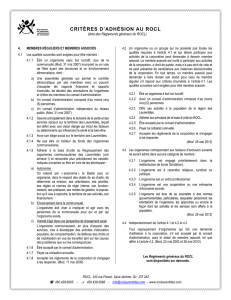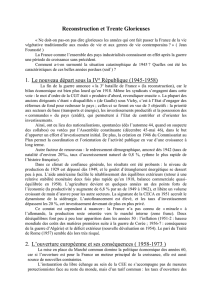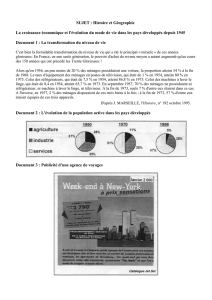quels modeles d`universite pour quel type de motivation des

QUELS MODELES D’UNIVERSITE POUR QUEL
TYPE DE MOTIVATION DES ACTEURS ? UNE
VUE EVOLUTIONNISTE
MODELS OF UNIVERSITY AND TYPES OF
MOTIVATION IMPLIED: AN HISTORICAL
PERSPECTIVE
J-L. Demeulemeester
In this paper, we summarize the long run (institutional) evolution of universities
in order to identify key models (ideal-types) and the implied motivations of
actors. We analyze the university as a medieval guild, its takeover by the State
and its decline; we then focus on the emergence of an open model of scientific
inquiry. We show how the Humboldtian model emerging in the early 19th
century can be viewed as a synthesis of prior developments. We show its
diffusion around the world and after the WW2 its problems in an age of massive
expansion of higher education and increased economic pressures. We show that
the today movement of academic reforms was at the same time unavoidable but
marking a clear rupture with the earlier developments. From autonomy and self-
regulation, academic institutions become tools of economic and social policies
steered from outside – with clear (negative) effects on the motivation of at least
the older generation of academics believing in the old academic (Humboldtian)
ethos.
JEL Classifications: I23 – N30
CEB Working Paper N° 09/033
August 2009
Université Libre de Bruxelles - Solvay Brussels School of Economics and Management
Centre Emile Bernheim
ULB CP145/01 50, avenue F.D. Roosevelt 1050 Brussels BELGIUM
e-mail: [email protected] Tel. : +32 (0)2/650.48.64 Fax : +32 (0)2/650.41.88

1
UNIVERSITELIBREDEBRUXELLES
QUELSMODELESD’UNIVERSITEPOURQUEL
TYPEDEMOTIVATIONDESACTEURS?UNE
VUEEVOLUTIONNISTE
MODELSOFUNIVERSITYANDTYPESOF
MOTIVATIONIMPLIED:ANHISTORICAL
PERSPECTIVE
JeanLucDemeulemeester–preliminarydraft
12/08/2009
Inthispaper,wesummarizethelongrun(institutional)evolutionofuniversitiesinordertoidentify
keymodels(ideal‐types)andtheimpliedmotivationsofactors.Weanalyzetheuniversityasa
medievalguild,itstakeoverbytheStateanditsdecline;wethenfocusontheemergenceofanopen
modelofscientificinquiry.WeshowhowtheHumboldtianmodelemergingintheearly19thcentury
canbeviewedasasynthesisofpriordevelopments.Weshowitsdiffusionaroundtheworldand
aftertheWW2itsproblemsinanageofmassiveexpansionofhighereducationandincreased
economicpressures.Weshowthatthetodaymovementofacademicreformswasatthesametime
unavoidablebutmarkingaclearrupturewiththeearlierdevelopments.Fromautonomyandself‐
regulation,academicinstitutionsbecometoolsofeconomicandsocialpoliciessteeredfromoutside
–withclear(negative)effectsonthemotivationofatleasttheoldergenerationofacademics
believingintheoldacademic(Humboldtian)ethos.JELcodes:I23–N30

2
QUELSMODELESD’UNIVERSITEPOURQUELTYPEDEMOTIVATIONDESACTEURS?UNE
VUEEVOLUTIONNISTE
JeanLucdeMeulemeester
INTRODUCTION
Lebutdecetarticleestdereplacerlestransformationsactuellesdel’université(quedansun
articleprécédentnousavionsqualifiéesderévolutionculturelleacadémique,aumoinsdans
lesensdel’abandondumodèlehumboldtienclassique;voirDeMeulemeester,2005)dans
uneperspectivehistoriquelongue.Nouscouvrironsunepériodehistoriquedeprèsdemille
ansaveclessimplificationsqu’imposecegenred’exercices.L’objectifesticid’utiliser
l’histoirepourdégagerlesprincipauxmodèlesd’université,typesd’organisationacadémique
quiontpuapparaître,comprendreleurstransformations(ouévolutions)ainsiqueletypede
motivationsquecesdiversmodèlesprésupposentchezlesacteursdeterrain(aupremier
rangdesquelslesprofesseursetchercheurs).Onpasseraenrevuesuccessivement
l’universitécommecorporationmédiévale(unlieuessentiellementd’enseignement,laissant
deplusenpluslarechercheàdesinitiativesprivéesetdoncsouventsecrètes),etlemodèle
concomitantderecherche«secrète»découpléedel’université,avantdemontrer
l’émergenceauxtempsmodernesd’unescienceouverte(PaulDavid,1998)oùlesrésultats
sontdébattuspubliquementetoùlessavantssebattentpourlanotoriétéetleprestige.On
verral’institutionnalisationdeceprocessusetlacaptureparl’Etatdecessociétéssavantes
au18ièmesiècle.Onparlerapluslonguementdumodèlehumboldtienquitented’unifier
enseignementetrecherche(publiqueetouverte)danslecadred’universitésprotégées(et
financéesparl’étatprussien)desexigencesdecourt‐termeetderentabilité,etdutype
d’acteuretdemotivationqu’ilprésuppose(professeurmuparlapassionpoursarecherche;
vocation–beruf–brefmotivation«interne»duchercheurmûparsaproprequêtede
savoiretdevérité).Cemodèlehumboldtienn’apasétéleseul(onauraitpuparlerdes
modèlesnapoléoniens,ainsiquedumodèledeNewman,1851),maisildominel’idéeque
l’ons’estlongtempsfaitedel’universitéidéale(peut‐êtreduseulpointdevuedes
professeurs).Cetexamendumodèlehumboldtienpermettrademieuxcomprendre
commentàlafoislesréformesactuellessontcorréléesàl’éclatementdecemodèlesuiteà
lamassificationdesuniversitésdanslecadredeséconomiessocialesdemarchéd’après‐
guerre,etlanature«révolutionnaire»(radicalementanti‐humboldtienne)desréformesen
cours.D’unemotivationintrinsèqueduprofesseuronpasseàunmodèlequichercheà
piloterl’universitédel’extérieurenfonctiond’objectifsfixésendehorsdecelle‐ci.Mutatis
mutandis,auseindecelle‐ci,lesautoritéscentralessouhaitantréaliserunestratégiedonnée
désirentaussipouvoircontrôlerlesacteursetorienterleurscomportementsetleurs
recherchesdansunsensdésiré(etdéfiniendehorsdespréférencesdecesacteurs).On
passeainsiversunmodèlequisupposeunemotivation«extrinsèque»envued’uncontrôle
parlehaut.Deuxtypesdemotivations(etparallèlementdepilotagedesacteurs)sontmis
enavant:celuidumarché(quêtederécompensemonétaire,d’argentvial’obtentionde

3
contratsrémunérateurs,vialafondationdespinoffsetc.…)ouceluidudirigisme(làencore
avecuneambigüitéentredesmodèleshiérarchiquesautoritairesserapprochantd’une
visionsurannéedel’entrepriseouviadesincitationsdiverses–avecdesévaluations
concomitantes).Onassistesouventàunmélangedesdeuxmodèles(unedes
caractéristiquesdunouveaumanagementpublicquiutiliseuneformederéplicationdes
incitationsdemarché,delaconcurrence,maisenvuedel’atteintedesobjectifsprédéfinis
parlecentre)etonparleraplussouventdequasi‐marchés(miseenconcurrencedecentres
derecherche,d’universités,depersonnelspourladistributiondefondsselonl’atteinte
d’objectifsfixésparlesautoritésétatiquesouuniversitaires)carlemondeacadémiquene
produitpasnécessairementdesbiensmarchandspossédantsdesprixdemarché(De
Meulemeester,2003).Onessaieradevoircommentcesmodèlespeuventrecelerunesérie
d’effetspervers(notammententermesd’innovationmaisaussidesimplemotivation).On
pourraitfaireiciunparallèleaveclesdébatssurlesdéfunteséconomiesplanifiées(quielles
aussiontoscilléentredesformesdeplanificationtrèsautoritairepourévoluerversdes
«quasimarchéscontrôlésparenhaut»‐cequ’onapuappelersocialismedemarché,avant
desetransformerenpureéconomiedemarché).
LANAISSANCEDESUNIVERSITESAUMOYENAGE:L’UNIVERSITECOMMECORPORATION
Lespremièresuniversités1apparaissentauMoyenAgeàpartirdu11ièmesiècle:d’abord
Bolognevers1088,ensuiteParis2vers1150,Oxfordvers1167,Toulouse1229(etpournos
régionsdesPays‐Bas:Louvainen1425).Lelienavecl’Eglise(quidominetoutlechamp
culturelàcetteépoque)estclair.C’estdanslesécolesdesmonastèresetcathédrales
qu’apparaissentau12ièmesiècledesconfrériesdeprofesseursetd’élèves:Universitas
MagistrorumetScolarium(Verger,1973;1999).EllessontorganiséesenNations(les
étudiantsvoyagentdéjà…)ethiérarchiséesselonlesgradesacadémiques(baccalauréat,
licence,maîtriseetplustarddoctorat).Cesconfrériess’autogèrent;ellesontleur
administrationetjusticepropres(onverraquecetteautonomieadûêtreconquisedehaute
lutte,sansparlerdel’autonomiefinancièrequineserajamaiscomplètementassurée).
L’enseignementàl’époqueconsisteessentiellementdanslalectureetexplicationdetextes
latinsetdedisputationes(controversesurunthème).D’entréedejeu,ilestbonderappeler
(àl’èredesdéclarationsdelaSorbonne,1998etdeBologne,1999)qu’ilyadeuxmodèles
distinctsdecorporations:celuideParis(corporationdeprofesseursoùlesétudiantssont
sousleurcontrôle,cesderniersappartenantauclergé)etceluideBologne(écolededroit
laïque,avecdesprofesseurslaïcssouslecontrôle,etembauchéspar,lesétudiants).Le
premiermodèleatriomphédusecond,maisnotreépoquecontemporaine(avidede
remettreleclient‐étudiantaucentre)aremislesecondaugoûtdujour.
1Pourl’histoiredesuniversitésauMoyenAge,voirJacquesVerger(1973;1999)etpouruneperspective
d’histoirelongueAlainRenaut(1995).
2Ilyaunmouvementdeformationdesuniversitéscommecorporationsquis’étenddanslecourantdu12ième
siècle.Parexemple,pourlaSorbonne,leshistoriensparlentd’unmouvementquis’étendde1180à1210–et
certainsinsistentsurtoutsurlapériode1200‐1210pourlaformationdelacorporationuniversitaire.

4
Lecontextequivoitlanaissancedesuniversitésestparticulier;ilestceluidemutations
politiques(lentmouvementderestaurationdupouvoircentral,particulièrementenFrance,
aveclesCapétiens)etderepriseéconomique(rôledesprogrèstechniquesenagriculture
autorisantunehaussedelatailledespopulations;périodedescroisades–prisede
Jérusalemen1099–quiauncontrecouppositifpourlecommerceenMéditerranéeetpour
ledéveloppementdesvillesitaliennescommeVenise,GênesetPise;re‐monétarisationdes
économiesetmouvementurbain,communalsurlequels’appuierad’ailleurslepouvoir
centralcontrelesféodaux).Ilestmarquéparlarenaissancedesvillesetunerelative
prospéritééconomique.Leclimatintellectuelestluiaussiinfluencéparceschangements
géopolitiques(conflitmaisaussicontactsdecultureavecl’Islam)etéconomiques.Les
occidentauxredécouvrentlessourcesantiques(notammentAristote),conduisantàune
approchenouvelledesproblèmespolitiques(placedelaréflexionrationnelle).L’Eglisequi
avaitjusquelàunmonopoleintellectueletculturelsedoitdefairefaceàceschangements,
cequilapousseraàinvestirdanslaproductiondenouvellesidéessynthétisantl’ancien
(maintiendesonpouvoirsymboliqueettemporel)etlemoderne(concilierladoctrinede
l’Egliseaveclaphilosophied’Aristote).C’estdanscecontextequeSaintThomasd’Aquin
(1225‐1274)(professeurdethéologieàlaSorbonneàParis)rédigesaSommeThéologique.
Lamotivationpremièredesacteursimpliquésdanscetteformationdecorporations
(professeursmaisaussiétudiants)estl’autonomie.C’estunconceptquiresteracentraldans
l’histoiredesuniversitésjusqu’ànosjours(oùcetteautonomieestcontestéeparlesdivers
pouvoirs).Maisc’estaussiunconceptnonexemptd’ambigüité.Onaditquelemodèlele
plushabituel(Paris)avuledéveloppementdesuniversitésàlasuitedesEcolesautourdes
cathédrales.Lelienavecl’Egliseestdoncdèsledépartambigü:l’universitéseveutàlafois
autonome,indépendante(parrapportauxévêques),maisellerestetoutàlafoisdans
l’orbiteecclésiale.Sesmembressontdesclercssoumisàlajusticeecclésiastique.Ilya
derrièrecelachezlesprofesseursunsoucidesécuritématérielle(salaire3)etdeprotection
parrapportaupouvoircivil.Lesuniversitésessaientdejouerdelapapautécontrele
pouvoirecclésiallocal;lapremièrelessoutiendrad’ailleurs,soucieusedesonpouvoir,desa
dimensioninternationaleetdesonrayonnement.Pourlesvilleselles‐mêmes,lerapportaux
universitésestambigü(Verger,1973,1999).Lesuniversitésconstituentpourellesune
charge(excèsdesétudiants,rixes,bagarres…maisaussipressionsurlesloyersparlahausse
delademandedelogements)maisaussiunatout(dépensesdesétudiantsetprofesseurs,
rayonnement…).L’universitévachercherl’autonomieen«surfant»entrelesintérêts
contradictoiresdecesdiversacteurspourobtenircommetoutecorporationdesprivilèges.
Qu’est‐cequ’unecorporation?
Comprendrecequ’estunecorporationpeutpermettredecomprendrelesmotivationsdes
acteursàenfairepartie.Dansunmondemédiévalcaractérisépardesrapportstrès
3Bienquesedéfinissantcommecorporation,l’universitéatoujourseudifficileàs’autofinancermêmeen
faisantpayersesservicesd’enseignementauprèsdesétudiants.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
1
/
26
100%