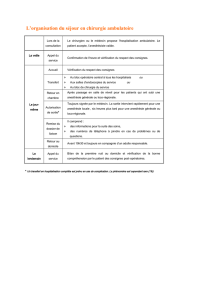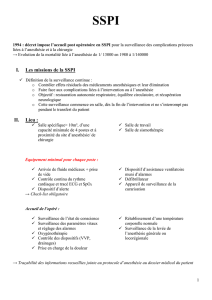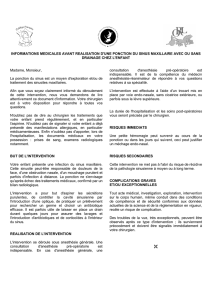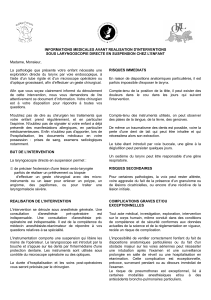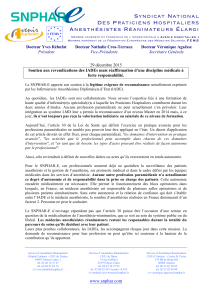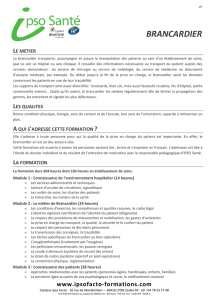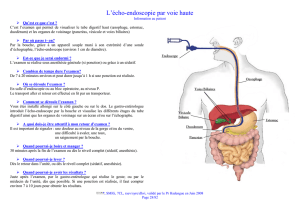lire le huitieme volet

MERCREDI2JANVIER 2013 23
Rendezvous avec le stress
Catherine Lambertini
catherine.lambertini@centrefrance.com
L’ hospitalisation
imprévue passe,dans la majeu
re partie des cas,par les urgen
ces.Dans la salle d’attente dé
diée aux familles et
accompagnants des patients,les
doigts se tordent, les yeux rou
gissent, le stress gagne du ter
rain.
«Cen’est pas
opérable. Il faut
attendreque ça se
résorbe. »
Mercredi dernier,midi, cinq
personnes d’une même famille
attendent des nouvelles du pa
triarche.Lematin, vers 8heu
res, l’une de ses filles aappelé le
SAMU. Il yavait urgence.
L’homme de 71 ans avait «tout
un côté paralysé ». Les pom
piers sont venus le chercher et
l’ont emmené aux urgences.Sur
place,une partie de la fratrie se
rejoint. Commencent alors de
longues heures d’attente,pour
quatredes huit enfants et
l’épouse.
«C’est l’angoisse », lâche l’uni
que fils.Lediagnostic est tombé
relativement tôt :AVC (accident
vasculairecérébral). Mais la fa
mille peine àêtreinformée et la
confusion s’installe.Caillot ?
Hémorragie ?Lepatient asubi
un scanner,dont les images ont
été envoyées àDijon. «Ils disent
que ce n’est pas opérable.Ilfaut
attendreque ça se résorbe.»
Vers 12 h30, en manque de
nouvelles,l’une des filles partà
la rencontred’un médecin, sui
vie par sa mère. Quelques mi
nutes plus tard, les deux fem
mes ressortent. L’ esprit plus
clair,mais pas apaisé pour
autant. «C’est une hémorragie
dans le cerveau, on nous a
montré l’image.Cen’est pas
opérable,confirmetelle.C’est
grave. »Ses yeux s’emplissent
de larmes.Elle les retient. Sa
sœur,celle qui aprévenu les se
cours,est en état de choc de
puis le matin. Elle ne dit pas un
mot.
«Ils disent que ça peut êtredû
àune poussée d’énervement. »
Le reste de la famille acquiesce.
«Onnel’a pas vu, ce ne sera
possible que quand ils lui
auront trouvé une chambre. »
Le fils s’agace.L’incompréhen
sion le gagne.«Siçasetrouve,
il ne sait même pas qu’on est là.
S’ils savent qu’ils ont tant de
patients dans l’année,ils pour
raient agrandir !»
«Çavaaller. […]C’est
un ancien combattant »
Les enfants,unpeu perdus,
essaient alors de comprendrece
qui les aamenés là. Le médecin
aparlé d’énervement. Ilscher
chent des explications.«De
toute façon, il atoujours été
comme ça », tranche le fils.Une
formule courante,qui pour une
personne en bonne santé
n’aurait soulevé aucun étonne
ment. Mais,étreint par le re
mordd’avoir pu évoquer son
pèreaupassé, il se reprend :
«Enfin, il est toujours comme
ça. Mais ça va aller.Cen’est pas
la premièrefois.Iladéjà eu un
triple pontage. Et puis,c’est un
ancien combattant. Il afait la
guerre»,serassurelejeune
homme.Comme il peut.
«Ilaurait mieux valu un
caillot, ils auraient pu le fluidi
fier.Leproblème,c’est qu’il pre
nait justement des médica
ments pour fluidifier le sang. »
Ilsont conscience que l’instant
estcrucial. Ne pas pouvoir voir
leur père, le toucher leur est in
supportable.Surtout s’il devait
lui arriver quelque chose.Mais
ça, ils s’interdisent d’ypenser.
Ilsserésignent. Et patientent. ■
Attente
Dans ce huitième voletdenotre
série sur l’hôpital d’Auxerre,nous
vousemmenons dans son quoti-
dien :les opérationsprogram-
mées, mais aussi l’attente et l’an-
goisse des patients et de leurfa-
mille…
ANGOISSE. Dans la salle d’attentedes urgences, les famillesdes patients appréhendent le diagnostic et les solutions
proposées par l’équipe médicale. PHOTO FLORIAN SALESSE
S’il existe des centresoudes uni-
tésantidouleurdans les hôpitaux
français, celui d’Auxerre ne dispo-
se que d’une consultation anti-
douleur,sans lit d’hospitalisation
ni équipe spécifiquement dédiée.
Le Dr Rodriguezest le seul à
tenir cette consultation pour la
quelle il faut compter deux à
trois mois d’attente.Lademan
de est importante (250 nou
veaux patients chaque année) et
les pathologies parfois lourdes.
«Ceque je rencontreleplus
souvent, ce sont des cas de lom
balgie (douleurs du dos) et de
douleurs diffuses ostéomuscu
laires (fibromyalgie) », indique
le Dr Rodriguezqui, afin de par
venir àsoulager les douleurs,
s’appuie sur des gestes techni
ques (auprès d’ostéopathes,po
dologues,psychologues…) et
des médicaments (psychotropes
et antalgiques).
Mais il aégalement recours à
l’auriculothérapie,«une techni
que qui rééquilibreles états
psychoémotionnels », en pi
quant de minuscules aiguilles
sur des points précis de l’oreille.
Le médecin dit obtenir 70 %de
«bons résultats ». Même si,
«parfois,les patients sont
sceptiques.»Entout cas,lepre
mier conseil, c’est qu’il faut ac
cepter sa douleur.«Quand on
est constamment en révolte,on
atoujours mal. » ■
C. L.
TECHNIQUE. L’auriculothérapie.C. L.
Douleur
Une prise en charge
aux techniques multiples
La peurdes aiguilles,del’incon-
nu, du noir,denepas se ré-
veiller,d’être malade au réveil,
de ce que le chirurgienvatrou-
ver pendant l’interventionou
l’angoisse de lâcherprise. L’anes-
thésierenvoie nombre de pa-
tients àdes peursancestrales.
L’acteest pourtant scientifique.
«Çaparaît plausible que les
gens aient peur,puisqu’on en
tend de temps en temps parler
d’accident », conçoit le Dr Pier
re Rodriguez, chef de service
anesthésiologieréanimation. Le
risque de choc allergique existe
en effet. «Oncompte un cas de
choc gravepour 1.000 pa
tients.»Enunquartd’heure, le
temps d’une consultation pré
anesthésique (obligatoireavant
toute opération), le médecin
tente,sibesoin, de rassurer le
malade.
Trois drogues sont utilisées
pour l’anesthésie àdes degrés
divers :undérivé de la morphi
ne pour bloquer la douleur,la
narcose,pour fairedormir,etle
curarepour le relâchement
musculaire. Le narcotique,
d’abordinduit en intraveineuse
est remplacé par une forme ga
zeuse tout au long de l’interven
tion, en fonction de l’âge et du
poids du patient. «Onbaisse les
doses avant la fin de l’interven
tion. »Silemédecin prescrit les
doses et la technique,aubloc,
les gestes sont assurés par les
infirmiers anesthésistes.«Ils
sont la cheville ouvrièrede
l’acte.S’ils viennent àmanquer,
on ferme des salles d’opéra
tion. » ■
C. L.
OPÉRATION. Durant tout le long de l’intervention chirurgicale, l’anesthésie
est prolongée par intubation et intraveineuse. PHOTO C. L.
Anesthésie
«Çaparaît plausiblequ’ils aientpeur »
Àcœur ouvert

24 MERCREDI2JANVIER 2013 MERCREDI 2JANVIER2013 25
AVANT. Avant d’êtreemmenéaubloc opératoire,Bruno aété douchéetasubi plusieurs analyses.
CHIRURGIE. Bruno est opéré par cœlioscopie. Cette technique permet au chirurgien d’intervenir sans ouvrir l’abdomen du patient. Il manœuvreàl’aide de trocarts et d’unecaméra, introduits dans de petites incisions.
PENDANT. De longues minutes s’écoulent avant que Bruno, allongé sur la table d’opération, ne soitpleinementanesthésié. APRÈS. Bruno met une heureàouvrir les yeux, et restesonné un moment.
Opéré le matin, de retour chez soi le soir
7heures
Bruno (*), âgé de 77 ans,atout intérêt à
êtrematinal. Il va subir le premier acte
chirurgical de la journée.Une hernie in
guinale.Son opération est programmée en
ambulatoire, depuis un mois et demi. Dé
barqué àl’hôpital à7heures,ilad’abord
été douché, avant une batterie d’analyses :
température, tension, constantes vitales.
Le personnel soignant lui aadministré un
calmant afin qu’il soit le plus détendu
possible.Ets’est assuré auprès de ses pro
ches qu’il ne serapas seul, àdomicile,à
son retour de l’hôpital. «Enambulatoire,
il doit toujours yavoir une personne avec
le patient, la nuit quisuit l’opération », ex
plique l’infirmièred’astreinte.
La chambredans laquelle le septuagé
nairepatiente aleteint blanc livide,bien
plus que lui dont les joues sont légère
ment rosies.Iln’est pas inquiet, se tourne
les pouces –ausens proprecomme au fi
guré –etbouge légèrement les pieds,plai
sante au sujet de son bracelet :«Ils ont
mis mon nom et ma date de naissance,
pour ne pas se tromper.»
Ce n’est que 45 minutes après son arri
vée que le brancardier viendraenfin le
chercher pour le conduireaubloc.Ilat
tendraencoreune petite demiheuredans
la salle dite d’accueil, auprès d’autres ma
lades,simplement recouverts d’une blou
se et d’une couverture. Régulièrement, le
personnel du bloc passe pour prendredes
nouvelles de chacun des patients,séparés
les uns des autres par une sorte de para
vent blanc.Pendant ce temps,l’équipe
préparelasalle d’op.Jusqu’à ce qu’enfin,
le futur opéré entre… ■
(*) Il s’agit d’un prénom d’emprunt.
Allongé sur la table d’opération, Bruno est d’abordpris
en charge par l’équipe d’anesthésie.Électrodes,perfusions,
il est vite raccordé àtout un tas de fils.«Elle est toujours
là, votrehernie ?»,taquine le chirurgien, qui fait les cent
pas dans le service en attendant d’êtreàpied d’œuvre.
L’équipe est d’humeur badine.Petit tacle de l’infirmier
anesthésiste (Iade) àl’interne de sa spécialité :«Tuvas de
voir prendrel’escabeau », en référence àsapetite taille.On
sent la sympathie qui les unit. Sans pour autant qu’ils per
dent le patient de l’œil. À8h20, ce dernier ferme les yeux,
mais peine àvraiment s’endormir.L’infirmier tireréguliè
rement sur ses paupières pour vérifier qu’il est inconscient,
avant de l’intuber,cinq minutes après.
Unefois Bruno sédaté, son corps est désinfecté par une
aidesoignante.Sous l’effet de la bétadine®, sa peau tire
sur le rouge brique.Pendant ce temps,l’Ibode (infirmière
de bloc opératoire) préparelekit de chirurgie :pinces à
clamper (servant àfermer les vaisseaux pour stopper l’hé
morragie), scalpels,solutions diverses,etc.Une fois le chi
rurgien équipé, il ne reste que les champs stériles àposer.
Le praticien effectue son premier acte chirurgical à8h38:
il implante une aiguille dans le ventredupatient, et diffuse
du gaz carbonique pour lui gonfler l’abdomen. Avant de le
raser àl’endroit où il pratiquerales incisions.«Pour être
chirurgien, il faut avoir la célérité des barbiers », s’amuse
til.Leseptuagénaireest opéré par cœlioscopie.Peu inva
sive, cette technique permet àl’équipe médicale de ne pas
ouvrir le ventre. Le chirurgien effectue trois petites en
tailles pour passer les trocarts,sortes de longues tiges qui
sont introduites àtravers la paroi de l’abdomen de Bruno
et grâceauxquelles il va pouvoir opérer.Lapremièreinci
sion, de onzemillimètres,sertàinsérer la caméra. Le mé
decin effectuerason intervention en fonction de ce qu’il
verrasur l’écran auquel elle est reliée.Les deux autres cou
pures ne sont que de cinq millimètres.Elles permettent
d’introduireune pince et un scalpel miniatures,qui vont
disséquer la hernie.Untravail d’une précision extrême.
Unefois cet ouvrage effectué, il ne reste qu’à positionner
et fixer une prothèse.L’intervention en tant que telle
n’auraduré qu’une quinzaine de minutes.L’opération ter
minée,les trois entailles sont refermées par des agrafes,
sur lesquelles sont disposés des pansements.
Si aucune complication ne s’est présentée lors de l’inter
vention, le réveil est plus dur pour Bruno qui, une fois l’ab
domen nettoyé par les soignants,nereprend toujours pas
conscience.Unpeu trop de stress,d’après l’Iade.Etl’une
des drogues injectée pour l’opération que son corps peine,
àl’évidence,àéliminer.Iltente de le stimuler,mais n’ob
tient qu’une «petite réponse ». Àl’extérieur,d’autres mala
des attendent leur chirurgie.Plusieurs personnes s’activent
déjà àpréparer la salle pour le suivant. L’infirmier appelle
la salle de réveil pour l’informer de l’arrivée de Bruno.Une
bouteille d’oxygène,àlaquelle il est relié, est fixée au lit. Il
quitte la salle d’opération, encoreintubé. ■
8h15
Entreson entrée dans la salle de réveil et le mo
ment où il reprend conscience,une heuretout
juste se seraécoulée.Régulièrement, une infirmiè
re tente de le ranimer.Elle l’appelle,lui tapote le
front. «Iln’y apas vraiment de tendances dans la
durée que prend le réveil. Ça dépend du métabo
lisme de chacun », expliquetelle.Elle ne peut pas
l’extuber,aurisque qu’il ne parvienne pas àrespi
rerseul. Àproximité, une petite dizaine de per
sonnes émergent tour àtour de leur anesthésie.
Ce n’est qu’à 10 heures que Bruno se réveille.
D’un seul coup.D’abordlevisage crispé par l’ef
fort, il tente de reprendresouffle.Puis tout son
corps se remet ensuite àbouger.Aumoment de
l’extubation, il al’air sonné, perdu même,lamain
tenue par celle,rassurante,del’un des membres
de l’équipe soignante,qui tente de le réorienter.
Il reste sous oxygène,diffusé par le biais d’un
cordon nasal, et ne demande s’il abien été opéré
et si tout s’est bien passé qu’au bout de quelques
minutes.Bruno ne quitterapas la salle de réveil
avant une bonne heure, le temps pour l’équipe de
s’assurer que toutes ses constantes vitales sont
correctes.Deretour dans le service de chirurgie
ambulatoire, il seraencoreune fois ausculté, dans
l’aprèsmidi, avant de pouvoir quitter hôpital. ■
Reportage réalisé par
Laurenne Jannot(textes) et Florian Salesse (photos)
9h05
Organisation.Sauf urgences, la programmation du bloc opératoire se fait sur la semaine,avec
lesopérations sous anesthésie généraledulundiaujeudi,enambulatoire ou avechospitalisa-
tionclassique. Le vendredi est réservé aux autres actes, notamment ceux ne nécessitant
qu’une anesthésie loco-régionale.Chaquechirurgienades vacations, sur lesquelles il est auto-
risé àprogrammerdes opérations,les autres journées étantconsacrées àlaconsultation. Le
programme doit être terminé avant le jeudi, 14 heures, pour validation. Il est vérifié une der-
nière fois le vendredi après-midi, jour où sont répartis lespersonnels soignants d’astreinte sur
les différentes opérations.
Spécialités.Le bloc du centre hospitalier, qui draine notamment lespersonnes âgées qui font
des chutes, fait beaucoup de traumatologie. Dans le domaine digestif,laquantité d’opérations
de chirurgie bariatrique (de l’obésité) est importante.Enorthopédie,l’essentiel des actes est
concentrésur le bas du corps (hanche,fémur) ainsi que sur l’épaule et le poignet.Les actes
chirurgicaux relevant de la neurologie, de l’ophtalmologie et de l’oto-rhino-laryngologie (ORL),
du facial et du rachis (colonnevertébrale) ne sont pas pratiqués àl’hôpital d’Auxerre.
Iade/Ibode.Les infirmiers anesthésistes (Iade) et de bloc opératoire (Ibode)diplômés d’Étatsui-
ventune formation spécifique,sur concoursetcomplémentaire àcelle dispensée en Institut de
soins infirmiers (IFSI).Celle-ci est de deux ans pour les Iades, qui exercent dans lesdomaines
de l’anesthésie-réanimation, de la médecine d’urgenceetdelaprise en charge de la douleur.
Le cursus est de 18 mois pour lesIbodes, qui exercent ensuite au sein d’une équipe en bloc
hospitalier, en étroite collaborationavec le chirurgien.
■LE FONCTIONNEMENT DU BLOC OPÉRATOIRE
■LE BLOC OPÉRATOIRE EN CHIFFRES
15.600
C’est,approximativement, le nombre
d’actes chirurgicaux (comprenant les
anesthésies)qui ont été pratiqués
en 2011 au centre hospitalier d’Auxerre.
8.700
Parmi les actespratiquésen2011,
c’est, approximativement, le nombre
d’actes opératoires.
6.900
Parmi les actespratiqués, c’est,
approximativement, le nombre
d’anesthésies pratiquéesen2011.
70
Le blocemploie 70 agents paramédicaux.
35
Le nombredechirurgiens en exercice
au bloc :11anesthésistes,15pour le bloc
central, deux gastro-entérologuesetsept
en gynécologie-obstétrique.
7
C’est le nombredesalles d’opérationau
seindubloc général :deux salles pour la
chirurgie orthopédique,deux pour la
chirurgie généraleetdigestive,une pour
l’urologie et la chirurgie vasculaire, une
pour les endoscopies et coloscopies,la
dernièreest réservéeaux actes de
cardiologie.
4
C’est le nombredesalles d’opération
qu’il yaura au sein du blocgynécologie-
obstétrique du futur pôlemère-enfant,
dont une seraréservée pour les
césariennes.Elles ne sont que de deux
dans l’actuelle maternité.
2
C’est le nombre de blocs au CHA:unbloc
général et un bloc gynécologie-obstétrique.
Ce dernier déménagera au moment
de l’ouverture du pôlemère-enfant.
Il n’y aura alors plus qu’une salle de réveil,
àlajointure desdeux blocs,contre deux
auparavant.
Àcœur ouvert
La préparation
Àpeine 40 minutes s’écoulententre l’anesthésie et la fin de l’intervention Le réveilprend du temps

26 MERCREDI2JANVIER 2013
1975
Naissance de Philippe
Sousa, àTonnerre.
1995
Il entre dans la vie active,
initialement dans une
fabrique industrielle
de meubles.
2010
Il effectue un stage
au mois de mai àl’hôpital
d’Auxerre, avant
d’enchaîner avec un CDD.
2011
Philippe entre àl’hôpital
en qualité de brancardier
vacataire. Il est titularisé
sur sonposte un an plus
tard, le 1er juillet2012.
■BIO EXPRESS
Philippe Sousafaitpartiedes rouages
Laurenne Jannot
laure[email protected]
D
rôle de coïncidence.
Il est férudeméca
nique.Sur le meuble
télé de son salon s’entas
sent les dizaines de voitu
resminiatures qu’il collec
tionne.Résident à
SaintFlorentin, il expli
que,les yeux sombres
mais tout sourire, que
lorsqu’il quitte l’hôpital, il
prend sa voiture, souffle,
démarre, et a«27bornes
pour se relaxer ». Philippe
Sousa aime l’automobile,
écoule une bonne partie
de son temps libreavec
d’autres passionnés.Pour
tant, ce sont bien des
brancards qu’il passe des
journées entières àfaire
rouler.
Philippe exerce le métier
de brancardier depuis un
peu plus de deux ans.An
cien ouvrier spécialisé, il
veut une véritable recon
version lorsqu’intervient
son licenciement. C’est un
ami salarié dans le milieu
hospitalier qui le met sur
la voie.
«Lerôle,c’est
de brancarder »
Il ne prodigue pas de
soin, mais comme la ma
jorité des employés de
l’hôpital, s’il est là, c’est
pour les patients et le con
tact, «pas pour gagner du
pognon ». Modeste sur
son rôle,ilestime ne pas
faireungrosboulot.
«Mais si on arrête,c’est la
merde… »Àl’écouter dé
rouler le fil de ses activi
tés,ilparaît pourtant bien
vite incontournable.
«Lerôle du brancardier,
c’est de brancarder », rap
pelletil. Mais il yales
glissements de tâches,
nombreux, surtout de
nuit. Carsienjournée,il
est plutôt cantonné àsa
fonction initiale,ilaà
charge,passées 21 heures,
les transports de prélève
ments au laboratoire, le
nettoyage du bloc, et file
même un coup de main à
la sécurité en cas de con
frontation avec un patient
impatient.
Le grade
de brancardier
n’existe pas
«Certaines personnes
prennent ça pour de l’ac
quis.»Autant de missions
qui ne sont pourtant que
peu reconnues.Philippe
jette un œil àsafiche de
paie,n’y trouvepas le gra
de de brancardier,spécifi
cité quin’est précisée que
dans la catégorie «affec
tation ». «Nous sommes
tous des assistants de ser
vice hospitalier qualifiés
(ASHQ). »Voirehyperqua
lifiés,dans les petits riens
du quotidien.
Quelquechose
du souffre-douleur
Il prend les choses avec
du recul. Mais s’il assure
que les relations avec le
reste de l’équipe médicale
relèvent, au cas par cas,
«durapporthumain », il
finit par admettreque oui,
le brancardier aquelque
chose du souffredouleur
quand il yades problè
mes de fonctionnement.
«Des fois,ilyauncouac
complet àcause d’un re
tardinitial. Desgens s’af
folent pour rien. Et on est
les premiers qui arrivent
sur place ;certains tempè
rent, d’autres non. »
Alors,Philippe atendan
ce àtout noter,pour éviter
les «boulettes ». Et passe
dans les couloirs comme
si de rien n’était. Il sourit
àl’évocation des guéguer
resentreservices,entre
collègues,etdes histories
de coucherie,«sujet ré
current ». Luis’est fixé une
règle :«Jenevois rien, je
n’entends rien. »Mais re
connaît que ses oreilles ne
sont pas totalement her
métiques.«Dufait qu’on
passe dans tous les servi
ces,onest un peu les
liaisons.»
Conscient de l’apparence
ingrate de son métier,il
n’en est pas moins pleine
ment satisfait. «Personne
n’est indispensable mais
tout le monde est utile.»
Comme des centaines de
collègues,ilafini par «vi
vrehôpital », espèreyévo
luer ;etàl’inverse de ses
anciens emplois,necon
çoit pasdelequitter.Lui
sans qui l’hôpital aurait
du mal àtourner. ■
Portrait
Brancardieràl’hôpital
depuis deuxans, Philippe
Sousa évoqueson quoti-
dien au CHA, àlafois par-
toutetnullepart.
BRANCARDIER. Philippe Sousatravaille au seinducentrehospitalier depuis maintenant près de trois ans. PHOTO FLORIAN SALESSE
MARDI 8JANVIER
Volet n°9. Focus sur quelques
maladies rares, ou complexes,
àprendreencharge.
èè
RENDEZ-VOUS
Àcœur ouvert
1
/
3
100%