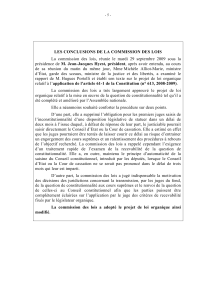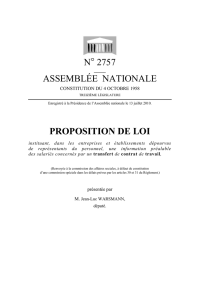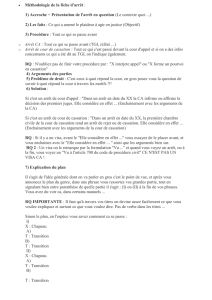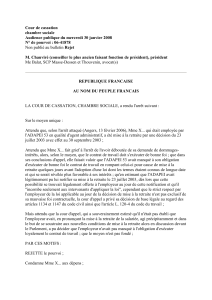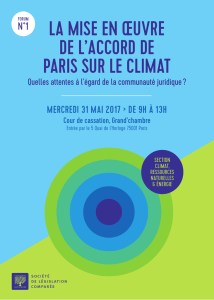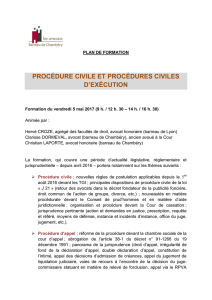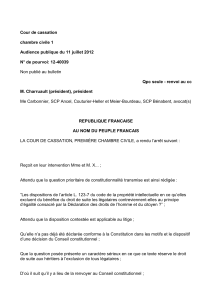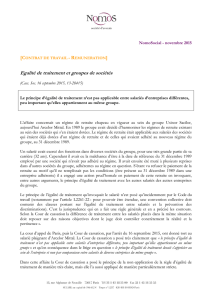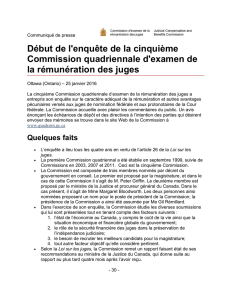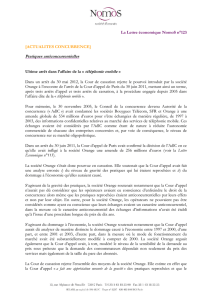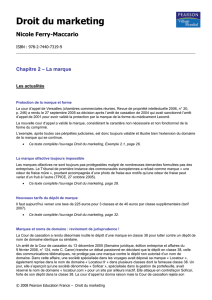la lettre juridique

L
LA
A
L
LE
ET
TT
TR
RE
E
J
JU
UR
RI
ID
DI
IQ
QU
UE
E
P a g e 1
LETTRE N°16
3 novembre 2010
PAS DE CONFIDENTIALITE POUR L’AVOCAT D’ENTREPRISE
Une entreprise anglaise a recours aux services d’un avocat interne inscrit
au Barreau néerlandais. Lors d’une visite domiciliaire de la Commission
Européenne dans les locaux de l’entreprise, dans le cadre d'une enquête
en matière de concurrence, la règle de confidentialité entre avocats et
clients est invoquée pour des échanges entre l’entreprise et son avocat
interne. La juridiction européenne rejette la demande car l'échange doit
être lié à l'exercice du « droit de la défense du client » et l'échange doit
émaner « d'avocats indépendants », c'est-à-dire « d'avocats non liés au
client par un rapport d'emploi ». L’avocat ne doit avoir aucun lien
structurel, hiérarchique et fonctionnel avec l'entreprise qui bénéficie de
cette assistance. Il n’y a donc pas de « legal privilege » pour l'avocat
d'entreprise et ses échanges avec son employeur peuvent être utilisés
comme preuves d'éventuelles pratiques anticoncurrentielles. Cette décision
pose un vrai problème à l’heure où la France envisage d’autoriser des
avocats à être salariés d’entreprises. Quel serait l’intérêt si les échanges
ne bénéficient pas de la confidentialité propre aux échanges avec l’avocat
libéral ? Cour de Justice de l’Union Européenne, 14/09/10, n° C-550/07
AU FINAL COMBIEN COUTE UN PRODUIT ?
La Commission d’examen des pratiques commerciales vient de rendre un
avis sur la communication des prix dans le cadre d’offres couplées à une
carte de fidélité. Deux mécanismes sont étudiés. Le premier annonce le
prix payé en caisse et fait figurer le montant de l’avantage attaché à
l’achat, comme par exemple « Prix + 1€ avec la carte XX ». La CEPC
considère que cette présentation est claire. Le consommateur sait le prix
qu’il paiera à la caisse et connaît le montant de l’avantage ultérieur qui lui
sera consenti. Bien évidemment les modalités succinctes de l’avantage
ultérieur doivent être indiquées. Dans le deuxième mécanisme, l’avantage
annoncé est déduit du prix du produit pour faire apparaître un prix net,
comme par exemple « prix Ŕ avantage carte=… », un astérisque
renvoyant à une explication précisant que le prix indiqué correspond au
prix auquel revient le produit après déduction de l’avantage lié à la carte,
sur un achat ultérieur. Pour la CEPC, cela peut faire croire au lecteur peu
attentif que le prix le plus bas est le prix net du produit. Dès lors que des
mentions correctives ou explicatives figurent en petits caractères, il n’y a
pas forcément de pratique trompeuse mais cela entraîne une nécessaire
application de la recommandation « mentions et renvois » de l’ARPP, déjà
évoquée dans le dernier n° de cette Lettre. En conclusion la CEPC
recommande d’éviter une communication qui fait apparaître un prix
d’article, avantage déduit. Cela pourrait constituer une mauvaise pratique,
cette présentation juridiquement incorrecte, pouvant être source
d’interprétation faussée pour le consommateur, et l’induire en erreur.
Commission d’examen des pratiques commerciales, avis n° 10-12 sur
l'utilisation des nouveaux instruments promotionnels dans la
communication sur les prix assurée par les distributeurs sur le marché du
jouet, 29 /09/10
Sommaire
Droit routier 2
Droit public 2
Droit social 3
Droit de la création 3
Droit des contrôles 4&5
Droit des affaires 5&6
Droit de la publicité 7
Focus 8
Divers 9
OLIVIER POULET
Avocat au barreau de Rennes
1 rue de Brocéliande
35760 Saint-Grégoire
Tel.02.99.23.42.08
Port.06.81.56.19.18
opoulet.avocat@orange.fr
Siret : 42358055400032

L
LA
A
L
LE
ET
TT
TR
RE
E
J
JU
UR
RI
ID
DI
IQ
QU
UE
E
P a g e 2
LETTRE N°16
3 novembre 2010
LA FONCTION CESSE MAIS LA RESPONSABILITE RESTE
Comme cela a déjà été évoqué à plusieurs reprises dans ces Lettres Juridiques, le code
de la route fait peser sur le titulaire de la carte grise la responsabilité pécuniaire de
l'amende encourue pour certaines infractions. Sauf si, notamment, il apporte des
éléments permettant d'établir qu'il n'est pas l'auteur véritable de l'infraction. Le
représentant d'une personne morale devra fournir les renseignements permettant
d'identifier le véritable auteur de l'infraction pour s'exonérer du paiement. La Cour de
Cassation vient de rappeler ce principe en précisant qu’est prise en compte l’identité
du représentant légal au moment des faits quels que soient les circonstances
postérieures. En l’espèce le représentant légal de la société reste responsable de ce
paiement alors qu'il avait quitté cette société quelques mois après la date des faits et
qu’il était de ce fait dans l’incapacité d'identifier l'auteur véritable. Cour de Cassation,
chambre criminelle, 2/09/10, n° 10-82.393
LA RESPONSABILITE PECUNIAIRE PEUT-ELLE ETRE DELEGUEE ?
Et si le responsable pénal de l’entreprise a mis en place une délégation de pouvoirs, le
bénéficiaire de cette délégation peut-il être condamné à payer une amende pour excès
de vitesse au nom de la personne morale titulaire de la carte grise ? Oui a répondu la
juridiction de proximité, et non ont décidé les juges de cassation. En effet, pour eux, il
résulte des textes que, lorsque le certificat d'immatriculation d'un véhicule verbalisé
pour excès de vitesse est établi au nom d'une personne morale, le représentant légal
de celle-ci, et lui seul, peut être déclaré redevable pécuniairement de l'amende
encourue. La délégation générale de responsabilité pénale ne s’applique pas en l’état.
On pourrait par contre s’interroger sur les conséquences d’une délégation qui viserait
expressément ce cas de figure, par exemple établie au nom du gestionnaire des
véhicules sachant que cette responsabilité pourrait s’accompagner d’une obligation de
sensibilisation des salariés concernés aux risques de l’excès de vitesse. Cour de
Cassation, chambre criminelle, 13/10/10, n° 10-81.575
L’ETAT DOIT TENIR SES PROMESSES
Les héritiers d’une ile méditerranéenne la vendent à l’Etat français tout en conservant
les parcelles sur lesquelles ils ont construit leur résidence principale et un hôtel. Ils ont
également cédé à l'État les droits à construire attachés aux terrains. En échange et
comme cela figure dans les actes, ils bénéficient de la promesse de pouvoir étendre
leurs propriétés actuelles. Ayant déposé des permis de construire dans ce sens, ils se
voient opposer un refus et le Pos est modifié pour déclassifier en inconstructibles les
terrains concernés. Les juges, saisis par les héritiers, estiment que les agissements de
l'État témoignent de son engagement à garantir aux héritiers un « droit à construire».
Les actes de vente, dont l'État est à la fois partie, rédacteur et autorité de réception
ne précisent à aucun moment que la faculté de construire serait conditionnée aux
règles d'urbanisme. Compte tenu de la qualité même du cocontractant qui constituait
indiscutablement un gage d'autorité, de bonne foi et du respect de la loi, les héritiers
pouvaient légitimement penser que l'État était en mesure de leur accorder de tels
droits à construire et s'attendre à ce qu'il respecte ses engagements contractuels. Pour
les juges, l’Etat aurait dû proposer une compensation matérielle ou financière en
réparation du préjudice subi du fait du non-respect des actes de vente. Cour
Européenne des Droits de l’Homme, 18/11/10, n°18990/07 et n°23905/07
Droit
routier
Droit
public

L
LA
A
L
LE
ET
TT
TR
RE
E
J
JU
UR
RI
ID
DI
IQ
QU
UE
E
P a g e 3
LETTRE N°16
3 novembre 2010
ON PEUT SUIVRE A LA TRACE SES SALARIES
Un coursier est licencié pour faute grave, notamment parce que l’employeur l’accuse
d’utiliser son véhicule à des fins privées, et de ne pas respecter le code de la route.
Comme preuves, l’employeur fournit des éléments provenant du système de géo-
localisation équipant ses véhicules. Pour mémoire la mise en place de tels systèmes
doit faire l’objet d’une information personnelle et préalable des salariés et d’une
déclaration auprès de la CNIL. L’employeur est dans l’incapacité de fournir la
déclaration, et concernant l’information préalable il ne peut remettre qu’une note de
service, dont les destinataires sont inconnus, et au contenu sibyllin, sans aucune
mention d’un service de géo-localisation. De ce fait, les informations utilisées pour
justifier le licenciement ayant été recueillies par des moyens illicites, ne peuvent être
retenues et le licenciement est jugé sans cause réelle et sérieuse.
Il est par contre intéressant de noter qu’en refusant d’admettre que l’utilisation
irrégulière d’un système de géo-localisation porte atteinte à la liberté fondamentale du
salarié disposant d’un véhicule de service qu’il n’avait pas le droit de l’utiliser à titre
personnel, la Cour reconnait que le suivi des déplacements, dans le cadre des
dispositions légales, ne porte pas atteinte à la vie privée ni à la liberté d’aller et venir.
Cour d’appel de Dijon, chambre sociale, 14/09/10
PORNOGRAPHIE NON SOLLICITEE
Un cadre ayant presque 10 années d’ancienneté est licencié, son employeur ayant
trouvé sur le disque dur de son portable professionnel des contenus pornographiques.
Contestant le caractère réel et sérieux du motif du licenciement, le cadre obtient des
dommages et intérêts. Les juges ont estimé que si la présence de ces contenus, en
nombre réduit, était attestée par un constat d’huissier, (constat qui pourrait être
contesté puisque réalisé après le licenciement du salarié et sans sa présence), rien ne
permet d’établir que c’est le salarié qui les a volontairement téléchargés. Le salarié
avait en effet invoqué le fait que ces contenus étaient arrivés sur son ordinateur sans
qu’il les sollicite et l’employeur n’apportait aucune preuve d’un téléchargement
volontaire. De ce fait, l’utilisation à des fins personnelle des matériels de l’entreprise
n’est pas avérée. Cour de Cassation, chambre sociale, 14/04/10, n°08-43.258
REVENIR AUX FONDAMENTAUX
Un photographe cède par contrat, à l’éditeur d’un dépliant, les droits de reproduction
de photographies de fleurs. L’éditeur s’estimant propriétaire des clichés réalise des
sets de table qu’il commercialise. Pour lui, dès lors que l’utilisation sur des sets n’était
pas expressément interdite, et qu’il reproduisait strictement les oeuves, respectant
ainsi l’esprit de l’auteur, il n’était pas attaquable. Les juges de cassation donnent
raison au photographe et rappellent qu'en matière de cession de droit de reproduction
d'une œuvre de l'esprit, chacun des modes d'exploitation cédés doit faire l'objet d'une
mention distincte et doit être limité. Cour de Cassation, 1ère chambre civile, 30/09/10,
n° 09-15.091
Droit de la
création
Droit
social

L
LA
A
L
LE
ET
TT
TR
RE
E
J
JU
UR
RI
ID
DI
IQ
QU
UE
E
P a g e 4
LETTRE N°16
3 novembre 2010
LES SAISIES INFORMATIQUES A LA LOUPE
Le 2 novembre 2010, la Cour d’Appel de Paris, saisie de recours contre les conditions
de réalisation de visites domiciliaires en matière de droit de la concurrence, a examiné
les pratiques de saisie informatique. Dans les trois dossiers, les juges ont détaillé les
différentes étapes de ces saisies et ont relevé des éléments discutables. Les modalités
techniques des saisies ne sont que sommairement décrites dans le procès verbal, et
notamment les modalités de sélection des documents, les messages saisis dans une
messagerie sont décrits trop synthétiquement dans l’inventaire pour permettre de
garantir l’identification desdits messages et de vérifier qu’ils rentrent dans le champ de
l’enquête, la saisie de la totalité de la messagerie d’un Directeur Juridique sans
précaution particulière notamment en ce qui concerne le secret des correspondances
et enfin l’absence de scellés. Par ailleurs, dans l’un des dossiers, l’entreprise visitée a
mis en avant l’existence de procédures de saisies différentes de celles pratiquées et
permettant de préserver l’authenticité et l’intégrité des données saisies et le contenu
des ordinateurs visités, de garantir le contrôle effectif des opérations et la possibilité
pour l’entreprise de faire retirer des documents sans rapport avec l’enquête ou
couverts par un « légal privilège ».
En conséquence de quoi, avant de se prononcer sur le fond des demandes, la Cour
d’Appel a nommé un expert avec pour mission d’examiner les pratiques de saisie
informatique en France, et par comparaison celles de la Commission européenne et
des autorités de concurrence néerlandaises et américaines. Il en résultera un recueil
des bonnes pratiques notamment pour la saisie des messageries. Le but est bien sûr
de concilier la nécessité d’avoir accès aux éléments pertinents avec la préservation
d’une indispensable confidentialité. Ce rapport d’expertise, qui doit être rendu dans les
six mois, aura une grande importance pour y voir plus clair sur ce sujet encore très
empirique.
Pendant ces six mois il y a fort à parier que toutes les visites comportant des saisies
informatiques, en droit de la concurrence mais aussi en droit fiscal ou en droit
financier pour ne citer que ces deux procédures proches, feront l’objet de recours sur
les mêmes fondements et logiquement les juges ne pourront statuer avant le dépôt du
rapport. Cour d’Appel de Paris, 2/11/10, n°10/01894 (et autres)
LA PREUVE DE L’HABILITATION DES ENQUETEURS
C’est au juge, qui autorise la visite, de vérifier si les agents nommés pour l’effectuer
sont effectivement habilités. Les agents des impôts effectuant la visite doivent avoir
été autorisés par le juge des libertés et de la détention et avoir été habilités à cet effet
par le directeur général des impôts. Les agents de l’administration fiscale présentent
leur habilitation au juge des libertés et de la détention, celui-ci en faisant mention
dans son ordonnance. Il ne résulte pas de l’article L. 16 B du livre des procédures
fiscales que les habilitations des agents doivent être annexées à l’ordonnance. Cette
décision est applicable aux visites domiciliaires en matière de concurrence du fait de
l’identité des textes. Cour de Cassation, chambre commerciale, 14/09/10, n°09-
67.980
Droit des
contrôles

L
LA
A
L
LE
ET
TT
TR
RE
E
J
JU
UR
RI
ID
DI
IQ
QU
UE
E
P a g e 5
LETTRE N°16
3 novembre 2010
PRECISIONS SUR LE CONTENU DE L’ARRET D’APPEL
Contrairement à l’ordonnance d’autorisation dont le contenu est détaillé par les textes,
les mentions devant figurer dans l’arrêt d’appel ne sont pas précisées.
L’article L. 16 B II du livre des procédures fiscales ne dispose pas que le premier
président de la Cour d’Appel statuant sur un recours contre l’ordonnance
d’autorisation, doit mentionner dans son ordonnance, à peine de nullité, que le dossier
du tribunal a été transmis au greffe de la cour d’appel et a été mis à la disposition des
parties. Cette décision est applicable aux visites domiciliaires en matière de
concurrence du fait de l’identité des textes. Cour de Cassation, chambre commerciale,
14/09/10, n° 09-67.404
LE DROIT DE S’OPPOSER A UNE VISITE
On le sait, la Commission Nationale Informatique et Libertés dispose d’un droit de
perquisition en entreprise. Mais elle ne peut accéder à des locaux que sous réserve
que le responsable de ces locaux ne s’oppose pas à cette visite, laquelle ne peut alors
avoir lieu qu’avec l’autorisation et sous le contrôle du juge judiciaire. Pour être
effective, une telle garantie nécessite que le responsable des locaux, ou le
représentant qu’il a désigné à cette fin, ait été préalablement informé de son droit de
s’opposer à la visite et qu’il soit mis à même de l’exercer. Dès lors qu’il n’est pas
contesté que les responsables des locaux, ayant fait l’objet des contrôles, n’ont pas
été informés de leur droit de s’opposer à ces visites, et que grâce à cela la CNIL a eu
accès à divers documents, l’entreprise visitée est fondée à soutenir que la sanction qui
lui a été infligée, dès lors qu’elle reposait sur les faits constatés lors des contrôles
effectués, a été prise au terme d’une procédure irrégulière et qu’elle doit pour ce motif
être annulée. Conseil d’État 10ème et 9ème sous-sections réunies, 7/07/10, n°309721
LE TRANSFERT DE LA RESPONSABILITE ENVIRONNEMENTALE DANS UN CONTRAT
A l’occasion de l’achat d’un terrain ayant appartenu à un producteur de produits
chimiques, un promoteur découvre dans le sol des produits polluants, ce qui entraine
pour lui des surcoûts et un retard dans les travaux. Il assigne la société qui, ayant
cédé le terrain à la société immobilière vendeuse, n’était pas l’exploitant direct de
l’installation mais seulement l’ayant droit à titre universel du dernier exploitant de
l’activité industrielle par le jeu d’apports partiels d’actifs successifs. Les juges ont
considéré que cette société était la dépositaire du passif environnemental résultant de
l’activité polluante et devait donc assumer la responsabilité délictuelle de la dernière
société exploitante, cette société ne démontrant pas avoir expressément transféré
l’obligation de remise en état des lieux à la société immobilière à qui le terrain avait
été cédé dans un simple but de transaction immobilière.
Cette décision montre avec quel soin le transfert de la responsabilité
environnementale doit être traité lors des cessions de bien industriels ou lors de la
mise en place d’apports partiels d’actifs. Il faut des clauses expresses et détaillées
pour s’assurer de transferts. Le silence ne vaut pas apport. Cour de Cassation, 3ème
chambre civile, 22/06/10, n° 09-10.215
Droit des
affaires
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
1
/
9
100%