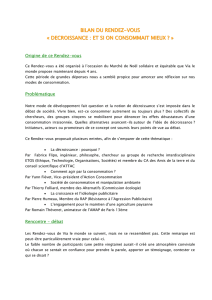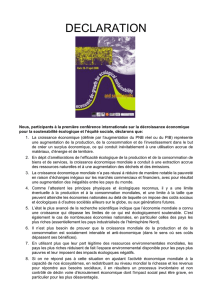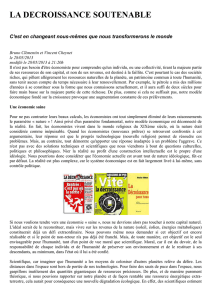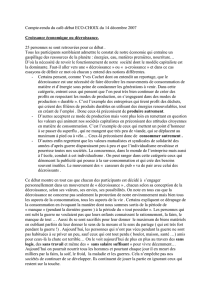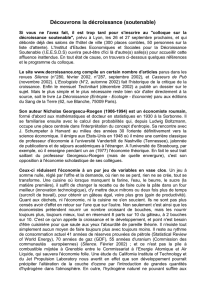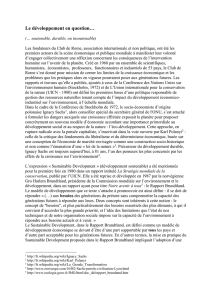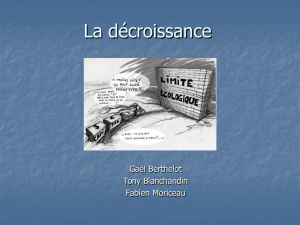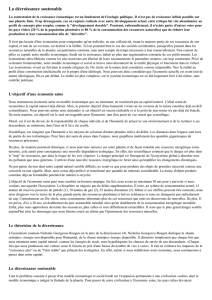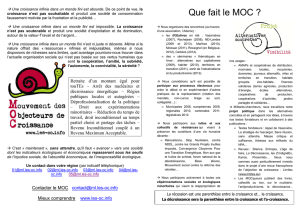La décroissance n`est pas porteuse d`espoir

Epreuve de synthèse de documents (3h) - Admission en 2ème année
Exemple de sujet : La décroissance est-elle une perspective d'avenir ?
Document n°1
La décroissance n'est pas porteuse d'espoir
Corinne Lepage, députée européenne et présidente de CAP 21
Article paru dans Le Monde du 21.08.10
Si l'écologie politique décide d'être le porteur de la décroissance et d'un projet défini comme avant tout anticapitaliste et
antilibéral, alors elle ratera le coche de l'Histoire qui propose au monde multiple de l'écologie politique d'être le passeur
d'une civilisation à une autre, et ce grâce à un projet de transition.
Les drames climatiques de l'été ont une fois de plus illustré ce que sera le monde du changement climatique avec ses
tragédies individuelles et ses risques collectifs. Pour autant, le prochain sommet sur le climat à Cancún s'annonce très
mal !
Certes, les menaces économiques font planer les plus grands doutes sur la reprise. La faiblesse de la création d'emplois,
la persistance d'un chômage à deux chiffres et touchant, dans le monde entier, les jeunes de plein fouet rendent très
pessimiste. Et pourtant, la transformation du système financier apparaît des plus modestes.
Mais le projet d'une décroissance, même qualifiée de prospère (ce qui est un oxymore du même ordre qu'une croissance
durable), ne peut aucunement fédérer nos concitoyens et constituer un projet porteur d'espoir. D'ailleurs, les décroissants
l'abandonnent progressivement.
Dans un ouvrage, Prospérité sans croissance. La transition vers une économie durable (De Boeck, "Planète en jeu",
248p., 17euros), Tim Jackson, de la Commission du développement durable du Royaume-Uni, propose d'abandonner le
terme et l'idée pour proposer un autre modèle, proche de ce que j'ai appelé l'évolution soutenable.
Plusieurs changements sont nécessaires : il faut avant tout passer d'un modèle économique à deux dimensions (travail et
capital) à un modèle macroéconomique à au moins trois dimensions, introduisant le principal facteur de rareté issu de la
finitude de notre planète. Il est également indispensable de modifier notre rapport au travail.
Dans le système actuel, le travail est avant tout un coût de production qu'il convient de réduire pour les entreprises, et le
moyen d'assurer son existence, qu'il convient donc de conserver coûte que coûte, pour le travailleur.
En prenant la dimension sociale du travail comme un des éléments d'existence dans une société, on ajoute une nouvelle
valeur à ce travail. Le travail devient une valeur sociale centrale du modèle macroéconomique qu'il faut à tout prix
préserver, développer, voire partager.
Mettre l'emploi au cœur des politiques permet de poser les questions de revenu disponible et de statut des individus
dans la société. Mais il implique aussi de changer le rapport à l'entreprise et cesser les amalgames entre les
entrepreneurs et le casino de la finance.
Il faut enfin changer notre manière de consommer pour aller vers un acte raisonné où le service rendu, à savoir la
satisfaction du besoin réel, et la façon dont ce produit ou ce service est obtenu sont les principaux paramètres du choix.
La macroéconomie soutenable redonne au politique son rôle et ses droits, celui d'un investisseur de long terme,
cependant que le capitalisme évolue vers un capitalisme entrepreneurial. Dans cette conception, l'idée de décroissance a
disparu et laisse une place à l'innovation et au progrès, à la recherche d'un bien-être collectif, à de nouvelles activités en

lien avec le territoire et la réhabilitation de l'entreprise en lieu et place de l'ingénierie financière.
A l'écologie politique de porter ce projet comme un projet de transition, qui respecte la réalité mais nous met en ordre
de bataille pour un projet collectif capable de résoudre les contradictions dans lesquelles nous sommes plongés.
A titre individuel, partagés entre les contraintes du quotidien et la prise de conscience des changements du monde. Mais
aussi, à titre collectif, tiraillés entre les nécessités du court terme et de la compétition internationale (qui existe même si
on ne peut que regretter la compétition entre Etats), et du long terme, de la justice intra et intergénérationnelle.
Notre vocation est de pousser à la construction, avec nos concitoyens et non dans des cénacles partisans quels qu'ils
soient, d'un projet qui propose des solutions concrètes aux besoins de notre pays. Nous devons, coûte que coûte,
réconcilier le possible et le souhaitable, faute de quoi nous rendrons impossible le souhaitable et détestable le possible.
C'est ici et maintenant que nous pouvons y parvenir, en nous dotant de nouveaux instruments de mesure, en dehors du
PIB, en particulier sur l'évolution de l'emploi et celle du patrimoine collectif, humain et environnemental. Ils
permettront de mesurer la soutenabilité, la santé, le bien-être, l'éducation…
Ces instruments permettront aussi de changer l'évaluation des politiques publiques, de reconvertir les industries du XXe
siècle et de favoriser le tissu des PME et non des "champions nationaux". Nous faisons le contraire ! Ils permettront
enfin d'aborder la question de la dette en différenciant l'investissement (y compris dans la plus grande richesse qui soit :
les humains) du fonctionnement.
Nous devons faire du "bien-vivre" un objectif partagé qui repose sur la sécurité humaine. L'intégrité de la personne ne
se divise pas et inclut la santé, la protection contre les risques naturels et technologiques, les accidents de la vie autant
que la protection indispensable contre les violences en tous genres, à commencer par celles faites aux femmes.
Cette société de transition que nous devons porter, qui rend possible le souhaitable, n'est envisageable que dans le cadre
d'une gouvernance publique et d'entreprise profondément rénovée, dans une République à laquelle nous sommes fiers et
heureux d'appartenir, dans la reconquête de l'espoir d'une vie meilleure.
Document n°2
La réflexion sur la décroissance, seul moyen de libérer
l'avenir
Par Alain Gras, professeur de socio-anthropologie des techniques à l'université Paris-I et Philippe Léna,
directeur de recherche à l'Institut de recherche
Article paru sur Lemonde.fr, le 26.08.10
Nous ne doutons pas un instant des
convictions écologistes de Corinne
Lepage, qu'elle a démontrées à
maintes reprises, parfois avec courage,
y compris contre son propre camp
politique. Sa charge contre la
décroissance est néanmoins
révélatrice des contradictions
incontournables dans lesquelles
s'enferment ceux qui, même
parfaitement conscients des limites de
la planète et des dangers que fait
courir à la biosphère ce qu'on appelle
le "développement économique",
n'acceptent pas de remettre
sérieusement en cause les
mécanismes et l'idéologie qui sont à
l'origine de la crise actuelle. Cela les
amène à chercher désespérément un
moyen de concilier le changement
radical dont ils perçoivent l'urgence
avec la perpétuation des valeurs
structurantes de la société actuelle
(compétitivité, "progrès",
rentabilité…). Nous connaissions déjà
le "développement durable", la
"croissance verte" et maintenant nous
avons la "macroéconomie soutenable"
et la "société de transition". Après
avoir traité d'oxymore, c'est-à-dire de
contradiction dans les termes, la
notion de décroissance prospère et,
fort justement, celle de croissance
durable, Corinne Lepage vante les
bienfaits de la macroéconomie
soutenable "qui redonne au politique
son rôle et ses droits". Dans cette
conception, ajoute-t-elle, "l'idée de
croissance a disparu, laissant la place
à l'innovation et au progrès".
Sustainable en anglais se traduit aussi
bien par durable que par soutenable.
Les deux termes étant donc
équivalents, Madame Lepage se
trouve elle aussi prise au piège de
l'oxymore : la notion de croissance
durable serait absurde selon elle, mais
cette macroéconomie qui pense le
"capitalisme entrepreneurial" dans le
cadre du marché libéral avec sa
croissance aurait l'avantage d'être
soutenable c'est-à-dire durable ! On a
du mal à saisir la cohérence du propos.

On se demande comment le
programme plein de bonnes
intentions de Corinne Lepage
parviendrait à marier le travail pour
tous ("partagé", selon ses termes), la
prise en compte de la finitude et de la
rareté, un revenu disponible final
décent pour tous, la protection contre
toutes les insécurités, le "mieux
vivre", sans débrancher la machine à
créer de la valeur et des inégalités,
machine qui nous a conduits là où
nous sommes, et sans restreindre ce
qu'H. Daly appelle le throughput (flux
de matière et d'énergie venant de
l'environnement et y retournant sous
forme de déchets une fois passé par le
processus de production-
consommation). A quoi il faut ajouter
l'impérieuse nécessité de diminuer
l'empreinte écologique de l'humanité
tout en accueillant 3 milliards de
nouveaux terriens, et une
consommation croissante pour
environ 7 milliards d'entre eux.
Comment cela sera-t-il possible ?
UNE AUTRE CONSOMMATION
Corinne Lepage soutient que
"l'innovation et le progrès" nous
sauveront dans ce cadre
macroéconomique soutenable, or c'est
précisément la succession
ininterrompue des générations de tous
nos appareils, que l'on jette après
chaque nouveauté, qui constitue le
fonds de commerce de la croissance.
Quant au progrès, comment peut-on
encore faire vivre, à l'intérieur de la
pensée écologique, ce vieux mythe
désuet et fourre-tout de l'optimisme
béat ? Certes, un fort investissement
technologique peut diminuer
l'empreinte écologique par unité de
produit, mais ce gain, en général tout
à fait insuffisant, sera annulé par
l'effet rebond d'une consommation
croissante per capita (rappelons que
même le simple statu quo actuel – ou
état stationnaire – n'est pas
soutenable). Du reste, l'ouvrage de
Tim Jackson (par ailleurs excellent),
cité par Corinne Lepage, nous
rappelle opportunément que "la vision
du progrès social qui nous meut –
fondée sur l'expansion permanente de
nos désirs matériels – est
fondamentalement intenable". La
"transition", dans cette version
anglaise du mot d'origine française,
chez Rob Hopkins notamment
(fondateur du mouvement pour la
transition), ne s'oppose pas à la
décroissance, elle l'accompagne.
Madame Lepage semble ignorer ce
qu'écrivent les décroissants français
depuis fort longtemps, ainsi que les
nombreux ouvrages parus récemment
sur la question, ou encore les revues
qui théorisent la décroissance, comme
Entropia, ou informent de manière
plus polémique sur les mouvements
en cours, tel le journal La
Décroissance. A la lecture de ce texte
nous sommes frappés par les
réticences que montrent certains
politiciens et intellectuels, pourtant
engagés, à associer la menace bien
réelle d'une fin possible à l'idéologie
et aux pratiques du système
économique mondial, et en particulier
au modèle libéral.
Il est vrai qu'une autre consommation,
fondée sur la sobriété et la
délibération démocratique à propos
des choix technologiques et des
productions à éliminer ou à
développer sonnerait le glas de la
société néolibérale. Est-ce la nécessité
d'exorciser cette perspective qui
conduit les tenants d'une "autre
croissance" à montrer une telle ardeur
et une telle créativité dans les
formules ? La capacité humaine à
projeter un avenir meilleur, la
conscience que tout se transforme, ne
nous semble plus devoir passer par la
notion éculée de progrès. Cette
dernière a surtout servi à faire
accepter comme inéluctables des
changements qui profitaient à une
minorité. Une tout autre vision du
monde reste à construire, la
contestation des objectifs actuels de
l'économie par la réflexion sur la
décroissance le permet.
Document n°3
L'obscure lubie des objecteurs de croissance
Par Pierre-Antoine Delhommais
Chronique parue dans Le Monde du 29 juillet 2006
Au-delà des grands classiques - protection sociale, flexibilité du marché du travail, chômage des jeunes, dette
publique -, un thème économique inédit pourrait émerger lors de la campagne présidentielle. Celui de la
décroissance, doctrine en vogue. L'économie, nous dit-elle, a besoin, pour croître, de ressources
énergétiques. Or, celles-ci étant limitées, la croissance est un non-sens. Il faut de toute urgence opter pour la
décroissance économique, seule voie pour sauver la planète de la folie des hommes.
"Chacun comprend qu'une croissance infinie est matériellement impossible dans un monde fini", affirme

dans son programme le Parti de la décroissance, né en avril 2006, et qui organise, cet été, plusieurs marches
prosélytiques. Car il s'agit de remettre dans le droit chemin les pauvres pécheurs consommateurs. "La
décroissance est d'abord une désintoxication, une désaliénation, un désencombrement."
Les objecteurs de croissance, comme ils aiment à se surnommer, bénéficient de la puissance médiatique de
quelques-uns d'entre eux, comme José Bové, Yves Cochet, Nicolas Hulot ou Hubert Reeves. Ils profitent
aussi de la perte de vitesse, chez les altermondialistes, du combat contre le libéralisme, moins mobilisateur
depuis que ce dernier n'est plus incarné par les Etats-Unis mais par des pays émergents comme la Chine,
l'Inde ou le Brésil.
Apparemment d'une grande simplicité, le concept de décroissance repose en réalité sur des fondations
philosophico-scientifiques complexes, voire obscures. "Nous analysons l'économie comme un système de
transformation de matière et d'énergie régi par les lois de la physique, et non comme une machine à
mouvement perpétuel conduite par des forces exogènes, avec la monnaie pour unique médium", explique un
de ses maîtres à penser, Robert Ayres, qui préconise de mesurer production et échanges en joules plutôt qu'en
dollars.
Les "décroissants" se proclament humanistes, mais ils ne croient pas en l'homme. Leur pessimisme leur fait
dire que l'humanité ne sera pas assez inventive pour trouver des énergies de substitution au pétrole ni assez
raisonnable pour éviter un désastre écologique. Mais ils laissent à son sort le milliard d'êtres humains qui vit
avec moins de 1 dollar par jour.
Si les économistes ne croient plus à l'idée, dominante dans les années 1960, selon laquelle une croissance
forte est une condition suffisante pour vaincre la pauvreté, ils s'accordent en revanche pour dire que la
progression du PIB est une condition nécessaire. "Il est impossible de faire reculer la pauvreté s'il n'y a pas
de croissance économique", résume Humberto Lopez, coauteur du rapport de la Banque mondiale "Poverty
Reduction and Growth : Virtuous and Vicious Circles". "Une politique de réduction de la pauvreté sans
croissance n'est pas viable, ajoute l'économiste Pierre Jacquet. Pour produire des biens publics et
promouvoir des objectifs sociaux, il faut un flux de ressources nouvelles, et donc de la croissance."
En Chine, le nombre de personnes très pauvres est passé, grâce au boom économique, de 377 millions en
1990 à 173 millions en 2003. Selon certaines simulations, l'extrême pauvreté y sera éradiquée dans quinze
ans si le PIB continue à progresser au même rythme. Le scénario catastrophe par excellence pour les
objecteurs de croissance.
Au-delà des préoccupations écologiques légitimes qui sont les siennes, il faut prendre la doctrine de la
décroissance pour ce qu'elle est, une théorie élaborée par des individus habitant des sociétés prospères. Une
lubie de gosses de riches parfaitement égoïstes. Mais cela va généralement ensemble.
Document n°4
Les axes d’une croissance durable
Par JEAN MATOUK Economiste
Article paru dans Libération, le 30 juillet 2010
Le monde peut-il trouver une croissance durable,
sans trop de gaspillage de ressources, ni trop de
pollution de notre «Terre Patrie» (Edgar Morin) ?
Certains pensent que non et qu’il convient de prôner
la décroissance. Economiquement et politiquement
irréaliste ! Il faut un minimum de croissance pour
répondre aux besoins sociaux, vieillissement, santé,
éducation. Voici donc quelques principes d’une
croissance ralentie, mais «soutenable», une «utopie
directrice» pour gouvernements un peu moins
hantés par la prochaine élection.
Devenir des écocitoyens

«Le sauvetage de la planète commence avec moi,
dans mes achats, mes comportements quotidiens.»
C’est la contrainte «kantienne» d’une croissance
soutenable. Nos enfants sont déjà plus convaincus
que nous de nos devoirs. Encore faut-il transformer
ces connaissances écologiques en savoir véritable
par un enseignement obligatoire. Ensuite,
progressivement, par conviction réciproque, nous
changerons nos habitudes. Administrations,
entreprises et même ménages, nos décisions
d’achat et d’investissement sont précédés de
calculs économiques plus ou moins formalisés.
Ceux-ci doivent avoir désormais leurs doubles
écologiques : bilans ressources et effluents,
notamment carbone. Pour que ce bilan écologique
devienne aussi impératif que le bilan économique, la
fiscalité doit être remodelée avec, par exemple, une
«taxation au carbone ajouté».
Produire où l’on consomme
Depuis deux siècles, on produit de plus en plus loin
d’où l’on consomme. On transporte aussi de
l’énergie électrique sur des centaines de kilomètres
avec une déperdition massive, alors que des
énergies potentielles locales ne sont pas utilisées.
Si la mondialisation des échanges apporte des
avantages, d’autres productions doivent être
impérativement relocalisées. D’abord celle des
aliments, près des agglomérations : retour des
jardins «ouvriers» près des villes ou, même, comme
à Chicago, en leurs centres, sur des friches
industrielles, voire sur les toits ; multiplication des
associations pour le maintien d’une agriculture
paysanne (Amap) pour court-circuiter les réseaux
commerciaux qui étranglent les agriculteurs ; mais
aussi, dans les pays émergents, réintroduction
massive des cultures vivrières paysannes à la place
des cultures d’exportation. Il faudrait subordonner
les actuels rachats massifs de terres dans ces pays
à cette contrainte. Enfin, produire le plus d’énergie
possible, sous toutes les formes durables, à où elle
est consommée, en ne faisant appel que
marginalement à l’électricité de centrales. A cet
égard, le gigantesque projet Desertec - électricité
solaire saharienne transportée de l’Arabie saoudite
au Maroc et en Europe - est totalement disqualifié.
Habiter où l’on travaille
C’est le principe complémentaire du précédent.
Tous les projets d’investissements productifs
devraient être accompagnés de projets parallèles
d’habitat pour ceux qui y produiront. Il s’agit
évidemment de diminuer les besoins de transport
privés comme publics pour le travail. Dans certains
pays comme la France, les déserts ruraux
pourraient être repeuplés pour peu que l’Etat
organise l’«irrigation» informatique haut débit du
territoire qu’exige la production intellectuelle, sur
laquelle nous devons nous recentrer. Dans les pays
émergents et pauvres, le développement est lié aux
usines, mais le principe s’applique tout autant, avec
la nécessité de développer les habitats nécessaires
en évitant les erreurs que nous avons commises au
XXe siècle dans nos «cités». Il faut également
revenir à une urbanisation plus dense. Le «mitage»
actuel des campagnes autour des villes est coûteux
économiquement et écologiquement très coûteux
pour la collectivité. Ces zones pourraient être
réallouées, au moins partiellement, à l’agriculture
maraîchère ou l’élevage biologiques pour
l’alimentation directe des citadins, et l’habitat, les
commerces et les services repensés en hauteur.
Exclure du marché santé et éducation
La santé est de plus en plus coûteuse, ce qui exclut
des soins un nombre croissant de citoyens.
Paiement à l’acte, absence de prévention, hygiène
de vie et alimentation déplorable et, surtout,
confusion de la recherche, de la fabrication et de la
vente au sein des seuls laboratoires
pharmaceutiques poussent irrésistiblement à la
hausse des coûts. Paiement par capitation,
enseignement obligatoire de l’hygiène de vie,
contraintes fortes sur l’industrie agroalimentaire,
séparation de la recherche et de la fabrication des
médicaments : la puissance publique doit
impérativement imposer ces inflexions à un système
qui déraille.Quant à l’éducation, elle est l’outil plus
indispensable que jamais d’insertion économique et
de développement culturel dans tous les pays, dont
les nôtres puisque la production intellectuelle doit
être notre créneau.
Maîtriser les inégalités
L’application de ces principes a une conséquence
probable : un taux de croissance ralenti. Les
investissements en matériel «vert» ne
compenseront pas la baisse des transports ou les
moindres consommations de ressources diverses.
Une croissance sobre est plus lente. C’est bon pour
l’atmosphère de la planète, mais quid de l’emploi ?
Comment financer le social ? Réponse, au moins
partielle : par une réduction drastique des inégalités,
dans la distribution primaire et la redistribution des
revenus. Les sommes récupérées, pour les
entreprises et les Etats, favoriseront
l’investissement donc l’emploi, y compris l’emploi
public qui n’est pas vicié à la base si sa productivité
est maintenue égale à celle du secteur privé.
Mais la réduction des inégalités a une autre vertu.
 6
6
1
/
6
100%