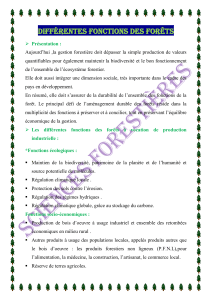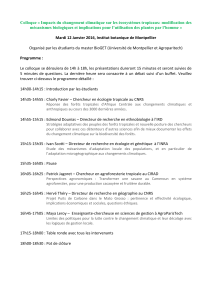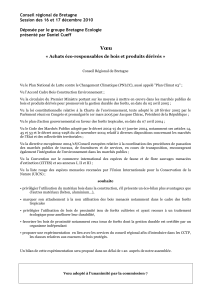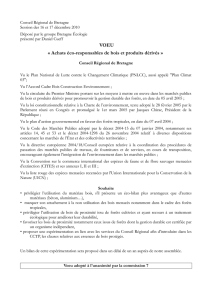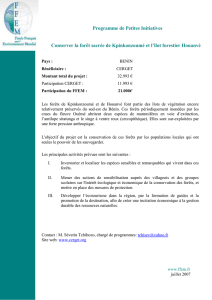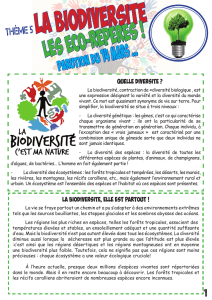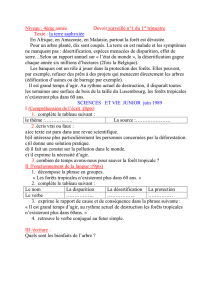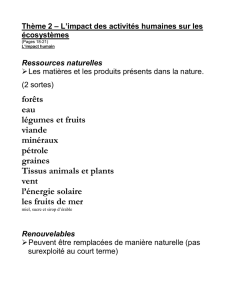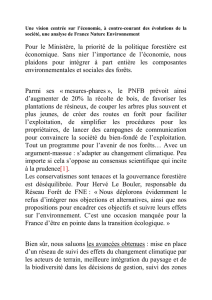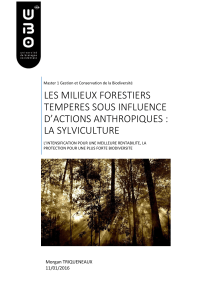La mission terrestre de l`expédition en Papouasie-Nouvelle

La mission terrestre de l’expédition en Papouasie-Nouvelle-Guinée
Pourquoi la Papouasie-Nouvelle-Guinée ?
Au pied du mont Wilhelm, à 3700m les lacs Aunde et Piunde © Xavier Desmier - MNHN
La Papouasie-Nouvelle-Guinée est exceptionnelle à plus d’un titre : abritant le troisième plus grand bloc de forêts tropi-
cales intactes après ceux des bassins de l’Amazone et du Congo, on estime qu’elle contient à elle seule environ 5 % de la
biodiversité mondiale, alors qu’elle ne représente que 0.5 % des terres émergées. Considérée comme un véritable « mini-
continent », susamment grande pour générer sa propre diversité, elle possède un taux d’endémisme très élevé : plus
de 70 % de ses plantes ne poussent nulle part ailleurs. Peu étudiées (le premier livre sur les mammifères de Papouasie-
Nouvelle-Guinée date de 1990 !), sa faune et sa ore ont néanmoins fait l’objet d’études considérées comme des références
dans le domaine de l’évaluation du nombre d’espèces vivant sur notre planète. Toutefois, ces travaux concernaient les
forêts de basse altitude. Or rien ne dit que les situations des forêts de plaine et celle des forêts d’altitude soient totalement
comparables.
La province de Madang, où sera menée la composante terrestre de l’expédition, est l’un des rares endroits au monde où
des forêts tropicales humides s’étendent de la côte jusqu’à leur limite naturelle en altitude. Cette situation constitue une
aubaine pour les chercheurs : grâce à ce nouveau volet de La Planète Revisitée, ils vont pouvoir étudier pour la première
fois en détails comment plantes et animaux se répartissent et interagissent en fonction de l’altitude sur une grande mon-
tagne tropicale.
Les spécimens et les données ainsi collectées permettront d’atteindre plusieurs objectifs :
- Améliorer les connaissances sur la biodiversité des forêts tropicales humides en fonction de l’altitude. Ces connaissances
pourront être utilisées pour améliorer le modèle utilisé actuellement pour calculer le nombre d’espèces vivant sur Terre.
Elles permettront aussi de mieux évaluer l’impact du changement climatique sur ces régions ;
- Encourager les communautés locales à participer à la collecte de données sur leur environnement, et favoriser leur
implication dans les programmes de conservation ;
- Contribuer à la formation de parataxonomistes et paraécologues papous, an de combiner les approches biologiques
modernes et les connaissances de terrain traditionnelles.

Un paradis de biodiversité bientôt perdu ?
Forêt de brouillardà 2200m © Olivier Pascal - MNHN - PNI
La biodiversité si particulière de Papouasie-Nou-
velle-Guinée est fortement menacée par les acti-
vités humaines, et en particulier par la déforesta-
tion galopante qui ronge les forêts du pays. Une
étude récente menée par des chercheurs de l’Uni-
versité de Papouasie-Nouvelle-Guinée a montré
que celle-ci s’accélère depuis le début des années
90. Les principales causes sont l’exploitation du
bois par l’industrie forestière, et la conversion
de surfaces boisées pour l’agriculture. Dans une
moindre mesure, les feux de forêts, l’installation
de plantations et les mines causent également des
dommages. Entre 1972 et 2002, ce sont ainsi 15
% des forêts de Papouasie-Nouvelle-Guinée qui
ont disparu, dont plus de la moitié à cause de l’in-
dustrie forestière. Exploitées par des compagnies
étrangères, le bois de Papouasie-Nouvelle-Guinée
est exporté partout dans le monde. À ce rythme,
on estime que la quasi-totalité des forêts acces-
sibles auront vu leur surface dramatiquement
réduite, ou auront purement et simplement dis-
paru, d’ici 10 à 20 ans.
Comme de nombreux pays en développement, la
Papouasie-Nouvelle-Guinée doit relever un dé
de taille : s’inscrire dans une économie mondia-
lisée sans laisser celle-ci détruire son riche patri-
moine naturel. Heureusement, contrairement à
d’autres pays, la Papouasie-Nouvelle-Guinée pos-
sède un atout majeur pour défendre ses intérêts :
sa Constitution, qui reconnaît et protège le droit
des communautés locales à posséder la terre. Ain-
si, 97 % des terres sont la propriété d’individus
ou de communautés villageoises, qui décident de
leur utilisation. Souvent, les villageois acceptent
de céder des droits à la prospection et à l’extrac-
tion minière en échange d’indemnités. Mais pas
toujours. Dans la région de Wanang, huit clans
ont ainsi refusé les propositions d’exploitation fo-
restière faites par le gouvernement, et ont déclaré
« zone de conservation » 10 000 hectares de leur
forêt. Aidée par le Binatang Research Center, qui
sponsorise notamment l’école primaire du village,
ces communautés maintiennent l’intégrité de leur
forêt et bénécient des études sur la biodiversité.
Celles-ci permettent de valoriser la région, et
fournissent des données importantes pour orien-
ter les politiques de conservation. Dans le parc
naturel du Mont Wilhelm, d’autres communau-
tés participeront à des projets similaires, quoique
d’ampleur moindre. De leur réussite naîtra peut-
être une prise de conscience salutaire pour la pré-
servation des forêts de Papouasie-Nouvelle-Gui-
née. Un passage obligé pour ce pays très engagé
dans la Rainforest Coalition, un partenariat mon-
dial pour la protection des forêts tropicales mis
en place en 2010.

La menace du changement climatique
L’exploitation forestière n’est pas la seule menace pesant sur les forêts de Papouasie-Nouvelle-Guinée. Les modèles actuels
permettant de mesurer l’impact du changement climatique en cours laissent entrevoir de profondes modications des
écosystèmes, notamment en altitude. En cas de réchauement de la région, il est très probable que les espèces des basses
terres gagnent du terrain sur celles d’altitude, plus adaptées à des environnements froids, menant à la disparition de ces
écosystèmes tropicaux. Des travaux antérieurs ont déjà documenté ce type de changements, mais ils concernaient des
environnements situés dans des régions tempérées ou sur l’île voisine de Bornéo. Or ces changements auront certaine-
ment un impact particulier en Papouasie-Nouvelle-Guinée, un des rares endroits des tropiques où se côtoient des forêts
tropicales humides et des écosystèmes alpins.
Les données détaillées recueillies durant l’expédition constitueront un état des lieux de l’état de la biodiversité (essentiel-
lement plantes et invertébrés) à diérentes altitudes, depuis la plaine jusqu’à 3700 mètres. Elles permettront par exemple
d’eectuer des simulations an d’estimer l’impact d’un réchauement global de quelques degrés, d’ici à 100 ans, sur la
répartition des diérentes espèces végétales et animales : lesquelles verront leur aire répartition augmenter ou diminuer
? Lesquelles disparaîtront ? Comment seront modiés les écosystèmes suite à ces changements ? Et, en conséquence,
quelles sont les mesures à prendre en termes de conservation pour tenter de se préparer à ces changements et si possible,
les minimiser ?
© Maurice Lepnce - MNHN - PNI
1
/
3
100%