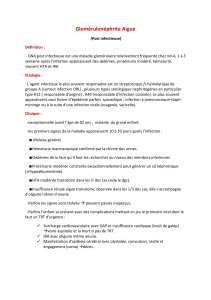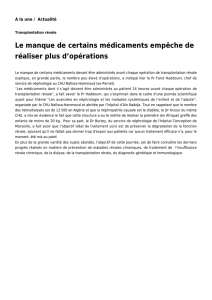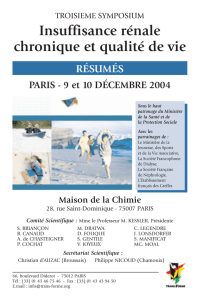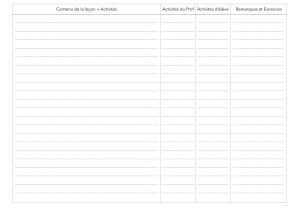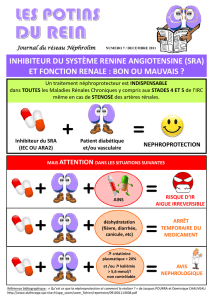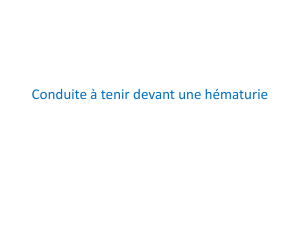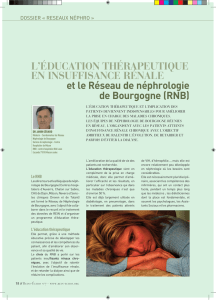qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty - ORBi

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwert
y
uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd
fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx
cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq
wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui
opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg
hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxc
vbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq
wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui
opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg
hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxc
vbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq
wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui
opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg
hjklzxcvbnmrtyuiopasdfghjklzxcvbn
mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwert
yuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopas
dfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklz
xcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnm
qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty
Néphrologie pédiatrique
A l’usage du 2° cycle médecine
Professeur Oreste Battisti
Faculté de Médecine,ULg

Néphrologie de l’enfant - 2 -
Prof Oreste Battisti, Université de Liège - 2 -
Table des matières
Biologie rénale et évaluation de la fonction rénale ............................................................................................. 4
Mesure et calcul de la filtration glomérulaire (FGR ou GFR) ........................................................................ 11
Protéinurie asymptomatique de l’enfant .................................................................................................... 13
Test pour dépistage de l’albuminurie orthostatique .................................................................................. 17
Diagnostic des protéinuries.................................................................................................................................. 18
L'hématurie ........................................................................................................................................................... 24
non expliquée par une cause évidente, par exemple une cystite, est un symptôme relativement fréquent.
Une hématurie isolée n'est pas dangereuse en elle-même sauf lorsqu'un saignement extraglomérulaire est
abondant et qu'il est responsable de la formation de caillots obstruant les uretères. Cependant la mise en
évidence d'une hématurie a une grande valeur diagnostique car celle-ci peut être le symptôme révélateur
d'une maladie rénale ou urologique grave. ......................................................................................................... 24
La physiopathologie des états oedémateux ........................................................................................................ 34
Les diurétiques ..................................................................................................................................................... 41
Rappel de la physiologie rénale en schémas ...................................................................................................... 45
Le Rein en période néonatale ............................................................................................................................. 50
Apports liquidiens en néonatalogie .............................................................................................................. 57
Composition corporelle-Besoins en eau et électrolytes .................................................................................... 58
Diagnostic sémiologique d'une maladie rénale ..................................................................................................... 59
chez le nouveau né et le nourrisson ........................................................................................................... 59
Répercussions d'une maladie rénale chronique sur la croissance .................................................................. 61
Le rachitisme par carence en vitamine D .......................................................................................................... 63
Le rachitisme hypophsphatémique .............................................................................................................. 70
La classification des maladies rénales repose sur des bases en partie arbitraires. .............................................. 71
LES NEPHROPATHIES HEREDITAIRES ......................................................................................................... 76
La glomérulonéphrite aiguë .......................................................................................................................... 81
1 Syndrome néphritique aigu ................................................................................................................... 82
2 Modalités évolutives du syndrome néphritique apparemment isolé .............................................. 82
3 Syndrome néphritique secondaire à une maladie générale ............................................................. 83
4 Traitement ............................................................................................................................................... 83
Syndromes néphrotiques de l'enfant ........................................................................................................... 84
Plus spécifiquement chez l’enfant ........................................................................................................ 100
Physiopathologie....................................................................................................................................... 100
Etude symptomatique .............................................................................................................................. 100
Formes anatomo-cliniques et étiologiques .......................................................................................... 102
Syndrome hémolytique et urémique ......................................................................................................... 105
LES INSUFFISANCES RENALES AIGUËS CHEZ L'ENFANT ............................................................... 106
Symptômes évocateurs d'une insuffisace rénale ............................................................................................. 106
Etiologies ........................................................................................................................................................ 106
Insuffisance rénale chronique de l'enfant ....................................................................................................... 110
Hématuries de l'enfant ...................................................................................................................................... 111
Protéinuries chroniques de l'enfant ................................................................................................................. 119
Le rein et le métabolisme .................................................................................................................................. 122
Lecture complémentaire : .......................................................................................................................... 123
Hypocalcémies du nourrisson et de l'enfant ................................................................................................... 137
1 Les hypocalcémies néonatales ................................................................................................................ 137
1.1 Etude clinique .................................................................................................................................... 137
1.2 Biologie ................................................................................................................................................ 137
1.3 Signes électriques .............................................................................................................................. 138
1.4 Diagnostic ........................................................................................................................................... 138
1.5 Etiologie .............................................................................................................................................. 138
2 Les hypocalcémies du nourrisson ........................................................................................................... 139
2.1 Diagnostic positif ............................................................................................................................... 139
2.2 Diagnostic étiologique ...................................................................................................................... 141
2.3 Evolution et pronostic....................................................................................................................... 141

Néphrologie de l’enfant - 3 -
Prof Oreste Battisti, Université de Liège - 3 -
3 Les hypocalcémies du grand enfant ....................................................................................................... 141
3.1 Etude clinique .................................................................................................................................... 141
3.2 Examen clinique................................................................................................................................. 142
3.3 Diagnostic positif ............................................................................................................................... 142
3.4 Diagnostic différentiel ...................................................................................................................... 142
3.5 Diagnostic étiologique ...................................................................................................................... 142
3.6 Formes étiologiques des hypoparathyroïdies ................................................................................ 143
4 Traitement des hypocalcémies ............................................................................................................... 144
Indications et traitements ...................................................................................................................... 144
Les principales tubulopathies héréditaires ou pseudo endocrinopathies ..................................................... 146
Maladie héréditaire formant un tableau clinique et biologique .................................................................... 147
L’insuffisance rénale chez l’enfant .................................................................................................................. 149
Clinical presentation, evaluation and diagnosis of acute renal failure in children .......................................... 154
Le dépistage anténatal des malformations des reins et voies urinaires ........................................................ 164
Anomalies de nombre et de taille des reins ............................................................................................ 164
1 Agénésie rénale ..................................................................................................................................... 164
2 Aplasie rénale ....................................................................................................................................... 165
3 Hypoplasie rénale ................................................................................................................................. 165
Dysplasie rénale ........................................................................................................................................ 166
Anomalies de position.................................................................................................................................. 168
1 Dystopie rénale...................................................................................................................................... 168
2 Ectopie rénale ....................................................................................................................................... 168
3 Fusion entre les deux reins ................................................................................................................. 169
Malformations des calices ........................................................................................................................... 170
1 Diverticule pré-caliciel (figure 2) : kyste pyélogénique ................................................................. 170
2 Hydrocalice ........................................................................................................................................... 170
3 Méga-polycalicose ................................................................................................................................. 171
Infections urinaires de l'enfant ........................................................................................................................ 172
1. CLINIQUE .................................................................................................................................................. 172
1.1. Chez le nouveau-né .............................................................................................................................. 172
1.2. Chez le nourrisson ................................................................................................................................ 172
1.3. Chez l'enfant plus grand ....................................................................................................................... 172
2. BIOLOGIE ................................................................................................................................................... 173
3. LE REFLUX VéSICO-URéTeRAL ................................................................................................................ 174
3.1. La néphropathie du reflux .............................................................................................................. 174
3.2. L'anomalie de la jonction urétéro-vésicale ........................................................................................... 175
4. LES MÉTHODES DU BILAN ................................................................................................................... 179
4.1. L'échographie ....................................................................................................................................... 179
4.2. Cystographie ........................................................................................................................................ 182
3. Explorations isotopiques rénales ............................................................................................................. 184
4. Tomodensitométrie ................................................................................................................................. 184
5. Autres investigations ........................................................................................................................... 184
BILAN DES INFECTIONS URINAIRES ...................................................................................................... 185
1. Infection urinaire haute (pyélonéphrite) .................................................................................................. 185
Infection urinaire basse ........................................................................................................................... 186
AU TOTAL ....................................................................................................................................................... 186
Pyélonéphrites aiguës non compliquées chez l’adolescent(te) Par convention, l'infection urinaire est définie
soit comme une infection du bas appareil urinaire (cystite aiguë) soit comme une infection du haut appareil
urinaire (pyélonéphrite aiguë). Malgré l'atteinte du haut appareil urinaire, la plupart des épisodes de
pyélonéphrite aiguë sont considérés comme non compliqués. Une infection de l'arbre urinaire compliquée,
qu'elle soit localisée au bas ou au haut appareil, est associée à des conditions sous-jacentes qui augmentent le
risque d'échec du traitement, comme une obstuction, une dysfonction urologique ou un germe uropathogène
multirésistant. Au moment de la présentation, il est difficile de savoir si un patient avec une pyélonéphrite a
une infection compliquée ou non compliquée. De façon pragmatique, une infection urinaire est considée
comme non compliquée lorsqu’elle survient chez une jeune femme non enceinte en bonne santé apparente
(pas d’antécédents pathologiques notamment urologiques) et est considérée comme compliquée dans tous les
autres cas. La pyélonéphrite aiguë doit être distinguée de la pyélonéphrite chronique, une forme de maladie
tubulo-interstitielle chronique liée à une obstruction chronique ou à un reflux vésico-urétéral, avec ou sans
infection récidivante. .......................................................................................................................................... 193

Néphrologie de l’enfant - 4 -
Prof Oreste Battisti, Université de Liège - 4 -
Biologie rénale et évaluation de la
fonction rénale
Bilan rénal
Sang :
Formule sanguine, plaquettes, fer, ferritine, réticulocytes, urée, créatinine, microglobulines,
ph, urates, calcium, phosphore, phosphatases alcalines, Mg plasmatique, Na, K, Cl, protéïnes
sériques et électrophorèse, fibrinogène, VS, CRP, ASL, IgA, G, M.
Urines :
réactions urinaires, sédiment urinaire, culture urinaire, 2 microglobulines,Ca, créatinine
Bilan immunologique :
C3, C4, ( C3PA, C3C), Ci IgA, CiC, anticorps anti-membranes-glomérulaires, anticorps anti
MBT, IgA, ANCA cyto , périnucléaire ( Wegener, P.N, GL rapidement progressive )
C3 néphritic factor
Etude du pouvoir de concentration rénale chez l’enfant
- La technique la plus aisée est le test au D.D.A.V.P (MINIRIN).
Les urines sont recueillies toutes les heures pendant 5 heures, après
administration nasale de D.D.A.V.P., leur osmolarité est mesurée.
Le pouvoir de concentration normal est de :
700 mosm/kg avant 3 mois,
1000 mosm/kg après 12 Mois.
Indications : la mesure du pouvoir de concentration est un élément essentiel de
surveillance des uropathies et des tubulopathies, le pouvoir de concentration est
perturbé bien avant l'atteinte de la filtration glomérulaire.
3 Evaluation des fonctions tubulaires
Tant proximales que distales : difficile et d'indication plus rare (mesure du taux de
réabsorption des phosphates, mesure du pouvoir d'acidification des urines, etc...).
Test dilution concentration urinaire
• L’enfant est à jeun
• Vider la vessie en prélevant : RU-SU-CU
Na, K, Ca, créat., osmol., Ph
• Noter l’heure de début du test
• Faire boire 25 à 30 cc / kg avec un maximum de 800cc
• Récolter les urines pendant 10 heures ( si possible 1x / heure)
• Sur les urines : demander osmolarité, densité
• Noter sur le tube : - heure du prélèvement
- volume
- qu’il s’agit d’un test de dilution concentration

Néphrologie de l’enfant - 5 -
Prof Oreste Battisti, Université de Liège - 5 -
• Pendant le test, l’enfant peut recevoir un repas sec, pas de boisson pendant 10 heures
Test de restriction hydrique
Ce test permet d’infirmer ou d’affirmer un trouble de concentration d’origine hypothalamo-
hypophysaire et rénal car il explore tout l’axe, il est sous la dépendance de la sécrétion
d’ADH par l’hypothalamus, stockage au niveau
hypophysaire et réception au niveau du tube collecteur.
Si ce test est normal : tout l’axe est normal.
En cas de réponse anormale, enchaîner avec un test au Minrin.
•
La veille au soir, repas sec, c’est à dire sans liquides
Patient à jeun. Début du test au réveil.
•
Restriction hydrique absolue pendant les 5 heures qui suivent
•
T0 : prélever une biologie avec Ca, P, Ph, Na, K, Cl, osmolarité, urée, créatinine, PS.
Toutes les heures : - prendre la TA
- peser
- récolter les urines pour osmolarité, densité et noter le volume
- le test peut être arrêter quand la densité est supérieure à 1025
•
Prélever une bio à H1, H2, H3, H5 avec : - osmolarité plasmatique
- ADH ( 8 à 10 cc héparinés ) centifugés puis
congelés
- neurophysines et AVP neurophysines ( 5 cc
coagulés )
•
Les modalités du test sont différentes chez le nourisson :
- on diminue les apports hydriques en donnant 2
biberons préparés avec la même quantité de lait sec mais avec
la moitié d’eau .
- on recueille les urines par urinocol pendant 5
heures.
•
le diabète insipide risque d’entrainer une déshydratation : suivre le poids de l’enfant de
près et arrèter le test si la perte de poids est > à 3 %.
•
Ce test peut être suivi d’un test de concentration rénale par le Minrin en intra-nasal avec
les mêmes mesures biologiques à H6 et H7.
Le Minrin en fin de test permet de faire le diagnostic différentiel entre le diabète central et le
diabète néphrogénique.
•
Si suspicion de diabète insipide important, pour éviter le risque de déshydratation, faire
plutôt un test de charge
saline.
Test de charge saline
Ce test a tendance à remplacer le test de restriction, notamment en cas de forte suspicion de
diabète insipide pour éviter
le risque de déshydratation.
•
Perfusion de NaCl à 5% à 0,06 ml / kg / min pendant 2 heures.
•
Prélever aux temps 0, H1, H2 : - osmolarité sanguine
- neurophysines totales et AVP neurophysines
( 5 cc
coagulés )
- ADH ( 8 à 10 cc héparinés )
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
 52
52
 53
53
 54
54
 55
55
 56
56
 57
57
 58
58
 59
59
 60
60
 61
61
 62
62
 63
63
 64
64
 65
65
 66
66
 67
67
 68
68
 69
69
 70
70
 71
71
 72
72
 73
73
 74
74
 75
75
 76
76
 77
77
 78
78
 79
79
 80
80
 81
81
 82
82
 83
83
 84
84
 85
85
 86
86
 87
87
 88
88
 89
89
 90
90
 91
91
 92
92
 93
93
 94
94
 95
95
 96
96
 97
97
 98
98
 99
99
 100
100
 101
101
 102
102
 103
103
 104
104
 105
105
 106
106
 107
107
 108
108
 109
109
 110
110
 111
111
 112
112
 113
113
 114
114
 115
115
 116
116
 117
117
 118
118
 119
119
 120
120
 121
121
 122
122
 123
123
 124
124
 125
125
 126
126
 127
127
 128
128
 129
129
 130
130
 131
131
 132
132
 133
133
 134
134
 135
135
 136
136
 137
137
 138
138
 139
139
 140
140
 141
141
 142
142
 143
143
 144
144
 145
145
 146
146
 147
147
 148
148
 149
149
 150
150
 151
151
 152
152
 153
153
 154
154
 155
155
 156
156
 157
157
 158
158
 159
159
 160
160
 161
161
 162
162
 163
163
 164
164
 165
165
 166
166
 167
167
 168
168
 169
169
 170
170
 171
171
 172
172
 173
173
 174
174
 175
175
 176
176
 177
177
 178
178
 179
179
 180
180
 181
181
 182
182
 183
183
 184
184
 185
185
 186
186
 187
187
 188
188
 189
189
 190
190
 191
191
 192
192
 193
193
 194
194
 195
195
 196
196
 197
197
 198
198
 199
199
 200
200
1
/
200
100%