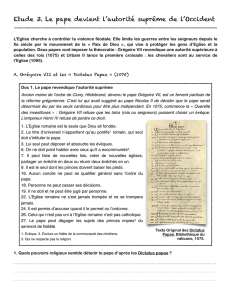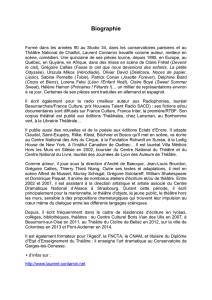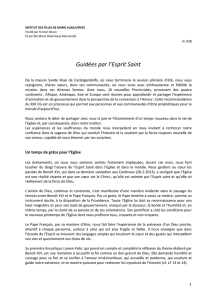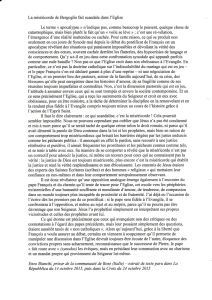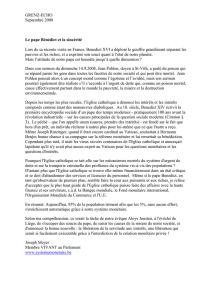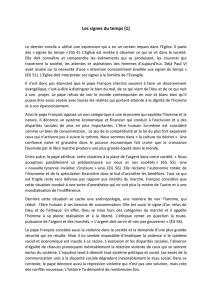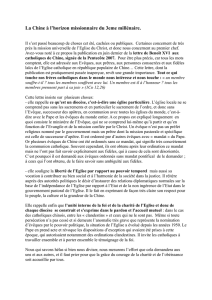GRÉGOIRE VII ET LA RÉFORME DU XIe SIÈCLE

1
GRÉGOIRE VII ET LA RÉFORME DU XIe SIÈCLE
PAR J. BRUGERETTE
INTRODUCTION
Au nom de Grégoire VII reste attaché dans l'histoire de l'Eglise le souvenir de la plus grande réforme qu'il ait été
donné à la Papauté d'accomplir. De ce fait, nul homme peut-être n'a été pour son temps comme pour les âges futurs un
signe de contradiction plus manifeste. C'est pour cela qu'il fut tant attaqué. Ni la hauteur des vues, ni la droiture des in-
tentions, ni même la sainteté de sa cause ne pouvaient soustraire Grégoire VII à l'orageuse destinée de ceux qui luttent
contre des abus. Le fils de l'artisan de Soana avait en effet blessé lui-même trop d'intérêts vulgaires, contrarié trop de
passions, soulevé trop de haines, pour n'être pas frappé à son tour. Il n'est pas étonnant que l'histoire ait été dure pour lui.
Beaucoup, égarés par l'esprit de parti ou trompés par les apparences, ont jugé ce grand pape sur ses doctrines poli-
tiques. Ils ont attribué aux égarements de l'ambition des actes d'autorité qui dans la pensée de leur auteur étaient bien
plus un moyen de garantir la liberté du sacerdoce que d'imposer au monde sa suprématie. C'est pour avoir méconnu les
vraies vues de Grégoire VII que ses historiens ont été amenés à mettre au premier plan un réformateur fougueux et impi-
toyable, lançant la foudre contre les rois et les empereurs, révolutionnant tout le monde chrétien, à la seule fin d'élever la
chaire de Pierre au-dessus de tous les trônes. Ils ont ainsi laissé dans l'ombre la sainteté, le génie, les vertus et les
qualités supérieures d'un Pontife à qui l'Eglise n'a point craint de dresser des autels.
De cet honneur suprême, jamais homme religieux ne fut plus digne que Grégoire VII. Grâce à lui, l'Eglise affranchie
des servitudes du siècle, sauvée de la corruption et de la mort, revenue en un mot «à son ancienne gloire» (Grég. Ep.,
coll. 46), avait pu reprendre sa marche vers l'idéale justice que son livre divin avait fait entrevoir aux hommes. Telle fut
l'œuvre féconde et durable de la réforme grégorienne du XIè siècle.
Il n'entre pas dans le cadre de cette étude d'apporter une histoire détaillée et complète de ce mémorable pontificat.
Notre but est plus modeste. Nous voulons simplement, en nous aidant des travaux les plus récents et les plus sûrs de la
critique française et allemande, retracer la véritable physionomie de Grégoire VII et de son temps, exposer les traits es-
sentiels de son œuvre et les idées qui en furent les principes directeurs. On verra dans cet ensemble de faits le plan mû-
ri et arrêté d'un homme qui sut mettre le plus grand courage au service de la plus noble des causes : la régénération
d'une société en décadence par le christianisme.
Il faut faire sans doute à la nature humaine sa part même dans la conquête du bien. Le livre du progrès n'est pas tou-
jours sans tache. Heureux du moins ceux qui peuvent y écrire d'un cœur pur une page immortelle. Grégoire VII fut un de
ceux-là. Il voulut être avant tout le pasteur universel des âmes et il sut l'être. Partout donc où il vit un danger pour
les âmes, il y courut, employant pour le conjurer tous les moyens en son pouvoir. Voilà sa mission par excellence, celle
que nos pages, inspirées par le seul amour de la vérité, aideront à faire ressortir en la dégageant tout à la fois des inter-
prétations erronées et des altérations de l'esprit de parti.
CHAPITRE PREMIER : L'EGLISE AVANT LA RÉFORME GRÉGORIENNE.
S'il est une œuvre qui porte avec éclat la marque d'une mission providentielle, c'est assurément la réforme reli-
gieuse de Grégoire VII. Il faut connaître l'état de désagrégation où l'Eglise était tombée, quand parut ce réformateur du
monde chrétien, pour comprendre qu'il était de ceux que Dieu envoie sur la terre pour ne pas laisser périr son ouvrage.
La grandeur du geste libérateur se mesure ici à l'étendue du mal à guérir et à l'importance de la cause à sauver. Et le
mal était si profond que l'Eglise devait en mourir. Avec elle allait succomber la civilisation chrétienne.
Sans doute depuis la chute de l'empire romain l'Eglise avait traversé des temps difficiles ; avec l'empereur elle avait
perdu un protecteur, qui avait été souvent un maître et qui le resta pour la chrétienté orientale. Elle avait eu à se faire, en
présence des souverains barbares, des conditions nouvelles d'existence, et ce fut de sa part une grande habileté et une
féconde initiative de réaliser cette séparation du monde spirituel et du monde temporel, seule garantie de son indé-
pendance. Par là prévalut peu à peu cette idée qu'il y avait en dehors des atteintes du pouvoir politique une retraite invio-
lable, le monde de la conscience, des croyances et jusqu'aux pratiques extérieures par lesquelles les croyances se mani-
festent et se maintiennent dans les âmes. Mais aucun régime n'avait été plus fatal à l'Eglise que le régime féodal, cette
confusion de tous les pouvoirs1. Les principes de désorganisation qui travaillaient la société politique avaient fait aussi
1 Note de LHR : Jugement excessif ! qui sera d’ailleurs nuancé par l’auteur un peu plus loin. Rappelons le jugement que le cardinal Pie,
dans LA ROYAUTÉ SOCIALE DE N. S. JESUS-CHRIST D’APRÈS LE CARDINAL PIE par le P. Théotime de Saint Just porte sur cette époque :
Mgr Pie jette d'abord un regard sur le passé et il constate que pendant de longs et beaux siècles, la royauté sociale de Jésus-Christ
était reconnue par la famille des nations européennes :
«Le droit chrétien, nous dit-il, a été pendant mille ans le droit général de l'Europe» (V, 188-189) et il a été pour elle, en même
temps que la source de tous les bienfaits, un principe de gloire incomparable, car, poursuit le grand évêque, nous ne craignons pas
de l'affirmer, l'histoire à la main, les temps et les pays chrétiens ont vu plus de grands règnes, des règnes plus purs, plus saints que
les temps d'Israël. Qu'on compare les livres des Juges, des Rois et des Machabées avec les annales des nations catholiques et
qu'on dise si le désavantage est du côté qui offre ici les Charlemagne et les saint Louis, là les saint Henri d'Allemagne, les saint
Étienne de Hongrie, les saint Wenceslas de Bohême, les saint Ferdinand de Castille, les saint Édouard d'Angleterre, enfin tant de
princes et de princesses non moins illustres par l'éclat religieux de leur règne que par leurs grandes et royales qualités» (V, 189)
Et à l'objection sur les vices et les crimes de ces époques de foi, il répond ainsi :
«Certes, cette société eut ses vices, et les hommes encore à demi barbares qui la composaient ne purent être tous transformés
jusqu'à dépouiller leur première nature. Mais ce qu'on peut affirmer, c'est que tout ce qu'il y eut de nobles sentiments et de grandes
actions à cette époque, et il y en eut beaucoup, fut le fruit des doctrines et des institutions, c'est que si le cœur humain resta faible
par ses penchants, la société fut forte par sa constitution et ses croyances ; en un mot, c'est que le vice ne découla pas de la loi et
que la vertu ne fut pas l'inconséquence et l'exception». (I, 66-67)

2
leur œuvre dans tous les rangs de la société religieuse. Le spirituel ne se distinguait plus du temporel, le sacerdoce était
tombé sous la domination des princes et avait perdu avec l'indépendance la conscience de son rôle. L'Eglise avait
laissé le monde envahir le sanctuaire et le monde lui avait apporté tous ses vices et toutes ses habitudes criminelles.
Ainsi l'on avait vu la grossièreté et la licence la plus éhontée déshonorer des fonctions dont le prestige avait grandi par
les vertus et les services. L'Eglise, qui représentait la force morale et les idées directrices, semblait s'abîmer dans le dé-
sordre, entraînant avec elle la société tout entière.
La papauté asservie par la puissance séculière portait la première les marques de cette déchéance qui caractéri-
sait l'Eglise féodale. La restauration impériale de l'an 800 avait eu, il est vrai, pour effet d'affermir l'autorité du pontife ro-
main sur toute l'Eglise occidentale, de donner à tout le corps ecclésiastique un principe de gouvernement spirituel qui
était le pape et un pouvoir disciplinaire qui était l'empereur. Mais la dissolution de l'empire avait compromis ce résultat et
l'on avait vu, avec les premiers essais de nationalités nouvelles, des tentatives pour constituer des Eglises nationales.
L'archevêque de Reims, Hincmar, représenta avec éclat la prétention des évêques qui voulaient rendre le pape à l'Ita-
lie ; il répondit à une menace d'excommunication lancée par le pape contre les évêques français : «S'il vient pour nous
excommunier, il s'en retournera excommunié lui-même».
De 883 à 955, pendant plus de soixante-dix ans, l'Eglise romaine vécut dans l'humiliation et dans la servitude : la
chaire apostolique était alors la proie et le jouet des factions rivales de la noblesse, elle fut même livrée, pendant un cer-
tain temps, aux mains de femmes ambitieuses et débauchées. Elle se releva un moment dans la personne de Grégoire V
(996-999) et de Sylvestre II (999-1003), lors de l'intervention des empereurs saxons. Mais bientôt après, la papauté re-
tomba dans l'ancienne anarchie et dans l'impuissance morale. Les comtes de Tusculum la rendirent héréditaire («Quo-
dam jure hereditario». Bonitho, l. v) dans leur famille. C'est alors qu'un enfant méprisable s'assit sur le Saint Siège pour le
déshonorer, sous le nom de Benoît IX (1033-1044), par de publiques débauches1, c'est alors que le trône pontifical fut
vendu et acheté comme une marchandise. Cette époque fut véritablement «l'âme de fer» de la Papauté (Léon Chaine,
Les catholiques français et leurs difficultés actuelles). N'avait-on pas vu trois papes à la fois se disputer la tiare ? Les em-
pereurs allemands crurent pouvoir mettre un terme à ces désordres en prenant eux-mêmes le gouvernement de l'Eglise.
Henri III ne craignit pas de disposer cinq fois du pouvoir pontifical en faveur de ses chapelains. Mais à partir du jour où
l'empereur d'Allemagne usurpa le droit de nommer lui-même les papes, la plus haute dignité de l'Eglise se trouva sou-
mise à un laïque. C'était bien l'affaissement de la papauté sous la domination impériale. Jamais l'Eglise n'avait été aussi
«complètement asservie à l'Etat.
Le clergé engagé comme son chef dans le lac des obligations féodales offrait à son tour au monde le spectacle de la
plus complète déchéance. Le laïcisme avec ses mœurs et ses ambitions semblait avoir vicié l'esprit même de l'institution
ecclésiastique en la ramenant aux temps éloignés où la distinction des deux pouvoirs n'avait pas encore été pressentie.
Les évêques de l'époque féodale n'étaient pas seulement des chefs religieux, ils avaient encore une forte part de pouvoir
politique. A cause de leurs domaines, ils étaient grands seigneurs, c'est-à-dire souverains sur leurs paysans et sur leurs
vassaux. Mais en acquérant les pouvoirs d'un seigneur laïque, ils avaient dû accepter les obligations attachées à cette
dignité. Or ces obligations n'étaient guère conformes à leur pacifique et saint état. On voyait, par exemple, des évêques
s'armer en guerre comme les laïques et suivre, la mitre en tête et le haubert au dos, les rois et les empereurs dans leurs
expéditions2. Parfois non moins redoutables que les barons qui infestaient leurs domaines, ils guerroyaient pour leur
compte, pillant même les abbayes dont les lois ecclésiastiques leur confiaient la tutelle (Hist. littér., t. VII, p. 5 et ss.). De
là ces exemptions concédées par les papes, exemptions qui affranchissaient les monastères de la juridiction épiscopale
pour les placer sous l'autorité directe du Saint-Siège (Cf. F. Rocquain : La cour de Rome et l'esprit de la Réforme). L'es-
Et encore : «Beaucoup de crimes, assurément, ont été commis alors comme aujourd'hui. L'humanité, depuis les jours de Caïn
et Abel, a été et sera toujours divisée en deux camps. Parfois même les passions ont été plus violentes, plus énergiques en face
des vertus plus fortes et de la sainteté plus éclatante. Mais personne de sensé ne le niera : tout ce qui subsiste aujourd'hui encore
de vraie civilisation, de vraie liberté, de vraie égalité et fraternité a été le produit du christianisme européen ; l'affaiblissement du
droit chrétien de l'Europe a été le signal de la décadence et de l'instabilité des pouvoirs humains ; enfin ce que l'œuvre d'ailleurs si
négative et si désastreuse des révolutions modernes pourra laisser de bon et de salutaire après elle, aura été la réaction contre
des excès et des abus que réprouvait le régime chrétien» a.
Le passé, malgré ses vices et ses misères, reste donc la belle époque pour l'Europe. Jésus-Christ était alors reconnu et proclamé Roi
des peuples et des nations.
a V, 189 Cf. aussi VII, 134 et sv. Dans son instruction pastorale sur les malheurs actuels de la France (Carême 1871) Mgr Pie établit
ainsi la supériorité morale du passé sur le présent. Après avoir affirmé qu'il n'est donné à aucune balance humaine, mais à la seule ba-
lance de Dieu, d'établir la proportion exacte entre la moralité du présent et celle du passé, il ajoute : «Mais, en ce qui est de la gravité
respective de tel ou tel péché, nous possédons des principes certains. Le mal moral, comme le mal physique, se discerne et se gradue
d'après le genre et l'espèce». Il note, ensuite, d'après saint Hilaire, une différence considérable entre l'impiété et le péché. «Par la
grâce de Dieu, tout pécheur n'est pas impie, parce que tout péché n'est pas impiété ; au contraire l'impie ne peut pas n'être point pé-
cheur, attendu que l'impiété implique par elle-même le plus grand péché». C'est sur la gravité et la multiplicité du péché d'impiété que
Mgr Pie se base pour affirmer que la société actuelle, sous un certain vernis de décence, est pourtant inférieure au point de vue moral
à la société du Moyen-Age. «N'est-il pas trop manifeste, dit-il, que le nombre des impies s'est étendu parmi nous et qu'il a prodigieu-
sement grandi dans les temps modernes ? Et ce qui est infiniment plus injurieux pour Dieu et plus pernicieux pour la terre, n'est-il pas
trop établi, que sous plusieurs de ses aspects, le crime d'impiété n'est plus seulement le crime des particuliers, mais qu'il est devenu le
crime de la société ? » VII, 98-100 ; X, 206-207.
1 Chassé de Rome par le peuple en 1044, Benoît IX y était rentré à main armée. A un moment il conçut le projet d'épouser la fille d'un
baron de la Sabine, et peu s'en fallut que la chaire de Pierre, devenue presque héréditaire ne fût occupée par un prêtre marié. (Bonitho)
l. v. - Desider, Dialog., l. III. Cf. Regesta pontific. Jaffé, Wattenbach, anno 1044).
2 Comme vassaux des rois les prélats étaient tenus, il est vrai, au service militaire ; mais la loi civile, d'accord en cela avec les prescrip-
tions de l'Eglise, les autorisait à se faire remplacer par des séculiers à la tête du contingent qu'ils étaient obligés de fournir. En France,
on appelait vidames ceux qui à la place des évêques commandaient aux hommes et aux vassaux des églises. (Guérard, Castal. de
Saint-Père de Chartres, t. I, p. 78).

3
prit féodal ou laïque avait pris peu à peu la place de l'esprit ecclésiastique. Entre ces deux intérêts, l'intérêt du posses-
seur de fief et l'intérêt du prêtre, le moins noble des deux avait fini par l'emporter sur l'autre.
La pratique de l'investiture féodale fut surtout préjudiciable à l'Eglise parce qu'elle amena l'absorption du pouvoir
spirituel par le pouvoir temporel. L'investiture n'était par elle-même qu'un symbole s'appliquant à une tradition, le signe
de la donation d'un bien propre à autrui1. Elle n'était pas particulière à la société féodale, il faut se rappeler quelle place
elle a tenue dans le droit privé ou public des époques antérieures. Elle intervenait partout où le transfert d'un droit ne
pouvait se faire que par la remise d'un objet, remise qui créait l'obligation. Nous la trouvons dans l'Eglise elle-même. Dès
les premiers temps du christianisme, l'un des premiers actes de la cérémonie du sacre fut le don des insignes sacrés. Si
l'évêque par la consécration recevait le caractère, par l'investiture il était extérieurement saisi de la juridiction. L'une lui
conférait le pouvoir d'ordre attaché uniquement à l'épiscopat, l'autre le droit de lier et de délier dans une église détermi-
née. Par l'imposition des mains et l'onction, il devenait vraiment membre du collège apostolique ; la remise de l'anneau et
de la crosse lui transmettait le gouvernement des âmes. Il y avait donc une investiture ecclésiastique qui complétait la
consécration. Cette investiture n'était d'ailleurs point spéciale à l'épiscopat. Toute fonction dans l'Eglise à laquelle était at-
tachée une juridiction se conférait par une cérémonie analogue. C’est par le don du baculus que l'abbé d'un monastère
recevait le gouvernement de son abbaye. S'agissait-il d'un simple curé, d'une église paroissiale, c'est par la tradition d'un
objet de cette église, de clefs ou d'une corde des cloches qu'était investi le titulaire. Ainsi à tous les degrés l'investiture
était la tradition visible du pouvoir (C. Villanuova, t. X, app. 25, Fulbert de Chartres, Lettres, Bouquet, t. X, p. 460).
Cette investiture ecclésiastique finit malheureusement par se confondre avec l'investiture laïque. Comment et quand
se fit cette confusion ? Il est impossible de répondre d'une manière précise a ces questions, faute de documents. D'autre
part, les formes de l'investiture varièrent beaucoup, le signe étant par lui-même indifférent. Ce qui est certain, c'est que
l'investiture, à l'époque féodale, avait passé de la puissance ecclésiastique à la puissance féodale. Et ce qu'il importe de
savoir, c'est ce que donnait le seigneur ou le roi quand il conférait cette investiture. Il semble, à première vue, que le sei-
gneur ou le roi ne conférait que les biens, c'est-à-dire les domaines attachés aux dignités ecclésiastiques. Or, nulle part
nous ne voyons indiquée cette idée que le laïque donnât seulement le temporel. La concession comprenait à la fois
l'église, les terres, la juridiction. C'est tout cela par exemple que les hommes du XIe siècle désignaient sous cette formule
générale le don de l'évêché, donum episcopatus (Cf. Imbart de la Tour, Les élections épiscopales dans l’Eglise de France,
du XIe au XIIe siècle, 1891, ch. L'Investiture).
Oui, sous ce terme vague, évêché, les hommes de ce temps comprenaient tout : les biens, l'Eglise, la juridiction et
dans la juridiction elle-même l'autorité sur la terre, l'autorité sur les âmes. Le laïque qui donnait l'église, comme le clerc
qui la recevait n'attachaient à cette tradition qu'une seule idée, c'est qu'elle conférait le gouvernement regimen, cura de
l'église. Par là même, comme l'investiture créait le sacre, elle créait un droit absolu à la consécration, ce n'était plus le
sacre qui créait un droit à l'investiture. On en arrivait ainsi à cette double conséquence : d'abord que l'investiture de
l'évêque échappait entièrement à l'Eglise, que par l'imposition des mains et l'onction les évêques ne faisaient que ratifier
le choix du seigneur; en second lieu que le gouvernement spirituel, par suite d'une confusion, était, tout comme le gou-
vernement de la terre, conféré par un laïque. Des deux actes qui faisaient l'évêque le dernier avait été laïcisé (Cf. Imbart
de la Tour). Ainsi, à une époque où tout était exprimé par des symboles, transmettre l'investiture, c'est-à-dire la marque
du pouvoir, c'était transmettre ce pouvoir lui-même et on était porté à croire que toute autorité venait du seigneur ou
du roi. Des mains qui avaient l'honneur suprême de «créer le Créateur» étaient réduites de ce fait, suivant la forte ex-
pression dit pape Urbain II, «à l'infamie de se soumettre à des mains souillées de sang et de rapines».
Cette confusion n'avait pas seulement pour conséquence de livrer l'Eglise entière au laïcisme, d'écraser le sacerdoce
et de réduire le prêtre à ne plus être que le chapelain des grands, elle introduisait encore dans la maison de Dieu cet
odieux trafic des dignités ecclésiastiques flétri sous le nom de simonie. Ayant besoin d'argent soit pour soutenir leur luxe,
soit pour faire la guerre, les souverains mettaient aux enchères les dignités ecclésiastiques2. Tout devenait fief ; l'évêché,
l'abbaye, la cure passèrent pour tels ; et comme on ne pouvait les tenir héréditairement, ce fut à chaque vacance un dé-
chaînement de convoitises. On achetait les dignités de l'Eglise comme on eût fait d'un office laïque. Ce trafic, flétri
par les saints canons, avait été pratiqué par l'empereur Conrad II, mort en 1039, avec une telle hardiesse, que la cour
d'Allemagne s'en faisait ouvertement une source de revenus (Cf. Zeller, Histoire d'Allemagne, t. III, l'Empire germanique
et l'Eglise au Moyen Age). D'autres fois les dignités ecclésiastiques servaient de récompenses aux flatteries des courti-
sans et aux bassesses d'indignes créatures. A leur tour, ceux qui avaient obtenu du pouvoir séculier ces hautes dignités
s'indemnisaient de leurs sacrifices en vendant les ordres sacrés. Ce droit d'occuper les paroisses et tous les services ec-
clésiastiques faisaient des choses ecclésiastiques des denrées vénales. Suivant le mot de saint Pierre Damien, «le ve-
nin de la simonie avait gagné tout l'Occident de l'Europe».
La simonie avait engendré un autre abus : l'incontinence des clercs. Du moment qu'on ne recherchait plus la sainte-
té et la vertu dans le choix de ceux qui devaient diriger les âmes et que le premier venu n'avait besoin que de se présen-
ter devant le souverain les mains pleines d'argent, l'Eglise était menacée d'une rapide sécularisation. Les laïques qui
avaient acquis des dignités ecclésiastiques ne pouvaient manquer d'apporter la corruption et les mœurs d'un monde bru-
tal dans l'exercice de leurs fonctions. Ils contractaient publiquement mariage. La femme d'un évêque portait son nom
episcopissa, comme celle du prêtre portait le sien, presbytera. Au IXe et au Xe siècle surtout, les évêques et les prêtres
qui ne vivaient pas conjugalement formaient l'exception. Nulle part les mariages défendus par l'Eglise n'étaient plus fré-
quents que dans la Haute Italie. A Lucques, tous les chanoines étaient mariés. Le mariage était depuis longtemps d'un
1 «Elle est ainsi appelée, dit Pierre de Nonantola, parce que nous montrons par ce signe que nous donnons à un autre ce qui est à
nous».
2 Reges potiorem quempiam ad regimen ecclesiarum vel animarum dijudicant ilium videlicet a quo ampliora munera sperant (Rad.
Glaber, II, 6).

4
usage constant dans le clergé de Milan. On en était venu à tenir en suspicion le clergé qui observait encore le célibat. Un
certain nombre d'ecclésiastiques avaient trois ou quatre femmes et s'il était possible de traduire le fameux liber Ghomor-
reanus de saint Pierre Damien, on verrait avec stupeur que rien ne manquait à ce honteux tableau de corruption.
L'éclipse du célibat ecclésiastique avait enfin pour conséquence la constitution de puissantes familles sacerdotales
héréditaires. Les dignités ecclésiastiques étaient devenues des biens patrimoniaux, les plus saintes fonctions tombaient
entre les pires mains. Les hommes de Dieu finirent ainsi par oublier complètement le ciel. Il faut sans doute se méfier de
certains historiens de cette époque dont les écrits témoignent trop de goût pour l'anecdote scandaleuse et hasardent trop
d'affirmations fausses pour ne pas éveiller le soupçon. Mais on ne saurait rejeter en bloc tout ce que ces historiens racon-
tent du relâchement des mœurs sacerdotales au IXe et au Xe siècle. C'est d'ailleurs dans les actes des conciles et des
hommes les plus saints que se trouvent les accusations les plus graves dirigées contre la société ecclésiastique de toute
cette époque (Cf. Concile de Limoges en 1031 et Act. sanctor., 14 avril, p. 234. Cf. etiam Murat, rer. ital., IV, p. 122. - Zel-
ler, p. 116. Pagii not. ibid. anno 1032, apud Baron et œuvres de saint Pierre Damien). Et rien n'était plus dangereux .pour
le monde chrétien que le spectacle de ces abus ; tôt ou tard la corruption du clergé devait amener la corruption de la so-
ciété tout entière, car l'Eglise et la société vivaient alors dans un trop étroit attachement pour que l'une pût souffrir sans
l'autre.
Une anarchie profonde était d'ailleurs le trait caractéristique de la société chrétienne. Les peintures que font les au-
teurs contemporains des mœurs de cette époque sont horribles ! «Le monde, dit saint Pierre Damien, n'est plus qu'un
gouffre d'encre et d'impudicité. La cupidité les asservit tous, depuis les plus petits jusqu'aux plus grands... Un mauvais
esprit précipite visiblement le genre humain dans un abîme de forfaits et fait naître en tous lieux l'envie, la haine, l'hypo-
crisie. Déjà, nous sommes comme à la fin du monde, comme sur les bords de la mer battus par les vagues furieuses du
schisme et de la dissension». Au dire encore des contemporains, la personne des ecclésiastiques n'était pas plus respec-
tée que la sainteté des autels et le bien des églises. «Plus d'une fois, observe M. Rocquain, on lit dans les chroniques
que les évêques sont attaqués sur les chemins et dépouillés, tandis que d'autres sont blessés ou tués au pied d'un autel».
Les actes de déprédation commis au détriment des églises ou des monastères étaient des plus fréquents. Ce
n'étaient pas seulement les seigneurs féodaux qui convoitaient les richesses et les vastes possessions du clergé. Il y
avait telle ville d'Italie où à la mort de l'évêque, on voyait les habitants faire irruption dans la demeure épiscopale, s'y em-
parer de tout ce qui avait appartenu au prélat décédé, et se jetant ensuite «comme des bêtes fauves» sur les terres atte-
nantes à cette demeure, couper les vignes, les arbres et incendier les bâtiments (Leo IX ad Auximanos. Mansi Concil.
XIX, 672).
Mais que l'on ne l'oublie point. Tous ces scandales ne sont point l'ouvrage de l'Eglise qui en gémissait, qui les repous-
sait. Les assemblées provinciales du clergé, les conciles généraux avaient essayé maintes fois de porter remède à ces
maux. Nous ne saurions donc le répéter assez. C'est à la puissance séculière, c'est au laïcisme qu'il faut attribuer les
abus dont l'Eglise se mourait presque. S'il y eut de mauvais papes, de mauvais évêques, de mauvais prêtres, c'est le
monde qui les avait faits. Et si le monde était lui-même corrompu, cette corruption était son œuvre, la conséquence de
ses brutales passions. Dans le déchaînement de ses violentes convoitises, la société féodale avait franchi malgré elle les
limites qui séparent le divin de l'humain et violé l'inviolable domaine de la conscience et des croyances. Elle avait ainsi
défiguré cette Eglise où elle avait jeté tous ses vices et toutes ses habitudes criminelles.
* * *
Au milieu du dévergondage et de l'égarement universel subsistaient cependant des éléments de vie et de salut qui
préparaient la régénération de l'Eglise et du monde chrétien. Ni la violence ni l'excès des passions brutales n'avaient
réussi à ébranler dans les âmes les puissantes assises où la foi avait édifié son empire. L'idée religieuse paraissait, au
contraire, s'être ravivée par l'excès des maux qui pesaient sur la société. Jamais les pèlerinages aux tombeaux des
saints n'avaient été aussi fréquents, et comme si l'on eût voulu se rapprocher des sources de la religion, des hommes de
toute condition et des femmes mêmes se rendaient, à travers mille périls, jusqu'à Jérusalem (Rad. Glaber, III, 6, 7 ; VI, 6).
Si le clergé séculier semblait avoir perdu toute retenue, et si sa licence ne laissait aux réformateurs comme Gerbert,
Fulbert de Chartres, Gérard de Cambrai qui essayèrent vainement de la réprimer, aucun espoir de relèvement, le clergé
régulier offrait du moins au monde un idéal et des vertus bien faites pour provoquer de soudains retours. Ce n'est pas
que le cloître fût resté pur de toutes les souillures qui avaient atteint l'Eglise séculière ; les abbés étaient engagés comme
les évêques dans les lacs des droits et des devoirs de suzerain et de vassal, et comme l'évêché, l'abbaye fut à chaque
vacance l'occasion et l'objet d'un déchaînement de convoitises. Mais les scandales qui affligeaient l'Eglise séculière ne fi-
rent que traverser le cloître et à partir du Xe siècle, une véritable renaissance monastique s'opéra sous l'impulsion fé-
conde du glorieux ordre de Cluny qui devait être le principal propagateur des idées de réforme.
Fondé en 910 par les soins de Guillaume le Pieux, comte d'Auvergne et duc d'Anjou, dans une contrée que les inva-
sions normandes et hongroises avaient respectée et où une sécurité relative avait favorisé le maintien de la foi et des
mœurs, le monastère de Cluny avait rapidement grandi. Des privilèges l'exemptaient de toute juridiction ecclésiastique, à
l'exception de la juridiction papale, et sous ses abbés, Bernon, Odon, Aimar, Mayeul, la ferveur d'un établissement nou-
veau se mêlant à l'austérité de l'ancienne règle de saint Benoît, on ne vit dans Cluny aucune trace de la licence com-
mune à beaucoup de monastères au Xe siècle ; la prière, le travail des mains et la lecture y étaient si continus que
dans les plus longs jours de l'été, à peine les frères avaient-ils une demi-heure de repos et de libre entretien. La réforme
monastique clunisienne venait à son heure ; c'était moins une réforme qu'un nouvel élan de vertu. Vingt-cinq ans après
la fondation de Cluny, dix-sept couvents s'étaient engagés à observer les usages du nouveau monastère qui devint ainsi
une maison mère et chef d'ordre ; la tige bénédictine un moment desséchée retrouva sa sève et sa vigueur. La position
géographique de Cluny favorisait le rayonnement de son influence en Allemagne et en Italie, non moins qu'en France ; à
cette époque surtout où les nationalités étaient indécises, le cosmopolitisme chrétien abaissait les barrières de peuple à

5
peuple. Cluny devait encore une bonne part de son autorité à la hiérarchie exacte qu'il maintenait entre les monastères
qui avaient été fondés sous ses auspices ou qui s'inspiraient de son esprit. Il exerçait sur eux une action directe et réelle ;
par là ses principes et ses exemples se répandaient et portaient des fruits.
Ainsi un mouvement réformateur avait commencé à se concentrer dans le monachisme. Cluny n'avait point borné son
effort à faire observer la règle, à rendre les mœurs plus pures, à proscrire jusqu'à la pensée du vice. Ce grand
corps s'était attaqué aux causes mêmes du mal, à l'investiture, au laïcisme. Avec le rétablissement de la règle béné-
dictine, c'est par la suppression des abbés laïques, l'union étroite au Saint-Siège et l'exemption de la juridiction épisco-
pale qu'il avait opéré sa réforme, préparant ainsi celle de l'Eglise tout entière. «L'aube d'un jour nouveau commençait à
poindre»1.
Si abaissée que fût la papauté, elle était encore capable d'exercer sur le clergé et sur le monde une action efficace.
On méprisait les papes, on respectait la papauté. On se rappelait des princes s'humiliant devant le Saint-Siège et
d'autres lui demandant la consécration de leur pouvoir. C'était un pape, Léon III, qui, posant le diadème sur le front de
Charlemagne, avait rétabli en sa personne l'Empire romain d'Occident ; et quand la race de celui-ci fut éteinte, c'était un
autre pape, Jean XII, qui, appelant Othon Ier en Italie, avait relevé une seconde fois l'Empire et transmis aux souverains
de Germanie le sceptre des carolingiens. C'étaient par les souvenirs de cette grandeur passée que se maintenait le pres-
tige de la papauté déchue. Le rôle de la papauté dans l'Eglise n'offrait pas de moindres témoignages de grandeur. On
n'avait pas oublié un Nicolas Ier se constituant le juge des évêques en même temps que l'arbitre des rois, érigeant la
chaire apostolique en un tribunal suprême et proclamant pour les simples clercs comme pour tous les fidèles le droit d'in-
voquer sa justice. Aussi par le respect qu'obtenait encore la papauté au milieu de son abaissement on pouvait juger de
ce qu'elle était capable d'accomplir si elle s'engageait dans la voie où l'appelaient les hommes de foi (Cf. Rocquain : La
cour de Rome. - La papauté au Moyen Age).
Tous ces éléments de vertu, de piété et de grandeur morale qui se développaient ou se maintenaient depuis un
siècle, dans une société où tout était combat, brutalité et désordre, attestaient que Dieu n'avait point abandonné Son
Eglise. Le salut était proche, mais à dire vrai il ne pouvait dépasser la sphère des résultats partiels que s'il venait de
Rome. La papauté seule avait l'autorité nécessaire pour unir et pour accroître les efforts entrepris par les monastères en
vue d'une régénération de l'Eglise. «Si Rome ne revient pas dans la voie des améliorations, écrira plus tard saint Pierre
Damien, le monde restera abîmé dans l'erreur, il faut que la réforme parte de Rome comme de la pierre angulaire du
salut des hommes» (Ep. II, 29, Migne, t. 144). En d'autres termes, pour arrêter la corruption de l'Eglise féodale et
l’asservissement des vicaires du Christ il fallait et l'on peut dire qu'il suffisait qu'une union se fît entre l'esprit des monas-
tères et le prestige de la papauté. La régénération de l'Eglise était à cette condition. Or Dieu voulut que ces deux forces
séparées, la sainteté des monastères et la sainteté de la papauté se trouvèrent un jour confondues sous la main d'un
homme de génie. Nous avons nommé Hildebrand, le futur Grégoire VII.
CHAPITRE II : LA VOCATION ET LES IDÉES DE GRÉGOIRE VII.
L'homme qui devait personnifier l'Eglise dans sa régénération était né vers 1020 à Soana, petite ville, fiévreuse, triste
et froide, de la Toscane. Dieu avait choisi le réformateur de son Eglise dans la boutique d'un artisan et jamais on ne pou-
vait dire avec plus de vérité : Infirma elegit Deus ut confundat fortia. Si l'on ajoute que, dès ses premières années, Hilde-
brand entra au couvent, il sera intéressant de noter l'origine plébéienne et monastique de ce puissant réformateur.
De bonne heure, en effet, il vécut à Rome, dans le monastère de Sainte-Marie au mont Aventin, dont son oncle était ab-
bé. «Celui-ci sera grand devant le Seigneur», avait dit l'abbé d'Hildebrand encore enfant. A cette époque, dans toute la
chrétienté et surtout dans les cloîtres, on parlait de la nécessité de rétablir l'ordre et la discipline ecclésiastique. Les
idées de rénovation religieuse ne pouvaient manquer d'impressionner fortement l'âme ardente du jeune Hildebrand.
D'autres circonstances le préparèrent encore plus directement au grand rôle que Dieu destinait à son âge mûr.
Il avait assisté à l'avènement de Grégoire VI, son ancien maître, qui avait acheté le pontificat, mais qui voulait s'en
servir pour accomplir des réformes ; il avait assisté aussi à sa déposition, quand, au synode de Sutri (1046), Grégoire re-
connut humblement sa faute : «Moi, Grégoire, serviteur des serviteurs de Dieu, je me confesse indigne du pontificat ro-
main à cause de la honteuse simonie et de la vénalité qui, par la perfidie du démon, l'antique ennemi des hommes, s'est
glissée dans mon élection au Saint-Siège». Hildebrand avait eu ainsi sous les yeux le spectacle de la déchéance où la
simonie et le laïcisme avaient réduit l'Eglise. Dès ce jour il s'était attaché à la pensée de travailler à la régénération du
monde chrétien. A la suite de ces événements il avait quitté Rome pour entrer à Cluny. Il devait y trouver la véritable pa-
trie de son âme.
Cluny ne représentait pas seulement la restauration de la discipline, le retour aux maximes de saint Benoît, c'était en-
core une école de mysticisme. L'éducation qu'on y recevait dans ses couvents tendait moins à former des lettrés que
des apôtres. La culture littéraire, le goût des choses de l'esprit, la délicatesse furent des qualités qui lui restèrent incon-
nues. La biographie de saint Mayeul raconte que ce saint faisait brûler tous les manuscrits des anciens (Cf. Pfister,
Etudes sur le règne de Robert le Pieux, p. 3 et seq). A Cluny, aucun livre païen n'était enseigné aux moines ; à Saint-
Riquier, il n'y avait que des ouvrages de piété dans la bibliothèque. Une telle culture était peu faite pour assouplir l'esprit
aux compromis, aux mœurs de la vie mondaine. Le mysticisme lui donna toujours une certaine raideur. Mais cela même
est une condition de force pour ceux qui agissent. Nourris des Pères, des lettres sacrées, ces moines sont préparés, par
1 L'esprit nouveau soufflait, d'ailleurs, d'autre part. Il y eut des influences autres que celle de Cluny mais qui travaillèrent dans le même
sens sur l'Eglise séculière. Les ermites italiens firent de leurs solitudes austères le refuge des âmes pures qui fuyaient l'Eglise trop
laïque. Ils furent «les citoyens du Ciel». Tels étaient ce Nil de Rossano dont l'Eglise a fait un saint, qui prêcha et organisa le détache-
ment du monde, Romuald de Ravennes qui fonda le fameux monastère de Vallombrosa, son disciple saint Pierre Damien, le plus
éloquent porte-parole de la réforme de l'Eglise séculière, l'homme qui devait en être le prophète.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
1
/
16
100%