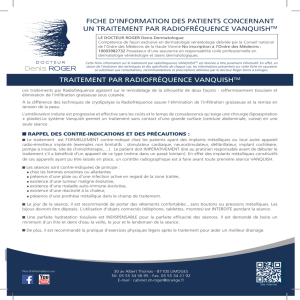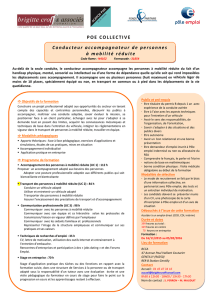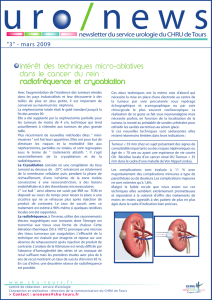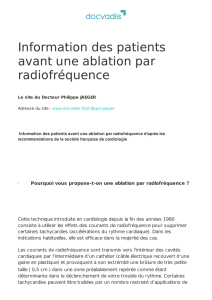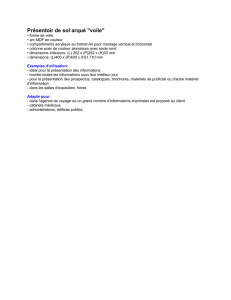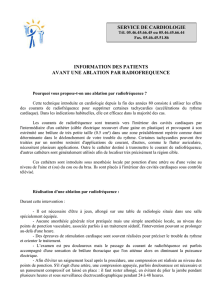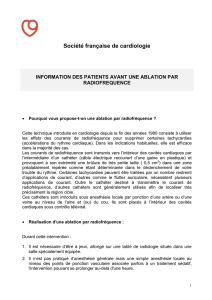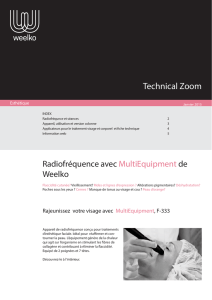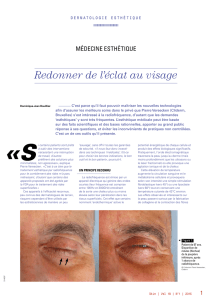du d - Elsan

Clini
q
ues Info
du Grand Nanc
y
li
Cli
Cli
du
d
u
n
q
q
q
u
q
ni
ni
G
an
q
q
q
Gr
rand Nanc
q
u
es
ues
d
d Na
nd
I
I
Jan
nfo
Inf
a
y
anc
c
y
Janvier 2009
o
o
y
Janvier 2009
Clinique
Clinique Saint-Jean/Clinique Saint-Don
C q
du
d
e Sain
Clinique Saint-Jean/Clinique Saint-Don
é/Polyclinique de Gentilly/Clinique Ambr
aint-Andr
G
an
Gr
rand Nanc
lly/Clinique Ambr
Clinique Saint-Jean/Clinique Saint-Don
que de Gentilly/Clinique Ambr
d Na
nd
e A
éoise Par
e Ambr
a
y
anc
c
y
y
et 900 places
8
et 900 places
8
Juin 2013
Sommaire À LA UNE - CLINIQUE AMBROISE PARÉ
Une prothèse high tech pour le traitement
des anévrismes de l’aorte.
Première chirurgicale pour le groupe
de cliniques privées VITALIA.
Le développement des techniques endo-vasculaires
(navigation à travers les vaisseaux et traitement de
leurs lésions à distance sous rayons X) a modifié
considérablement le traitement des anévrismes de
l’aorte et en particulier de l’aorte abdominale. Ces
anévrismes ou dilatations pathologiques de l’aorte
(artère principale naissant du cœur et traversant le
thorax et l’abdomen) évoluent inéluctablement en
l’absence de traitement, vers la rupture et la mort
par hémorragie interne.
Depuis un peu plus de 15 ans, le traitement endo-
vasculaire des anévrismes de l’aorte (exclusion de
l’anévrisme par l’intérieur de l’artère à l’aide d’une
prothèse auto expansive introduite par l’artère fémorale
après incision au pli de l’aine) peut se substituer
dans 30 à 50% des cas au traitement chirurgical
classique (ouverture de l’abdomen et remplacement
par une prothèse que l’on coud). Cependant, certains
anévrismes de l’aorte remontent jusqu’à la naissance
des artères rénales et digestives, au niveau de la
jonction abdomen-thorax impliquant une chirurgie
lourde et agressive avec ouverture de l’abdomen et
du thorax pour remplacer l’aorte malade et réimplanter
les artères du rein, de l’intestin et du foie. De plus, il
s’agit souvent de malades âgés, souffrant de patho-
logies associées respiratoires et cardiaques, dont le
risque opératoire est élevé.
Depuis peu, une nouvelle génération de prothèses
dites fenêtrées avec des ouvertures en regard des
artères digestives et rénales permettent de traiter
ces anévrismes complexes par voie endo-vasculaires
après simple abord au niveau de l’aine et du bras.
Ces prothèses sont confectionnées sur mesure à
partir de logiciels informatiques sophistiqués traitant
les données de l’examen scannographique préopé-
ratoire, un délai de 10 à 12 semaines étant nécessaire
pour la planification de l’intervention. Un test sur
modèle plastique de l’anévrisme est réalisé en
salle d’opération afin de confirmer la technique
et valider la fabrication.
Ces prothèses dites fenêtrées étaient jusqu’à présent
réservés à quelques centres hospitaliers universitaires,
dit experts, en raison de leur non remboursement et
de la nécessité d’êtres évaluées cliniquement. De
plus ces centres doivent êtres équipés de salles
d’opérations radio
chirurgicales très
spécialisées et coû-
teuses dont dispose
la clinique Ambroise
Paré de Nancy du
groupe Vitalia depuis
2007.
Ainsi le professeur
Pascal Bour, chirur-
gien vasculaire nancéen a réalisé avec succès sous
anesthésie locorégionale la pose d’une prothèse
fenêtrée pour cure d’un anévrisme complexe de
l’aorte le 25 janvier à la clinique Ambroise Paré, en
coopération avec une des deux seules sociétés
à fabriquer et à commercialiser en France ces
prothèses fenêtrées sur mesure.
Cette procédure, qui doit être effectuée chez des
malades sélectionnés sur des critères d’inclusion
rigoureux, permet de raccourcir de moitié le temps
d’hospitalisation et de diminuer significativement le
risque opératoire.
Il s’agit de la première prothèse fenêtrée de ce
niveau technologique implantée avec succès en
France dans le secteur privé, ce qui donne à la cli-
nique Ambroise Paré sous l’égide du professeur
Bour, la qualification de centre expert, en raison de
sa grande expérience des techniques endo-vasculaires
et de son équipement radio-chirurgical de pointe.
■Pr Pascal BOUR
Une prothèse high tech pour
le traitement des anévrismes
de l’aorte.
Première chirurgicale pour le
groupe de cliniques privées
VITALIA
Clinique Ambroise Paré.........1
Le développement durable:
une notion intégrée à la
Clinique Saint André .............2
Traitement des tumeurs
hépatiques par
radiofréquence
Polyclinique de Gentilly..........3
Le suivi médical après
traitement endoscopique
pour HBP
Polyclinique de Gentilly..........4
Traitement du ronflement
par radiofréquence
Clinique Saint André ......5 et 6
La radiothérapie
stéréotaxique: une technique
innovante – Centre
d’Oncologie de Gentilly..........6
Brèves......................................6

Social
Conditions de travail,
droits fondamentaux,
compétences
Économie
Efficacité,
rentabilité
Environnement
Consommation,
émissions,
déchets
Performance globale de l’organisation
Gouvernance
(Gestion, administration, contrôle)
CLINIQUE SAINT-ANDRÉ
Le développement durable: une notion
intégrée à la Clinique Saint André
Qu’est ce que le développement durable?
C’est «un déve-
loppement qui
répond aux
besoins des
générations
du présent, à
commencer par
les plus démunis,
sans compromettre la
capacité des généra-
tions futures à
répondre
aux leurs».
Le développement durable s’appuie sur 3 piliers:
q
Un volet SOCIAL
q
Un volet ÉCONOMIQUE
q
Un volet ENVIRONNEMENTAL
La combinaison de ces 3 piliers constitue un
développement durable pour nos activités.
Comment intégrer la notion de développement
durable dans un établissement de santé?
Il faut intégrer la notion de développement durable
dans la stratégie de l’établissement, en incluant
les préoccupations économiques, sociales et
environnementales à moyen et long termes.
L’objectif étant d’atteindre un niveau de performance
globale de l’organisation.
Comment décliner ces trois piliers ?
Quelle organisation adoptée?
La prise en compte du développement durable
dans les organismes (publics et privés) a entrainé
de multiples initiatives. C’est dans ce contexte
que la notion de Responsabilité Sociétale de
l’Entreprise (RSE) a vu le jour.
C’est une démarche volontaire des entreprises à
intégrer les préoccupations sociales et environne-
mentales à leurs activités commerciales et relations
avec leurs parties prenantes (exemples : les sous
traitants, le Groupe VITALIA, les patients,…).
Cette notion de RSE est reconnue au travers
d’une norme ISO reprenant les lignes directrices
pour la responsabilité sociétale.
Il s’agit de la norme ISO 26000.
Les 7 grands principes de la Responsabilité Sociétale de l’Entreprise (RSE)
Les 7 questions centrales
2 étapes
de cadrages
Identifier et déterminer
la démarche RSE de l’entreprise
Identifier et dialoguer
avec les parties prenantes
Rendre
compte Transparence Comportement
éthique
Parties
prenantes
Réglementation
Normes
internationales
Droits de
l’homme
Droits de
l’homme
Relations
et conditions
de travail
Environnement Ethique
des affaires
Respect du
consommateur
Gouvernance Solidarité
Elle repose sur 7 grands principesqui sont ensuite déclinés en 7 questions centrales :
Concrètement, quelles sont les actions à entreprendre pour favoriser le Développement
Durable à l’échelle de la Clinique Saint André? À quels niveaux pouvons-nous agir?
Aujourd’hui, la clinique Saint André mène des démarches en faveur du Développement Durable, parfois
même sans le savoir. Notamment à travers le référentiel HAS v.2010 de certification, dans lequel figure
un certain nombre de critères impliquant la notion de Développement Durable.
1b : Engagement dans le développement durable
3d : Qualité de vie au travail
6f : Achats éco-responsables et approvisionnements
7a : Gestion de l’eau
7b : Gestion de l’air
7c : Gestion de l’énergie
7d : Hygiène des locaux
7e : Gestion des déchets
Voici quelques exemples d’actions concrètes mises en place à la Clinique:
q
mise en place d’une enquête «Bien être au travail» réalisée en 2010 par la médecine du travail;
q
démarche de gestion et de maîtrise de la collecte des déchets;
q
sensibilisation aux éco-gestes (autocollants dispatchés dans les lieux stratégiques de la clinique).
Exemple dans les toilettes, un autocollant stipulant «Ne gaspiller pas l’eau, svp» est collé à
proximité du robinet, ou encore un autocollant «Eteignez-moi en sortant, svp» à proximité de
l’interrupteur dédié à l’éclairage ;
q
réalisation d’un audit énergétique et du bilan carbone par une société spécialisée (en Mai 2013) ;
q
mise en place d’une politique de gestion des énergies, avec un suivi régulier des consommations
énergétiques;
q
développer la communication autour du développement durable (exemple: article dans le journal
interne.
8 critères de l’HAS ayant
une interaction avec les
grands principes de la
Responsabilité Sociétale
de l’Entreprise.
Liens entre HAS et ISO 26000
Engagement
DD
Qualité de vie
au travail
Achats
éco-resp.
Gestion
de l’eau
Gestion
de l’air
Gestion
de l’énergie
Hygiène
des locaux
Gestion
des déchets
Gouvernance
Relations et
conditions de travail
Droits de l’homme
Environnement
Loyauté des pratiques
Questions relatives
au consommateur
Solidarité/Communauté
Économie Social
Environnement
Équitable
DURABLE
Viable Vivable
2

En cas de volumétrie insuffisante, une embolisation
portale pré opératoire du lobe métastatique (à
droite le plus souvent) est donc nécessaire de
manière à développer le lobe «sain» contro latéral.
Il arrive que le lobe à conserver présente également
des foyers métastatiques; dans ce cas, l’emboli-
sation sera couplée à de la radiofréquence, per-
mettant ainsi d’augmenter les indications opératoires
et les chances de résection complète (R0).
En termes de récidive locale et de survie, les hé-
patectomies restent la référence et présentent de
meilleurs résultats que la RF. Toutefois les données
de la littérature sont plus mitigées concernant la
RF versus les tumorectomies.
■A visée palliative
Lorsque le nombre, la topographie, la taille ou
l’état général du patient ne permettent pas de
résection chirurgicale, une RF per cutanée peut
être proposée. Il est dorénavant connu que la
survie des patients bénéficiant d’une chimiothéra-
pie+RF et supérieure à la chimiothérapie seule.
■Autres applications
La RF peut être proposée dans le traitement des
tumeurs de Grawitz de moins de 3 cm et dans
certain cas de métastases pulmonaires.
Notre générateur nous permet également d’utiliser
des électrodes bipolaires de Habib® qui apportent
une excellent coagulation sur une bande de 1cm
de large et permettent donc une section paren-
chymateuse exsangue. Cette application offre
des possibilités de résection chirurgicale par voie
cœlioscopique (fig 4).
■Conclusion
La résection chirurgicale reste actuellement le
«gold standard» même si les résultats de la RF à
3 ans sont identiques si les indications sont res-
pectées. La RF n’a donc pas vocation à remplacer
la chirurgie mais fait désormais partie de l’arsenal
thérapeutique des tumeurs malignes du foie.
Comme tous les autres traitements oncologiques,
l’indication d’une RF seule ou en association avec
une chimiothérapie systémique ou intra-artérielle
doit être validée en réunion pluridisciplinaire.
■Dr Anthony ROUERS
Chirurgie viscérale et digestive
Polyclinique de Gentilly
POLYCLINIQUE DE GENTILLY
Traitement des tumeurs hépatiques
par radiofréquence
La radiofréquence (RF) hépatique est une technique
de destruction locale des tumeurs hépatiques.
Son utilisation peut s’envisager par voie per cutanée
ou en per opératoire. Son générateur délivre un
courant sinusoïdal d’une fréquence de 400-500
KHz qui mobilise les ions contenus
dans les tissus traités: leur agitation
est responsable d’une friction
des particules entre elles, pro-
voquant un échauffement et
une nécrose de la lésion tu-
morale. Cette énergie est déli-
vrée par une aiguille dont seule
son extrémité (unique ou en pa-
rapluie) est active (Fig 1). Elle est
placée au centre de la tumeur sous
contrôle radiologique (TDM, échographie standard
ou per opératoire) et délivre ainsi une température
supérieure à 60°C responsable d’une nécrose cel-
lulaire, pendant un temps moyen de 8 à 15 minutes
(Fig 2). Cette zone de nécrose varie en fonction du
type et du nombre d’aiguilles utilisées, du temps
d’application et de l’intensité du générateur. Le
contrôle de la procédure se fait en surveillant la
température de l’électrode et l’impédance tissulaire.
Les facteurs limitant sont:
q
la proximité de la tumeur des gros vaisseaux
(porte, veines sus hépatiques) car ces derniers
refroidissent les tissus traités et réduisent ainsi
l’efficacité. Dans ce cas de figure, la RF per
opératoire sera préférée avec des techniques
de clampage pédiculaire synchrone ;
q
des températures supérieures à 100°C car il existe
un risque de carbonisation de l’électrode. Les
dispositifs récents sont munis d’un système de
perfusion de l’aiguille pour limiter ce phénomène ;
q
la proximité avec les axes biliaires centraux qui
expose à une sténose ;
q
les lésions sous capsulaires qui exposent au
risque d’ensemencement sur le trajet de ponction.
Dans ce cas de figure, la RF coelio assistée
sera préférée.
Les aiguilles actuelles peuvent se déployer jusqu’à
5 cm et donc détruire des lésions de 4 cm avec
0,5 cm de marge.
RF et CHC
La particularité des hépatocarcinomes est la pré-
sence de cellules néoplasiques satellites autour
de la lésion, surtout si le CHC mesure plus de 3
cm. La résection chirurgicale parait donc être la
référence dans un but curatif car elle apporte les
meilleures marges de sécurité. Toutefois la chirurgie
est grevée d’une morbi-mortalité très nettement
supérieure à la RF, surtout dans un contexte de
cirrhose ou de tumeur centrale. La RF est donc
une alternative intéressante chez les patients
fragiles ou en attente de greffe hépatique.
Les indications de la RF sont les patients CHILD
A-B, les lésions au nombre de 2 maximum dont
le diamètre n’excède pas 3 cm, les lésions centro-
hépatiques.
Les contre-indications sont les CHILD C, la pré-
sence d’ascite et la dilatation des voies biliaires
intra hépatiques.
RF et métastases hépatiques
La résection chirurgicale des métastases hépatiques
est le seul traitement à visée curative lorsqu’elle
permet une résection complète des lésions (R0).
La survie à 5 ans des patients non accessibles au
traitement chirurgical de leur métastase hépatique
est de 0%! Toutefois, seulement 15% des patients
métastatiques sont opérables d’emblée, soit parce
que le caractère diffus des lésions ne laisse pas
entrevoir de résection complète, soit parce que
la volumétrie du «foie restant» est insuffisante
pour éviter une insuffisance hépato-cellulaire post
opératoire.
■À visée curative
La radiofréquence apparait ici comme un outil de
destruction local épargnant le parenchyme sain.
Elle permet, lorsque le nombre et la taille l’autorisent,
de «stériliser» un lobe hépatique quand une hé-
patectomie majeure controlatérale est envisagée
(Fig 3). C’est également le traitement de choix
des récidives métastatiques après hépatectomie.
Lorsqu’une hépatectomie majeure est envisagée,
une volumétrie hépatique du foie restant et une
clairance au vert d’indocyanine sont réalisées.
Lorsque la clairance ne retrouve aucun trouble de
la fonction hépatique, on considère que la volu -
métrie du foie restant mesurée à au moins 25%
du foie total permet d’éviter une insuffisance
hépato-cellulaire post opératoire. Lorsque la clai-
rance est perturbée ou que le patient a déjà des
antécédents de chimiothérapie, la volumétrie doit
être chiffrée à au moins 35%.
Fig 1 : aiguille
déployable
Fig 2 : traitement per cutané écho-guidé d’une
métastase hépatique
Fig 3 : traitement per opératoire de métastases
hépatiques du lobe gauche avant embolisation
portale droite
Fig4 : peigne de Habib®
3

Ce numéro de Cliniques info a été
imprimé à 2 200 exemplaires.
201306
Imprimé en France par Colin Frères Imprimeurs sur papier , contribuant à la gestion durable des forêts.
POLYCLINIQUE DE GENTILLY
La chirurgie bariatrique
en plein essor
17% de la population lorraine est concernée
par l’obésité (contre 10 % en 1997), une
progression considérable.
Si le plan Obésité 2010/2013 a labellisé
deux centres experts en Lorraine, le privé
n’est pas en reste. Le Docteur Anthony
Rouers, chirurgien bariatrique à la Polyclinique
de Gentilly effectue à lui seul plus de 200
procédures par an (Bypass, sleeve…) ce
qui le place en terme d’activité à un niveau
sensiblement comparable au CHU de
Brabois.
Le Dr Rouers a par ailleurs crée une structure
pluridisciplinaire IMCLO (Institut Médico
Chirurgical Lorrain de l’Obésité) qui regroupe
10 praticiens (nutritionnistes-diététiciens,
psychiatres, gastro-entérologues, cardio-
logues, pneumologues et anesthésistes
autour de sa spécialité, la chirurgie baria-
trique), une structure plus qu’innovante
puisqu’elle est la première à disposer d’un
dossier patient informatique sécurisé consul-
table on-line par les différents intervenants
de la prise en charge de l’obésité.
Ce logiciel est le 1er à être développé
en France par INFODEV, le site pilote utilisé
par l’IMCLO est voué à être développé
ensuite dans tous les centres spécialisés.
Pour plus de renseignements:
www.docteur-rouers-obesite.fr
CLINIQUE SAINT ANDRÉ
Polysomnologie
Depuis le 1er juin, une nouvelle spécialité
à la clinique St André : la polysomnologie.
Les Docteurs Ponçot-Mongars et Maadi
prennent en charge les patients dans le
cadre des troubles du sommeil.
CENTRE D’ONCOLOGIE DE GENTILLY
La radiothérapie stéréotaxique:
une technique innovante
C’est à Berkeley en Californie, à partir de 1954, que les premières
radiochirurgies, avec des particules lourdes chargées, ont été réa -
lisées. Parallèlement, la chirurgie en conditions stéréotaxique, s’est
développée en Angleterre, en France et aux Etats-Unis.
■Les avantages :
pas ou peu de douleurs postopératoires, saignements
rares, possibilité de recommencer le geste plusieurs
années après en cas de récidive.
■Complications :
qfréquemment un œdème peut apparaître dans le
voile et la luette dans les 24 à 72 heures qui suivent
le traitement par radiofréquence du palais mou ;
qhabituellement une hyperhémie (rougeur) du palais
peut être observée 4 à 6 jours après l'intervention ;
qun blanchiment peut apparaître autour des
points
de radiofréquence et s'atténuera 2 semaines après
l'intervention ;
qpetite ulcération, perforation, nécrose localisée et
couverture de fibrine (de couleur jaune) sont tout à
fait communes après le traitement et se referment
généralement en quelques semaines.
■En préoperatoire :
Il est impératif d'éviter toute prise d'aspirine ou
d'anticoagulants dans les jours avant le traitement
pour éviter des hématomes ou saignements.
■En postopératoire :
Les fumeurs doivent arrêter pendant quelques jours
de fumer. L'alimentation doit être légère, ni trop chaude
ni trop froide.
Le patient peut avoir également quelques difficultés
pour parler dans les heures qui suivent en raison
de l'œdème ainsi qu’une dysphagie. Un traitement
antalgique et anti-inflammatoire est prescrit.
Conclusion
Le ronflement est un phénomène complexe dont les
causes peuvent être multiples et dont le traitement
doit être progressif : traitement hygiéno-diététique,
traitement de la perméabilité nasale, traitement de la
laxité du voile. En cas d’échec de ces traitements, et
en cas d’insuffisance d’ouverture de l’espace basi
retro lingual, les orthèses d’avancée mandibulaire sont
alors proposées.
Elles permettent de libérer le passage de l’air au
niveau du pharynx, n’entraînant plus la vibration des
tissus pharyngés.
Ces travaux ont été conjugués pour déve-
lopper diverses techniques de traitement en
conditions stéréotaxiques. Plus tard elles
devaient aboutir à une nouvelle technique
de radiothérapie externe, la radiochirurgie.
C’est au début des années 1980 que les
premières techniques de radiochirurgie uti-
lisant un accélérateur linéaires ont été mises
au point. Les années 2000 ont vu l’avènement
de machines dédiées.
La radiothérapie stéréotaxique est une tech-
nique de haute précision utilisant de multiples
mini-faisceaux convergents pour délivrer
sélectivement une très forte dose dans un
petit volume cible en respectant autant que
possible les tissus situés à proximité immé-
diate afin qu’ils ne reçoivent qu’une dose
quasi négligeable.
La précision est millimétrique, ce qui suppose
une immobilisation rigoureuse du crâne, un
repérage par imagerie tridimensionnelle et
une planification dosimétrique avec un logiciel
spécialisé.
L’immobilisation est assurée par un masque
thermoformé et la position est ajustée en
s’aidant du système Exact Trac avec une
table à six degrés de liberté et un système
d’imagerie embarquée.
Actuellement, deux orientations opposées
se dessinent: d’une part, développer des
machines dédiées à la radiothérapie en
conditions stéréotaxiques et d’autre part,
améliorer les performances des accélé -
rateurs haut de gamme pour leur permettre
de réaliser dans de bonnes conditions ces
irradiations.
Au centre d’Oncologie de Gentilly, nous
utilisons un collimateur micromultilame mis
en place sur l’accélérateur, il ne s’agit pas
d’un appareil dédié.
Nous avons commencé à utiliser cette tech-
nique innovante en début d’année, dans un
premier temps pour les métastases cérébrales
uniquement. Le traitement est réalisé, le
plus souvent, en 3 à 4 séances sur environ
1 semaine.
Trois irradiations stéréotaxiques ont déjà été
réalisées avec une excellente tolérance et
un très bon résultat clinique et IRM à 1
mois et 3 mois.
■Dr Isabelle MARQUIS
Suite de la page 5
Brèves

■
Le traitement endoscopique de l’hyper-
trophie bénigne de la prostate (HBP) peut
être réalisé par différentes techniques
chirurgicales :
q
La résection endoscopique de la prostate
(RTUP), la plus ancienne et la plus fréquemment
pratiquée. Elle réalise une désobstruction
prostatique par ablation de copeaux au niveau
de l’adénome. Le résecteur utilise un courant
électrique de section et de coagulation du tissu
prostatique.
q
La vaporisation prostatique, qui détruit le tissu
prostatique par effet thermique et coagulant à
l’aide d’un résecteur bipolaire ou d’un laser.
Il existe plusieurs types de lasers avec des ap-
plications physiques différentes, en particulier
– le laser «greenlight», disponible à la Polyclinique
de Gentilly depuis 2012 et permettant une
photovaporisation laser (PVP) – et l’énucléation
laser Holmium (holep) avec retrait du tissu
prostatique près morcellation.
q
L’incision cervico-prostatique, qui peut être
considérée comme une résection «à minima»,
indiquée davantage pour la maladie du col
vésical ou la prostate de petit volume.
q
La thermothérapie entraînant une nécrose de
coagulation par élévation locale de température
intra-prostatique :
- la thermothérapie par radiofréquence, ou TUNA
(Transuretral needle ablation), est une technique
de traitement à haute énergie. Un courant de
radiofréquence monopolaire entraîne une
nécrose de coagulation par chauffage. Les
électrodes sont introduites dans la zone
prostatique à traiter sous contrôle endoscopique
trans-urétral,
- les micro-ondes trans-urétrales (TMTU) sont
très peu pratiquées.
Toutes ces techniques ont des effets secondaires
variés et peuvent être suivies de complications
amenant le patient à solliciter son médecin
généraliste après son retour à domicile.
■
Effets secondaires fréquents, dont le patient
a été prévenu:
q
Les brûlures mictionnelles sont très fréquentes
quelle que soit la technique utilisée et elles
peuvent persister jusqu’à cicatrisation complète
de la loge de résection, qui peut n’être obtenue
qu’après deux à trois mois. Ces urétro-cystalgies
sont liées à l’inflammation de la zone opératoire
et ne sont pas dues à une infection urinaire.
Elles expliquent l’hématurie et la leucocyturie
(sans germes) post opératoires.
q
La pollakiurie et les impériosités mictionnelles,
habituelles aussi dans les premières semaines
post opératoires, sont également d’origine in-
flammatoire, aggravées par la recommandation
d’une diurèse abondante et parfois par une hy-
peractivité vésicale pré-existante ou secondaire.
q
L’hématurie peut se produire pendant les trois
à six semaines suivant l’intervention prostatique.
Elle est en général modérée, mais peut dans
certains cas être abondante avec constitution
d’un caillotage vésical par chute d’escarre,
obligeant à une réhospitalisation.
■
Complications possibles
q
Le caillotage vésical peut entraîner une rétention
aiguë d’urine, obligeant à un décaillotage en
hospitalisation.
q
L’infection urinaire est prévenue par la réa -
lisation systématique d’un ECBU pré-opératoire
et d’une antibio-prophylaxie. L’infection post-
opératoire, pouvant se compliquer d’une épidi-
dymite, peut être liée à un rétrécissement de
l’urètre, à un résidu post mictionnel important
(rétention chronique initiale, vessie neurolo-
gique…); elle est documentée par ECBU.
q
La survenue d’une dysurie, d’aggravation pro-
gressive, fait suspecter une sténose de l’urètre,
rarement une résection incomplète. Le rétré-
cissement est cervical, cicatriciel ou urétral lié
au traumatisme de l’endoscope ou de la sonde
urinaire. Il faut penser à vérifier le méat urétral
et l’urètre balanique.
q
L’incontinence urinaire est le plus souvent une
incontinence par urgenturie, consécutive à
une hyperactivité vésicale, elle-même liée à
l’inflammation vésico-prostatique. Il s’agit
rarement d’une incontinence par insuffisance
sphinctérienne.
q
La dysfonction érectile est très rare après
chirurgie pour HBP. Au contraire l’éjaculation
rétrograde est présente après environ 90%
des RTUP. L’incision cervico-prostatique, quand
elle est possible, permet de limiter cet effet
secondaire sur l’éjaculation.
■
Gestions des complications
q
Le caillotage vésical nécessite une réhospitali-
sation pour décaillotage et lavage par sonde
urinaire à double courant.
q
L’infection urinaire est traitée par une antibio-
thérapie adaptée avec nouveau contrôle post
antibiothérapie.
q
La dysurie justifie d’anticiper la consultation de
contrôle auprès de l’urologue pour réalisation
d’une débitmétrie avec mesure du résidu post
mictionnel (échographie ou bladder scan) et
fibroscopie éventuelle.
q
L’incontinence urinaire par impériosités peut
être soulagée par des antispasmodiques
urinaires (Oxybutinine chloride, Chlorure de
trospium, Solifenacine…) après s’être assuré
que la vidange vésicale est satisfaisante.
L’incontinence urinaire par insuffisance sphincté-
rienne est gérée par l’urologue. L’éjaculation
rétrograde peut être mal comprise, et à l’origine
de troubles de la sexualité. Le fait qu’elle n’empêche
pas d’avoir un rapport sexuel (érection et orgasme
conservés) et qu’elle n’a pas de conséquence
néfaste sur la santé doit être bien expliqué au
patient avant l’intervention.
■
Patients sous traitements anticoagulant
et antiagrégant
q
La résection endoscopique de la prostate est
une intervention à risque hémorragique élevé,
Aspirine et Clopidogrel sont arrêtés au moins
5 jours avant l’intervention et ne sont repris si
possible qu’au moins 10 jours après la résection,
car le risque de chute d’escarre est majeur
durant cette période.
Les AVK arrêtés 3 à 5 jours avant l’intervention
et relayés par HBPM jusqu’à 12 heures avant
l’intervention ne sont repris également que 10
jours au minimum après la résection. Il y a un
compromis parfois difficile à définir entre le
risque hémorragique de l’intervention et le risque
thrombo-embolique (stent actif…).
q
La technique de vaporisation permet en principe
d’opérer les patients sous anti-agrégant ou
avec un arrêt plus limité des anticoagulants.
Chaque cas est discuté entre l’anesthésiste, le
cardiologue et le chirurgien en relation avec le
médecin traitant.
POLYCLINIQUE DE GENTILLY
Le suivi médical après traitement
endoscopique pour HBP
Par Jean Luc Moreau pour le Centre d’urologie de Nancy (urolor.fr)
4
■
Recommandations au patient à son retour
à domicile
Elles sont mentionnées dans les fiches d’in-
formation-patient de l’Association Française
d’Urologie (AFU) sur son site urofrance.
Il est utile de rappeler au patient que les signes
irritatifs urinaires sont habituels, non inquiétants
et qu’ils vont s’amender en quelques semaines.
Les conseils à donner:
q
maintenir une diurèse abondante surtout en
cas d’hématurie persistante ;
q
éviter les efforts importants pendant 4 à 5
semaines ainsi que les longs trajets en voiture,
les marches prolongées, le vélo et le sport afin
de limiter le risque de chute d’escarre ;
q
reprendre progressivement ses activités ;
q
abstinence sexuelle d’au moins un mois ;
q
reprise d’une alimentation normale en s’hydratant
correctement ;
q
éviter la constipation en augmentant éventuel-
lement la consommation de fibres ;
q
bains et douches sont autorisés indifféremment.
Examens de surveillance:
q
l’ECBU de contrôle n’est pas systématique; il
est à demander dans le cas de signes infectieux
patents. La colonisation urinaire, qui s’est pro-
duites sur sonde, est fréquente dans la période
post-opératoire précoce ;
q
la leucocyturie ou l’hématurie microscopique
avec culture négative ne justifie pas d’antibio-
thérapie. Elle est la traduction de la persistance
de phénomènes inflammatoires locaux ;
q
une consultation de contrôle auprès de
l’urologue est souhaitable dans les 2 mois post
opératoires.
 6
6
1
/
6
100%