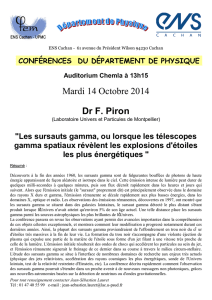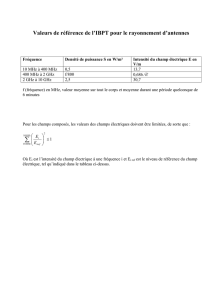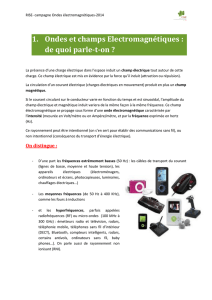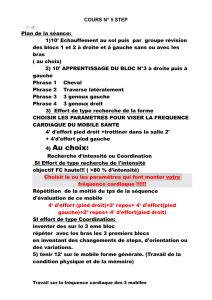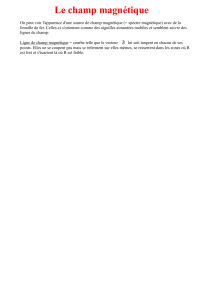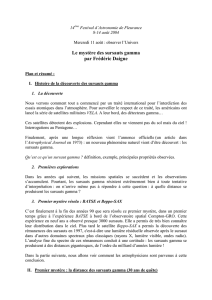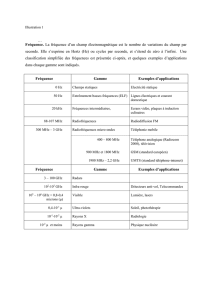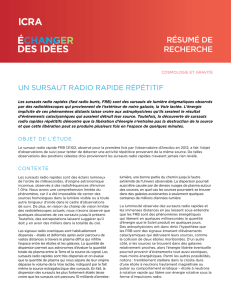Les sursauts " S " de Jupiter

Plasmas
LES SURSAUTS “S”
DE JUPITER
L’analyse automatisée de nouvelles données d’observation numériques à haute résolution temporelle
et spectrale nous permet d’identifier, après trente ans de controverse, le scénario de production
des intenses sursauts radio décamétriques de Jupiter. Dans le cadre du modèle proposé, le
satellite Io joue un rôle crucial comme source d’accélération des populations électroniques à
l’origine de l’émission des sursauts, et plusieurs faits observationnels trouvent une interprétation
plausible. Divers paramètres du plasma magnétosphérique dans les sources peuvent être déduits
des observations radio, qui deviennent un moyen de sondage à distance du magnéto-plasma
jovien. L’application des conclusions tirées pour les sursauts S aux autres émissions radio
planétaires – voire stellaires – est discutée.
INTRODUCTION
C
’est en 1955 qu’a été décou-
verte la première émission
radio planétaire : celle de
Jupiter, sur ondes décamétriques
(fréquences de ≤10 à environ
40 MHz). C’est une émission extra-
ordinairement intense : si elle était
d’origine thermique, la région émet-
trice devrait avoir une température
de 10
18
K ! Ce rayonnement radio
est donc évidemment d’origine non
thermique. Il est polarisé ~ 100 %
elliptiquement. Une dizaine d’an-
nées plus tard, la découverte d’une
émission radio analogue d’origine
terrestre par les satellites soviétiques
Elektron lui a fait perdre son statut
de simple « curiosité ». L’émission
terrestre couvre les longueurs
d’onde kilométriques (fréquences
<1 MHz). Quoiqu’intense, elle
n’est pas détectable du sol car elle
est émise bien au-dessus de l’iono-
sphère terrestre et réfléchie vers
l’espace par cette dernière. Entre
1980 et 1989, les sondes Voyager 1
et 2 ont permis de découvrir les
émissions radio de Saturne, Uranus
et Neptune, et d’étendre jusqu’au
domaine kilométrique le spectre ra-
dio jovien.
Les observations de Voyager ont
montré que les cinq planètes forte-
ment magnétisées du système so-
laire – la Terre et les quatre planètes
géantes – s’entourent d’une bulle
magnétique, ou magnétosphère,
semi-perméable au vent solaire en-
vironnant, où des particules char-
gées sont accélérées à de hautes
énergies (keV, MeV). Les mouve-
ments de ces électrons et de ces
ions sont guidés par les lignes du
champ magnétique planétaire qui les
focalisent au voisinage des pôles
magnétiques où ils produisent d’in-
tenses émissions radio et d’autres
rayonnements électromagnétiques
« auroraux », notamment dans l’in-
frarouge et l’ultraviolet.
Les émissions radio planétaires
apparaissent aujourd’hui comme un
phénomène général, où les mécanis-
mes à l’œuvre sont peut-être simi-
laires à ceux qui engendrent les
rayonnements radio produits lors
des éruptions solaires ou stellaires.
Elles sont de plus l’un des seuls
moyens d’étudier à distance les
magnéto-plasmas où elles sont en-
gendrées, généralement des régions
clés magnétosphériques comme les
zones aurorales – à hautes latitudes
magnétiques – de Jupiter ou le tore
de plasma de son satellite galiléen
volcanique Io. Les observations à
distance sont réalisables sur des du-
rées bien plus longues que le survol
d’une sonde spatiale, et avec une
instrumentation bien plus sophisti-
quée que celle embarquée. Leur in-
terprétation théorique a pour but
d’accéder à une meilleure connais-
sance des mécanismes de produc-
tion des émissions radio, puis de la
topologie du champ magnétique pla-
nétaire et des propriétés des particu-
les chargées qui précipitent dans les
zones aurorales (nature, origine, dis-
tribution spatiale et énergétique).
L’idée d’une émission par un
processus de type cyclotron a
émergé dès la fin des années 1950.
La fréquence émise en chaque point
des lignes de champ traversant la
région source serait voisine de la
fréquence cyclotron − ou gyrofré-
quence − locale du mouvement héli-
coïdal des particules chargées émet-
trices :
f
c
=qB/2 pm
où q et m sont la charge et la masse
de la particule et B l’intensité du
– Laboratoire ARPEGES (URA 1757
CNRS), Observatoire de Paris, Section
d’astrophysique, 92195 Meudon Cedex.
– Station de radioastronomie de Nançay
(USN), 18330 Nançay.
– Institut de radioastronomie, Kharkov,
310004 Ukraine.
118

champ magnétique ; dans le cas
d’un électron en mouvement, q = e
et
f
c
= 2,8 B (avec f
c
en MHz et B
en Gauss – 1 Gauss = 10
–4
Tesla)
Cette explication qualitative rend
compte de la polarisation circulaire
ou elliptique du rayonnement pro-
duit, et du fait que seul Jupiter émet
en décamétrique : les plus hautes
fréquences sont en effet émises plus
près de la surface de la planète, où
le champ dipolaire augmente en R
–3
– R étant la distance au centre –, et
les éventuels termes multipolaires
en R
–5
,R
–7
..., et le champ magnéti-
que jovien atteint 14 Gauss en sur-
face, contre moins de 1 Gauss pour
les autres planètes.
Les travaux théoriques des quinze
dernières années, étayés d’études in-
situ dans les sources du rayonne-
ment kilométrique terrestre, particu-
lièrement par le satellite suédois
Viking, ont permis d’identifier le
mécanisme microscopique probable-
ment à l’origine des émissions radio
aurorales planétaires : une émission
cyclotron de type maser, où l’éner-
gie libre permettant d’amplifier les
ondes électromagnétiques provient
d’une inversion de population dans
la distribution des vitesses des élec-
trons libres énergétiques (de quel-
ques keV) précipitant dans les ré-
gions aurorales. La condition de
résonance électrons-ondes s’écrit :
f−k
//
v
//
/2 p−f
c
/C=0
où
~
f−k
//
v
//
/2 p
!
est la fréquence
de l’onde dans le référentiel de
l’électron,
v
//
étant la vitesse paral-
lèle des électrons et
k
//
la compo-
sante parallèle du vecteur d’onde
~
k
//
v
//
/2 p
traduit donc un effet
Doppler), et
f
c
/C
est la gyrofré-
quence électronique relativiste locale
(où
C=@1−
~
v
//
2
+v
⊥
2
!
/c
2
#
− 1/2
est le facteur de Lorentz). Si la po-
pulation électronique est à l’équili-
bre thermodynamique, le rayonne-
ment cyclotron amplifié par les
électrons de haute énergie est réab-
sorbé par ceux, dominants, de basse
énergie car la condition de réso-
nance dépend peu de la vitesse. Si
en revanche, la population électroni-
que possède un excès d’électrons de
haute énergie (plus exactement une
inversion de population en vitesse
perpendiculaire au champ magnéti-
que local, à laquelle correspondent
des gradients positifs de la fonction
de distribution électronique par rap-
port à
v
⊥
!
,
l’absorption devient
moins importante que l’émission sti-
mulée et la population électronique
instable peut ainsi transférer une
partie de son énergie libre aux on-
des en les amplifiant de plusieurs
ordres de grandeur, tout en revenant
vers l’équilibre thermodynamique
(distribution Maxwellienne). Ce
processus est, pour une distribution
continue de vitesses, l’analogue au
surpeuplement de niveaux d’énergie
discrets, atomiques ou moléculaires,
conduisant à une émission de type
laser ou maser. Dans les régions
aurorales planétaires, la condition
de résonance est généralement satis-
faite pour
f≈f
c
et
k
//
!k
⊥
,
ce
qui se traduit par une émission au
voisinage de la gyrofréquence et
quasi-perpendiculairement au champ
Figure 1 - (a) Spectre dynamique à basse résolution temporelle (~ 1 sec) de l’émission décamétrique
de Jupiter enregistré à Nançay, et montrant la structure lentement variable des émissions, à l’échelle
de quelques minutes. Le noircissement est proportionnel à l’intensité reçue et les lignes parallèles à
l’axe des temps sont des parasites à fréquence fixe. Les émissions décamétriques (DAM) joviennes
apparaissent comme des structures sombres inclinées, striées verticalement par des phénomènes de
propagation. (b) Zoom (principalement temporel) du cadre blanc de (a) obtenu au spectrographe
acousto-optique, et révélant les sursauts S comme des structures fines dérivant rapidement dans le
plan temps-fréquence.
Plasmas
119

magnétique local. On a pu ainsi ren-
dre compte quantitativement du
spectre et de l’intensité de ces émis-
sions, et qualitativement de leur po-
larisation.
Les scénarios d’émission détaillés
sont en revanche mal connus,
d’autant que la structure des émis-
sions radio planétaires est très com-
plexe et variable : elles sont
généralement constituées d’une
composante lentement variable (à
l’échelle de quelques minutes à
quelques heures – voir figure 1a) et
de brefs sursauts (très intenses et de
durée très inférieure à la seconde).
Parmi ces derniers, seuls les sur-
sauts décamétriques joviens, appelés
« millisecondes » ou « S » d’après
leur forme sur les spectres dynami-
ques (distribution de l’intensité dans
le plan temps-fréquence) de l’émis-
sion, sont observables du sol (voir
figures 1b et 2a). Leur structure dé-
taillée a donc pu être régulièrement
étudiée à très hautes résolutions
temporelle et spectrale. Malgré
trente ans d’étude, l’origine de ces
sursauts restait controversée, mais
de récentes observations nous per-
mettent de lever la controverse.
ORIGINE DES SURSAUTS «S»:
MODÈLES ET CONTROVERSE
Les sursauts S de Jupiter ont été
découverts en 1961, peu après
l’émission décamétrique elle-même.
Leur occurrence représente ~ 10 %
de l’activité radio de Jupiter, et ils
sont très distincts du reste des émis-
sions, plus lentement variables quoi-
que très structurées (voir figure 1a).
Outre leur durée à fréquence fixe de
quelques millisecondes, et leur lar-
geur spectrale instantanée de quel-
ques kHz, ces sursauts se caractéri-
sent principalement par le fait qu’ils
dérivent en fréquence, presque tou-
jours négativement : ils apparaissent
à haute fréquence et « glissent » très
rapidement vers les basses fréquen-
ces, au rythme de plusieurs dizaines
de MHz/s. Cette dérive varie au
cours du sursaut, de sorte que sa
forme résultante dans le plan temps-
fréquence est une courbe – peu in-
curvée mais dont le sens de cour-
bure peut être quelconque –
ressemblant à une portion de « S »,
d’où leur nom (voir figures 1b et
2a). Enfin, les observations à long
terme montrent que ces sursauts ne
sont détectés que dans des confi-
gurations très particulières du trian-
gle Observateur/Jupiter/Io, seule-
ment quand la « phase de Io »,
comptée positivement dans le sens
direct à partir de la direction oppo-
sée à l’observateur (voir figure 5),
vaut 90° ou 230° (±10°).
Dans le cadre d’une théorie de
type cyclotron, leur dérive presque
toujours négative suggère que la ré-
gion émettrice s’éloigne de la pla-
nète au cours d’un sursaut, de sorte
qu’elle parcourt une ligne de champ
dans le sens des gyrofréquences dé-
croissantes. On suppose par analo-
gie avec l’émission radio terrestre
Figure 2 - (a) Spectre dynamique d’une autre séquence de sursauts S enregistrés au spectrographe
acousto-optique (à Nançay, le 18/04/94). Leur dérive négative apparaît clairement à cette résolution
temporelle (10 msec). (b) Résultat de l’identification automatique des sursauts. C’est à partir de ce
« squelette » de spectre dynamique que les paramètres physiques de l’émission sont mesurés tous les
200 kHz.
120

que cette région émettrice est une
population électronique chaude ins-
table. Sans indice particulier d’une
accélération vers le haut à partir du
sommet de l’ionosphère jovienne,
on a imaginé dès 1965 que ces élec-
trons étaient accélérés au voisinage
de Io vers Jupiter. Ils précipitent
alors vers la planète en suivant des
lignes de champ magnétiques le
long desquelles l’intensité du champ
(B) augmente. La théorie adiabati-
que impose que le rapport
v
⊥
2
/B
reste constant au cours de ce mou-
vement (voir encadré). La conserva-
tion de l’énergie totale de la parti-
cule implique donc que sa vitesse
parallèle (au vecteur B) diminue au
profit de sa vitesse perpendiculaire.
Si la vitesse parallèle s’annule avant
que la particule n’atteigne l’iono-
sphère (point miroir où
v=v
⊥
!
,
celle-ci repart en sens inverse en
s’éloignant de la planète. Ce scéna-
rio, qui ne préjuge pas du détail du
mécanisme microscopique de pro-
duction de l’émission, n’explique
pas l’origine des faisceaux d’élec-
trons pulsés requis pour expliquer
les séries de sursauts S consécutifs,
ni pourquoi ces populations électro-
niques n’émettent pas d’ondes radio
en se rapprochant de la planète (car
ces dernières présenteraient alors
des dérives positives, non observées
– ce dernier point sera éclairci plus
bas). En revanche il a le mérite de
prédire une loi calculable pour la
variation des dérives des sursauts en
fonction de la fréquence observée :
u
df/df
u
≈K.f.v
//
~
f
!
où K = constante et
v
//
~
f
!
est une
fonction décroissante de f (voir en-
cadré). Pour des électrons s’éloi-
gnant de Jupiter le long d’une ligne
de champ magnétique à partir de
leur point miroir (point de rebrous-
sement de la trajectoire électroni-
que, à B élevé, près de la planète),
la fréquence
f≈f
c
=eB/2 pm
e
décroît en
zR
−3
tandis que les
particules accélèrent
~
v
//
augmente)
du fait du transfert
v
⊥
→v
//
lié à
leur mouvement adiabatique. En va-
leur absolue, la dérivée
u
df/dt
u
est
donc nulle à la gyrofréquence du
point miroir ; elle augmente rapide-
ment quand f décroît (l’accélération
des électrons domine) puis atteint
un maximum avant de décroître li-
néairement pour les faibles valeurs
de f (pour lesquelles
v
//
~
f
!
devient
quasi-constante − voir figure 3). La
fonction
u
df/dt
u
~
f
!
est seulement
paramétrée par la vitesse (ou l’éner-
gie) totale des électrons, et leur an-
gle d’attaque Φ(angle v-B – voir fi-
gure 5) en un point quelconque de
la ligne de champ, par exemple à
l’équateur magnétique (Φ
éq
). Pour
des électrons de quelques keV se
déplaçant le long du tube de flux de
Io, le maximum de
u
df/dt
u
se situe
vers 20-25 MHz.
Les sursauts S ont été intensive-
ment étudiés de 1965 à 1982 à
l’aide de récepteurs analogiques de
résolution temporelle élevée
(<1 msec par spectre), notamment
dans le but d’établir empiriquement
la courbe df/dt(f) et de la comparer
à la prédiction théorique ci-dessus.
Aucune mesure à haute résolution
n’a été obtenue pour f >33.7 MHz.
Entre ~ 5 et 33 MHz, on a constaté
une croissance régulière de
u
df/dt
u
avec f, la dispersion des mesures
augmentant également avec la fré-
quence (voir figure 3). Ce résultat
semble infirmer le modèle « adiaba-
tique » ci-dessus. Il a motivé la flo-
raison de nombreuses autres inter-
prétations théoriques dans les
années 1978-92 : d’abord limitées à
une modification du modèle adiaba-
tique consistant à accélérer les élec-
trons vers le haut à partir du som-
met de l’ionosphère jovienne
– selon un mécanisme indéter-
miné –, elles ont évolué vers des
processus plus exotiques (mécanis-
mes à hautes énergies, de l’ordre du
MeV, conversion ou battements
d’ondes de plasma, effet laser dans
une cavité résonante à parois mobi-
les, etc.)... et moins vérifiables sans
mesures in-situ dans les sources des
Figure 3 - Variation des dérives (df/dt) des sursauts S en fonction de la fréquence. Nos résultats (cer-
cles pleins), compatibles avec les précédents (cercles vides, résumant la plupart des mesures de dé-
rives effectuées entre 1965 et 1982), sont basés sur un nombre beaucoup plus grand de mesures et
atteignent des fréquences plus élevées. Chaque cercle plein indique le pic de la distribution des dé-
rives observées à la fréquence correspondante. Les barres d’erreur (±5 MHz/s) résultent de la dis-
persion intrinsèque des dérives durant un orage et d’un orage à l’autre. Les courbes sont les
meilleurs ajustements calculés à partir du scénario adiabatique, avec U
éq
= 2,8° et v = 0,14c
(tirets) ±0,03c (pointillés). Modifier U
éq
de seulement ±0,1° suffıt à décaler latéralement les courbes
de ±2 MHz.
Plasmas
121

Encadré
THÉORIE ADIABATIQUE DE L’ÉMISSION
DES SURSAUTS S
1 – CONSERVATION DU 1
ER
INVARIANT ADIABATIQUE (MOMENT MAGNÉTIQUE av
⊥2
/B) DU MOUVEMENT D’UNE PARTICULE
CHARGÉE DANS UN CHAMP MAGNÉTIQUE D’INTENSITÉ VARIABLE
Lors de son mouvement le long d’une ligne de champ, la particule « voit » un champ magnétique d’intensité variable B(t), dont
la variation induit un champ électrique perpendiculaire à B
~
rot E =B/t
!
,qui va donc modifier l’énergie perpendiculaire de
la particule (le courant jcorrespondant induit un champ Bqui s’oppose à la variation de B(t)). Pour un champ dipolaire de
quelques Gauss, la variation dB/B au cours d’une gyropériode électronique 1/f
ce
=2pm
e
/eB est très faible :
dB/B≈3.dr/r!6pm
e
c/eBR
j
≈10
−6
.On peut donc considérer B constant pour évaluer le travail de Edurant une gyropé-
riode :
*
m
e
.dv
⊥
/dt .dL =
*
e.E.dL=e.
**
rot E .dS =−e.
**
B/t.dS
2pq
ce
2pq
ce
pq
ce2
pq
ce2
avec q
ce
=m
e
v
⊥
eB d’où :
~
2pm
c
2
v
⊥
/eB
!
.dv
⊥
/dt =ep.
~
m
e
v
⊥
/eB
!
2
dB/dt ⇒2.dv
⊥
/v
⊥
=dB/B⇒v
⊥2
/B=C
te
Comme la force magnétique (seule force extérieure effectivement appliquée à la particule, e .v×B) ne travaille pas lors du mou-
vement de la particule le long de la ligne de champ, la variation d’énergie perpendiculaire s’accompagne d’une variation corres-
pondante d’énergie parallèle.
2 − CALCUL DE LA DÉRIVE df/dt DE L’ÉMISSION D’UN ÉLECTRON EN MOUVEMENT ADIABATIQUE DANS UN CHAMP DIPOLAIRE,
EN FONCTION DE LA FRÉQUENCE D’ÉMISSION f
De l’intensité du champ magnétique
B=
u
B
u
=M/R
3
.
~
1+3cos
2
h
!
1/2
(M = moment magnétique, en Gauss .R
J3
,si R est exprimé en rayons joviens : 1 R
J
= 71 400 km) et de l’équation d’une ligne de
champ coupant l’équateur magnétique à L .R
J
R=L.sin
2
~
h
!~
hest la colatitude magne´tique
!
on déduit la variation dB/dt « vue » par un électron de vitesse parallèle v
//
:
dB/dt =dB/dh×dh/ds ×ds/dt avec v
//
=ds/dt et ds =@dr
2
+
~
r.dh
!
2
#1/2
⇒dB/dt =−3/
~
L.R
J
!
.g
~
h
!
.B.v
//
avec g
~
h
!
=
~
cosh/sin
2
h
!
.
~
3+5cos
2
h
!
/
~
1+3cos
2
h
!
3/2
La vitesse parallèle d’un électron en mouvement adiabatique s’exprime :
v
//
=v.
~
1−B.L
3
.sin
2
~
U
e´q
!
/M
!
1/2
où v est la vitesse totale (constante) de l’électron, et U
e´q
son angle d’attaque (v-B) à l’équateur. On pose ici L = 6 (lignes de
champ coupant l’orbite de Io), et M = 7 Gauss .R
J
3
de sorte que la gyrofréquence au pied des lignes de champ à L = 6 excède la
fréquence maximum observée (36 MHz). Le moment dipolaire jovien est en fait de 4,2 Gauss .R
J
3
,mais des termes quadrupolaires
et octupolaires s’y ajoutent à hautes latitudes près de la planète. L’altitude de la source s’étend de ~ 0,01 R
J
à 36 MHz jusqu’à
~ 0,28 R
J
à 17 MHz (voir figure 5) ; sa colatitude varie de h=27,5°à 24,2°, et g
~
h
!
est quasi-constante. Comme
f≈f
ce
= eB/2 pm
e
on obtient finalement :
df/dt =−3/
~
L.R
J
!
.g
~
h
!
.f.v.
@
1−sin
2
~
U
e´q
!
.2pm
e
.f.L
3
/
~
M.e
!
#
1/2
≈−K.f.v
//
~
f
!
df/dt n’est fonction que de f, et est paramétrée par v et U
e´q
.L’énergie caractéristique des électrons est évidemment :
E=
~
C−1
!
m
e
c
2
=@
~
1−v
2
/c
2
!
−1/2
−1#m
e
c
2
.
122
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
1
/
10
100%