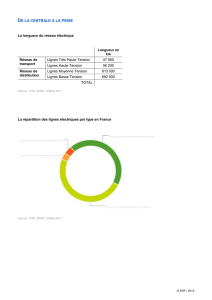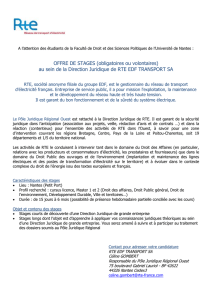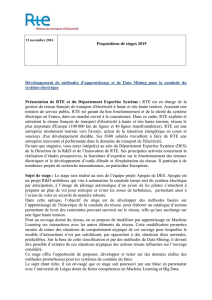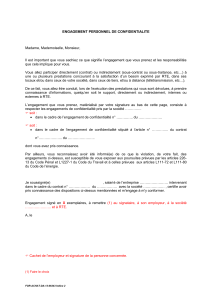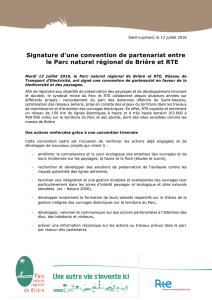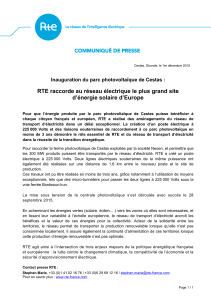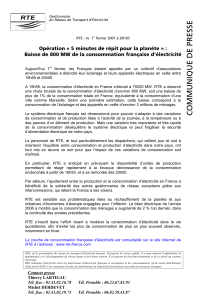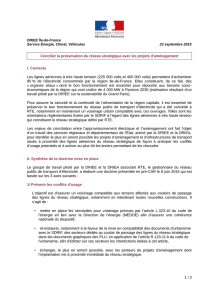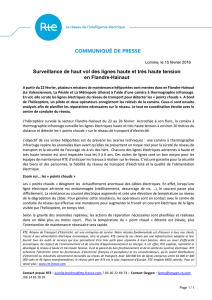Le maire et le réseau de transport d`électricité

UNE POSSIBLE SOURCE
DE REVENUS
Les pylônes et les postes de transformation pré-
sents sur votre territoire peuvent générer des res-
sources spécifiques (taxe, impôt, contribution
territoriale) qui viennent renforcer votre budget.
> La taxe pylône
Les communes sur le territoire desquelles sont
implantés des pylônes supportant des lignes élec-
triques à très haute tension (225 000 et 400 000 volts)
perçoivent annuellement une imposition forfaitaire
dont le montant, révisé chaque année par arrêté
ministériel, dépend de la tension électrique.
> La Contribution économique territoriale (CET)
et l’Impôt tarifaire sur les entreprises (IFER)
À la suite de la réforme de la fiscalité locale, la taxe
professionnelle versée aux communes par le ges-
tionnaire de réseau au titre des postes électriques
a été remplacée par la Contribution économique
territoriale (CET) et l’Impôt forfaitaire sur les entre-
prises de réseau (IFER).
GESTION ET MAINTENANCE
DU RÉSEAU
Afin d’entretenir et de développer le réseau de
transport d’électricité dont il a la charge, RTE peut
être amené à effectuer des opérations de mainte-
nance sur les différents ouvrages présents sur
votre commune.
> Les travaux d’élagage et de peinture
Conformément à la législation en vigueur et afin
de répondre à des exigences de performance tech-
nique, de sécurité des tiers et des intervenants, et
de respect de l’environnement, des opérations
d’élagage sous et aux abords des lignes électriques
sont réalisées tous les quatre à cinq ans.
Par ailleurs, des travaux de remise en peinture sont
Si la présence d’un ouvrage RTE sur votre commune peut avoir une incidence positive sur votre
budget, elle implique aussi une attention particulière quant à l’entretien et au développement du
réseau, à la maintenance de l’ouvrage et à la délivrance de permis de construire à proximité de celui-ci.
LeMaire
et le réseau de transport
d’électricité
LES FICHES DE SYNTHÈSE ••••••••••••
Près de 18 000 communes françaises sont concernées par la présence
sur leur territoire d’un ouvrage électrique — poste, pylône ou ligne à haute
et très haute tension — géré par RTE, le gestionnaire unique du réseau
de transport d’électricité.
Un ouvrage RTE sur votre commune :
ce qu’il faut savoir
• Un ouvrage RTE
sur votre commune :
ce qu’il faut savoir P. 1-2
• La concertation
au cours des étapes
d’un projet P. 3
• La sécurité à proximité
des lignes à haute
et très haute tension P. 4
• Préserver
l’environnement P. 5
• Les clés pour
comprendre P. 6
>
URBANISME,
AMÉNAGEMENT
SOMMAIRE
LE RÉSEAU
DE TRANSPORT
D’ÉLECTRICITÉ
EN CHIFFRES
•100 000 kilomètres
de lignes à haute
et très haute tension.
•18 000 communes
directement concernées
par les ouvrages RTE.
•250 000 pylônes.
•2 600 postes
de transformation.
•46 liaisons
transfrontalières.

effectués, dans le respect des exigences environnementales
(produits appliqués, mise en œuvre), afin de préserver les
pylônes de la corrosion.
Pour l’ensemble de ces travaux, le maire est informé par RTE
des interventions prévues. Un affichage en mairie et une
communication par voie de presse avertissent la population
riveraine des futurs travaux. Un interlocuteur unique, au
sein du Groupe d’exploitation transport (GET) dont dépend
l’ouvrage, informe et traite toute sollicitation relative à ces
sujets.
> L’urbanisation à proximité des ouvrages existants
Certains projets d’urbanisation et projets d’aménagement
soumis à enquête publique peuvent interférer avec la pré-
sence d’ouvrages RTE.
Avant la délivrance d’un permis de construire, RTE doit être
consulté afin que le projet concilie les intérêts des particu-
liers et de la commune avec les impératifs d’exploitation du
réseau de transport.
> La sécurisation mécanique du réseau
Le programme de sécurisation du réseau de transport d’élec-
tricité, qui court jusqu’en 2017 et revoit le dimensionnement
de 45 000 kilomètres de lignes, a permis à RTE de faire face
efficacement à la tempête Klaus de janvier 2009.
VALORISER LES INSTALLATIONS
ÉLECTRIQUES POUR L’AMÉNAGE-
MENT NUMÉRIQUE DU TERRITOIRE
Les collectivités et leurs groupements ont le droitde créer ou
de subventionner l’établissement de réseaux haut débit sur
leur territoire, dans le cadre de délégations de service public.
Pour certains territoires, la mise à disposition des « points
hauts » que constituent les pylônes, ainsi que le déploie-
ment de fibres optiques sur les ouvrages électriques peu-
vent être une solution pour l’accès au haut débit. Arteria est
la filiale de RTE chargée de valoriser ces actions.
QUELLES PROCÉDURES LORS DE TRAVAUX À PROXIMITÉ D’UN OUVRAGE RTE ?
Tous les travaux à proximité d’un ouvrage haute ou très haute tension doivent faire l’objet d’autorisations préalables spécifiques.
Les mairies tiennent à la disposition des entreprises et des particuliers les noms et adresses des exploitants de réseaux présents sur
la commune, ainsi que les plans de zonage des ouvrages.
>
Demande de renseignements (DR)
Dès le stade de l’élaboration du projet
de travaux, la Demande de renseignements
permet d’obtenir des informations sur
l’existence éventuelle d’ouvrages, afin que
les travaux envisagés puissent être exécutés
en toute sécurité. Toute personne (maître
d’ouvrage public ou privé et, pour son
compte, le maître d’œuvre de l’opération)
qui envisage la réalisation de travaux, doit
se renseigner auprès de la mairie sur le
territoire de laquelle se situeront les
travaux, pour disposer de ces informations.
Les travaux de faible ampleur ou ne
comportant pas de fouilles au sol en sont
dispensés.
Déclaration d’intention de commencement de
travaux (DICT)
La DICT a pour objet de demander aux exploi-
tants d’ouvrages leurs recommandations ou
prescriptions techniques avant d’entreprendre
des travaux à proximité de leurs ouvrages.
Pour faciliter vos démarches : www.protys.fr
Le Maire
et le réseau de transport
d’électricité
LES FICHES DE SYNTHÈSE ••••••••••••
2

Le maire, en tant que représentant de la population concernée par un ouvrage électrique nouveau ou à reconstruire,
a un rôle fondamental à jouer. Il est associé aux différentes étapes d’un projet et consulté à plusieurs reprises.
La concertation au cours des étapes d’un projet
>
3
Le dossier de justification technique
et économique
Il présente les besoins à l’origine du projet (évolution de la pro-
duction locale et de la consommation d’électricité, besoin de
renouvellement d’une ligne ou d’un poste, etc.), les avantages
et inconvénients de chaque solution envisagée, ainsi que le
choix de RTE. Ce dossier est soumis à l’autorité de tutelle qui
vérifie l’opportunité du projet. S’il est jugé recevable, il sert de
support à la concertation.
Débat public
Il permet d’associer le public à l’élabora-
tiondesprojetsprésentantdefortsenjeux
socio-économiques ou ayant un impact
significatif sur l’environnement ou l’amé-
nagement du territoire.
La saisine de la Commission nationale du
débatpublic(CNDP)est obligatoirelorsque
le projet concerne une ligne aérienne de
tension égaleousupérieure à400 000 volts
et d’une longueur supérieure à 10 kilomètres,
ou une ligne souterraine supérieure à 100 kilomètres.
Concertation préalable aux procédures
administratives
Laconcertationréunitlesmaires,lesservicesdel’État,lesasso-
ciations, les acteurs économiques et, le cas échéant, le monde
agricole avec le maître d’ouvrage RTE au cours de trois étapes :
la validation de l’aire d’étude, la délimitation des « fuseaux », le
choix du « tracé de moindre impact » ou l’emplacement retenu
pour le projet.
Étude d’impact
L’étude d’impact, élaborée tout au long de la concertation et
dont l’objet est de synthétiser les conséquences des projets
d’ouvrages électriques sur l’environnement, est un moment
essentiel pour faire évoluer les projets de travaux et d’aména-
gement vers la solution de moindre impact environnemental.
Déclaration d’utilité publique (DUP)
Une demande de DUP est adressée au préfet pour les postes de
transformation et pour les lignes à 90 000 et 63 000 volts, au
ministre concerné pour les lignes à 225 000 et 400 000 volts.
Après consultation, notamment du maire, l’intérêt général du
projet étant proclamé, la DUP permet à l’État, en cas de besoin,
d’imposer des servitudes pour les lignes et de recourir à une
expropriation pour les postes.
Élaboration du projet de détail
Le projet de détail de l’ouvrage est élaboré en liaison avec les
communes concernées, les services de l’État et les chambres
d’agriculture. Les propriétaires et les exploitants agricoles sont
consultés pour déterminer l’emprise exacte de l’ouvrage.
Servitudes et transferts
de propriété
Si les tentatives d’accord amiable avec
lespropriétaireséchouent,laprocédure
administrative de mise en servitude
légale (pour les lignes) ou d’expropria-
tion (pour les postes) est engagée. Dès
quepossible,des plantationsarbustives
ou d’autres mesures palliatives sont
proposéesaux propriétaires demaisons
d’habitation situées à proximité des nou-
veaux ouvrages, afin d’en limiter l’impact visuel. Les
propriétaires d’habitation situés dans la bande des 200 mètres
autour de l’ouvrage sont recensés et contactés pour l’indemni-
sation du préjudice visuel.
Travaux
Le maire est informé par le maître d’ouvrage de l’avancement
du chantier.
COMMENT EST DÉFINIE LA CONCERTATION ?
La justification
technico-économique
La concertation
La Déclaration
d’utilité publique
Le projet détaillé
Les servitudes et
le transfert de propriété
Les travaux
La concertation, telle que précisée dans la circulaire « Fontaine »
du 9 septembre 2002, a pour objectifs :
• de définir avec les élus et les associations représentatifs des populations
concernées, les caractéristiques du projet ainsi que les mesures d’insertion
environnementale et d’accompagnement qui en découlent ;
• d’apporter une information de qualité aux populations concernées
par le projet.

Les communes sont devenues, aux côtés d’autres acteurs, des maillons essentiels en matière d’information
et de prévention des risques. La pratique de certaines activités, de même que l’exécution de chantiers à proximité
d’installations électriques — lignes à haute et très haute tension, pylônes et postes de transformation — peuvent être
dangereuses et nécessitent certaines précautions.
La sécurité à proximité des lignes à haute
et très haute tension
>
4
La pratique de certaines activités — telles que les travaux agricoles, l’éla-
gage, les loisirs nautiques ou aériens, la pêche ou l’exécution de chantiers
à proximité d’installations électriques — peut être dangereuse et néces-
site certaines précautions, que RTE rappelle régulièrement à travers sa
campagne “ Sous les lignes, prudence : restons à distance. ”
Le danger existe en cas de contact avec une ligne, directement ou par l’inter-
médiaire d’un instrument, mais aussi si l’on s’en approche de trop près ou si
l’on pointe un objet en direction de la ligne. Un arc électrique peut alors se for-
mer et il y a risque d’électrocution.
Lignes à haute et très haute tension et santé
Les lignes haute et
très haute tension
(HT et THT), indis-
pensables à toute
forme d’activité,
peuvent susciter
des interroga-
tions le plus souvent liées au fait de vivre à
proximité de ces lignes, et à la crainte d’un
éventuel impact sur la santé. Fort d’une col-
laboration étroite avec l’Association des
maires de France, consacrée par la signature
d’une convention de partenariat, RTE pro-
pose, depuis octobre 2010, un service d’in-
formation et de mesures des champs
magnétiques de très basse fréquence
(50 Hz). Ce service est mis à la disposition
des maires afin de répondre à toutes les
questions sur les expositions à ces champs
magnétiques, y compris celles rencontrées
au voisinage des lignes HT et THT.
Le service d’information
et de mesures des champs
magnétiques 50 Hz proposé
aux maires
Les maires dont la commune se situe
à proximité d’un ouvrage RTE peuvent
adresser une demande d’information et / ou
de mesures de champs magnétiques par
courrier électronique, à l’adresse suivante :
Pour chaque sollicitation, RTE prend contact
avec le maire demandeur dans un délai
de sept jours afin de définir la meilleure
solution pour répondre à son attente.
Ainsi, il lui sera proposé :
• l’intervention d’un agent RTE dûment
formé pour effectuer des relevés de
champs magnétiques 50 Hz dans les lieux
de vie de la commune. À cette occasion, il
répondra également à toutes les questions
qui lui seront posées et diffusera des sup-
ports d’information sur le sujet.
RTE s’engage à ce que ces interventions
soient réalisées dans les meilleurs délais ;
• l’intervention de laboratoires indépen-
dants pour réaliser les mesures de champs
magnétiques 50 Hz. Ces laboratoires appli-
queront un protocole de mesures établi au
niveau national par l’UTE (Union technique
de l’électricité). Conformément aux guides
de bonnes pratiques et normes internatio-
nales traitant de la mesure des champs
magnétiques 50 Hz, ce protocole établit un
cahier des charges précis et strict en
termes de qualité du matériel de mesure,
de professionnalisme des intervenants et
de forme du compte-rendu. De manière à
garantir leur indépendance, les rapports
de mesures sont communiqués aux maires
par les laboratoires. RTE s’engage à appor-
ter par la suite toutes les informations
complémentaires et explications que
pourraient nécessiter ces rapports.
RTE prend totalement en charge les inter-
ventions de ses agents, pour effectuer des
relevés locaux et les commenter, de même
que celles des laboratoires indépendants.
Pour ces dernières, toutefois, le maire devra
expressément préciser qu’il sollicite la prise
en charge financière de RTE.
Le décret n° 2011-1697 du 1er décembre 2011,
relatif aux ouvrages des réseaux publics
d’électricité et des autres réseaux d’électri-
cité et au dispositif de surveillance et de
contrôle des ondes électromagnétiques,
prévoit par ailleurs un dispositif renforcé de
mesures et de surveillance des champs élec-
tromagnétiques émis par les lignes à très
haute tension.
Pour en savoir plus :
www.clefdeschamps.info
URBANISME,
AMÉNAGEMENT

LES FICHES DE SYNTHÈSE ••••••••••••
5
Le Maire
et le réseau de transport
d’électricité
LE RESPECT DES MILIEUX
NATURELS ET DES PAYSAGES
70 % des installations haute et très haute tension se trou-
vent en milieu agricole, et 20 % en milieu forestier. Une
attention particulière est portée à la construction et l’ex-
ploitation des ouvrages électriques dans le maintien de la
diversité biologique, à la préservation des zones naturelles
ou encore à la prévention des pollutions et de la maîtrise du
bruit. Des partenariats ont ainsi été mis en place avec la
Fédération des parcs naturels régionaux, les chambres
d’agriculture et le Comité national avifaune.
MISE EN SOUTERRAIN
DES OUVRAGES
Les liaisons souterraines sont privilégiées pour :
• les ouvrages en 63 000 et 90 000 volts dans les zones
urbaines de plus de 50 000 habitants, dans les zones d’ha-
bitat regroupé, dans les zones considérées comme priori-
taires (ZICO, ZNIEFF, ZPPAUD, PNR, zones périphériques
des parcs nationaux et aux abords des postes sources) ;
• les ouvrages en 225 000 volts dans les zones urbaines de
plus de 50 000 habitants, pour les projets situés en dehors
des couloirs de lignes existants ;
• les ouvrages en 400 000 volts dans des situations excep-
tionnelles du fait du coût de la mise en souterrain.
90 % du réseau de transport d’électricité est situé en milieu rural. Construire ou maintenir des ouvrages dans
cet environnement se fait donc dans le respect de ces milieux naturels et dans une recherche prioritaire d’insertion
environnementale.
Préserver l’environnement
>
La construction d’un nouvel ouvrage, de par son impact sur les populations concernées et sur les paysages, fait
l’objet de mesures spécifiques portées par un Plan d’accompagnement de projet (PAP).
>
La construction d’un nouvel ouvrage fait l’objet d’un Plan d’ac-
compagnement de projet (PAP) financé par RTE. Il permet de
soutenirdesmesuresaméliorantl’intégrationdunouvelouvrage,
des mesures de compensation pour un plus grand respect des
milieuxnaturels,ouencoredesactionsdedéveloppementdura-
ble.Équivalent à10 %ducoûtdeslignesaériennesà400 000 volts
et à 8 % pour les lignes aériennes de tension inférieure, la moitié
deces fonds est allouéeauxcommunes traverséesparl’ouvrage.
Accompagner le développement du réseau
L’article 8 de la loi n° 2010-1488 du 7 décembre 2010 portant nouvelle organisation du marché de l’électricité (dite loi NOME)
prévoitque,à lademandedescollectivitésterritoriales,RTEpeut participeraufinancementdelamiseensouterraindesouvrages
existants dont il a la charge, pour des motifs liés au développement économique local ou à la protection de l’environnement.
>
 6
6
1
/
6
100%