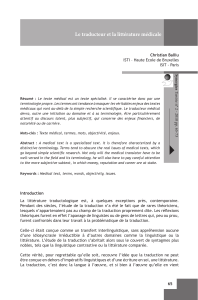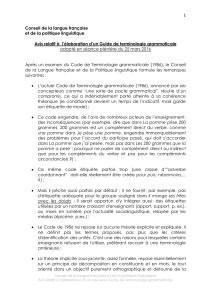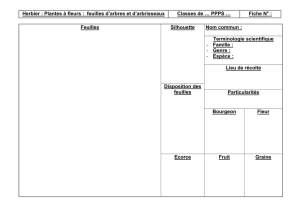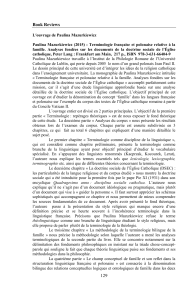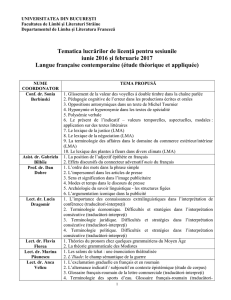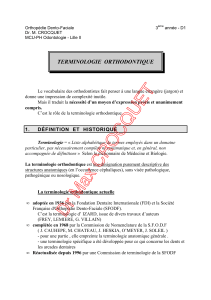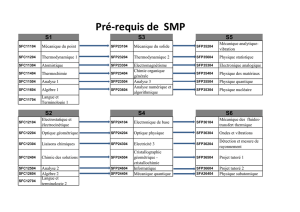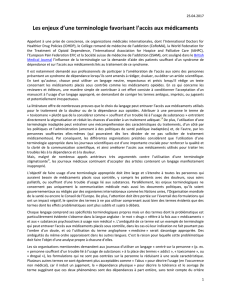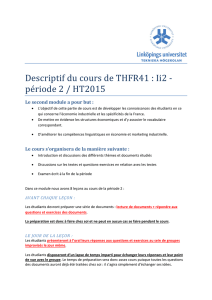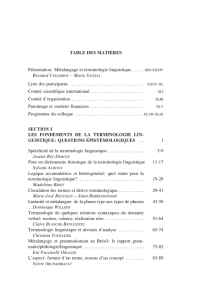Le langage de la médecine : les mots pour le dire

1
LE LANGAGE DE LA MÉDECINE : LES MOTS POUR LE DIRE
Christian Balliu
ISTI
Haute École de Bruxelles
Résumé : La médecine, comme tout domaine de spécialité, se caractérise par une terminologie particulière. Celle-ci
pourrait donner à penser que le langage médical est dénoté, strictement scientifique, afin de garantir la rigueur et
l’exactitude des faits exposés. En réalité, le discours médical est tout aussi professionnel que savant ; il recourt ainsi à
des figures métonymiques et métaphoriques qui connotent le discours et donnent vie aux termes en véhiculant une
véritable philosophie de l’art de guérir.
Mots-clés : médecine, notion, sociolecte, connotation, subjectivité
On ne trouvera, dans cet exposé, aucune question de théorie, aucun débat de linguistique ou de
terminologie, mais seulement une étude de cas et la recherche d’un mobile.
Avec le dessein de ne m’adresser qu’à des linguistes et à des étudiants, non à des praticiens de l’art de
guérir, je ne pouvais pas croire que, même dans le cadre d’une conférence, un ton et des démonstrations
trop arbitrairement imperturbables dussent être adoptés. Partout où la nécessité m’en est apparue, j’ai
délaissé le souci architectural de l’exposé, la « rotondité » de la question, et préféré montrer, non pas en
des édifices didactiques superficiels, mais dans leur état brut, et non encore encadrés, les faits eux-mêmes.
Enfin, sans ignorer ce que l’absence réelle ou apparente de recherche bibliographique, de recours aux
travaux des autres, donne de mouvement au récit et de facilités à l’auteur et au lecteur, je n’ai pas songé à
me priver ni à priver celui qui me lira de l’instruction éparse dans les meilleurs travaux sur le sujet. Usant
d’eux de mon mieux, je ne savais plus ne pas citer les auteurs. Bref, je ne ferai pas comme Voltaire, qui
conseillait de « citer tout le monde, sauf ceux à qui on a pris quelque chose » ; je paierai volontiers mes
dettes intellectuelles.
La médecine est une discipline qui a son propre langage. Cela est trivial. Cette corrélation entre
discipline et langage n’est évidemment pas sans conséquence sur l’évolution de celle-ci, de ses notions et
des dénominations chargées de relayer ces notions au sein de la société. Elle conduit à mon sens à trois
paradoxes fondamentaux.
Derrière les notions et la terminologie du domaine se cachent des choix théoriques dont l’intuition n’est
pas absente. Le grand Claude Bernard s’était un jour adressé à son élève Paul Bert de la manière suivante :
« Laissez votre imagination avec votre paletot au vestiaire, mais reprenez-la en sortant ». J’en arrive ainsi
tout de suite à mon premier paradoxe : l’objectivité qui est à la base de toute science doit nécessairement
s’adosser en l’espèce à une subjectivité inébranlable qui est la caution de l’intuition, de la découverte, du
génie. Comment une science qui s’occupe des arcanes physiologiques, mais aussi psychologiques, d’un
sujet pourrait-elle ne pas être, en partie du moins, marquée au sceau de la subjectivité ? Comment un
médecin pourrait-il investiguer le corps d’un patient en faisant abstraction de ses propres grilles de
lecture ?
Les mots traduisent cet état d’esprit. Ils donnent aux termes leur sens en les emplissant de vie. En
traduction médicale, être à l’affût des sentiments, des sensations, c’est être à l’écoute du sens. Si les termes
font appel inconsciemment à la langue répertoire, les mots organisent l’univers physiologique selon des
critères holistiques. La question fondamentale est la suivante : le discours médical cautionne-t-il le
caractère scientifique de la discipline par une terminologie, à savoir un lien indéfectible entre une notion et

2
une dénomination, ou ce discours fait-il aussi la part belle aux mots, qui mettent en jeu un lien elliptique,
métonymique, voire métaphorique, entre la notion et sa matérialisation linguistique ?
Ayant observé de nombreux dialogues dans des services hospitaliers de pointe, ayant parcouru de
nombreux protocoles et diagnostics transmis de confrère à confrère,
a fortiori
dans un même domaine de
spécialité, j’ai pu remarquer le caractère central du langage naturel spontané dans les processus de
communication entre médecins. Il y a une oralité dans les communications écrites entre spécialistes. Le
langage médical est pour nombre de médecins un « parlécrit » pour reprendre l’expression de Jeay
(1991 : 47).
En n’ancrant pas la médecine dans une sociologie diachronique par un souci d’actualisation, la
terminologie a souvent préféré dans ses analyses des domaines de spécialité le linguistique au détriment du
discursif. C’est cette approche méthodologique, fondée sur une classification en tiroirs, qui a été
privilégiée par la terminologie pour éluder les vases communicants polysémiques. Il s’agit dans son esprit
de circonscrire l’usage d’un terme ou d’un syntagme à un domaine particulier dont il ne pourrait
s’échapper en gardant le même sens. Le sens équivaudrait dès lors à une signification prise dans l’étau
d’un domaine de spécialité au monologue singulier. Or, la monosémie d’apparence cache quelquefois des
sens plus profonds, imperceptibles si on ne lit pas sous la surface des signes linguistiques qui sont, eux
aussi, la simple matérialisation d’enjeux sémantiques et sémiologiques plus enfouis. J’en arrive alors à
mon deuxième paradoxe. Si l’on devait accréditer la thèse d’une terminologie scientifique,
monoréférentielle et univoque, la distinction entre approches synchronique et diachronique n’aurait aucun
sens. Les termes seraient les garants intemporels d’un lien notionnel qui traverse les époques sans
dommages, dans la mesure où la constante dénominative serait insensible aux outrages du temps. Ce n’est
assurément pas le cas.
En d’autres mots, la terminologie médicale dépend étroitement de l’environnement social qui la voit
naître. Elle relève des modes de raisonnement qui induisent les évolutions techniques plutôt qu’ils ne les
suivent. L’hyperspécialisation actuelle fait que même l’interniste peut être désarmé devant un patient
d’une cinquantaine d’années qui lui commente un résultat ou lui cite un nom propre dont il n’a jamais
entendu parler. Être spécialisé, c’est aussi méconnaître des pans entiers du savoir médical. C’est là toute la
difficulté de rédiger des dictionnaires et des bases de données terminologiques qui conjuguent
harmonieusement actualisation du domaine et vision épistémologique large.
Cela ouvre la voie au sociolecte médical, lequel véhicule aussi une théorie du langage des fonctions qui
résiste aux tentatives de hiérarchisation et d’inclusion. Le vocabulaire et les modes d’expression de la
médecine sont
professionnels
, c’est-à-dire qu’ils ne sont pas nécessairement
savants
. Cela explique
également que ce vocabulaire se renouvelle sans cesse ou, mieux, qu’il est renouvelé par la communauté
scientifique au fil des découvertes ou des modes. C’est ainsi qu’avec le temps la phtisie s’est muée en
tuberculose et que l’anaphylaxie est devenue l’allergie. C’est la compréhension intime du
modus operandi
de l’affection qui en change la dénomination. Mais l’évolution médicale n’induit pas nécessairement une
correction lexicale. L’hystérie n’est bien entendu plus considérée comme à l’époque de Charcot (1889) et
son étiologie « utérine » si je puis dire est depuis longtemps délaissée. Le terme n’a pourtant pas changé.
Même au plan synchronique, le discours médical se caractérise – et c’est le cas de nombreuses activités
humaines – par une
compréhension opérative
comme l’écrit Ochanine
(1978 : 63-79), à savoir la
mobilisation cognitive d’un expert dans une situation qui lui est habituelle, dans un domaine circonscrit.
Au plan psychologique, une grille de lecture propre au domaine envisagé est déjà activée par
l’interlocuteur avant même que l’information ne lui soit fournie. Le langage opératif, ce dialecte particulier
aux experts, est économique, il évite la redondance en faisant l’impasse dans le discours sur les
connaissances partagées. L’économie cognitive autorise le « devenir » (j’insiste sur cette notion)
monosémique du terme.
Cette compréhension opérative a été décrite par Chibout, Kotowicz et Briffault (2003 : 103) :
– le
laconisme
et l’
adéquation à la tâche
: seuls les éléments pertinents de l’objet par rapport à la tâche en
cours sont pris en compte ;

3
– la
déformation fonctionnelle
: certains traits de l’objet, de la situation ou de l’opération sont accentués
par rapport aux autres.
Les outils par excellence de ce discours sont les raccourcis de langage d’une part, et la figure
métonymique ou elliptique d’autre part, le procédé métaphorique enfin.
Voici l’un ou l’autre exemple de raccourci :
– les acronymes : ASP pour abdomen sans préparation (en radiologie) ; UIV pour urographie
intraveineuse ;
– des abréviations, souvent des apocopes : « nucléo » pour nucléolyse ; « endo » pour endoscopie ; « bru »
(voire « rub ») pour René Brugière, le patient qui permit à Luc Montagnier d’identifier le VIH à l’Institut
Pasteur de Paris en 1983.
La figure métonymique ou elliptique :
– « Il y a encore un foie et un rein qui vont monter » (en salle d’opération) ;
– « Le transit est sur la table » (en radiographie) ;
– « Amenez l’ulcère pour un contrôle ».
Il est à noter que dans ces exemples la métonymie se rapporte chaque fois au patient. Mais ce n’est pas
toujours le cas, comme le montre le phénomène de polysémie suivant dans le cadre d’un service de
radiologie :
– « L’infirmière est allée chercher le foie du quatrième » (patient) ;
– « Affichez-moi le foie » (cliché sur le négatoscope) ;
– « Il y a un foie qui vient de tomber » (demande de radiographie) ;
– « Il faut retaper ce foie » (le protocole d’examen clinique contient des coquilles).
On peut dire que nous sommes en présence à la fois de contractions du signifiant par l’utilisation
d’acronymes et d’abréviations, et de contractions du signifié par le jeu des métonymies.
Cette notion linguistique de contraction du signifiant et du signifié a bien entendu un relais dans la
pensée du praticien : la dépersonnalisation du patient et, en aval, son appropriation par le corps médical
(Balliu 2002 : 77-101).
Les exemples cités le montrent bien : l’ulcère, le foie, le rein… Une théorie du langage des organes
s’est substituée à une vision holistique de l’homme. C’est à la fois la rançon d’une médecine
hyperspécialisée, divisée en sous-domaines, et qui ventile par la même occasion l’homme en territoires
anatomiques de spécialité. Même lorsque le thérapeute s’adresse directement au patient, il le subordonne à
une vision organique de l’art de guérir. Un exemple à mon sens extraordinaire : « Surveillez votre foie ! ».
L’organe se voit doté ici d’une personnalité morbide. Parfois aussi, le patient se voit dénué de toute
existence autonome comme dans : « Amenez le 212 en salle d’op’».
La terminologie médicale a été hantée ces dernières années par le fantôme de l’émiettement. Le
foisonnement des notions, la multiplication des dénominations et la complexité croissante des
connaissances ont poussé les terminologues à subdiviser les domaines en sous-domaines dans un premier
temps, en microdomaines ensuite. Le savoir médical devient extérieur au sujet, et le médecin en serait le
seul dépositaire en vertu d’une compétence intrinsèque. C’est le thème de l’appropriation de la maladie et
du patient par le médecin. Par exemple :
«
Un malade de Launay
est pris brutalement, trois heures après le repas, d’une douleur extrêmement
violente, qui se calme pendant tout le lendemain ; mais brusquement, dans la nuit, la douleur réapparaît. À
l’opération, on trouve une perforation cachée sous des fausses membranes. Le second temps peut être
tardif, comme dans
un cas de Courty
, où l’on voit, après un syndrome de perforation, un abcès

4
prégastrique évoluer, guérir, par l’incision, et la péritonite ne survenir que dans une deuxième crise,
plusieurs mois après (Mondor 1949 : 225) ».
Un autre cas d’appropriation du patient par le médecin est l’éponymie : la maladie d’Alzheimer, le
bacille de Koch, le sarcome de Kaposi, la maladie de Parkinson… Tous des médecins qui volent aux
patients la « paternité » de leur pathologie et qui, dans un nombre non négligeable de cas, ne peuvent pas
même revendiquer la paternité de leur guérison.
La communication médicale vise indubitablement des créneaux, des crédits de recherche, des
débouchés ; elle est autant orientée vers un positionnement dans la communauté scientifique que par la
seule volonté de faire progresser la discipline. La soif de notoriété, le statut universitaire, la reconnaissance
des pairs, autant d’alibis qui poussent le spécialiste à se revendiquer de son propre mouvement, à chercher
tantôt un père spirituel, tantôt des disciples, afin de créer une école de pensée ou du moins y appartenir. La
médecine, c’est aussi cela : une lutte d’influences et de pouvoir. À cet égard, la terminologie joue un rôle
capital, car elle symbolise et labellise la notion dans la société (Balliu 2005 : 1-19).
C’est plutôt le mot, voire le nom dans le cas de l’éponymie, associé à une découverte ou à une avancée
qui marque les esprits que le progrès en lui-même. Voici un exemple que je tire du merveilleux
Diagnostics urgents-Abdomen
d’Henri Mondor, qui fut pendant de longues années professeur de clinique
chirurgicale à la Salpêtrière. À propos de la douleur caractéristique des ulcères perforés, il écrivit ceci :
« La douleur abdominale, soudaine, atroce, angoissante,
le coup de poignard péritonéal de Dieulafoy
,
est le premier symptôme de la perforation »
(1949 : 194).
On remarquera le cousinage intellectuel fascinant de la terminologie éponymique et de sa définition à
l’aide de simples mots.
Le summum de l’appropriation se retrouve dans les génitifs d’appartenance, souvent dérivés des
génitifs saxons, comme dans la
listériose
(
Lister’s disease
), du nom du médecin anglais Joseph Lister,
professeur à King’s College à Londres. Rien de scientifique dans tout cela et une paternité parfois toute
relative, dans le sens où l’éponyme peut changer selon le pays.
Chose curieuse, le nom du découvreur de la maladie (ou de son guérisseur) peut en effet varier selon les
pays et la maladie, la même, porter des noms différents selon les latitudes. C’est ainsi que le goitre
exophtalmique hyperthyroïdien se dénomme
Graves’disease
dans les pays anglo-saxons, en l’honneur de
l’interniste irlandais Robert James Graves, alors qu’en Allemagne cette même maladie s’appelle
Basedow
Krankheit
, d’après le médecin allemand Karl Adolf von Basedow. En Italie, la même maladie est
dénommée
malattia di Flajani
, en hommage au médecin italien Giuseppe Flajani. En France, pays resté en
marge de cette dispute d’appartenance, l’affection porte généralement le nom de
maladie de Basedow-
Graves
(Navarro 1997 : 10).
Ce phénomène n’est pas linguistique. Sa matérialisation dans le discours est symptomatique du vécu
quotidien du praticien, lequel doit affronter la méfiance et l’opposition de ses confrères, lorsque lui-même
ne les leur fait pas subir. Plus la notoriété est en jeu, plus l’attitude scientifique semble devoir s’effacer au
profit de la position dans la société. Pour le dire autrement, l’effet d’annonce l’emporte sur l’annonce des
faits. À titre d’anecdote, je raconterai l’effervescence médicale qui entoura la mort de Léon Gambetta
(décédé d’appendicite rétro-cæcale non diagnostiquée) et qui n’est pas sans rappeler les savoureuses mises
en scène de la Faculté par Molière. Autour de l’illustre patient se trouvaient de non moins célèbres
praticiens : Charcot, Siredey, Verneuil et Lannelongue. L’épisode se passe en 1882 et voici ce que
consigne Lannelongue dans ses
Cliniques chirurgicales
de 1905 :
« Une opération aurait-elle sauvé le malade ? je ne saurais le dire, mais on devait et il fallait la
pratiquer. Ma conviction, là-dessus, était si profonde et si absolue que je tentai, en dehors du moment de
nos consultations, plusieurs démarches auprès de Charcot, de Verneuil, de Trélat pour les y déterminer. Je
croyais l’opération si nécessaire et si urgente que j’avais porté sur le malade, dès le 22 décembre, un
pronostic fatal, si on ne l’entreprenait pas… Mes propositions furent rejetées… À partir de ce moment, on
cessa de m’accorder autour de Gambetta la confiance dont j’avais joui jusqu’alors… » (1905 : 33)

5
En l’absence d’opération, Gambetta mourut le 31 décembre. Cette erreur de diagnostic et l’incapacité
des médecins à prendre la bonne initiative a dans le jargon médical une appellation empreinte de
délicatesse ; on appelle cela « abstention thérapeutique ».
L’immunologie – discipline à la base de la conception contemporaine de l’art médical – ne propose
plus seulement des balises ponctuelles, « organicistes » et synchroniques, mais la trame complexe et
diachronique de la causalité à l’œuvre dans la maladie. Le nouveau langage médical est celui du conte
immunologique qui met en scène un scénario policier où l’intrigue est fournie par l’enchevêtrement
logique et parfait d’une organisation de défense de l’organisme. C’est mon troisième paradoxe : le corps
médical tient un discours connoté, affectif, dans la mesure où le rapport à la pathologie est humain. Dès
lors, le discours médical dans son ensemble – car l’immunologie traverse horizontalement la structure
physiologique – devient métaphorique et recèle, derrière un style en apparence impersonnel, un combat
tout personnel contre la maladie. Pour le dire autrement, peu à peu le sujet pensant est réhabilité au sein de
la communauté des patients.
Voici un exemple que l’on retrouve dans cet aphorisme classique de la chirurgie abdominale :
« Le ventre de la péritonite ne crie pas toujours au secours ».
Ou encore, toujours à propos de la péritonite, ce conseil pour la palpation :
« Continuez à parcourir tout le ventre. Il est à peu près uniformément douloureux, tendu,
hyperesthésique. La douleur provoquée, son maximum ? Comme c’est difficile à préciser : partout, en
effet, la défense musculaire instantanée, rigide, indépressible : c’est le
ventre de bois
. À force de patience,
vous vous êtes cependant convaincu que c’est bien à droite et en bas qu’est la douleur la plus vive et la
contracture la plus durcie ». (Mondor 1949 : 72)
Ainsi, je dirais que la quête des enjeux enfouis sous la surface linguistique déplace l’attention du
traducteur vers l’auteur du texte et vers son destinataire.
Le lecteur non averti fera l’impasse sur ces enjeux latents ; mais le traducteur médical a pour tâche de
faire émerger le propos caché et d’éventer la ruse implicite. En présence d’un texte médical, le traducteur
se doit d’être un médecin des âmes. Comme je l’ai écrit ailleurs, un texte bien documenté n’est pas
forcément un texte bien traduit (2001 : 92-102).
Ordonner ces notions secourables, non pas en une longue suite, mais dans leurs liaisons ordinaires et
leurs écarts éventuels, m’a paru justifier l’effort de cet exposé.
 6
6
1
/
6
100%