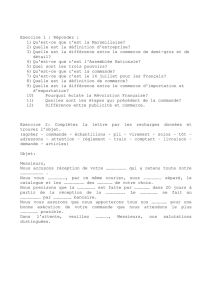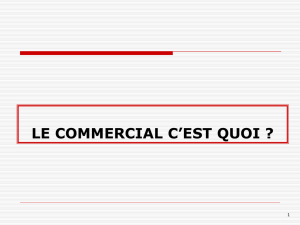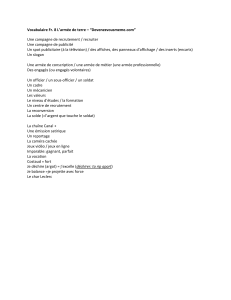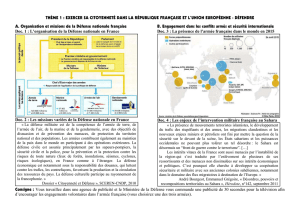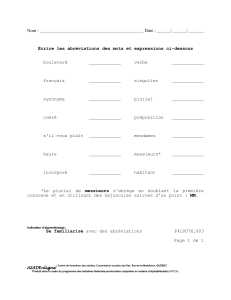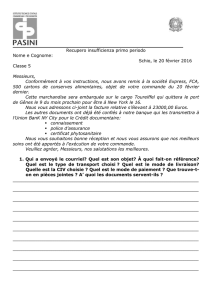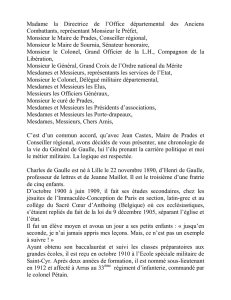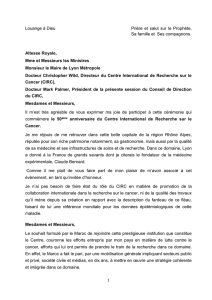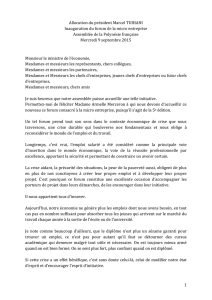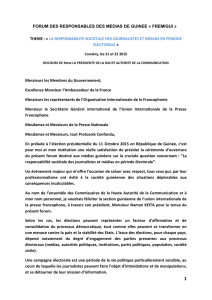DE MOLTKE La Guerre

1
DE MOLTKE
LA GUERRE
(illustration tirée du livre Das Eiserne Kreuz de Hanns von
Zobeltik, Volksbücher der Geschichte n°123, sans date, p.16)
HELMUTH KARL BERNARD DE MOLTKE était d’origine danoise. Il naquit à Parchim,
dans le Mecklenbourg, le 25 octobre 1800. Son père quitta sa première résidence pour aller s’établir
dans le Holstein, le jeune de Moltke fut envoyé de fort bonne heure avec un de ses frères à l’académie
militaire des Cadets, de Copenhague, d’où il sortit pour entrer dans l’armée danoise : On voit par là
que cet homme de guerre doit à sa patrie d’origine l’éducation militaire qu’il devait compléter dans sa
patrie d’adoption et tourner contre la première.
On pourrait juger fort sévèrement cette conduite qui a fait d’un des grands généraux du siècle
l’ennemi et presque le destructeur de son pays natal, mais il ne faut pas oublier qu’à l’époque où est né
de Moltke, le Danemark faisait partie, pour certaines de ses provinces, de la Confédération
germanique, et que cela suffisait pour faire de von Moltke, un Allemand. En outre, les duchés soumis
au Danemark étaient déjà habités par une population en grande partie allemande de langue, de mœurs
et de tendances. Ajoutons enfin que jamais personne n’a songé à lui faire un reproche de ce chan-
gement de patrie, auquel de Moltke se décida à un âge où il avait une conscience très claire de la
responsabilité qu’il prenait devant l’histoire.
Il avait vingt-deux ans quand il prit ce parti. Entré au service de la Prusse, il ne tarda pas à
acquérir la réputation d’un officier instruit, capable, et d’un grand avenir. Il connaissait fort bien les
principales langues européennes. Il était alors sous-lieutenant au 8erégiment d’infanterie. En 1823, il
fut admis à l’école de guerre de Berlin, où il compléta ses études jusqu’à l’automne de 1826. Dès les
premiers mois de l’année suivante, il était nommé instructeur de l’école attachée à la division de

2
Francfort-sur-l’Oder. Mais son mérite ne tardait pas à lui valoir partout un avancement rapide, de sorte
qu’en 1828, il était nommé à un emploi qui devait lui faciliter l’étude des grandes conceptions
militaires : il était appelé au département topographique du grand état-major général. En 1832, il
prenait dans ce corps une place qu’il devait garder en l’agrandissant tous les jours.
Ces progrès étaient d’autant plus remarquables qu’à cette époque, par suite de la longue paix,
du grand nombre des officiers, et de l’organisation militaire, l’avancement était d’une lenteur extrême.
Tout en passant par les diverses fonctions que nous avons indiquées, de Moltke n’avait encore que le
grade de lieutenant, où il fut maintenu pendant douze ans.
En 1835, il obtint un long congé, dont il passa la plus grande partie en Orient. Il reçut de son
gouvernement l’autorisation de prendre du service dans l’armée ottomane. À cette époque, Méhémet-
Ali avait déjà mis à exécution une partie de ses projets ; il voulait n’avoir vis-à-vis du sultan qu’une
dépendance nominale, et lui qui était d’une naissance infime, rêvait de fonder une dynastie. La Porte
avait répondu à ses propositions en le traitant comme un sujet révolté et en envoyant contre lui une
armée. Mais elle l’avait trouvé prêt à lui tenir tête. Il avait lui aussi son armée, dont il avait confié
l’organisation à des officiers français.
Le sultan, qui appréciait beaucoup les talents supérieurs de de Moltke, lui avait donné le
commandement de l’artillerie dans le corps envoyé contre Méhémet-Ali. Ce dernier, sachant à quoi
s’en tenir sur la désorganisation militaire et financière de la Turquie, avait hardiment envahi la Syrie,
et y attendait le choc des Turcs, au nombre de soixante-dix mille hommes, commandés par Hafiz-
Pacha. Les mollahs ou prêtres musulmans qui avaient suivi le général turc insistaient auprès de lui
pour qu’il livrât bataille immédiatement ; de Moltke eut beau représenter que l’état moral, le nombre
des troupes les rendaient inférieures à celles de Méhémet-Ali, il ne fut pas écouté : le combat
s’engagea le 22 avril et se termina le 24 par la déroute complète des Turcs. Le général qui les vainquit
était un Français. Comme de Moltke avait conseillé de battre rapidement en retraite, il était évident
que, quelque fût son talent, et lors même qu’il aurait eu le commandement en chef et sans contrôle
dans cette journée, il eût dû céder à la supériorité de l’armée commandée par l’officier français. Aussi
la carrière du grand tacticien, du grand stratégiste, du grand organisateur commençait par une défaite,
et la France pouvait à bon droit s’attribuer la victoire de Nedjib.
De Moltke s’empressa de renoncer à une situation qui lui avait valu ce fâcheux début, et
retourna à Constantinople, au moment même où le sultan Mahmoud II rendait le dernier soupir,
laissant le gouvernement entre les faibles mains d’un adolescent, Abdul-Medjid, âgé de seize ans.
Après la victoire de Nedjib, l’amiral turc ou capoudan-pacha avait capitulé devant la flotte de
Méhémet-Ali, et l’ambitieux parvenu était en mesure d’attaquer Constantinople par terre et par mer. Il
fut arrêté soudain par les représentations des grandes puissances, qui ne voulaient ni la guérison ni la
mort de l’homme malade, comme on a facétieusement désigné l’empire ottoman. Ce fut surtout la
crainte de voir la Russie intervenir en faveur du sultan, qui décida les puissances. Elles redoutaient que
la Russie ne fit payer son intervention par de vastes cessions territoriales et par une mise en tutelle et
indéfinie du sultan. La paix fut faite entre celui-ci et le vice-roi.
De Moltke retourna à Berlin, où il reprit ses fonctions dans le grand état-major ; les services
qu’il avait rendus à la Porte furent récompensés par la Prusse qui donna au jeune officier, alors
capitaine, la décoration du Mérite. L’année suivante, 1840, il fut envoyé à l’état-major du 4ecorps
d’armée, dont le centre était Magdebourg. Un congé qu’il obtint lui permit de rendre visite à sa sœur,
qui le fiança. Le mariage fut retardé par le service de de Moltke jusqu’en 1845, époque où il fut
nommé adjudant et désigné pour accompagner en Italie le prince Henri, oncle du roi. Ce personnage
était d’une santé très faible, qui lui interdisait toute participation à la vie publique et aux fonctions
militaires, de sorte que la mission de de Moltke était une sinécure qui lui laissait tous les loisirs
nécessaires pour ses études, ses voyages et ses distractions. Il emmena sa femme et passa deux ans à
Rome. La mort du prince, arrivée en 1847, mit fin à cette mission, et détermina le rappel de de Moltke,
qui fut envoyé comme chef de l’état-major de la huitième division, établie à Coblentz. Il y resta
jusqu’en 1856, où il fit un voyage en Russie, avec le prince royal. Ce fut pendant cette partie de sa vie
qu’il écrivit à sa femme ces lettres dont la publication fut un événement et un succès. Continuant à
suivre le prince royal, il assista aux fiançailles de Frédéric avec une des filles de la reine Victoria ;
cette cérémonie eut lieu à Balmoral. De Moltke visita d’ailleurs plusieurs fois l’Angleterre.
Jusqu’à présent nous avons toujours vu de Moltke dans une fonction subalterne, très favorable
sans doute pour l'étude, mais où toute initiative lui était interdite. Désormais son rôle va prendre une

3
importance capitale, et ses talents vont trouver un vaste champ d’application. En 1858 il est nommé
chef du grand état-major à Berlin, en même temps que de Roon est appelé au ministère de la guerre.
C’est à la collaboration et à la concorde de ces deux hommes que la Prusse doit d’être devenue
l’arbitre des destinées de l’Allemagne, alors que tout son passé lui prédisait un avenir bien différent,
de figurer au premier rang parmi les puissances de l’Europe centrale, d’avoir survécu à ses victoires, et
de conserver ses conquêtes avec quelque sécurité, malgré la perspective toujours menaçante de la
désagrégation, de la révolte et de la revanche.
Avant de continuer la biographie du grand homme de guerre, il nous semble nécessaire et
intéressant de mentionner parmi les nombreux voyages celui qu’il fit en France en accompagnant le
prince de Prusse en Angleterre. Ils arrivèrent en décembre 1861 à Paris, où le prince Jérôme les
attendait à la gare du Nord avec une escorte d’honneur. Ils montèrent dans une des voitures impériales,
suivirent le faubourg Saint-Martin, les boulevards de Strasbourg, Montmartre et Poissonnière, le
boulevard des Italiens et la rue de Rivoli jusqu’aux Tuileries, où l’empereur Napoléon III les attendait
sur le grand escalier et les présenta à l’impératrice. Le baron de Moltke fut logé au pavillon de Marsan.
Dans son carnet de notes on a trouvé les lignes suivantes relativement à ce voyage.
« Je m’étais représenté l’empereur plus grand ; il a très belle tournure à cheval ; il est moins
imposant à pied. Une fixité des traits, et le peu d’éclat de son regard, qui était presque éteint, pour
ainsi dire, voilà ce qui me frappa le plus en lui. Il a sur la physionomie un certain sourire de
bienveillance et même de bonté qui n’est guère napoléonien. Il est le plus souvent assis, la tête
légèrement inclinée de côté, et c’est justement cet air de calme, qui, au su de tous, ne l’abandonne
jamais, même dans les moments les plus critiques, qui fait le plus d’effet sur la mobilité française.
Toutefois cette impassibilité n’est nullement de l’apathie, c’est le résultat d’une énergie supérieure aux
émotions et d’une forte volonté, comme on l’a vu dans maintes circonstances. Dans un salon, il se
départ de toute attitude imposante, et montre dans la conversation de la bonhomie. C’est un empereur,
ce n’est point un roi. – Napoléon III n’a rien du regard sombre de son oncle, il n’en a point l’aspect
impérieux, ni la démarche calculée. – Louis-Napoléon a montré de la hardiesse, de la persévérance, de
la fermeté, de la confiance en lui-même, mais aussi de la modération et de la douceur, tout cela caché
sous un extérieur tranquille. Ce n’est qu’à cheval qu’il a l’air impérial. Simple dans sa personne, il
n’oublie pas que les Français veulent voir une cour brillante autour de leurs souverains. »
De Moltke visita alors la caserne nouvellement construite dite caserne Napoléon ; il en trouva
l’intérieur aussi sale que l’extérieur était somptueux. L’empereur assista devant lui à une revue de
vingt-deux bataillons d’infanterie dans la cour des Tuileries, et de Moltke trouva que les troupes
françaises avaient une tenue négligée, une marche irrégulière. Il prit part à une chasse organisée en
l’honneur des visiteurs à Fontainebleau ; il visita les trésors des musées parisiens, l’École militaire de
Saint-Cyr, les modèles et les précieuses collections du Musée d’artillerie. Il vit nos futurs officiers
faire l’exercice. Il inscrivit aussitôt la note suivante dans ses souvenirs de voyage :
« Les Français, tout en négligeant la précision dans les manœuvres, la recherchent et la
poussent jusqu’à la dernière limite dans l’exercice du fusil. Chez nous, il serait impossible d’obtenir
un son unique lorsque les crosses posent à terre, et il n’y a qu’une arme abîmée qui puisse résonner
aussi bruyamment. Cependant le fusil français est lourd, assez grossier, mais excellent et des plus
maniables. Il n’y a que les chasseurs à pied et la garde impériale qui soient pourvus de fusils rayés.
Une arme aussi délicate que notre fusil à percussion ne serait pas celle qu’il faudrait donner à
l’infanterie française ; car elle nécessite chez nous une attention continuelle, des précautions infinies à
exercer sur les hommes d’infanterie et leur arme. »
Le 22 décembre, les deux Allemands se remirent en roule pour Berlin ; ils traversèrent
Saverne et Strasbourg et de Moltke ajouta à son carnet la note suivante :
« Il était triste d’entendre (dans ces deux villes) parler allemand et cela par de bons Français.
Nous sommes véritablement coupables de les avoir plantés là. »
En 1863, la Prusse entreprit contre le Danemark une campagne diplomatique conduite avec
une mauvaise foi si peu dissimulée, que les hostilités ne tardèrent pas à éclater. De Moltke put ainsi
mettre à l’épreuve l’instrument de victoires et de conquêtes qu’il avait préparé, et faire cette
expérience sans danger ; il était évident que le petit État, s’il remportait quelques succès, était hors
d’état de les pousser bien loin. Pour plus de sûreté, la Prusse s’adjoignit une armée autrichienne ; les
deux corps, qui devaient suivre les plans préparés par de Moltke, étaient sous le commandement
effectif du général de Wrangel. Il eut à emporter d’assaut les fortifications danoises à Duppel.

4
L’honneur du petit État était sauvé, et il put traiter de la paix. Il paya les frais de la guerre et céda à
l’Allemagne les duchés de Sleswig, de Holstein et de Lauenbourg, par le traité du 30 octobre 1864.
Cette campagne eut pour résultat une modification profonde dans l’armement de l’artillerie prussienne,
qui fut bientôt pourvue de canons se chargeant par la culasse. En même temps, l’infanterie adoptait le
fusil à aiguille. L’Autriche, qui avait commis la faute d’aider la Prusse à chasser le Danemark de la
Confédération germanique, en fut à son tour chassée dès 1866, grâce à la supériorité que ces armes
assuraient à sa rivale. Notons toutefois que sur le champ de bataille, les meilleures armes ne
compensent jamais l’infériorité du nombre, de la tactique, de l’entraînement, et que l’Autriche eût été
battue, lors même que la Prusse n’aurait pas eu le fusil à aiguille. Elle avait des fautes et des
négligences à expier, et il en était tout autrement de la Prusse, conduite par M. de Bismarck, et armée
par de Moltke.
Ce dernier était en si haute faveur, que le 8 juin 1866, peu de jours avant le commencement
des opérations contre l’Autriche, il était nommé général d’infanterie. Le gouvernement prussien
déclara dissoute la Confédération germanique, somma chacun des États qui la composaient de prendre
parti pour la Prusse ou pour l’Autriche, et le 15 juin la guerre commença. Elle fut rapidement menée :
en peu de jours, les États secondaires étaient occupés par des troupes prussiennes ; malgré cette
rapidité foudroyante des premières manœuvres, le commandant en chef des Autrichiens se faisait
illusion sur la valeur de l’ennemi, et dans un ordre du jour lu aux troupes, faisait cette déclaration
insensée : « L’ennemi ne possède pas un seul général qui ait eu l’occasion d’apprendre ses devoirs sur
le champ de bataille. »
Le général autrichien ne tarda pas à s’apercevoir combien il se trompait. Malgré la rapidité
avec laquelle les opérations étaient conduites, il était bientôt réduit à se tenir sur la défensive, puis il
battait en retraite devant deux armées prussiennes dont chacune prise séparément était inférieure en
nombre à la sienne ; enfin il lui fallait assister à leur jonction sans pouvoir l’empêcher, et accepter dans
des conditions désastreuses une bataille si décisive, qu’elle fut la seule de toute cette campagne. À la
suite de la victoire de Sadowa, le roi de Prusse était en état de dicter ses conditions à l’empereur
d’Autriche ; la première, la plus importante de ces conditions, était que l’Autriche cesserait de faire
partie de la Confédération germanique. La Prusse y gardait non seulement sa place, mais y devenait la
puissance prédominante. De cette époque date une nouvelle phase pour l’histoire de l’Europe, dont la
politique devait s’orienter désormais sur celle du cabinet de Berlin.
À la suite de cette guerre, de Moltke fut élevé à la principale dignité dans l’ordre de l’Aigle
noir et nommé colonel honoraire du 20erégiment de grenadiers ; il reçut en plus une dotation de
200,000 thalers (700,000 francs environ), avec laquelle il acheta en 1857 la propriété de Kreisau, près
de Schweidnitz, dans cette Silésie qui était aussi une conquête de la Prusse sur l’Autriche. Il avait 66
ans lors de la campagne de Sadowa. L’on ne peut guère citer d’autre exemple d’un général dont les
débuts sur un vrai champ de bataille aient été aussi tardifs, mais il devait faire dans sa longue et verte
vieillesse tout ce que les Condé et les Hoche ont fait dans un âge que l’on peut presque appeler
l’adolescence.
Il avait d’ailleurs sous ses ordres des généraux de premier ordre. Il ne fut pas présent de sa
personne à la bataille de Koeniggraetz, qui est plus connue en France sous le nom de Sadowa mais le
prince royal de Prusse y exécuta d’une manière fidèle, intelligente et rapide les manœuvres indiquées
par de Moltke, et en somme c’est à ce dernier que revient la principale part dans la victoire.
L’année suivante, 1867, de Moltke fut élu comme député au premier Parlement de
l’Allemagne réorganisé par la Prusse, et y prit maintes fois la parole dans des questions militaires, et
les bavards qui pullulent dans ces sortes d’assemblées furent fort étonnés d’entendre la voix du
« grand silencieux », comme on l’avait déjà surnommé depuis bien des années ; il leur fallut
reconnaître la faculté qu’il possédait de convaincre sans éloquence ou du moins sans rhétorique, par le
seul langage de la raison et de la nécessité. Le 25 avril, de Moltke, qu’on peut appeler non seulement
le plus silencieux, mais encore le plus froid des hommes, celui qui regardait la guerre, avec toutes ses
conséquences, comme le plus noble des devoirs, éprouva le grand, peut-être le seul chagrin de sa vie :
sa femme mourut après une courte mais douloureuse maladie ; il n’avait pas d'enfants, il avait survécu
à presque tous les membres de sa famille ; il évita les consolations banales de la société, se replongea
avec une ardeur nouvelle dans ses études. Il lui restait cependant une sœur, veuve depuis longtemps,
elle vint s’établir auprès de lui avec son fils, bon musicien, qui fut bien accueilli du vieillard. Cette

5
société lui suffisait amplement. C’est dans la première année de sa retraite qu’il élabora les divers
plans de la guerre contre la France.
Après cette longue et minutieuse préparation de l’armée, de l’armement, des
approvisionnements, de l’espionnage, des plans de campagne, il ne restait plus qu’à attendre
l’occasion. La Prusse avait provoqué les hostilités contre l’Autriche, elle crut nécessaire d’attendre les
provocations de la France, ou plutôt de se faire déclarer la guerre par elle : il fallait bien faire quelque
étalage de modération et mettre de son côté les apparences du bon droit. M. de Bismarck se chargea de
cette partie de la tâche, et s’en tira avec son adresse, son bonheur ordinaires. Maintenant qu’il est
tombé du pouvoir et que bien des secrets se révèlent, on a quelques raisons de croire à une fourberie
bien digne d’un prince italien du XVIesiècle qu’aurait conseillé de Commines ou Machiavel.
L’histoire de M. de Bismarck nous causera sans doute plus d’une surprise, plus d’une indignation.
Quant à de Moltke, il était prêt ; il avait même élaboré quatre plans différents contre la France
; les uns, dans le cas où elle combattrait seule, les autres, dans le cas, difficile à prévoir, où la France
aurait eu des alliés qui n’attendissent que la première occasion, le premier coup de fusil pour entrer en
scène. Tous ces plans avaient été si admirablement construits que l’on put passer sans danger du
premier au second dès la fin de la quinzaine ; un troisième fut laissé de côté quand on vit que les États
de l’Allemagne méridionale adhéraient franchement à la politique prussienne. Le quatrième plan fut
définitivement adopté le 1er août, et l’on commença dès le 2 août à le mettre à exécution. Ce même
jour la France remportait à Spicheren un avantage dérisoire qui était peut-être calculé pour engager nos
troupes dans le filet tendu autour d’elles. Le 25 septembre, tout ce qui restait des armées françaises
tenant la campagne était obligé de se renfermer dans les places de Metz et de Sedan.
Après la capitulation, qui livra Napoléon III à l’Allemagne, la résistance réelle de la France
était concentrée dans la défense de Paris : en même temps, la guerre prenait le caractère de guerre
nationale, qui est si redoutable pour les vrais soldats. De Moltke condensa autour de Paris les
meilleures troupes de la confédération, en porta le nombre à 230,000 hommes, et maintint leur
communication avec le Rhin, pendant que 500,000 hommes divisés en plusieurs corps luttaient contre
les armées improvisées par la défense nationale. Pendant cinq semaines l’investissement de Paris eut
lieu en même temps que celui de Metz. Nous n’insisterons pas sur cette partie si connue et si
douloureuse pour nous de la biographie de de Moltke. Bornons-nous à dire que la victoire définitive
était bien son œuvre. Lorsque, au dîner qui eut lieu à la préfecture de Versailles pour célébrer la chute
de Paris, le vieil empereur serra de Moltke dans ses bras, il lui dit : L’Allemagne vous doit ce triomphe
des triomphes, jamais lèvres royales n’avaient dit plus sincèrement la vérité.
Lorsque la paix eut été signée, le baron de Moltke reçut le titre de comte, il fut promu au rang
de feld-maréchal, et fut récompensé par une magnifique dotation en espèces, qu’il employa à acheter
des domaines. Il revint à Berlin avec le roi de Prusse qui était désormais empereur d’Allemagne, et
lors de l’entrée triomphale dans la capitale de Frédéric le Grand, il eut aux ovations une part aussi
grande que celle de l’empereur et de M. de Bismarck. Le czar lui envoya la décoration de l’ordre de
Saint-Georges, chacun des États de l’Allemagne rivalisa d’empressement à honorer l’homme auquel
ils devaient leur subordination plus étroite à l’hégémonie prussienne, et aussi la part qu’ils avaient
prise au pillage et au démembrement de la France. Cette gloire ne changea rien aux habitudes de de
Moltke, il reprit sa vie studieuse et solitaire, et on ne le vit guère en public que lorsqu’il venait prendre
sa place au Parlement et donner sou avis sur une question qui intéressait l’armée.
C’est ainsi qu’il vécut, toujours travailleur, toujours solitaire, jusqu’au jour où la mort le
surprit. Comme la plupart des grands hommes de guerre, de Moltke avait des habitudes de simplicité
qui lui rendaient insupportable la cour et le salon. Ses traits avaient d’ailleurs une expression
d’austérité, et même de dureté et de sécheresse qui encourageaient peu la sympathie. Pendant les
dernières années de sa vie, qui se passèrent dans sa propriété rurale de Kreisau, il se levait à sept
heures du matin, s’habillait lui-même, en petite tenue d’officier, travaillait quelque temps, puis allait
faire une promenade avant de se remettre au travail, qui cette fois consistait dans la lecture des
journaux. Il déjeunait à midi, ensuite son adjudant lui lisait des livres de voyage, des biographies, de
temps à autre un roman. Si le temps le permettait, le vieux guerrier s’offrait le luxe d’une partie de
croquet, jeu où il était fort habile et montrait quelque talent stratégique. Il jouissait d’une excellente
santé, et ce ne fut que vers la fin de sa vie que son ouïe commença à s’affaiblir. Il aimait le jeu
d’échecs pour se distraire à l’intérieur autant que le croquet pour le plein air, et s’y faisait battre assez
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
1
/
17
100%