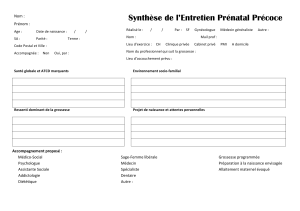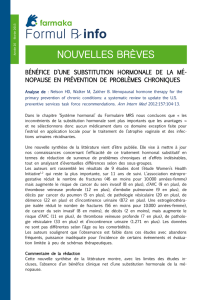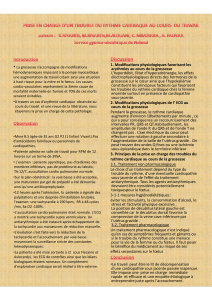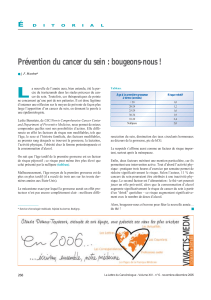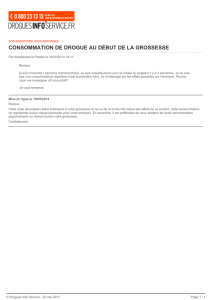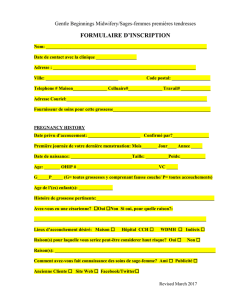Rapport du Comité national d`experts sur la mortalité maternelle

Rapport du Comité national
d’experts sur la mortalité
maternelle (CNEMM)
2001-2006
Unité 953. Recherche épidémiologique en santé périnatale,
santé des femmes et des enfants

Rapport du Comité national d’experts sur la mortalité maternelle (CNEMM) – 2001-2006 — Institut de veille sanitaire
Introduction 1. 2
Missions et fonctionnement du Comité national d’experts 2. sur la mortalité maternelle 3
Création et missions 2.1 3
Procédure adoptée par le CNEMM 2.2 3
Épidémiologie des morts maternelles en France 3. 5
Nouvelles estimations de la mortalité maternelle 3.1 5
Données de l’expertise 13.2 4
Étude spéciale : disparités régionales de mortalité maternelle en France : 3.3
situation particulière de l’IDF et des DOM, 2001-2006 17
Analyse clinique 24. 3
Hémorragies 24.1 3
Hypertension artérielle gravidique (HTA) 24.2 8
Embolies amniotiques 34.3 0
Thrombo embolismes 34.4 4
Accidents vasculaires cérébraux 34.5 7
Infections 34.6 9
Mortalité maternelle 4.7 et anesthésie 42
Causes obstétricales indirectes 44.8 4
Faits marquants en guise de conclusion 45. 8
Annexe 1 – Liste des assesseurs de l’enquête 49
Annexe 2a – Questionnaire 1996-2003 51
Annexe 2b – Questionnaire 2004-2006 72
Annexe 3 – Tirés-à-part d’études réalisées en partie avec les données de l’enquête 74
• Épidémiologie de la mortalité maternelle en France, fréquence et caractéristiques 74
• Can excess maternal mortality among women of foreign nationality be explained by suboptimal obstetric care? 82
• Surmortalité maternelle des femmes de nationalité étrangère en France et qualité des soins obstétricaux :
étude nationale 1996-2001 90
• Le rapport 2003-2005 sur la mortalité maternelle au Royaume Uni : commentaires et comparaison aux données françaises 94
Sommaire

Institut de veille sanitaire — Rapport du Comité national d’experts sur la mortalité maternelle (CNEMM) – 2001-2006 / p. 1
Rapport du Comité national
d’experts sur la mortalité
maternelle (CNEMM)
2001-2006
Analyse et rédaction du rapport
Marie-Hélène Bouvier-Colle
Catherine Deneux-Tharaux
Monica del Carmen Saucedo
Inserm U953 : recherche épidémiologique en santé périnatale, santé des femmes et des enfants, Paris
CNEMM
Pr Gérard Levy, président du comité, Aix-en-Provence
Dr Albertine Aouba, Inserm CépiDc, Le Vésinet
Dr André Benbassa, clinique Belledonne, Grenoble
Mme Marie-Hélène Bouvier-Colle
Pr Dominique Chassard, hôpital mère enfant, Bron
Dr Henri Cohen, Institut mutualiste Montsouris, Paris
Dr Serge Favrin, clinique de l’Union, l’Union
Dr Daniel Fillette, clinique Ambroise Paré, Toulouse
Mme Marie-Josée Keller, présidente du Conseil national de l’ordre des sages femmes, Bennwihr-Gare
Dr Corinne Le Goaster, InVS, Saint-Maurice
Pr Frédéric Mercier, hôpital Antoine Béclère et Université Paris-Sud, Clamart
Pr Francis Puech, hôpital Jeanne de Flandres, Lille
Dr Stéphane Saint-Leger, CHI Robert Ballanger, Aulnay-sous-Bois
Remerciements
Nos remerciements s’adressent à tous les professionnels de l’obstétrique qui ont consacré leur temps et leur expérience au recueil
des informations relatives aux décès maternels et sans qui la publication de ce rapport n’aurait pas été possible.
En particulier à :
tous les assesseurs anesthésistes réanimateurs et gynécologues-obstétriciens qui ont contribué directement aux investigations -
sur le terrain ;
aux experts qui ont analysé les cas et ont contribué à la rédaction du rapport - ;
à l’InVS et à l’Inserm qui soutiennent financièrement ces travaux.
-

p. 2 / Rapport du Comité national d’experts sur la mortalité maternelle (CNEMM) – 2001-2006 — Institut de veille sanitaire
Des morts maternelles évitables
Pr. Gilles Crépin, gynécologue-obstétricien, membre de
l’Académie nationale de médecine, France
La France peut, à juste titre, se féliciter d’être dotée de deux indicateurs
particulièrement enviables : un nombre croissant de naissances qui a
atteint 834 000 en 2008 et un indicateur conjoncturel de fécondité1
supérieur à 2. De ce fait, notre pays se situe au sommet des pays
européens en matière de natalité et de fécondité.
Ces données rassurantes ne doivent cependant pas cacher la réalité
beaucoup plus péjorative de la mortalité maternelle, de la morbidité
et de la mortalité périnatales. Si la mortalité maternelle, documentée
depuis plus de 15 ans par l’OMS2, situe la France dans la moyenne
des pays européens, elle reste en-deçà des meilleurs, et très loin de
la Suède dont les taux sont deux fois plus faibles.
Même si l’on peut discuter la crédibilité de certaines estimations
et nuancer ainsi les différences, le rapport3 du Comité national
d’experts sur la mortalité maternelle et le Bulletin épidémiologique
hebdomadaire n° 2-34 viennent à point pour apporter un éclairage
pertinent sur la réalité française actuelle de ce sujet particulièrement
sensible.
L’enquête a été menée par des experts d’une rigueur sans faille.
Elle a été établie sur une période à la fois récente (c’est la première
enquête de ce genre au cours de cette décennie) et suffisamment
longue (elle porte sur la séquence 2001-2006). Le rapport fait
la synthèse d’un très grand nombre de paramètres assortis de
recommandations exigeantes.
Parmi toutes les données présentées, trois d’entre elles méritent à nos
yeux une attention toute particulière :
le taux global de mortalité maternelle a certes régressé depuis -
2001, mais il s’élève encore à 9,6/100 000 naissances. De l’avis
des experts qui se sont penchés sur les principales causes,
le plus alarmant réside dans le chiffre de 50 % (46 % précisément)
de morts évitables, ou présumées telles, et le plus souvent liées
à des mesures thérapeutiques inappropriées. Ces 40 morts
maternelles par an procurent le vertige. Elles requièrent des mesures
fortes là où ces situations sont les plus pressantes ;
la disparité entre l’Ile-de-France, les Départements d’outre-mer et -
l’hexagone, de même que les différences entre population française
et population d’origine étrangère, sont hautement significatives.
Elles exigent des investigations approfondies ;
un tiers des décès n’a pas été expertisé dans l’enquête faute -
de
dispositions officielles permettant une exhaustivité pourtant
essentielle
et fondamentale. De même, on ne relève que 20 %
d’autopsies, chiffre faible par rapport aux pays anglo-saxons.
De telles lacunes dans le système de recueil d’informations
à l’échelon national peuvent laisser supposer un nombre de morts
évitables supérieur.
Il faut très vivement remercier et féliciter les responsables, les auteurs
et les experts qui ont contribué de manière exemplaire à l’élaboration
de cette publication référence.
Cet authentique "document vérité" se doit d’interpeller les pouvoirs
publics, les décideurs à tous niveaux de responsabilité, et tous les
professionnels de santé impliqués dans la naissance. Il doit permettre
d’atteindre l’objectif d’un recueil de la totalité des décès, même s’il
s’agit de situations dramatiques. Il doit être à l’origine de mesures
radicales et contraignantes et d’une application rigoureuse de
recommandations déjà existantes ou à codifier.
C’est le seul moyen de passer de l’espoir à la réalité, afin d’obtenir la
réduction drastique des chiffres actuels et mieux encore l’éradication
complète du spectre insoutenable des morts maternelles évitables.
1
"Naissances et fécondité en 2008" sur le site Internet de l’Insee : www.insee.fr
2
Betran AP, Wojdyla D, Posner SF, Gulmezoglu AM. National estimates for maternal mortality: an analysis based on the WHO systematic review of maternal
mortality and morbidity. BMC Public Health. 2005;5:131.
3
Disponible sur le site Internet de l’InVS : www.invs.sante.fr
4
La mortalité maternelle en France : bilan 2001-2006. Bulletin épidémiologique hebdomadaire (BEH) n° 2-3, 19 janvier 2010 ; InVS. Disponible sur le site Internet
de l’InVS : www.invs.sante.fr
Introduction1.
Ce texte est la reprise de l’éditorial paru dans le Bulletin épidémiologique hebdomadaire (BEH) n° 2-3 du 19 janvier 2010.

Institut de veille sanitaire — Rapport du Comité national d’experts sur la mortalité maternelle (CNEMM) – 2001-2006 / p. 3
Missions et fonctionnement du Comité national 2. d’experts sur la mortalité maternelle
Création et missions2.1
La création, par arrêté du ministère de la Santé, du Comité national
d’experts sur la mortalité maternelle (CNEMM) remonte au 2 mai 1995.
La composition de ce comité a été définie par un premier arrêté de
nomination du 18 septembre 1995. Il a été renouvelé en septembre
1998 et 2001.
En 2006, en vertu des missions qui lui sont confiées, l’InVS a eu la
charge de reprendre les activités gérées initialement par la DGS,
et une convention a été signée entre l’InVS et l’unité 149 de l’Inserm
afin que puisse être réalisée l’Enquête nationale et confidentielle sur
la mortalité maternelle (ENCMM). Ainsi le comité a pu poursuivre son
activité d’expertise. Outre les membres de droit, Direction générale
de la santé (DGS), Direction des hôpitaux et de l’organisation des
soins (Dhos), Conseil national de l’ordre des sages-femmes, Caisse
nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés (CnamTS),
le comité comprenait douze personnalités qualifiées des établissements
publics et privés : cinq gynécologues-obstétriciens, trois anesthésistes-
réanimateurs, trois épidémiologistes et une sage-femme.
Les missions du comité ont été fixées comme suit : analyse confidentielle
des décès maternels, proposition de mesures de prévention concernant
la mortalité maternelle et rédaction en fin de mandat d’un rapport au
ministre sur les causes et l’évolution de la mortalité maternelle.
Procédure adoptée 2.2 par le CNEMM
La procédure démarre par le repérage des cas potentiels au Centre
d’étude épidémiologique sur les causes médicales de décès (CépiDc)
de l’Inserm, à partir des certificats médicaux de décès. Lorsqu’un
décès de femme est associé à un état gravido-puerpéral, le CépiDc
écrit au médecin certificateur du décès pour l’informer de l’existence
de l’enquête confidentielle sur les morts maternelles et l’inviter à y
participer. Si lui-même n’est pas en mesure de fournir les renseignements
complémentaires nécessaires, il lui est demandé d’indiquer le nom et
les coordonnées du (ou des) médecin(s) à contacter éventuellement.
Les coordonnées de ces médecins sont transmises à l’Unité de
recherches épidémiologiques en santé périnatale et santé des femmes,
de l’Inserm (unité 149, unité 953 depuis janvier 2009), qui avise deux
assesseurs, l’un parmi les gynécologues-obstétriciens, l’autre parmi
les anesthésistes-réanimateurs. Ceux-ci sont chargés de remplir le
dossier type, en se mettant en rapport avec la ou les équipes médicales
concernées.
Les assesseurs sont choisis sur une liste officielle qui a été déterminée
par les instances professionnelles, le Collège national des gynécologues
et obstétriciens français d’une part et la Société française d’anesthésie
réanimation d’autre part. Les assesseurs n’ont pas connaissance de la
cause ayant été portée sur le certificat médical de décès. Pour identifier
le cas, ils connaissent la date de naissance et la date de décès de la
patiente et ils disposent des coordonnées du ou des médecins avec
lesquels se mettre en rapport.
Les assesseurs jouent un rôle central, car ils ont à remplir un dossier
standard le plus précisément et le plus complètement possible.
Ce dossier a été élaboré par le comité pour être complété à partir
des informations recueillies auprès des professionnels et à partir
des dossiers médicaux (feuilles de soins, résultats des examens
de laboratoire, compte-rendu opératoire, rapport d’autopsie).
Toutes les pièces complémentaires utiles doivent être jointes au
dossier, après avoir été strictement anonymisées. Mais il n’y a
qu’un seul dossier par cas, rempli en concertation par les deux
assesseurs.
L’action des assesseurs est essentielle à cette étape, pour rassembler
les éléments indispensables au travail du Comité national, car une
fois le dossier rendu anonyme, et retourné à l’unité 149/953 de
l’Inserm, il n’est plus possible de revenir à la source pour demander
des compléments d’information.
Les dossiers parfaitement anonymes (on ne connaît ni la région
d’origine, ni naturellement les noms des patientes, des établissements
ou des médecins concernés) sont ensuite analysés au sein du Comité
national d’experts qui se réunit en commission plénière. Tous les
membres du comité reçoivent copie de tous les dossiers complets.
Deux rapporteurs sont plus spécialement chargés de rapporter le cas
en séance afin de procéder à son expertise. L’expertise est réalisée
collégialement. Elle a pour but : premièrement de préciser la cause
du décès (choix d’une cause initiale ou principale) et donc de se
prononcer sur la nature obstétricale directe ou indirecte de la cause
de décès ; deuxièmement de dire si les soins ont été optimaux ou
non ; et troisièmement d’énoncer les conditions auxquelles le décès
aurait pu éventuellement être évité. Les conclusions sont arrêtées
après discussion et de manière consensuelle.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
 52
52
 53
53
 54
54
 55
55
 56
56
 57
57
 58
58
 59
59
 60
60
 61
61
 62
62
 63
63
 64
64
 65
65
 66
66
 67
67
 68
68
 69
69
 70
70
 71
71
 72
72
 73
73
 74
74
 75
75
 76
76
 77
77
 78
78
 79
79
 80
80
 81
81
 82
82
 83
83
 84
84
 85
85
 86
86
 87
87
 88
88
 89
89
 90
90
 91
91
 92
92
 93
93
 94
94
 95
95
 96
96
 97
97
 98
98
 99
99
 100
100
 101
101
 102
102
1
/
102
100%