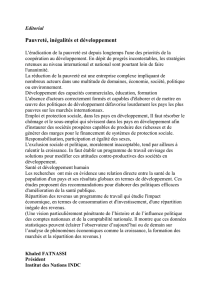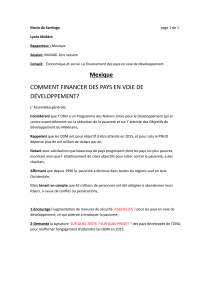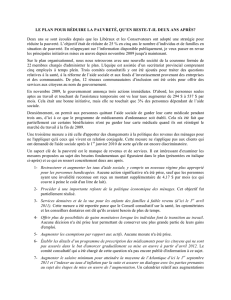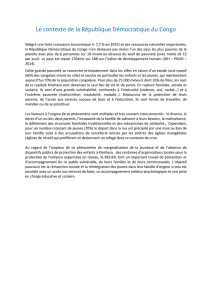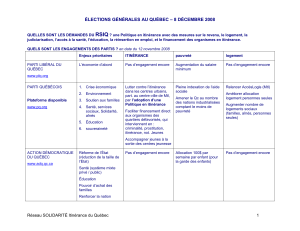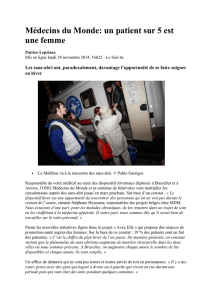Comparer l`incomparable ? Les personnes à la rue

0
COMPARER L’INCOMPARABLE ?
Les personnes à la rue : Belgique, France, Québec
RAPPORT DE RECHERCHE FINAL
Sous la direction de Pascale Pichon
avec les chercheurs du réseau :
Bernard Francq, Shirley Roy, Marc-Henry Soulet,
Jean-Marie Firdion, Maryse Marpsat
Janvier 2007
Réf contrat : SU04000173
CRESAL- UMR 5043
6 rue Basse des Rives
42 023 Saint-Etienne cedex

1
SOMMAIRE
Préalable
INTRODUCTION
PREMIERE PARTIE
NOMMER : LA GENESE D’UN PROBLEME SOCIAL DANS DIFFERENTS CONTEXTES
Chapitre -1 Travail de distinction des pauvres et régulations sociales : la naissance de l’itinérance au
Québec (S. Roy)
Chapitre -2 Construction d’un problème social et émergence de la catégorie SDF en France (P.
Pichon)
Chapitre -3 Irrésolution des politiques publiques en Belgique : des pauvres aux sans-abris (B. Francq)
DEUXIEME PARTIE
ENQUETER : REFLEXIVITE ET IMPLICATION DES CHERCHEURS
Chapitre -4 : De l’action collective à une sociologie des épreuves (B. Francq)
Chapitre -5 : Rendre visible et penser la complexité du phénomène de l’itinérance (S. Roy)
Chapitre -6 : Observer et décrire un monde : de la carrière de survie à la forme idéal-typique de la
dérive urbaine (P. Pichon)
Encart : Enquête statistique et subjectivité du chercheur (J-M. Firdion)
TROISIEME PARTIE
ORGANISER LA RECHERCHE : LES INSTITUTIONS, LES JEUX D’ACTEURS ET LEURS EFFETS
Chapitre 7- : La genèse de la recherche en France : composer avec le mouvement associatif, observer
et analyser des situations vécues et des rapports sociaux, caractériser et compter. (M. Marpsat, P.
Pichon)
Encart : Développer des choix théoriques et méthodologiques : l’approche statistique (J-M. Firdion)
Chapitre 8- : En Belgique : Un modèle de concertation, entre exemplarité et impuissance (B. Francq)
Chapitre 9- : Québec : Le partenariat, une approche innovante (S. Roy)
CONCLUSION

2
PREALABLE
Arrivés au terme de nos séminaires de recherche qui se sont déroulés en France, au Québec,
en Belgique, les chercheurs sont parvenus à réaliser l’objectif principal : éclairer différentes
dimensions de la réalité du phénomène du sans abrisme dans trois contextes et montrer
l’interdépendance entre les contextes nationaux et les actions entreprises en direction des
personnes ainsi désignées officiellement : sans domicile fixe, sans-abri ou itinérantes. Pour
autant, la démarche comparative que nous avons initiée n’a pas été sans obstacles car il fallait
trouver les modalités d’échanges qui ne se focalisent pas sur les approches théoriques
divergentes. Ne pas les effacer non plus.
C’est dans cette tension entre une visée comparative exploratoire et des acquis
méthodologiques et théoriques déjà très affirmés que se sont déroulés les dialogues,
volontaires, libres, enthousiastes parfois, mais aussi traversés par le doute, voire le
découragement. L’expérience a pu être conduite jusqu’au bout parce que nous avons opté
pour une logique comparative descriptive et épistémologique plus qu’explicative.
Ajoutons que la composition du réseau, petit par sa taille, a été à la fois une limite et une
facilitation. Limite parce que les chercheurs se sont appuyés essentiellement sur leurs propres
travaux de recherche -malgré leur connaissance des autres travaux nationaux- qui ne couvrent
pas le spectre des connaissances acquises en la matière, eu égard à la diversité des
problématiques et des investigations conduites ; limite parce qu’une seule discipline -la
sociologie- était convoquée ; limite encore, parce que seulement trois contextes étaient
représentés. Mais ces limites ont pu être retournées parfois en avantages. En effet, la
profondeur de l’exploration a permis de ne pas se perdre dans les spécificités des contextes.
Plus encore, le contre-point de la situation suisse -où le phénomène n’a pas trouvé de
résonances médiatiques et politiques- qui n’apparaîtra pas dans ce rapport, a pourtant été
déterminant pour confirmer les points d’appuis du travail comparatif. Sur ce point, nous
voulons souligner la participation de Marc-Henry Soulet -chercheur suisse- qui ne se lira pas
explicitement dans chacun des textes mais plus en filigrane, dans le travail de synthèse et dans
l’écriture conjointe des introductions des différentes parties du rapport. Enfin, l’exploration a
conduit parfois avec bonheur, à l’articulation entre le micro-sociologique et le macro-
sociologique. Au final, la principale facilitation a été celle de parler la même langue ce qui a

3
permis d’entrer directement dans des dialogues soutenus sur les contenus et les
problématiques de recherche comme sur ses enjeux politiques.
Dans notre projet initial de recherche nous notions : « Le constat le plus important est que
nous sommes à un moment critique dans les recherches portant sur les situations des
personnes à la rue : le phénomène s’est complexifié et transformé (…). Il paraît donc
nécessaire d’infléchir de manière raisonnée certains axes de recherche, de les faire converger
au niveau national mais aussi européen et international, non pas pour écraser les différences
de cultures et d’approches mais au contraire pour les mettre à jour et rendre le travail de
comparaison possible. » Nous espérons que la mise à jour des spécificités nationales, telles
que nous avons tenu à les décrire et les mettre en perspective est une première étape vers un
travail comparatif qui ne se contente pas de considérer l’expérience extrême de l’homme à la
rue mais qui prennent en compte le rapport étroit et inéluctable entre recherche et politique.
La lecture du rapport permettra d’en relever les enjeux.
****
Ce rapport de recherche constitue la première version d’un ouvrage qui a pour visée d’élargir
le cercle du petit réseau initial. En effet, notre réseau n’a pas vocation à se refermer. Nous
voudrions au contraire poursuivre le questionnement, en prenant pleinement en compte les
acquis de notre travail commun. La comparaison pourrait se déployer de deux façons : d’une
part, en formalisant plus que nous ne l’avons fait, l’objet même de la comparaison : le lien
entre politique (question sociale et urbaine) et recherche ; d’autre part, en ce centrant sur les
situations limites, qui débordent la question des personnes à la rue mais qui toutes, interrogent
l’espace urbain contemporain. Les apports de recherche de la sociologie du sans-abrisme sont,
sur ces deux registres, essentiels mais peu exploités encore.

4
INTRODUCTION
Au moment de l’écriture de ce rapport de recherche qui présente les résultats du travail en
réseau des chercheurs français, belge et québécois, l’actualité s’impose une nouvelle fois à
nous. La médiatisation du mouvement de lutte des « Enfants de Don Quichotte » poursuivant
l’action dite « des tentes » initiée par Médecins du monde, l’avant-projet de loi relatif au droit
au logement opposable, font l’objet de débats publics en France. La mort de l’abbé Pierre,
figure charismatique et publique de la lutte pour les sans logis et les mal logés devient au
même moment, l’occasion de dresser le bilan des formes pérennes ou nouvelles d’inégalités
sociales et d’injustice sociale. La « question SDF », loin d’être résolue -mais le pourrait-
elle sans un remaniement profond du projet social au regard des enjeux nationaux et
internationaux ?- ne fait pas l’objet d’un diagnostic consensuel éclairé1 mais réinstruit le
procès du « concernement » du public, en exacerbant l’émotion et la compassion face à
l’insupportable - ne pas avoir de toit, mourir de froid, de maladies, d’épuisement, dans la rue -
qui demeurent les leviers principaux de la réaction politique sur le court terme. Cette actualité
nationale n’est pas sans impact sur d’autres réalités nationales et renforce le questionnement
initial des chercheurs du réseau, dont les travaux ont contribué à l’analyse du phénomène dit
du sans-abrisme ou de l’itinérance, et des situations des personnes à la rue dans les pays
riches.
En effet, notre travail en commun est né d’une interrogation portée sur la place et l’utilité de
la recherche face à l’installation et la banalisation du phénomène, à sa diffusion dans
d’autres pays émergents, à la carence souvent, d’une politique de recherche concerté entre
les financeurs publics. L’histoire présentée ici voudrait précisément articuler le temps
présent de ce constat et les conditions de possibilité des recherches conduites depuis les
années 90. Notre démarche commune se centrera sur les enjeux sociétaux et politiques dans
lesquels s’inscrit toute démarche de recherche et de connaissance. Elle n’a d’ailleurs pas
écarté d’autres formes de connaissances (journalistiques, associatives, professionnelles,
issues de l’expérience) qui se sont développées au cours de la même période et qui l’ont
1 Les grandes associations se positionnent d’ailleurs en tant qu’experts face au « jeune » mouvement des « enfants de Don
Quichotte » et mettent en garde les pouvoirs publics contre toute illusion de résolution à court terme du problème.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
 52
52
 53
53
 54
54
 55
55
 56
56
 57
57
 58
58
 59
59
 60
60
 61
61
 62
62
 63
63
 64
64
 65
65
 66
66
 67
67
 68
68
 69
69
 70
70
 71
71
 72
72
 73
73
 74
74
 75
75
 76
76
 77
77
 78
78
 79
79
 80
80
 81
81
 82
82
 83
83
 84
84
 85
85
 86
86
 87
87
 88
88
 89
89
 90
90
 91
91
 92
92
 93
93
 94
94
 95
95
 96
96
 97
97
 98
98
 99
99
 100
100
 101
101
 102
102
 103
103
 104
104
 105
105
 106
106
 107
107
 108
108
 109
109
 110
110
 111
111
 112
112
 113
113
 114
114
 115
115
 116
116
 117
117
 118
118
 119
119
 120
120
 121
121
 122
122
 123
123
 124
124
 125
125
 126
126
 127
127
 128
128
 129
129
 130
130
 131
131
 132
132
 133
133
 134
134
 135
135
1
/
135
100%