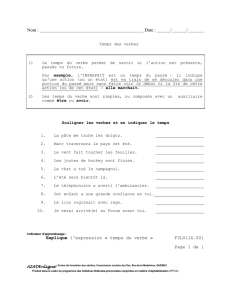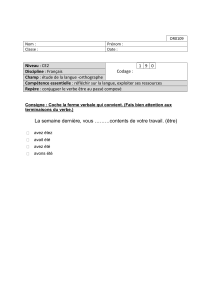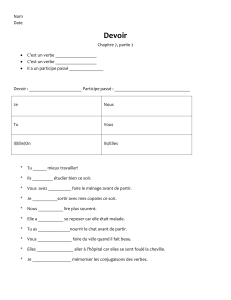Valence verbale, transitivité et voix

Chapitre 21
Valence verbale, transitivité et voix
21.1. La notion de valence verbale
Par valence verbale on entend l’ensemble des propriétés de rection des verbes,
des deux points de vue sémantique et syntaxique :
(a) sémantiquement, le signifié lexical de chaque verbe implique la participation
d’un nombre déterminé d’
arguments
(entités qui jouent chacune un rôle précis dans
le type d’événement ou de situation signifié par le verbe), et conditionne en outre
plus ou moins la possibilité d’introduire dans la construction des constituants
ajoutant divers types de précisions, notamment la mention d’autres entités peuvant
participer à l’événement, ou des circonstances de l’événement ; par exemple,
couper
dans son acception la plus courante implique sémantiquement deux arguments, un
agent et un patient, mais le sens de ce verbe suggère aussi l’intervention possible
d’un instrument, à la différence par exemple d’un verbe comme
saisir
;
(b) syntaxiquement, chaque constituant nominal assumant dans la construction
d’un verbe un rôle sémantique déterminé présente des caractéristiques formelles
susceptibles de le distinguer des autres constituants nominaux participant à la
construction du même verbe avec des rôles sémantiques différents.
Il n’y a pas une correspondance simple et directe entre la valence sémantique et
la valence syntaxique d’un verbe. La relation entre rôles syntaxiques et rôles
sémantiques est évidente au niveau de chaque verbe pris individuellement, mais il
n’est pas facile de déterminer jusqu’à quel point il est possible de faire des
généralisations, et dans quelle mesure ces généralisations sont indépendantes des
langues particulières. Autrement dit, la connaissance de la valence verbale qu’ont
les locuteurs d’une langue met probablement en jeu à la fois des règles universelles
de correspondance entre propriétés sémantiques et propriétés syntaxiques des
verbes, des règles spécifiques de leur langue, et enfin des choses relevant d’une pure
et simple mémorisation, mais il est difficile de se faire une idée précise de la part
respective de ces divers facteurs.
La valence d’un lexème verbal ne doit pas être conçue comme déterminée de
manière unique. Beaucoup de verbes ont plusieurs possibilités de construction, du
double point de vue syntaxique et sémantique. La relation entre les différentes
constructions d’un même verbe peut relever de mécanismes relativement généraux,
mais parfois aussi les variations dans la valence d’un lexème verbal peuvent tenir à

2 Syntaxe générale, une introduction typologique
un phénomène de polysémie ne se prêtant à aucune généralisation, comme
l’illustrent avec le verbe français
prendre
les trois phrases
L’homme a pris une
cigarette / L’infirmière lui a pris la température / L’hortensia a pris
.
21.2. L’ambitransitivité
21.2.1
Remarques générales
Selon la définition posée en 17.2.2, une construction comportant deux termes
nominaux ayant les mêmes caractéristiques morphosyntaxiques que l’agent et le
patient des verbes d’action prototypiques est dite transitive, et toute construction ne
comportant pas un couple <
A
,
P
> est désignée comme intransitive (les
constructions parfois désignées comme ‘transitives indirectes’ étant désignées ici
comme constructions intransitives à argument oblique).
En toute rigueur,
transitif / intransitif
qualifie des constructions, et les verbes ne
peuvent être qualifiés de transitifs ou intransitifs que par un raccourci de langage.
En effet, dans la plupart des langues, on n’observe pas seulement des variations de
valence tenant aux diverses acceptions que peut avoir un lexème verbal
polysémique : en général, une proportion plus ou moins importante des verbes
d’une langue peuvent figurer également en construction transitive ou en
construction intransitive sans cesser de représenter le même type d’événement. On
peut désigner de tels verbes comme
ambitransitifs
, mais cette notion recouvre une
variété de mécanismes sémantiques, et la répartition des verbes d’une langue en
classes selon leurs propriétés de transitivité est rarement une question simple.
Les langues diffèrent en effet beaucoup dans la codification de la valence
syntaxique des verbes susceptibles d’entrer dans une construction transitive. On
peut dégager cinq grands types de comportements quant à la possibilité d’organiser
la valence de tels verbes sans toucher à leur forme (c’est-à-dire sans entrer dans le
cadre des mécanismes de voix dont il sera question un peu plus loin).
21.2.2
Verbes transitifs nécessairement construits avec un objet
Il peut y avoir selon les langues une classe plus ou moins importante de verbes
transitifs qui, en l’absence d’une modification morphologique relevant d’un
mécanisme de voix, sont totalement inaptes à entrer dans une construction où ne
figure explicitement, ni constituant nominal dans le rôle d’objet, ni indice d’objet.
21.2.3.
Omission de l’objet à valeur d’indétermination
Il peut arriver qu’un verbe apte à figurer en construction transitive puisse aussi
figurer tel quel dans une construction intransitive où le rôle syntaxique du sujet reste
inchangé, mais avec une signification d’indétermination quant à l’identité de
l’argument représenté par l’objet dans la construction transitive. En français, ce type
de comportement, qui est notamment celui du verbe
manger
, est assez commun,
sans être toutefois général. Il est beaucoup plus général en tswana – ex. (1).

Valence verbale, transitivité et voix 3
(1) a.
Ke y-a go rek-a ditlhako
S1S aller.FIN INF acheter.FIN 8/10chaussure
‘Je vais acheter des chaussures’
b.
Ke y-a go rek-a
S1S aller.FIN INF acheter.FIN
‘Je vais faire des achats’ (litt. ‘Je vais acheter’)
21.2.4.
Omission de l’objet à valeur anaphorique
Une troisième possibilité est que l’utilisation de verbes transitifs en construction
intransitive sans changement dans le rôle sémantique du sujet implique d’identifier
le deuxième argument du verbe transitif à un référent discursivement saillant. Ce
phénomène s’observe sporadiquement en français, mais il est beaucoup plus
systématique dans certaines langues. Par exemple, en baoulé – ex. (2), il est exclu
d’interpréter la phrase (2b) comme ‘Kofi a mangé’ (c’est-à-dire, avec une
indétermination quant à la chose mangée) ; la seule interprétation possible est ‘Kofi
l’a mangé’ (en se référant à quelque chose de précis déjà mentionné ou au moins
suggéré par le contexte), et la seule manière d’exprimer l’indétermination du second
argument du verbe ‘manger’ en baoulé consiste à faire explicitement figurer comme
objet un nom de sens général, comme en (2c).
(2) a.
kòfí dì-lì juê
Kofi manger-ACP poisson
‘Kofi a mangé du poisson’
b.
kòfí dì-lí
Kofi manger-ACP
‘Kofi l’a mangé’
(en se référant à quelque chose de précis, supposé connu de l’allocutaire)
c.
kòfí dì-lì àliɛ̌
Kofi manger-ACP nourriture
‘Kofi a mangé’
De manière analogue, en turc, l’absence de l’objet des verbes transitifs
s’interprète régulièrement comme ayant une valeur anaphorique, tandis que
l’expression d’une indétermination quant à l’argument objet tend à s’exprimer en
utilisant dans le rôle d’objet un nom apparenté au verbe (objet interne). Par
exemple, à côté de
kazak örmek
‘tricoter un pullover’, ‘faire du tricot’ se rend par
örgü örmek
, litt. ‘tricoter du tricot’ ; de même
elbise dikmek
‘coudre une robe’ /
dikiș dikmek
‘faire de la couture’, etc.
21.2.5.
Emploi intransitif de verbes transitifs à valeur réfléchie ou réciproque
En anglais,
wash
ou
shave
employés intransitivement ont une interprétation
réfléchie, et
kiss
ou
meet
employés intransitivement ont une interprétation

4 Syntaxe générale, une introduction typologique
réciproque. Beaucoup de langues ignorent totalement ce type d’ambitransitivité,
d’autres au contraire y ont recours beaucoup plus systématiquement que l’anglais.
21.2.6.
Emploi intransitif de verbes transitifs
avec changement de valence de type passif ou décausatif
On désigne parfois comme
labiles
1 les verbes transitifs dont l’emploi intransitif
implique que le rôle sémantique du sujet soit modifié de la même façon qu’auprès
d’une forme verbale passive, ou auprès d’une forme moyenne de sens décausatif.
Avec les verbes transitifs prototypiques, dont le sujet représente un agent, ce type de
comportement signifie qu’en l’absence d’objet, le sujet reçoit le rôle de patient ou
celui de siège du procès. Le français a ainsi un nombre relativement élevé de verbes
comme
baisser
, dont l’emploi dans
Le prix des tickets de bus a baissé
peut être
qualifié de décausatif par rapport à l’emploi transitif illustré par
La compagnie de
transport a baissé le prix des tickets de bus
.
Ce type d’ambitransitivité est pratiquement inexistant en tswana. Le bambara
illustre à l’opposé un cas de langue dans laquelle tout verbe transitif semble pouvoir
s’utiliser de cette façon, alors qu’en dehors d’un nombre limité de verbes transitifs
qui admettent une alternance de valence de type antipassif dans laquelle l’objet est
converti en oblique (cf. 26.3), il est extrêmement rare de pouvoir utiliser
intransitivement les verbes transitifs du bambara en maintenant le rôle sémantique
assigné au sujet. En règle générale, on ne peut signifier en bambara
l’indétermination du second argument d’un verbe transitif qu’au moyen d’une
construction dans laquelle le verbe ‘faire’ prend pour objet le nom de procès dérivé
du verbe transitif, comme l’illustre l’ex. (3).
(3) a.
N bɛ sogo dun
PRO1S INACP.POS viande manger
‘Je mange (de) la viande’
b.
*N bɛ dun
PRO1S INACP.POS manger
(pourrait seulement signifier ‘On me mange’, ou ‘Je suis comestible’)
c.
Sogo bɛ dun
viande INACP.POS manger
‘La viande, ça se mange’ ou ‘On est en train de manger la viande’
d.
N bɛ domuni kɛ
PRO1S INACP.POS action de manger faire
‘Je mange’
1 On trouve aussi selon les auteurs, avec le même sens, des termes comme
réversible
,
symétrique
ou
neutre
.

Valence verbale, transitivité et voix 5
21.2.7.
Situations complexes : le cas du basque
En fonction de la morphologie verbale de chaque langue, on peut rencontrer des
structurations du phénomène d’ambitransitivité qui combinent de manière plus ou
moins complexe les possibilités qui viennent d’être énumérées.
Par exemple, en basque, un verbe potentiellement transitif peut généralement
s’employer intransitivement avec une signification de type passif ou décausatif : dans
ikusten du
‘il/elle le/la voit’, l’auxiliaire transitif
du
marque l’accord avec un sujet et
un objet tous deux de 3ème personne du singulier), alors que dans
ikusten da
‘il/elle
est visible, ça se voit’, la même forme du verbe ‘voir’ se combine à l’auxiliaire
intransitif
da
qui marque seulement l’accord avec un sujet de 3ème personne du
singulier). Mais ce n’est là qu’une partie de l’histoire, car une phrase telle que
Ez du
ondo ikusten
(avec l’auxiliaire transitif
du
) peut selon les contextes s’interpréter, soit
comme ‘Il/elle ne le/la voit pas bien’ (le deuxième argument de ‘voir’ s’identifiant à
un référent contextuellement saillant), soit comme ‘Il/elle n’y voit pas bien’ (avec
indétermination quant au deuxième argument de voir). Une explication possible est
que les formes du verbe transitif basque couramment considérées comme marquant
l’accord avec un objet de 3ème personne du singulier sont plutôt les formes par
défaut du verbe transitif, qui en l’absence d’un constituant objet permettent aussi
bien l’identification du deuxième argument du verbe transitif à un référent
contextuellement saillant qu’une interprétation de type indéterminé.
21.3. La notion de voix
Pour décrire un même événement, il est fréquent de pouvoir utiliser des verbes
différents ne présentant pas le même traitement syntaxique des constituants
nominaux qui représentent les participants (comme par exemple
vendre / acheter
).
Cet aspect de la valence verbale étant fondamentalement une question de
lexicographie, on n’en parlera pas plus ici.
Il arrive souvent aussi que des variations dans la construction d’un même verbe
sans aucun changement dans la forme du verbe renvoient à des phénomènes de
polysémie, comme dans le cas de
prendre
évoqué en 21.1 ; c’est là encore un
phénomène dont la description relève de la lexicographie.
Mais il faut aussi envisager la possibilité que des variations dans la construction
d’un même verbe sans aucun changement dans sa forme tiennent à la possiblité de
traiter syntaxiquement de plusieurs façons différentes les entités impliquées dans un
même événement. Des phénomènes de ce type méritent par contre de figurer dans
la description syntaxique d’une langue, à partir du moment où ils ont un certain
degré de productivité, c’est-à-dire à partir du moment où ils tendent à se produire
systématiquement pour tous les verbes ayant certaines caractéristiques sémantiques.
En 21.2 – cf. notamment l’ex. (3), nous avons vu de tels cas, avec des verbes
transitifs dont l’emploi intransitif implique un changement régulier dans le rôle
sémantique du sujet. Rappelons aussi les constructions impersonnelles du français
et du tswana examinées en 19.5. Un autre exemple est la possibilité de faire varier
en anglais la construction de
give
‘donner’ et d’autres verbes de schème argumental
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
1
/
19
100%