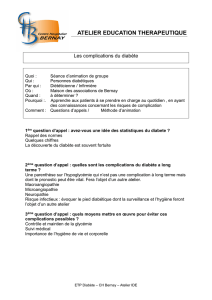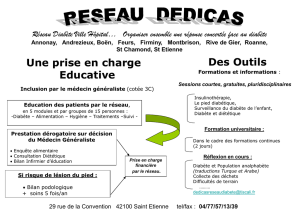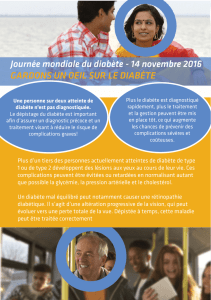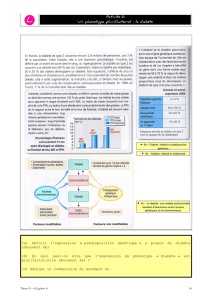Diabète et foie – Diabetes and the liver

70 | La Lettre de l’Hépato-gastroentérologue • Vol. XII - n° 3 - mai-juin 2009
DOSSIER THÉMATIQUE
Foie métabolique
Les effets du diabète sur le foie sont multiples.
Chacun connaît l’association entre diabète
de type 2 et stéatopathie métabolique, mais
il existe également des atteintes spécifiques du
diabète de type 1. Des données récentes ont par
ailleurs permis de mieux apprécier l’impact pronos-
tique du diabète sur la cirrhose et son rôle dans la
survenue du carcinome hépatocellulaire. Enfi n, les
traitements médicamenteux du diabète peuvent être
hépatotoxiques. L’objet de cet article est de faire la
revue de ces différentes atteintes.
Diabète de type 1
Au cours du diabète de type 1, les atteintes hépa-
tiques sont rares. Deux types de complications lui
sont spécifi ques : la fi brose périsinusoïdale et la
glycogénose.
Fibrose périsinusoïdale
Le diabète est associé à la présence de dépôts de colla-
gène dans l’espace de Disse. Au cours du diabète de
type 1, l’importance de ces dépôts apparaît liée à celle
de la microangiopathie diabétique (1). Il a été décrit
chez quelques patients, présentant par ailleurs des
complications microvasculaires sévères, une fi brose
périsinusoïdale extensive non cirrhotique (2). Le terme
d’hépatosclérose diabétique a été proposé pour dési-
gner cette entité, qui pourrait être l’expression hépa-
tique de la microangiopathie diabétique.
Glycogénose hépatique
(syndrome de Mauriac)
La surcharge glycogénique hépatocytaire est une
complication du diabète de type 1 mal équilibré,
où se succèdent hyperglycémies importantes et
administrations de fortes doses d’insuline. Elle
est surtout observée chez l’enfant et l’adolescent,
plus rarement chez l’adulte. La description princeps
en a été faite par Pierre Mauriac en 1930 dans la
Gazette hebdomadaire des sciences médicales de
Bordeaux. Le tableau clinique associe une hépato-
mégalie et une augmentation des transaminases
(3, 4). L’hépatomégalie est typiquement volumi-
neuse, de surface lisse, s’accompagnant parfois de
douleurs de l’hypochondre droit, de nausées et de
vomissements. L’augmentation des transaminases
est habituellement modérée, mais elle peut être
importante, supérieure à 5 à 10 fois, voire 30 fois,
la limite supérieure de la normale (3). Une élévation
modérée des phosphatases alcalines est parfois asso-
ciée. Les tests fonctionnels hépatiques sont toujours
normaux. L’échographie montre une hépatomégalie
homogène hyperéchogène.
La confi rmation du diagnostic repose sur l’examen
anatomopathologique. L’aspect est identique à celui
des glycogénoses constitutionnelles. L’architecture
hépatique est normale. Les hépatocytes sont de
grande taille, d’aspect “végétal” par leur cytoplasme
clair et leurs limites accentuées (3). Leur noyau est
refoulé en périphérie. La coloration par l’acide pério-
dique Schiff (PAS) avant et après diastase met en
évidence la surcharge en glycogène des hépatocytes.
Il n’y a pas de nécrose hépatocytaire.
La physiopathologie retenue pour expliquer la
surcharge glycogénique hépatocytaire fait intervenir
conjointement l’hyperglycémie et l’hyperinsulinémie
(3). Le glucose pénètre dans l’hépatocyte par un
mécanisme de diffusion facilitée, indépendant de
l’insuline, à la différence des autres cellules de l’or-
ganisme. Il y est rapidement transformé de façon
irréversible en glucose-6-phosphate et trappé ainsi
dans la cellule. Chez les patients ayant un diabète
mal contrôlé, la concentration élevée en glucose
dans les hépatocytes – secondaire aux épisodes d’hy-
Diabète et foie
Diabetes and the liver
Arnaud Pauwels*
* Service d’hépato-gastroentérologie,
Centre hospitalier, Gonesse.

La Lettre de l’Hépato-gastroentérologue • Vol. XII - n° 3 - mai-juin 2009 | 71
Points forts
Au cours du diabète de type 1, les atteintes hépatiques sont rares. Deux types de complications lui sont
»
spécifiques : la fibrose périsinusoïdale et la glycogénose.
À l’inverse, au cours du diabète de type 2, la stéatopathie est fréquente. On en distingue deux formes : »
la stéatose, qui est la plus fréquente et d’évolution bénigne, et la stéatohépatite, qui peut se compliquer
de fibrose, de cirrhose et de carcinome hépatocellulaire.
Au cours de la cirrhose, un diabète est observé chez 20 à 40 % des patients. Il constitue un facteur
»
pronostique indépendant, affectant la survie à moyen/long terme.
Le risque de survenue d’un carcinome hépatocellulaire est 2,5 fois plus élevé en cas de diabète de
»
type 2.
Les médicaments hypoglycémiants sont peu hépatotoxiques, à l’exception peut-être des glitazones. »
Mots-clés
Diabète
Hépatopathie
Stéatopathie
métabolique
Cirrhose
Carcinome
hépatocellulaire
Keywords
Diabetes
Liver disease
Nonalcoholic fatty liver
disease
Liver cirrhosis
Hepatocellular carcinoma
perglycémie – et l’administration de doses excessives
d’insuline conjuguent leurs effets pour stimuler la
glycogénogenèse et inhiber la glycogénolyse.
Le traitement repose sur l’obtention d’un bon équi-
libre glycémique. Lorsque cet objectif est atteint,
on observe une disparition de l’hépatomégalie et
une normalisation des enzymes hépatiques en 2 à
4 semaines. Les anomalies histologiques régressent
complètement, sans fi brose séquellaire.
Diabète de type 2
Au cours du diabète de type 2, les atteintes hépa-
tiques sont fréquentes. Elles sont dominées par la
stéatopathie métabolique, dont on distingue deux
formes : la stéatose, qui est la plus fréquente et
d’évolution bénigne, et la stéatohépatite, qui peut
se compliquer de fi brose, de cirrhose et de carci-
nome hépatocellulaire. La stéatopathie métabo-
lique est également associée aux autres éléments
du syndrome métabolique (obésité abdominale,
dyslipidémie et hypertension artérielle). Elle est
donc souvent considérée comme la manifestation
hépatique de ce syndrome, dont le substratum
physiopathologique est l’insulinorésistance. Ses
aspects cliniques, diagnostiques et thérapeutiques
sont développés ailleurs dans ce dossier.
La prévalence de la stéatopathie métabolique chez
les patients ayant un diabète de type 2 est mal
connue. Elle serait 2 à 5 fois plus élevée que dans
la population générale (5). Les estimations varient
entre 34 % et 74 %.
Chez les patients atteints de stéatopathie méta-
bolique, la présence d’un diabète est un facteur
prédictif indépendant de fi brose sévère et de morta-
lité (6). Younossi et al. ont rapporté en 2004 le
suivi d’une cohorte de patients dont la stéatopathie
avait été diagnostiquée entre 1979 et 1987 (7). Chez
les patients diabétiques, une cirrhose est survenue
dans 25 % des cas, versus 10 % chez les patients
non diabétiques. La mortalité a été de 56 % versus
27 %. Après ajustement pour les facteurs confon-
dants (âge, indice de masse corporelle, existence
d’une cirrhose), le risque relatif de décès lié à une
maladie du foie était de 22,8 chez les patients
diabétiques.
Dans la Verona Diabetes Study, la cirrhose comptait
pour 4 % des décès, contre 40 % pour les maladies
cardiovasculaires et 20 % pour les cancers. Pour
autant, il est intéressant de noter que, dans cette
cohorte de patients diabétiques, le taux standardisé
de mortalité – rapporté à la population générale –
était de 2,52 pour la cirrhose, contre seulement 1,34
pour les maladies cardiovasculaires (8).
Diabète et cirrhose
Diabète hépatogénique
Soixante à 90 % des cirrhotiques présentent une
intolérance au glucose, et 20 à 40 % ont un diabète.
De fait, une fois la cirrhose constituée, l’incidence
annuelle de l’intolérance au glucose est bien supé-
rieure à celle de la population générale, de l’ordre de
5 à 10 % selon l’altération de la fonction hépatique.
On parle de diabète hépatogénique, qui se distingue
du diabète de type 2 par une moindre association
avec l’âge, l’indice de masse corporelle et les anté-
cédents familiaux de diabète.
La pathogénie du diabète hépatogénique est multi-
factorielle (9). L’hyperinsulinémie, l’insulinorésis-
tance hépatique et périphérique, ainsi que l’altération
de la fonction bêtacellulaire, sont impliquées. L’in-
sulinorésistance périphérique, caractérisée par une
diminution de la synthèse musculaire de glycogène,
est un phénomène précoce au cours de la cirrhose.
L’insulinorésistance hépatique, avec augmentation
de la production hépatique de glucose malgré l’hy-
perinsulinémie et l’hyperglycémie, est d’apparition
plus tardive. L’hyperinsulinémie est de mécanisme
complexe, résultant à la fois de perturbations de la
sécrétion pancréatique d’insuline, qui est plus lente
et supérieure à celle de témoins non cirrhotiques,
et d’une réduction de la clairance hépatique de l’in-
suline liée aux altérations hépatocytaires et aux
shunts portosystémiques. Elle est précoce, jouant
probablement un rôle important dans l’initiation de
l’insulinorésistance périphérique et hépatique, tout
en constituant également un mécanisme d’adap-
tation à la diminution de la sensibilité à l’insuline.
Une fois que l’hyperinsulinémie et l’insulinorésis-
tance périphérique et hépatique sont présentes, la

72 | La Lettre de l’Hépato-gastroentérologue • Vol. XII - n° 3 - mai-juin 2009
DOSSIER THÉMATIQUE
Foie métabolique Diabète et foie
progression vers le diabète est liée à l’altération de
la fonction bêtacellulaire. De ce fait, la transplan-
tation hépatique, qui diminue l’insulinorésistance,
ne guérit le diabète hépatogénique que chez deux
patients sur trois.
La cause de la cirrhose semble jouer un rôle au moins
aussi important que la progression de la fi brose dans
la survenue du diabète “hépatogénique”. Ainsi, le
diabète est beaucoup plus fréquent en cas de cirrhose
virale C (25-50 %) ou alcoolique (20 %) qu’en cas de
cirrhose compliquant une infection virale B (10 %) ou
une hépatopathie cholestatique (1-2 %). Au cours de
l’hépatite virale C, certains génotypes (notamment
le génotype 1) favorisent le développement de l’insu-
linorésistance indépendamment du stade de fi brose.
De même, au cours de la maladie alcoolique du foie,
la réaction infl ammatoire hépatique – via la libéra-
tion de cytokines et le stress oxydatif – contribue à
l’insulinorésistance, tandis que les lésions pancréa-
tiques induites par l’éthanol expliquent en partie
l’altération de la fonction bêtacellulaire.
Le diabète, facteur de comorbidité
Chez les patients cirrhotiques, le diabète est un
facteur pronostique indépendant, affectant la survie
à moyen/long terme (10, 11). L’augmentation de la
mortalité n’est pas due aux complications propres
du diabète. Bien au contraire, les complications
liées à la macro- et à la microangiopathie diabé-
tique paraissent relativement peu fréquentes. Cela
pourrait s’expliquer, d’une part, par l’absence de
certains autres facteurs de risque vasculaire (dysli-
pidémie, hypertension artérielle), et, d’autre part,
par une espérance de vie réduite. En conséquence, le
diabète hépatogénique semble moins souvent traité
que les autres types de diabète, avec des objectifs de
contrôle glycémique plus modestes. Dans l’étude de
Bianchi et al., seulement 55 % des patients étaient
traités quand le diabète avait été diagnostiqué en
même temps que la cirrhose ou après, contre 86 %
lorsque le diagnostic du diabète avait précédé celui
de la cirrhose.
La cirrhose semble pourtant avoir une évolution plus
sévère chez les patients diabétiques, avec une surmor-
talité liée à ses complications. Les mécanismes en
cause restent à préciser. À l’instar de ce qui est observé
dans la stéatopathie métabolique, le diabète pourrait
favoriser la progression de la fi brose, avec une évolu-
tion plus rapide vers l’insuffi sance hépatique sévère.
Le diabète pourrait également majorer les troubles
circulatoires de la cirrhose, tant au niveau hépatique
que systémique, et contribuer au développement de
l’hypertension portale (9). Il pourrait ainsi favoriser
l’apparition d’une ascite réfractaire chez des patients
ayant par ailleurs une fonction hépatique conservée
(11). Enfi n, le diabète pourrait également augmenter
le risque de survenue d’un carcinome hépatocellulaire
(cf. infra).
Diabète et carcinome
hépatocellulaire
Une association entre diabète et carcinome hépa-
tocellulaire a été régulièrement retrouvée, quelles
que soient la région d’étude, la population étudiée
et la méthodologie utilisée. La méta-analyse de
El-Serag et al., rassemblant 13 études cas-contrôles
et 13 études de cohorte, a conclu à un risque de
carcinome hépatocellulaire 2,5 fois plus élevé en cas
de diabète de type 2 (12). Ce risque augmenterait
avec la durée d’évolution du diabète (5). L’association
entre diabète et carcinome hépatocellulaire persiste
après ajustement sur les données démographiques
et les autres facteurs de risque (maladie alcoolique
du foie, hépatites chroniques virales, hémochro-
matose, cirrhose non spécifi que) et après exclusion
des patients avec autres facteurs de risque. La ques-
tion de savoir si le carcinome hépatocellulaire est
directement lié au diabète (et à l’obésité) ou s’il
est secondaire aux lésions hépatiques de stéato-
pathie métabolique n’est pas tranchée (5, 13). Il est
intéressant de noter que l’hyperinsulinémie, avant
même la survenue d’un diabète, expose à un risque
environ trois fois plus élevé de décès par carcinome
hépatocellulaire (14). Par ailleurs, l’hyperinsulinémie
postprandiale est associée à une plus grande vitesse
de croissance tumorale. Il existe une interaction
synergique entre diabète, consommation excessive
d’alcool et hépatite chronique virale pour la survenue
d’un carcinome hépatocellulaire.
Après résection chirurgicale d’un carcinome hépa-
tocellulaire, le rôle pronostique du diabète est
diversement apprécié. Il augmente la morbidité post-
opératoire (sepsis, décompensation hépatique) et
pourrait également favoriser la récidive tumorale.
Hépatotoxicité des
médicaments hypoglycémiants
D’une façon générale, les médicaments hypo-
glycémiants sont peu hépatotoxiques, à l’exception,
peut-être, des glitazones.

La Lettre de l’Hépato-gastroentérologue • Vol. XII - n° 3 - mai-juin 2009 | 73
DOSSIER THÉMATIQUE
La metformine pourrait être exceptionnellement
responsable d’hépatites aiguës, cholestatiques ou
cytolytiques, de mécanisme probablement immu-
noallergique. Les cas rapportés ont toujours été
d’évolution favorable. L’acidose lactique est une
complication rare (3-5 cas/100 000 patients-années)
du traitement par la metformine. L’insuffisance
hépatique est un facteur de risque de survenue d’une
acidose lactique, bien que d’importance moindre
qu’un antécédent de cardiopathie ou d’insuffi-
sance rénale. Chez les patients cirrhotiques sans
insuffi sance hépatique signifi cative (Child A), la
metformine est probablement sans risque et peut
être prescrite à ceux chez qui elle est indiquée. En
revanche, chez les patients Child B ou C, la metfor-
mine doit être évitée en raison du risque d’acidose
lactique (15).
Toutes les sulfonylurées sont potentiellement
hépatotoxiques, mais cette toxicité reste rare avec
les médicaments actuellement commercialisés
(glibenclamide, gliclazide, glimépiride…) [16]. Il
s’agit surtout d’hépatites cholestatiques (17), plus
rarement granulomateuses. Des manifestations
d’hypersensibilité (fi èvre, rash cutané, éosinophilie)
peuvent être associées. Quelques patients ont déve-
loppé une ductopénie sévère.
L’acarbose est, à de très rares occasions, responsable
d’hépatites aiguës cytolytiques, de survenue tardive
(2-8 mois), réversibles à l’arrêt du traitement (15).
Les thiazolidinediones, ou glitazones, sont une
nouvelle classe de médicaments réduisant l’in-
sulinorésistance. La troglitazone, premier agent
commercialisé, a été retirée du marché en 2000
après la survenue de plus de 100 cas d’hépatites
aiguës, certaines mortelles ou ayant nécessité une
transplantation hépatique (16). Les glitazones de
deuxième génération – rosiglitazone et pioglitazone
– sont moins hépatotoxiques. Elles peuvent néan-
moins être responsables d’hépatites aiguës cytolyti-
ques, parfois sévères (15, 18). Il est recommandé de
surveiller régulièrement les enzymes hépatiques en
cas de traitement par les glitazones. En cas d’aug-
mentation des transaminases supérieure à 3N, le
traitement doit être interrompu.
L’insuline humaine a été impliquée dans un cas d’at-
teinte hépatique avec réintroduction positive.
Conclusion
Les effets du diabète sur le foie ont été longtemps
sous-estimés. Une littérature de plus en plus impor-
tante montre que le diabète favorise la progression
de la fi brose au cours de la stéatopathie métabo-
lique, aggrave le pronostic de la cirrhose, favorise la
survenue du carcinome hépatocellulaire. Les méca-
nismes sous-jacents sont encore mal compris. En
particulier, les rôles respectifs de l’insulinorésistance
et de l’hyperglycémie doivent être précisés. Alors que
l’épidémie de diabète s’étend, un nouveau champ
d’investigation s’est ouvert qui pourrait élargir notre
compréhension de la pathologie hépatique. ■
1. Bernuau D, Guillot R, Durand AM et al. Ultrastruc-
tural aspects of the liver perisinusoidal space in diabetic
patients with and without microangiopathy. Diabetes
1982;31:1061-7.
2. Harrison SA, Brunt EM, Goodman ZD, Di Bisceglie AM.
Diabetic hepatosclerosis: diabetic microangiopathy of the
liver. Arch Pathol Lab Med 2006;130:27-32.
3. Chatila R, West AB. Hepatomegaly and abnormal liver
tests due to glycogenosis in adults with diabetes. Medicine
(Baltimore) 1996;75:327-33.
4. Pigui A, Montembault S, Bonte E, Hardin JM, Ink O. Volu-
mineuse hépatomégalie chez une jeune malade diabétique.
Gastroenterol Clin Biol 2003;27:1038-40.
5. El-Serag HB, Tran T, Everhart JE. Diabetes increases the
risk of chronic liver disease and hepatocellular carcinoma.
Gastroenterology 2004;126:460-8.
6. Angulo P, Keach JC, Batts KP, Lindor KD. Independent
predictors of liver fi brosis in patients with nonalcoholic
steatohepatitis. Hepatology 1999;30:1356-62.
7. Younossi ZM, Gramlich T, Matteoni CA, Boparai N, McCul-
lough AJ. Nonalcoholic fatty liver disease in patients with type
2 diabetes. Clin Gastroenterol Hepatol 2004;2:262-5.
8. De Marco R, Locatelli F, Zoppini G, Verlato G, Bonora E,
Muggeo M. Cause-specifi c mortality in type 2 diabetes. The
Verona Diabetes Study. Diabetes Care 1999;22:756-61.
9. Buyse S, Valla D. Perturbations du métabolisme des
glucides au cours de la cirrhose: pathogénie, impact pronos-
tique et implications thérapeutiques. Gastroenterol Clin
Biol 2007;31:266-73.
10. Bianchi G, Marchesini G, Zoli M, Bugianesi E, Fabbri A,
Pisi E. Prognostic signifi cance of diabetes in patients with
cirrhosis. Hepatology 1994;20:119-25.
11. Moreau R, Delègue P, Pessione F et al. Clinical characte-
ristics and outcome of patients with cirrhosis and refractory
ascites. Liver Int 2004;24:457-64.
12. El-Serag HB, Hampel H, Javadi F. The association
between diabetes and hepatocellular carcinoma: a syste-
matic review of epidemiologic evidence. Clin Gastroenterol
Hepatol 2006;4:369-80.
13. Regimbeau JM, Colombat M, Mognol P et al. Obesity
and diabetes as a risk factor for hepatocellular carcinoma.
Liver Transpl 2004;10:S69-73.
14. Balkau B, Kahn HS, Courbon D, Eschwege E, Ducime-
tiere P. Hyperinsulinemia predicts fatal liver cancer but is
inversely associated with fatal cancer at some other sites: the
Paris Prospective Study. Diabetes Care 2001;24:843-9.
15. Chang CY, Schiano TD. Drug hepatotoxicity. Aliment
Pharmacol Ther 2007;25:1135-51.
16. Chitturi S, George J. Hepatotoxicity of commonly
used drugs: non steroidal anti-infl ammatory drugs, anti-
hypertensives, antidiabetic agents, anticonvulsivants,
lipid-lowering agents, psychotropic drugs. Sem Liver Dis
2002;22:169-83.
17. Sitruk V, Mohib S, Grando-Lemaire V, Ziol M, Trinchet JC.
Hépatite aiguë cholestatique induite par le glimépiride.
Gastroenterol Clin Biol 2000;24:1233-4.
18. Arotçarena R, Bigué JP, Etcharru F, Pariente A. Hépa-
tite aiguë sévère à la pioglitazone. Gastroenterol Clin Biol
2004;28:610-1.
Références bibliographiques
1
/
4
100%