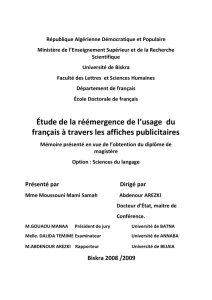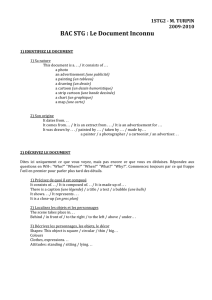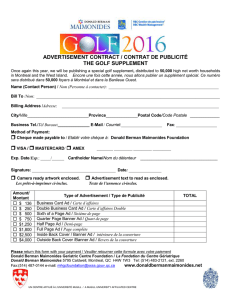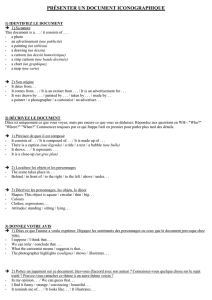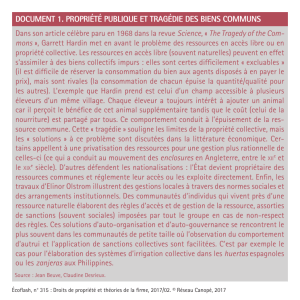Mode éthique. Saturation et slow advertising

Mode éthique. Saturation et
slow advertising
Parler de mode éthique, c’est parler des conditions de
production du vêtement, c’est parler des matériaux et des
produits utilisés, des conditions des travailleurs, de
l’environnement, comme mentionné dans l’article d’ouverture du
dossier « Mode éthique » (Enfants exploités et milliers de
morts, pourquoi nous n’avons rien compris à la mode éthique).
Cependant il y a une autre dimension de l’éthique dans la mode
sur laquelle nous pourrions nous pencher : c’est le rapport au
consommateur, la façon dont le vêtement lui est vendu. Je
parle bien ici du marketing, de la publicité, que dis-je, de
l’advertisement pour être tout à fait correcte.

Production éthique
Surexposition publicitaire et autres pubs
Zalando
La publicité, l’idée même de vendre/acheter s’est intégrée
dans le paysage quotidien de tout un chacun. Chaque personne
est littéralement bombardée d’invitations plus ou moins
subtiles à acheter, à porter en étendard. Invitations jouant
avec les codes, les psychologies, les sociologies de chacun
avec une ribambelle d’outils. Prenez un individu lambda.
Appelons-le Nathan. Nathan se lève le matin, l’alarme sur son
portable a sonné. Naturellement, l’objet de type cellulaire
étant à portée de main, il va checker ses mails, survolant les
multiples publicités et autres promotions, les mêmes marques
quotidiennes s’imprégnant dans sa rétine et par la même
occasion, son cerveau. Il fait ensuite son petit tour sur les
réseaux sociaux ou va lire quelques articles. Il s’y est
habitué mais les mises en page de ces sites incluent plusieurs
onglets de pub pour acheter des sneakers, des joggings, des

cravates ou que sais-je encore. Il ne clique pas dessus mais
elles sont cependant omniprésentes. Pendant que Nathan prend
son petit déjeuner, il allume la télé. Inutile de dire
qu’encore une fois, la publicité est là aussi, entre chaque
émission, au milieu des dessins animés, entre deux reportages.
Il sort, prend le bus pour aller en cours. Le bus dépasse
plusieurs panneaux publicitaires. Il regarde un clip sur son
portable, remarque les placements de produit peu discrets,
pendant que son cerveau imprime la marque inconsciemment. Dans
cette vie fictive de Nathan, il est à peine 9h du matin et il
a déjà été exposé une dizaine de fois à des invitations à
consommer, et ce ne sont que les plus évidentes. Selon iDMAa’s
Middletown Media Study, nous sommes exposés à cela environ
11,7 heures par jour. Je parle ici de la consommation en
général, mais dans le cadre de la mode éthique,
contextualisons en nous concentrant sur l’advertisement du
vêtement.
IOU Project
Le désir de suicide de la mode : une
valeur sûre
En effet, l’advertisement du vêtement est particulier
puisqu’il repose sur la mode. C’est le modèle du reste de
l’advertisement, il joue sur les codes sociaux, sur les

sentiments d’appartenance et d’exclusion, sur l’identité
individuelle et globale, sur l’image, sur la communication. La
mode, selon Marc-Alain Descamps, repose sur une subtile
dynamique d’envie de distinction et d’exaltation de la
ressemblance. Cependant, un autre phénomène est inhérent à la
mode : son auto-destruction du fait de son mouvement de
balancier entre l’individualisme et le conformisme. « Un désir
de suicide ronge la mode » (König 1969). Pour toutes ces
raisons, l’advertisement du vêtement s’infiltre partout, passe
par mille outils explicites et implicites, et bombarde
d’autant plus les individus. L’advertisement se doit de jouer
de cet équilibre, sans arrêt puisque la mode est une valeur
sûre tant elle est ancrée et symptomatique de l’humanité, et
puisqu’elle offre tant de chances de se renouveler. Il n’y a
donc pas que la nature productrice et les travailleurs qui
sont monopolisés à l’extrême, lessivés, essorés par
l’industrie de la mode. Lorsque l’on considère la capacité
d’attention d’un être humain comme étant une ressource finie
et partagée, est-ce éthique de la monopoliser ainsi à
outrance ?
https://youtu.be/WfGMYdalClU
Tragédie : l’advertising va droit dans le
mur
Matthew Syrett a eu l’idée de transférer le modèle de la
tragédie des biens communs de Hardin au concept de
l’advertising, prédisant la fin de la publicité telle que nous
la connaissons. Pour faire court sur la tragédie des biens
communs, elle a été théorisée par Garett Hardin en 1968 et a
entraîné de nombreux travaux au niveau du développement
durable. Dans son livre Tragedy of the Commons, Hardin met en
évidence une différence de gérance des ressources
individuelles et des ressources communes. En effet, les biens
communs, en raison de leur nature même, selon lui, courent
droit dans le mur de l’auto-destruction en situation de

laisser-faire. Pourquoi donc, vous demandez-vous ? Et bien en
raison de la nature humaine elle-même : l’individu possède
moins de raisons de s’investir dans le management d’une
ressource commune plutôt qu’une ressource individuelle
puisqu’il y a de fortes chances que cette ressource commune
soit surexploitée et ne lui serve pas tant que cela. Ajoutez à
cela le comportement du passager clandestin : pourquoi
s’investir quand les autres peuvent le faire à notre place et
donner le même résultat ? On possède alors les mêmes
ressources que les autres sans avoir levé le petit doigt.
Ainsi, ces comportements égoïstes intrinsèques à l’humain (pas
de généralisations, on parle ici d’une simple théorie et
l’évolution des tendances de consommation tend à prouver que
cela change) finissent sur le long terme par auto-détruire ces
ressources communes (ou du moins leur valeur). La règle :
maximiser son profit personnel tout en minimisant son coût
personnel.
Le lien avec la publicité semble ici un peu flou, et c’est
bien normal, cette théorie concernant à l’origine les biens
matériels. Prenons l’attention donnée du consommateur aux
publicités comme une ressource commune. Aujourd’hui,
l’environnement médiatique est graduellement peuplé de
consommateurs saturés par la communication. Là où l’industrie
de la mode, et l’advertisement en général, fait une erreur et
où son comportement est non-éthique vis-à-vis du consommateur,
c’est dans le fait de considérer que son attention est
infatigable et insaturable. Les esprits à influencer
(puisqu’en effet c’est le jeu du marketing) sont considérés
comme des biens normaux. Or au-delà d’un certain point, les
esprits sont saturés et l’attention est perdue : le but
premier de l’advertisement est donc manqué en raison d’un
« communication stress ». Les advertisers vont alors
intensifier leur présence dans l’environnement publicitaire,
ce qui dégrade encore plus celui-ci en augmentant la
saturation, aucun d’entre eux n’ayant envie de prendre le
risque de céder un pouce de terrain dans l’esprit des
 6
6
 7
7
1
/
7
100%