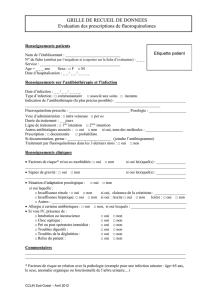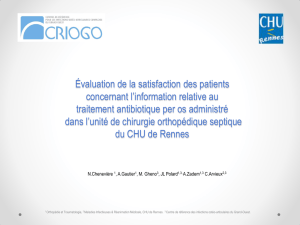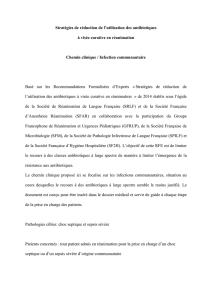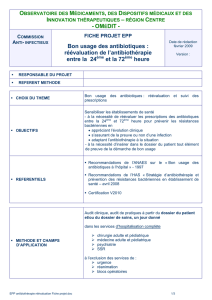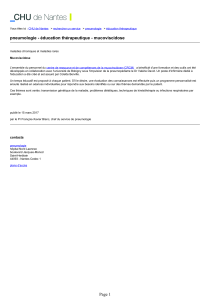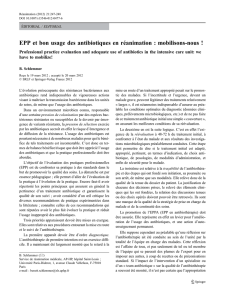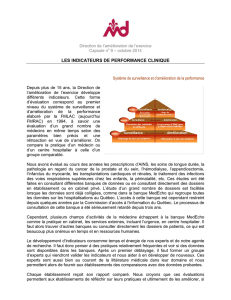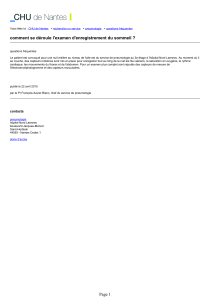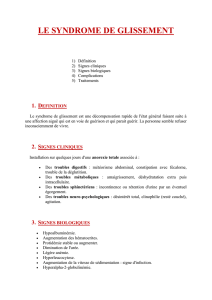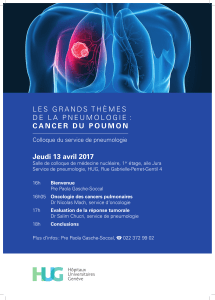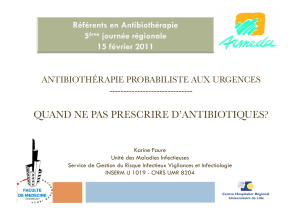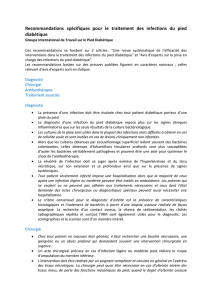Enquête de pratiques de l`antibiothérapie des infections

ARTICLE ORIGINAL
Enquête de pratiques de l’antibiothérapie
des infections bronchopulmonaires dans un service de pneumologie
Survey of antibiotherapy for bronchopulmonary infections in a pneumology department
C. SCHALLER
1
, A.-C. GAIRARD-DORY
1,*
, G. PAULI
2
, L. BERETZ
1
, F. DE BLAY
2
1
Service de pharmacie-stérilisation, Hôpital de Hautepierre, Centre hospitalo-universitaire de Strasbourg
2
Service de pneumologie, Hôpital Lyautey, Centre hospitalo-universitaire de Strasbourg
Résumé
.Objectif : confronter l’utilisation des antibiotiques en pneumologie aux recommandations nationales et
évaluer l’adaptation des antibiothérapies. Méthode : étude prospective menée sur 1 mois (mars 2004) dans un service
de pneumologie. Tous les patients admis et traités par antibiothérapie au cours d’une infection respiratoire basse ont
été inclus dans l’étude. Les caractéristiques du patient, les critères de gravité, les comorbidités et les traitements
antibiotiques prescrits ont été relevés. Le traitement antibiotique était déclaré conforme s’il correspondait aux
recommandations des référentiels français (Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, Société de
pathologie infectieuse de langue française et Société de pneumologie de langue française). Résultats : l’enquête a
concerné 24 patients, dont 10 cas de pneumopathie, 9 cas d’exacerbation aiguë de bronchite chronique, 3 cas de
surinfection bronchique, 1 cas de pleurésie et 1 cas d’opacité pulmonaire. Parmi les 38 traitements mis en place, 14
ont fait l’objet d’une modification pour bithérapie réévaluée (n = 7), pour inefficacité clinique (n = 4), pour spectre non
adapté selon l’antibiogramme (n = 1), pour apparition d’un nouveau signe de gravité (n = 1) ou sans raison
apparente (n = 1). Tous les traitements de pneumopathie et d’exacerbation aiguë de bronchite chronique se sont
révélés conformes aux recommandations, sauf un, qui a été réajusté en moins de 24 heures. L’évolution a été
favorable pour l’ensemble des patients. Conclusion : les résultats de cette enquête montrent une adhésion satisfaisante
des pratiques du service aux recommandations nationales. Néanmoins, l’évaluation de la prise en charge anti-
infectieuse au moyen d’enquêtes de pratiques est nécessaire pour veiller au bon usage des antibiotiques.
Mots clés :
enquête de pratiques, antibiothérapie, pneumologie
Abstract
.Objectives: assessment of antibacterial prescriptions regarding community-acquired lower respiratory tract
infections and comparison with national guidelines. Methods: one-month prospective survey on treatment habits.
Patients hospitalised for community-acquired pulmonary infections in one unit of the pneumology department and
treated with antibiotics were included. Diagnosis, severity factors, comorbidities and antibiotic prescriptions were
analyzed. Treatments were thought consistent when following the national guidelines. Results: twenty-four patients
with community acquired pulmonary infection were included (10 patients with pneumonia, 9 with exacerbation of
chronic obstructive lung disease, one with pleurisy, one with pulmonary opacity). All the treatments were consistent
with the national guidelines, except one, which was modified within 24 hours. The patients’outcome was favorable in
all cases. Conclusion: in this survey, the management of community acquired pneumonia was consistent with the
national guidelines. Nevertheless, antibiotherapy assessment by means of surveys is necessary for proper use of
antibiotics.
Key words:
survey, antibiotics, pneumology
L’utilisation élargie des antibiotiques au cours de
ces 20 dernières années, notamment en France, a
amplifié la sélection de bactéries résistantes [1].
Dans le domaine des infections respiratoires, la fréquence
des pneumocoques à sensibilité diminuée à la pénicilline
(PSDP) est en augmentation [2, 3] et nécessite une cer-
taine prudence dans le choix de l’antibiothérapie. Les
caractéristiques propres aux pneumopathies aiguës com-
munautaires chez l’adulte (traitement probabiliste, notam-
ment en raison de la lourdeur de la recherche microbiolo-
gique, résistance bactérienne, terrain, comorbidités,
signes de gravité) conduisent à une utilisation étendue des
molécules à large spectre, comme les fluoroquinolones
anti-pneumococciques. C’est dans ce contexte que
l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de
*Correspondance et tirés à part : A.-C. Gairard-Dory
ORIGINAL ARTICLE
J Pharm Clin 2005 ; 24 (4) : 197-202
J Pharm Clin, vol. 24, n° 4, décembre 2005 197
Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 04/06/2017.

santé (Afssaps) a proposé en 2002 une réactualisation
des recommandations concernant l’antibiothérapie des
infections respiratoires basses de l’adulte [4], en accord
avec les consensus émis par la Société de pathologie
infectieuse de langue française (SPILF) [5] et la Société de
pneumologie de langue française (SPLF) [6].
Par ailleurs, l’Agence nationale d’accréditation et d’éva-
luation de la santé (Anaes) s’attache à veiller au bon
usage des antibiotiques et encourage les établissements
de santé à évaluer la prise en charge anti-infectieuse à
l’hôpital [7, 8]. Dans cette optique, nous avons réalisé une
enquête de pratiques de l’antibiothérapie dans un service
de pneumologie du centre hospitalier universitaire de
Strasbourg. Le premier objectif était de confronter l’utilisa-
tion des antibiotiques dans cette unité de soins aux recom-
mandations émises par les référentiels français. Le second
était d’évaluer l’adaptation des antibiothérapies docu-
mentées et probabilistes mises en place au vu, respective-
ment, des résultats microbiologiques et de l’évolution
clinique.
Méthode
Déroulement de l'étude
Une étude prospective a été menée au mois de mars 2004
dans le service de pneumologie des Hôpitaux Universitai-
res de Strasbourg (Hôpital Lyautey) pour laquelle les
prescripteurs ont été informés. Tous les patients admis et
traités par antibiothérapie au cours d’une infection bron-
chopulmonaire ou de la plèvre ont été inclus dans l’étude.
Chaque diagnostic posé et chaque antibiothérapie pres-
crite ont été validés par un médecin senior (chef de
clinique ou professeur d’université – praticien hospitalier)
lors des visites quotidiennes dans le service. Les analyses
microbiologiques et les antibiogrammes ont été réalisés
par le laboratoire de bactériologie de l’établissement à
partir de divers prélèvements biologiques (crachats, sang,
liquide pleural, liquide broncho-alvéolaire). Les antibio-
thérapies documentées étaient jugées adaptées si la poso-
logie était correcte et si le ou les micro-organismes étaient
sensibles à au moins une des molécules employées. Les
traitements probabilistes étaient jugés adaptés si l’évolu-
tion était favorable sans modification d’antibiothérapie
et/ou si la documentation ultérieure confirmait le choix
thérapeutique.
Patients
Pour chaque patient ont été recueillies les données suivan-
tes : les renseignements administratifs du patient, la durée
du séjour, les motifs d’hospitalisation, l’indication de
l’antibiothérapie, les comorbidités, les signes de gravité,
les critères prédictifs d’un risque élevé de PSDP dans un
contexte de pneumonie, l’origine du patient (entrée di-
recte, transfert d’un autre service ou d’un autre établisse-
ment), l’antibiothérapie prescrite (un relais per os n’étant
pas considéré comme un changement de traitement), le
suivi thérapeutique (documentation microbiologique, mo-
tif d’une éventuelle modification de traitement) et l’évolu-
tion du traitement.
Recommandations des sociétés savantes
Le traitement antibiotique était déclaré conforme s’il cor-
respondait aux recommandations des référentiels à la fois
pour la molécule prescrite et pour la dose. Pour les
pneumopathies communautaires de l’adulte requérant une
hospitalisation et les exacerbations aiguës de bronchite
chronique, l’Afssaps [4], la SPILF [5], et la SPLF [6] ont
émis des recommandations qui sont résumées dans le
tableau 1. Pour les autres infections bronchopulmonaires,
il n’existe pas de recommandations particulières au re-
gard de l’antibiothérapie. Le choix thérapeutique doit être
discuté individuellement en tenant compte de la nature des
facteurs de risque, de l’état clinique et des germes poten-
tiellement responsables [4].
Résultats
Durant le mois de mars 2004, 96 patients ont été admis,
dont 24 patients (5 femmes et 19 hommes) ont été traités
par une antibiothérapie à visée pulmonaire. La moyenne
d’âge des patients traités était de 71 ans (extrêmes : 46 –
90 ans) dont 18 patients âgés de plus de 65 ans. La
durée moyenne de séjour atteignait 16 jours (extrêmes : 4
– 47 jours), mais en occultant les 4 séjours de plus d’un
mois (prolongation de séjour indépendante de l’antibio-
thérapie), elle se réduisait à 11 jours (4 – 22 jours), durée
inférieure à celles précédemment rapportées [9, 10].
Deux patients sur 24 présentaient une allergie aux antibio-
tiques, l’un à la pénicilline, et l’autre à la pristinamycine et
à la cloxacilline.
Différents diagnostics justifiaient la mise en place de
l’antibiothérapie : 10 cas de pneumopathie, 9 cas d’exa-
cerbation aiguë de bronchite chronique (EABC), 3 cas de
surinfection bronchique, 1 cas de pleurésie et 1 cas
d’opacité pulmonaire. Dix-neuf patients (79 %) présen-
taient au moins 1 signe de gravité, le plus fréquent étant
une hypoxémie (12 patients) (figure 1). Tous les 24
patients présentaient un ou plusieurs facteurs de comorbi-
dité (figure 2), notamment des antécédents pulmonaires
(dont 12 patients avec une insuffisance respiratoire chro-
nique) et un âge supérieur à 65 ans. Toutes les antibiothé-
rapies ont été réévaluées en moins de 24 heures au vu des
résultats des cultures ou au bout de 48 heures au vu de
l’évolution clinique en cas de traitement non documenté.
De plus, le relais injectable/per os a été réalisé dans les
24 heures lorsque la forme orale était disponible. La
posologie et le rythme d’administration des antibiotiques
étaient toujours conformes aux Autorisations de mise sur le
marché. L’évolution sous antibiothérapie a été favorable
pour l’ensemble des patients.
Pour les 10 cas de pneumopathies, 20 traitements au total
ont été mis en place ou poursuivis au service de pneumo-
logie (tableau 2), dont 18 probabilistes et 2 documentés.
Parmi ces patients, on dénombrait :
– 3 admissions directes du domicile, dont 2 avec antibio-
thérapie instaurée en ville et modifiée à l’admission ;
– 6 admissions après séjour aux urgences inférieur à
24 heures dont : 4 avec antibiothérapie instaurée aux
urgences et modifiée à l’admission ; 2 avec antibiothéra-
pie instaurée en ville dont l’une modifiée à l’admission et
l’autre poursuivie au service de pneumologie ;
– un transfert d’un service de réanimation avec antibiothé-
rapie instaurée en réanimation et poursuivie au service de
pneumologie.
La durée moyenne de séjour pour les pneumopathies était
de 10,8 jours. Chaque patient présentait au moins un
facteur de prédiction de PSDP (figure 3). La documenta-
tion microbiologique a été recherchée dans 9 cas sur 10,
C. Schaller, et al.
J Pharm Clin, vol. 24, n° 4, décembre 2005
198
Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 04/06/2017.

mais seules 2 se sont trouvées positives (patients 1 et 5 du
tableau 2). Concernant ces 2 cas, l’antibiogramme n’a
pas conduit à une réduction du spectre de l’antibiothéra-
pie en place. La recherche microbiologique était négative
dans un prélèvement de liquide broncho-alvéolaire sur
deux, dans 4 crachats sur 5, ainsi que dans les 3
prélèvements de liquide pleural effectués. En outre, les 10
hémocultures, les 7 sérologies et la recherche d’antigènes
urinaires solubles de légionelles étaient négatives. Un seul
traitement a fait l’objet d’un dosage d’antibiotique (amika-
cine). Dix modifications de traitement ont été relevées : 5
pour bithérapie réévaluée ; 3 pour spectre non adapté au
vu de l’inefficacité clinique (n = 2) ou des résultats de
l’antibiogramme (n = 1) ; 1 pour apparition d’un nou-
veau signe de gravité ; et 1 sans raison apparente (pas-
sage de lévofloxacine à l’association amoxicilline + acide
clavulanique + rovamycine). Un seul traitement probabi-
liste sur 18 n’était pas conforme aux recommandations
(téicoplanine), mais il a été réajusté en moins de 24 heures.
Pour les 9 cas d’EABC, 10 traitements probabilistes ont
été mis en place ou poursuivis au service de pneumologie
(tableau 2). Parmi ces patients, on dénombrait :
– 4 admissions directes du domicile, dont 2 avec antibio-
thérapie instaurée en ville ;
– une admission directe d’une institution avec antibiothé-
rapie instaurée dans l’institution et poursuivie au service
de pneumologie ;
– 1 admission après séjour aux urgences inférieur à
24 heures sans antibiothérapie instaurée aux urgences ;
– un transfert des urgences avec antibiothérapie instaurée
aux urgences et poursuivie au service de pneumologie ;
– un transfert d’un service de réanimation sans antibiothé-
rapie instaurée en réanimation ;
– un transfert du service des maladies vasculaires avec
antibiothérapie instaurée en maladies vasculaires et modi-
fiée à l’admission en pneumologie.
La documentation microbiologique a été recherchée dans
5 cas sur 9, mais toutes étaient négatives. Aucun traite-
ment n’a fait l’objet d’un dosage d’antibiotique. Une
modification de traitement a été effectuée pour bithérapie
réévaluée. La durée moyenne de séjour était de
16,8 jours, mais elle est réduite à 10,9 jours si on occulte
la durée de séjour du patient hospitalisé pendant 31 jours
en raison d’une insuffisance respiratoire chronique, et
celle du patient hospitalisé pendant 44 jours pour bilan
de cancer. Parmi les 10 traitements instaurés, cinq consti-
tuaient des bithérapies, ce qui ne figure pas dans les
recommandations.
Tableau 1.Tableau synoptique des recommandations de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (Afssaps),
de la Société de pathologie infectieuse de langue française (SPILF) et de la Société de pneumologie de langue française (SPLF)
concernant l’antibiothérapie des pneumopathies requérant une hospitalisation et des exacerbations aiguës de bronchite
chronique.
1re Intention Alternative
Pneumopathies requérant une hospitalisation
Cas général Amoxicilline 3 g/24 h
ou amoxicilline/ac. clav.
C3G injectable
(ceftriaxone ou céfotaxime)
Suspicion de germes
intracellulaires et
apparentés (légionellose)
Amoxicilline/ac. clav. + macrolide
ou amoxicilline + ofloxacine
C3G injectable + macrolide
ou FQ AP
En médecine
Suspicion d’inhalation Amoxicilline/ac. clav. injectable C3G injectable
+ métronidazole injectable
Cas général Amoxicilline/ac. clav. injectable
+ macrolide injectable ou FQ injectable
C3G injectable
+ macrolide injectable ou FQ injectable
En soins
intensifs
Suspicion de germes
intracellulaires et
apparentés (légionellose)
Idem + rifampicine injectable Idem + rifampicine injectable
Exacerbations aiguës de bronchite chronique
Sans facteur de risque
- Télithromycine
- Pristinamycine
- Amoxicilline
- Doxycycline
- Macrolides
- Amoxicilline/acide clavulanique
- FQ AP ou ciprofloxacine
(si Pseudomonas aeruginosa)
- C3G orales
Avec facteurs de risque
- Amoxicilline/acide clavulanique
- FQ AP ou ciprofloxacine (si Pseudomonas aeruginosa)
- C3G orales (céfotiam-hexétil ou cefpodoxime-proxétyl)
ac. clav. : acide clavulanique ; C3G : céphalosporine de 3e
génération ; FQ : fluoroquinolone ; FQ AP : fluoroquinolone
anti-pneumococcique (lévofloxacine ou moxifloxacine).
Antibiothérapie et infections bronchopulmonaires
J Pharm Clin, vol. 24, n° 4, décembre 2005 199
Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 04/06/2017.

Tableau 2.Traitements des cas de pneumopathies (n = 10), des exacerbations aiguës de bronchite chronique (EABC) (n = 9) et
des autres infections bronchopulmonaires (n = 5) admis au service de pneumologie au mois de mars 2004.
N° du
patient 1e
Intention 2e
Intention ≥ 3e Intention
1C3G + FQ AP
en réa et en pneumo
FQ AP
Streptococcus pneumoniae
2Amoxicilline + ac. clav. + rovamycine
aux urgences Amoxicilline + ac. clav. Amoxicilline + ac. clav. + FQ
puis : FQ AP
3Ceftriaxone
en ville et aux urgences C3G + FQ AP FQ AP
4Ceftriaxone
en ville C3G + métronidazole
enicymocnav+QF+G3CQF+G3C5
Imipénème + amikacine
puis : Imipénème
Streptococcus viridans
6Clarythromyine
en ville Téicoplanine FQ AP
7Amoxicilline + ac. clav.
aux urgences
Amoxicilline + ac. clav. +
rovamycine Amoxicilline + ac. clav.
8Amoxicilline + ac. clav.
aux urgences PAQF
9Amoxicilline + ac. clav.
en ville, aux urgences et en pneumo
Pneumopathies
10 Céfotaxime + FQ
aux urgences FQ AP Amoxicilline + ac. clav. +
rovamycine
11 Amoxicilline + ac. clav. + FQ
aux urgences et en pneumo
12 Télithromycine
en ville et en pneumo
13 Clarythromycine
en ville C3G + FQ AP
14 Ceftazidime + FQ AP Ceftazidime
QF+matcabozat+enillicarépiP51
16 Amoxicilline + ac. clav.
en institution
FQ AP
en institution et en pneumo
QF+.valc.ca+enillicixomA71
18 Céfixime
en maladies vasculaires Ceftriaxone
EABC
19
20 Pristinamycine
en ville Télithromycine
enicymorhtiléT12
elozadinortém+G3CPAQF+G3C22 Imipénème + amikacine
puis : Imipénème
23 Amoxicilline + ac. clav. + FQ AP
en ville C3G + métronidazole
Autres
24 QF+G3C
Lorsque l’antibiothérapie n’a pas été initiée au service de pneumologie, le lieu du traitement est précisé en italique.
Pour les 2 cas où l’antibiothérapie était documentée (patients 1 et 5), la nature du germe est indiquée en italique.
ac. clav. : acide clavulanique ; C3G : céphalosporine de 3e
génération ; FQ : fluoroquinolone ; FQ AP : fluoroquinolone anti-
pneumococcique (lévofloxacine ou moxifloxacine).
Pristinamycine
C. Schaller, et al.
J Pharm Clin, vol. 24, n° 4, décembre 2005
200
Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 04/06/2017.

Parmi les 5 autres patients, on dénombrait 3 surinfections
bronchiques, une suspicion de pleurésie et une opacité
pulmonaire. La documentation microbiologique a été re-
cherchée dans 4 cas sur 5, sans résultats positifs. Au total,
8 traitements ont été mis en place dans le service de
pneumologie (tableau 2), tous probabilistes. Un seul trai-
tement a fait l’objet d’un dosage d’antibiotique (amika-
cine). Trois modifications de traitement ont été relevées : 2
pour inefficacité clinique, une pour bithérapie réévaluée.
La durée moyenne de séjour était de 26,2 jours, mais elle
est réduite à 12,7 jours si on occulte la durée de séjour du
patient hospitalisé pendant 46 jours pour fin de vie, et
celle du patient hospitalisé pendant 47 jours pour attente
de moyen séjour.
Discussion
De nombreuses études se sont consacrées à l’antibiothéra-
pie des infections bronchopulmonaires en réanimation
[11, 12], mais peu d’études ont été menées en pneumolo-
gie [9, 10]. Aux Hôpitaux universitaires de Strasbourg,
les antibiotiques sont prescrits nominativement, mais seuls
les services de chirurgie font appel à un expert en infectio-
logie pour la prescription des antibiotiques. Néanmoins,
notre travail a été présenté au comité des anti-infectieux
de l’établissement et, dès septembre 2005, le suivi des
consommations des antibiotiques par dose définie journa-
lière sera réalisé au moyen d’un logiciel Access dédié.
L’effectif de notre étude était plus faible que celui des
études comparables retrouvées dans la littérature [9, 10],
puisqu’elle n’a duré qu’un mois. Les prescripteurs avaient
été informés de l’enquête, ce qui a pu modifier leur
pratique. Cependant, une culture de l’évaluation est en
place car des enquêtes sont régulièrement réalisées dans
le service. Tous les patients inclus présentaient des signes
de gravité et/ou des comorbidités qui justifiaient leur prise
en charge thérapeutique à l’hôpital avec mise en place ou
poursuite d’une antibiothérapie. En cas d’inefficacité clini-
que, les traitements de première intention ont été modifiés
au bout de 48 à 72 heures. Lors d’un deuxième échec, la
modification était réalisée après3à5jours. Le passage
d’une bithérapie à une monothérapie avait lieu après 5 à
9 jours de traitement et l’administration d’un aminoside,
le cas échéant, était limitéeà5à6jours. Chez les 7
patients préalablement traités par les urgences, 5 antibio-
thérapies conformes aux recommandations ont cepen-
dant été modifiées en pneumologie. Par ailleurs, pour les
2 cas où le germe a été identifié, le délai de prise en
compte des résultats était inférieur à 12 heures, alors qu’il
était d’environ 1,5 jour dans une étude réalisée dans un
autre service de pneumologie [9]. Concernant le traite-
ment pour lequel la téicoplanine a été prescrite par erreur,
la réévaluation a également été rapide (moins de 24 heu-
res). Ces résultats montrent une bonne réactivité du ser-
vice pour l’adaptation de l’antibiothérapie. Cependant,
les antibiogrammes pourraient conduire au changement
de l’antibiotique en cours vers un antibiotique à spectre
plus étroit. Le seul antibiotique ayant été systématique-
ment dosé est l’amikacine. En revanche, ni la vancomy-
cine, ni la téicoplanine n’ont été dosées, alors que,
comme pour les aminosides, le dosage des glycopeptides
est réalisable en pratique et permet une meilleure adapta-
tion des posologies. Le suivi thérapeutique des autres
antibiotiques n’a pas été réalisé, son intérêt restant encore
à être évalué [13].
Parmi les cas de pneumopathies, deux traitements asso-
ciant céphalosporine de 3
e
génération et fluoroquinolone
ont été mis en place en première intention, mais ils étaient
2
3
0
1
3
1
1
1
0
0
12
5
0
151050
Nombre de patients concernés
Atteinte fonction supérieure
Atteinte fonction vitale
Température < 35 °C
Température > 40 °C
Néoplasie associée
Pneumonie d'inhalation
pH < 7,35
Urée > 11 mmol/L
Na < 130 mmolL
Hématocrite < 30 %
PaO2 < 60 mmHg
Épanchement pleural
Abcédation
Type de signes de gravité
Figure 1. Facteurs de gravité (critères de l’Afssaps [4]) des 24
patients traités pour infection bronchopulmonaire par antibio-
thérapie en mars 2004.
18
19
5
0
10
4
6
3
11
0
0 5 10 15 20
Nombre de patients concernés
> 65 ans
Antécédents pulmonaires
Diabète
Insuffisance rénale
Antécédents cardiologiques
Antécédents hépatiques
Immunodépression
Vie en institution
Hospitalisation antérieure dans l'année
Drépanocytose
Type de facteurs de comorbidités
Figure 2. Facteurs de comorbidités (critères de l’Afssaps [4])
des 24 patients traités pour infection bronchopulmonaire par
antibiothérapie en mars 2004.
3
2
2
0
7
2
01234567
Nombre de patients concernés atteints de pneumopathie
Traitement antérieur
aux bêta-lactamines
Hospitalisation
dans les 3 mois précédents
Maladie chronique
Caractère nosocomial
> 65 ans
Gravité initiale
Type de facteurs de prédiction de PSDP
Figure 3. Facteurs de prédiction de PSDP (critères de l’Afs-
saps [4]) des 10 patients traités pour pneumopathie.
Antibiothérapie et infections bronchopulmonaires
J Pharm Clin, vol. 24, n° 4, décembre 2005 201
Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 04/06/2017.
 6
6
1
/
6
100%