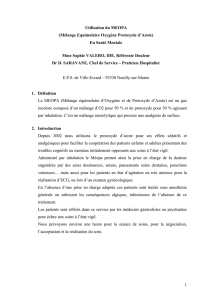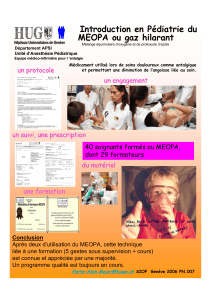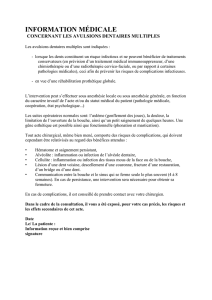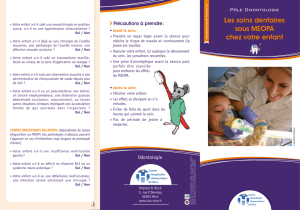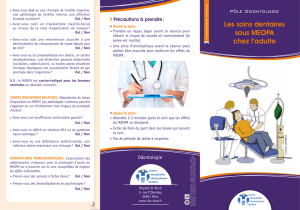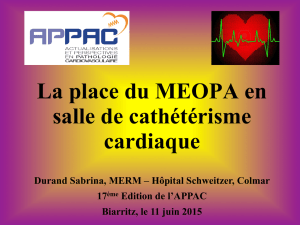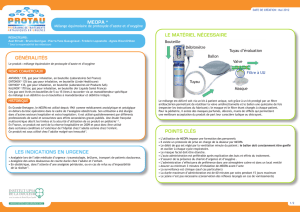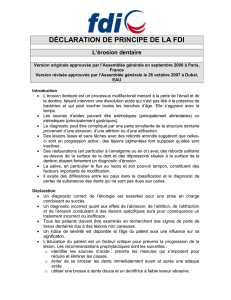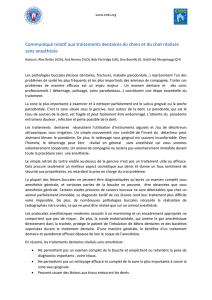Lire l`article complet

Analgésie et sédation consciente
pour soins dentaires chez l’enfant
Yves Delbos*, Javotte Nancy*, Sophie Parfait*, Christiane Maudier**
C’est lors d’un spectacle organisé le
10 décembre 1844 par un certain
Colton que Horace Wells, dentiste de
son état, découvre les bienfaits anes-
thésiques du protoxyde d’azote. À
cette époque, on utilisait les effets
sédatifs du gaz hilarant pour animer
des soirées festives : un des partici-
pants, quelque peu excité, se casse une
jambe dans une acrobatie personnelle
mais continue la farandole comme
si de rien n’était ! Wells subodore les
bienfaits que l’on pourrait tirer d’une
telle propriété et, peu après, il se fait
enlever une dent de sagesse supé-
rieure par son confrère Riggs. Après
une vingtaine de cas réussis en cabi-
net, il échoue malheureusement lors
de la présentation officielle de ses tra-
vaux devant la faculté... Tuberculeux,
raillé par ses collègues, blessé par les
succès de son ancien associé William
Green Morton2qui fait usage de l’éther,
il sombre dans la folie et meurt en se
sectionnant l’artère fémorale sous
chloroforme le 24 janvier 1848.
Réintroduit en France grâce à la per-
sévérance d’une équipe de l’hôpital
Trousseau (Dr Annequin, 1995), le
protoxyde d’azote est de nouveau uti-
lisé pour des soins douloureux, et
tout particulièrement en dentisterie
chez l’enfant difficile, “opposant”,
ainsi que chez certains handicapés pour
lesquels il permet d’éviter le recours
à une anesthésie générale, mais sous
une forme bien spécifique : le MEOPA.
Après une autorisation temporaire
d’utilisation (ATU) datée du 30 mars
1998, ce dernier bénéficie d’une auto-
risation de mise sur le marché (AMM)
depuis le 17 novembre 2001 (incluant
l’obstétrique et l’odontologie), qui
le classe sur la liste 2 des substances
vénéneuses et le réserve à l’usage
hospitalier. L’inhalation doit être
conduite par du personnel médical
ou paramédical spécifiquement formé
mais non nécessairement anesthésiste,
et sur prescription nominative.
Principe de l’analgésie
relative
L’analgésie relative est la disparition
de la perception douloureuse sans
modification de la conscience. Le pro-
toxyde d’azote (N2O) est un gaz stable,
incolore, non inflammable, non irri-
tant, d’odeur douce et de saveur légè-
rement sucrée. L’emploi du N2O en
odonto-stomatologie pédiatrique ne
s’intéresse qu’à un mélange fixé
d’emblée sous forme de 50 % de pro-
toxyde d’azote et 50 % d’oxygène :
c’est le mélange équimolaire oxy-
gène-protoxyde d’azote, ou MEOPA
(1, 2).
À cette concentration, le protoxyde
d’azote dans le mélange N2O/O2pré-
sente deux effets majeurs : un effet
anxiolytique, euphorisant et amné-
siant ; un effet antalgique de surface.
Le protoxyde d’azote est un anesthé-
sique faible, qui a des capacités antal-
giques même à faible concentration
(dès 10 %). Toutefois, c’est entre
50 et 60 % qu’il se révèle le plus effi-
cace sans risque de perte de cons-
cience3. Associé à 50 % d’oxygène,
il peut être employé en toute sécurité,
sans craindre l’asphyxie du patient.
Le mélange a un effet amnésiant en
agissant sur des régions du cerveau
impliquées dans les processus de la
* Section d’odontologie pédiatrique, université
Victor-Segalen – Bordeaux-2. Hôpital Saint-André.
** Hôpital Robert-Debré, Paris.
1. Gaz découvert par Joseph Samuel Priestley
en 1772. Son activité analgésique a été démon-
trée par Davy et Allen dès 1800. Dès 1846, Wells
l’utilise en dentisterie. Il est introduit en France
vers 1868 par Thomas Evans.
2. L'éther a été utilisé pour la première fois en
1842 par Crawford Long à Jefferson, aux États-
Unis, mais la postérité a retenu le nom de celui
qui effectua la première démonstration publique
de l'éther comme anesthésique le 16 octobre 1846,
au Massachusetts General Hospital à Boston : le
dentiste William Morton.
3. À 80 % se produit un stade d’anesthésie, avec
dépression cardiovasculaire par hypoxie. Utilisé
pur, il provoque une perte de conscience en moins
d’une minute, suivie d’une paralysie bulbaire,
d’une apnée et d’un arrêt cardiovasculaire.
I
l n’est peut-être pas inutile de rappeler la contribution essentielle
des odontologistes à la sédation. C’est en effet aux chirurgiens-
dentistes que l’on doit l’introduction de l’éther et du protoxyde d’azote
1
dans le but louable de soulager les souffrances de leurs contemporains
au cours d’actes opératoires.
Mots-clés : Sédation consciente – MEOPA – Dentisterie pédiatrique.
Statue de Horace
Wells (1815-1848)
d’après le sculpteur
T.H. Barlett, telle
que l’on peut la voir
dans sa ville natale
de Hartford, Connec-
ticut, au Bushnell
Park.
36
Le Courrier de l’algologie (3), no2, avril/mai/juin 2004
Mise au point
Mise au point

mémorisation. Son inhalation entraîne
un détachement de la réalité sans
perte de conscience. On parle de
sédation consciente. L’enfant subit
un certain degré d’analgésie tout en
conservant ses réflexes laryngés. Il
peut répondre à tout moment à un sti-
mulus psychique et à des commandes
verbales. Le gaz est éliminé rapide-
ment : en quelques minutes, le patient
revient à son état normal. Il n’est pas
dépresseur respiratoire, il n’a pas
d’effet sur la fréquence cardiaque et
la pression artérielle chez le sujet
sain.
L’enfant sous protoxyde d’azote est
relaxé, détendu ; il peut toutefois res-
sentir quelques désagréments tels
que des paresthésies (picotements,
fourmillements) au niveau des extré-
mités, une sensation de lourdeur, de
chaleur, de légèreté.
Quelques effets indésirables ont été
décrits dans la littérature :
– des nausées et des vomissements,
dans moins de 5 % des cas ;
– une sensation de malaise, une dys-
phorie chez certains enfants très
anxieux ;
– une excitation ;
– une certaine somnolence (3).
Pratique de la sédation
consciente
Indications
La sédation consciente est particu-
lièrement utilisée pour :
– les actes de courte durée (jusqu’à
45 minutes maximum) ;
– les enfants phobiques ;
– les enfants non coopérants ;
– les enfants polyhandicapés ;
– la petite chirurgie, les extrac-
tions.
Contre-indications (4)
Elles sont rares.
✓Contre-indications absolues :
– Accident de plongée, pneumo-
thorax ou occlusion digestive.
– Hypertension crânienne.
– Bulles d’emphysème.
– Embolie gazeuse.
– Altération de la conscience non
évaluée.
– Traumatisme crânien non évalué,
accident cérébrovasculaire.
– Fracture des os de la face.
✓Contre-indications relatives :
– Impossibilité de respiration par le
nez (sinusite, bronchite, rhume des
foins).
– Prudence en cas d’insuffisance
hépatique ou rénale, de drépano-
cytose et de greffes d’organes.
– Certaines associations médicamen-
teuses. Il existe un risque de dépres-
sion respiratoire par potentialisation
par un psychotrope (benzodiazé-
pines : Valium®, Hypnovel®) ou
opioïde (Codenfan®) (5).
✓Contre-indications liées à l’acte
lui-même :
– Durée d’intervention trop longue.
– Interventions répétées à moins
d’une semaine d’intervalle.
– Intensité nociceptive trop grande.
– Refus de l’enfant, non-acceptation
du masque.
Matériel
Le matériel nécessaire à l’adminis-
tration du MEOPA comporte les élé-
ments suivants :
– une bouteille de 1 m3de mélange
équimolaire N2O/O2(MEOPA) ;
– un manodétendeur qui permet
d’ouvrir la bouteille ;
– une valve d’anesthésie de type
Ruben, valve antiretour évitant la
réinhalation du gaz expiré ;
– un ballon standard 21, un ballon
réservoir ;
– un débitmètre gradué qui permet
d’adapter le débit du gaz à chaque
enfant ;
– un tuyau reliant le manodétendeur
et le ballon ;
– un chariot AGA 1m3sur lequel
repose la bouteille ;
– un masque nasal parfumé et coloré
adapté à la taille de l’enfant ;
– un filtre sodé antibactérien ;
– un jeu de sifflets “sirène”, système
non obligatoire.
Prise en charge de l’enfant
en odontologie pédiatrique
Les principaux problèmes à gérer, aussi
bien pour l’enfant que pour le prati-
cien, sont la douleur, la peur de la
douleur, l’anxiété que ressent l’enfant
vis-à-vis du dentiste et des soins. Tout
traitement est perçu comme une expé-
rience stressante qui mobilise l’enfant
face à une situation nouvelle (2).
Le comportement de l’enfant est
avant tout le reflet de son état émo-
tionnel. Le travail du praticien est
d’aider son jeune patient à adapter
et à modifier ses comportements
pour permettre la réalisation des
soins.
Méthode
Première séance
Elle consiste en l’évaluation du com-
portement de l’enfant et de sa coopé-
ration.
L’acte n’est pas forcément réalisé au
cours de la première séance. Il s’agit
d’appliquer le “Tell-Show-Do”, c’est-
à-dire :
Tableau. Enquête multicentrique sur l’utilisation du MEOPA pour la réalisation de gestes
invasifs et douloureux chez l’enfant (moyenne d’âge 7,2 ans ; 1 025 observations, dont
43 dentaires). D’après Annequin D, Carbajal R et al. (Pediatrics, 2000).
Effet Cas observés
Absence (62 %) 644
Euphorie (20 %) 207
Paresthésie (2 %) 17
Modification de la perception sensorielle (7 %) 71
Rêve (6 %) 58
37
Le Courrier de l’algologie (3), no2, avril/mai/juin 2004
Mise au point
Mise au point

38
Le Courrier de l’algologie (3), no2, avril/mai/juin 2004
Mise au point
Mise au point
– présenter le soignant ;
– familiariser l’enfant avec l’envi-
ronnement et les appareils et lui
montrer leur fonctionnement ;
– interroger l’enfant sur sa peur et
l’amener à la formuler ;
– apprendre à l’enfant le mode de
ventilation buccal/nasal par applica-
tion du masque buccal ;
– recueillir le consentement éclairé
des parents ou des tuteurs.
Deuxième séance (figures 1 et 2)
✓Il n’est pas nécessaire que l’enfant
soit à jeun, mais il est préférable qu’il
n’ait rien absorbé 2 heures avant
l’acte thérapeutique.
✓Application du masque bucco-
nasal (ou nasal bouche fermée) pen-
dant 3 minutes minimum. Le débit
est fonction de l’âge et du poids :
généralement entre 6 et 12 ans,
après une phase d’induction initiée à
9 l/mn, l’acte opératoire pourra se
dérouler avec un débit moindre de
l’ordre de 6 l/mn. Le ballon ne doit
pas être complètement gonflé (dimi-
nuer le débit) ni collabé (augmenter
le débit).
✓Ouverture de la bouche, réalisa-
tion de l’anesthésie locale (le contrat
de confiance passé avec l’enfant
interdit toute sensation de douleur :
il lui faut apprendre à discriminer les
sensations d’engourdissement propres
à l’anesthésie).
✓Fermeture de la bouche, applica-
tion du masque de nouveau pendant
3 minutes.
✓Dès la perte de contact avec la réa-
lité et le début de l’euphorie, le masque
est remonté, l’acte est réalisé en gar-
dant le contact vocal et visuel. Le
mode de ventilation est constamment
surveillé : l’aide opératoire doit s’as-
surer, en posant la main sur le ventre
de l’enfant, que celui-ci respire correc-
tement et profondément. Si la ventila-
tion buccale intervient, des pauses sont
nécessaires. Il faut de nouveau appli-
quer le masque sur le nez et la bouche.
✓Une prémédication avec de l’hydro-
xyzine (Atarax®), une cuillère à café
par 10 kg de poids 1 heure avant les
soins (6), peut éventuellement être
associée d’emblée dans les cas sévères,
ou en deuxième intention si la pre-
mière application n’est pas concluante.
Une fois la confiance retrouvée, les
séances suivantes pourront éventuel-
lement se dérouler avec une utilisation
du MEOPA plus ponctuelle lors des
soins.
Les parents et les praticiens corres-
pondants doivent avoir conscience
que l’usage du masque ne facilite pas
la conduite du geste opératoire : si les
extractions simples ne posent géné-
ralement pas de problème, “dévitali-
ser” une molaire peut s’avérer beau-
coup plus difficile !
Personnel nécessaire
Le praticien, un personnel paramé-
dical formé (7) :
– le praticien doit posséder la maî-
trise de l’utilisation du MEOPA ;
– les auxilliaires paramédicaux
peuvent intervenir seuls, en l’absence
de traitement morphinique ou psycho-
trope, et sur prescription médicale
(décret du 15 mars 1993, articles 1er
et 4).
Cette prescription doit être consignée
dans le dossier médical du patient.
Comme pour la pratique des soins
sous anesthésie générale, une forma-
tion clinique, universitaire et/ou hos-
pitalière est indispensable. Un diplôme
interuniversitaire d’anesthésie-séda-
tion (Bordeaux, Marseille, Montpel-
lier, Paris, Toulouse) est accessible
aux chirurgiens-dentistes depuis cette
année.
Discussion et résultats
Un bon rapport risque-bénéfice
pour le patient et le praticien
Les bénéfices de l’utilisation du
mélange équimolaire N2O/O2sont
nombreux et variés. Ils sont liés aussi
bien aux propriétés intrinsèques (phar-
macologiques, biologiques) qu’aux
Figure 1. Application du MEOPA : une induction réussie. Figure 2. Soins dentaires sous MEOPA.

39
Le Courrier de l’algologie (3), no2, avril/mai/juin 2004
Mise au point
Mise au point
propriétés extrinsèques (rapport avec
les enfants, les parents, simplicité d’uti-
lisation du produit). Le grand intérêt
de l’utilisation du MEOPA en odonto-
stomatologie chez l’enfant est d’obte-
nir une réduction de la perception de la
douleur sans perdre l’état de cons-
cience, de façon rapide et réversible (8).
Aucun autre antalgique ne présente
ces avantages. En effet, le N2O/O2
offre une rapidité d’action (3 minutes
d’inhalation) et une réversibilité
(l’effet disparaît dans les 5 minutes
qui suivent l’arrêt de l’inhalation).
Le protoxyde d’azote altère la per-
ception de la douleur mais ne dispense
pas de l’anesthésie locale.
Des études menées sur un même
groupe d’enfants ont montré que :
– chez des enfants très anxieux, la
diminution de la peur est significa-
tive dès la première séance ;
– le protoxyde n’interfère pas sur la
relation praticien/enfant.
Au fil de la séance, le patient se sent
de plus en plus en confiance et son
anxiété diminue, l’emploi du MEOPA
lui permettant de coopérer et de sup-
porter les soins.
Il faut en outre retenir la sécurité
d’emploi du protoxyde d’azote pour
un
praticien parfaitement formé (9).
Comme l’anesthésie générale, cette
méthode tend à réintroduire l’enfant
dans le circuit classique des soins en
cabinet dentaire. Sur les traces du Dr
Maudier (hôpital Robert-Debré, Paris),
nous avons pu utiliser avec satisfac-
tion cette technique à l’hôpital Saint-
André (dans l’unité fonctionnelle
d’odontologie du Pr Dorignac) sur
des enfants âgés de 4 à 15 ans depuis
le printemps 2003, pour des soins den-
taires, des extractions ou des actes
de chirurgie buccale comme des fré-
nectomies.
Un bon rapport coût-bénéfice
pour le patient et la collectivité
Même si “la santé n’a pas de prix”
dans l’absolu, il en est tout autrement
dans la réalité. Dans de nombreux cas
bien sélectionnés par un praticien
expérimenté, l’emploi du protoxyde
d’azote évite l’anesthésie générale et
donc le recours à une logistique lourde
pour le petit patient et le personnel.
Une anesthésie générale est onéreuse
tant sur le plan humain que sur le
plan financier. Les complications de
l’anesthésie générale sont très excep-
tionnelles, mais elles peuvent être
gravissimes et laisser des séquelles
neurologiques, le décès du patient
étant l’accident le plus redouté. Ce
tableau ne se produit jamais sous
sédation consciente.
L’emploi du MEOPA en odonto-
stomatologie pédiatrique est une
solution adéquate pour les nombreux
enfants anxieux et apeurés par les
soins en cabinet dentaire. Bien sou-
vent, il s’agit tout simplement de
pouvoir passer le cap de l’anesthésie
locale ou de diminuer l’effet anxio-
gène induit par le bruit des instru-
ments rotatifs (sifflement de la tur-
bine, etc.). Cet outil supplémentaire
permet dans bien des cas d’éviter le
recours à l’anesthésie générale.
Cependant, le N2O/O2n’est pas un
produit miracle mais un médicament.
Son utilisation en odonto-stomato-
logie s’adresse à des cas particuliers
(enfants ou patients handicapés), par-
faitement sélectionnés par un prati-
cien formé au sein d’une équipe hos-
pitalo-universitaire confirmée. ■
Références bibliograpiques
1.
Hallonsten AL, Koch G, Schroder U. Nitrous
oxide-oxygen sedation in dental care. Community
Dent Oral Epidemiol 1983;11:347-55.
2.
Weinstein P, Milgrom P, Ramsay DS. Treating
dental fears using nitrous oxide oxygen inhalation
and systematic desensitisation. Gen Dent 1998;
36:322-6.
3.
Hennequin M, Faulks D, Collado V, Greman C.
A retrospective study of the indications for rela-
tive analgesia by inhalation of a mixture of 50%
oxygen/50% nitrous oxide in special needs den-
tistry. Congress of the International Association
of Paediatric Dentistry 2001, Paris.
4.
Mapleson WW. Mathematical aspects of the
uptake distribution, and elimination of inhaled
gases and vapours. Br J Anaesth 1964;36:129-37.
5.
Berthet A, Jacquelin LF, Ducrot G. Sédation
consciente et enfant difficile. Inf Dent 1994;14:
1211-7.
6.
Moody EH, Mourino AP, Campbell RL. The
therapeuthic effectiveness of nitrous oxide and
chloral hydrate administered orally, rectally, and
combined with hydroxygene for pediatric dentis-
try. J Dent Child 1986;53:425-8.
7.
Rowland AS, Baird DD,Weinberg CR, Shore DL,
Shy CM,Wilcox AJ. Reduced fertility among women
employed as dental assistants exposed to high level
of nitrous oxide. N Engl J Med 1992;327:993-7.
8.
Annequin D, Murat I. Bonnes pratiques pour
l’utilisation, à titre d’antalgique, du mélange équi-
molaire oxygène-protoxyde d’azote (Entonox®) chez
l’enfant. Ann Fr Anesth Reanim 1998;17:fi 160-3.
9.
Hennequin M. Utilisation du mélange équi-
molaire N2O/O2pour les personnes handicapées.
31eRéunion annuelle de la Société française de la
douleur, Paris, 1997:70-1.
Pour en savoir plus
✓American Dental Association Council on Scien-
tific Affairs. Nitrous oxide in the dental office. J Am
Dent Assoc 1997;128:364-5.
Analgésie et sédation consciente pour soins dentaires chez l’enfant
Si les soins dentaires sont souvent perçus comme des interventions mineures, leur prise
en charge ambulatoire chez de jeunes enfants polycariés, handicapés, ou tout sim-
plement phobiques, s’avère souvent très problématique, pour ne pas dire impossible.
L’utilisation du mélange équimolaire protoxyde d’azote-oxygène peut permettre de lever
les inhibitions et d’éviter ainsi le recours à l’anesthésie générale. Tous les acteurs de
santé doivent s’impliquer dans cette lutte contre la carie dentaire, certes banale, mais
qui, suivant le mot de Pierre Fauchard, père de la dentisterie moderne auquel on prête
d’avoir soigné Louis XIV, “est une maladie qui fait mal et qui rend laid”...
Analgesia and conscious sedation in dental procedures for children
Although most procedures in dentistry are regarded as minor the management of
caries in handicaped, phobic children remains a great challenge. The use of Entonox
®
(an equimolar mixture of oxygen and nitrous oxide) as an analgesic and a sedative in
these cases can obviate the need for general anesthesia. Dental caries, although banal,
is in the words of Pierre Fauchard, the father of modern dentistry who treated King
Louis XIV, a disease that causes not only pain but also brings out the ugly side of us.
Keywords: Conscious sedation - Nitrogen protoxyde - Paediatric dentistry.
Résumé/
Summary

40
Le Courrier de l’algologie (3), no2, avril/mai/juin 2004
✓Arch LM, Humphris GM, Lee GT. Children
choosing between general anaesthesia or inha-
lation sedation for dental extractions: the effect on
dental anxiety. Int J Paediatr Dent 2001;11:41-8.
✓Blain KM, Hill FJ. The use of inhalation seda-
tion and local anaesthesia as an alternative to
general anesthesia for dental extractions in chil-
dren. Br Dent J 1998;184:608-11.
✓Crawford AN. The use of nitrous oxide oxygen
inhalation sedation with local anaesthesia as an
alternative to general anaesthesia for dental extra-
ction in children. Br Dent J 1990;168:395-8.
✓Crawford AN. The specialised role of the com-
munity dental service in providing dental care for
the anxious child. Br Dent J 1986;157:331-2.
✓Devine V, Adelson R, Goldstein J, Valins S,
Davison GC. Controlled test of the analgesic and
relaxant properties of nitrous oxide. J Dent Res
1974;53:489-90.
✓Hallonsten AL. Nitrous oxide scavenging in
dental surgery. A comparison of the efficiency of
different scavenging devues. Swed Dent J 1982;
6:203-13.
✓Kanellis MJ, Damiano PC, Momany ET. Medi-
cal costs associated with the hospitalisation of
young children for restorative treatment under
general anaesthesia. J Public Health Dent 2000;
60:28-32.
✓Kaufman E, Chastain DC, Gauchan AM, Gra-
cely RH. Staircase assessment of the magnitude
and time-course of 50p. 100 nitrous-oxygen anal-
gesia. J Dent Res 1992;71:1598-603.
✓Le comité sécurité de la SFAR. À propos d’une
préoccupation fréquente sur l’emploi du N2O. Ann
Fr Reanim 1998;17:121-4.
✓Lienhart A. Protoxyde d’azote. Encycl Med
Chir, Anesthésie, réanimation, Éditions techniques
Paris 6.1 1990 36272 A10.
✓Malamed SF, Quinn CL. Sedation: a guide to
patient management. Saint Louis: 3rd Edition
Mosby, 1995, 641p.
✓Peretz B, Gluck GM. Children’s sense of plea-
sure from nitrous oxide therapy during dental
visits. J Clin Paediatr Dent 1998;22:199-202.
✓Primosch RE, Buzzi IM, Jerell G. Effect of
nitrous oxide-oxygen inhalation with scavenging
on behavioural and physiological parameters
during routine paediatric dental treatment.
Pediatr Dent 1999;21:417-20.
✓Shaw AJ, Meechan JG, Kilpatrick HN, Wel-
bury RR. Inhalation sedation and local anaesthe-
sia instead of general anaesthesia for extractions
and minor oral surgery in children. A prospective
study. Int J Paediatr Dent 1996;6:7-11.
✓Sweeney B, Bingham RM, Amos RJ, Petty AC,
Cole PV. Toxicity of bone marrow in dentists expo-
sed to nitrous oxide. Br Med 1985;291:567-9.
Agenda
Ambuforum. 3eForum
multidisciplinaire de prise
en charge des patients
en ambulatoire et à domicile
Montpellier,
du 9 au 10 décembre 2004.
Nombreuses sessions douleur, soins
palliatifs, nouveautés thérapeutiques,
etc.
Renseignements :
MCO Congrès, 27, rue du Four-à-
Chaux, 13007 Marseille.
Tél. : 04 95 09 38 01.
E-mail : [email protected]
4eForum d’hypnose
Saint-Malo,
du 2 au 4 juin 2005.
Il s’agit d’un Forum de la Confédé-
ration francophone d’hypnose et de
thérapie brève. L’hypnose chez les
enfants doit se développer en France
et les praticiens doivent être acteurs et
moteurs de ce mouvement.
Renseignements :
Dr Jean-François Marquet, pédopsy-
chiatre, 5, rue de l’Horloge, 35000
Rennes. Tél. : 02 99 78 23 11. E-mail :
CONGRÈS INTERNATIONAUX
3rd World Congress, World
Institute of Pain : Advances
in Research and Clinical Practice
Barcelone (Espagne),
du 21 au 25 septembre 2004.
Renseignements :
Meet2 Ltd, POB 14264, Barcelone,
Espagne. Fax : +34 94 417 22 79.
E-mail : [email protected]
3rd All Africa Anaesthesia Congress
(3eCongrès panafricain
d’anesthésie)
Tunis (Tunisie), du 21 au 25 mai 2005.
Sessions douleur aiguë, de la physio-
logie de la douleur à l’organisation
de la prise en charge de la douleur, etc.
Renseignements :
STAAR, BP n° 2, El Menzah VI,
2091 Tunis, Tunisie.
11th World Congress on Pain
Sydney (Australie),
du 21 au 26 août 2005.
Renseignements :
CONGRÈS NATIONAUX
Actualités dans le traitement
de la douleur
Le vendredi 8 octobre 2004,
à Marseille.
Journée de formation sous l’égide du
Réseau de soins Douleur PACA-
Ouest. Présidence : Pr Jean-Claude
Peragut.
Thèmes traités : histoire de la dou-
leur, douleurs neuropathiques, dou-
leurs par excès de nociception, algies
faciales et lombalgies.
Renseignements :
Atlanta, 27, bd Gambetta, 92130 Issy-
les-Moulineaux.
Tél. : 01 46 38 77 37.
Fax : 01 46 38 77 31.
E-mail : [email protected]
4eCongrès annuel de la SETD
(Société d’étude et de traitement
de la douleur)
Montpellier,
novembre 2004.
Renseignements :
www.setd-douleur.org
Mise au point
Mise au point
1
/
5
100%