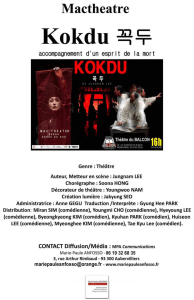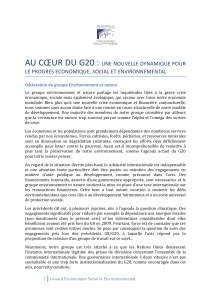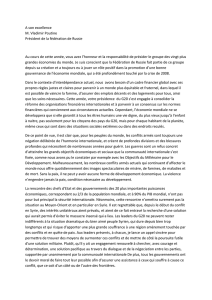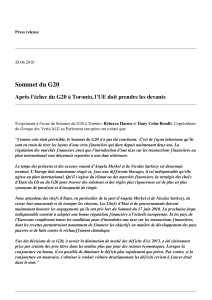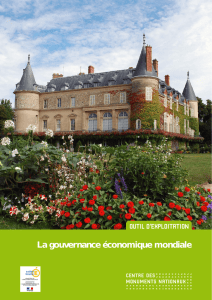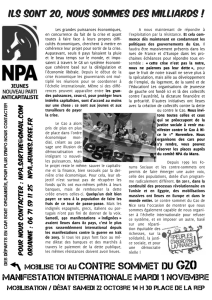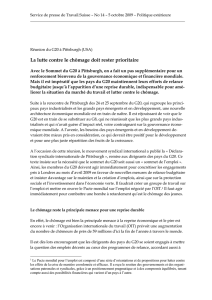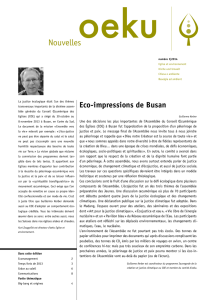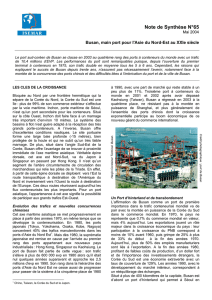CR restitution 16 12 2011

Paris, le 21 décembre 2011
F
ORUM DE
B
USAN
RESTITUTION
AFD,
16
DECEMBRE
2011
Points évoqués par M. Serge Tomasi, directeur de l’économie globale et des stratégies de
développement, direction générale de la mondialisation, Ministère des affaires étrangères et
européennes.
L’agenda du développement se trouve à un moment historique.
• Fragmentation de l’aide et modèle de financement inadapté (aux contraintes
budgétaires des pays du nord) obligent à reconstruire l’architecture de l’aide.
• Axé sur la réduction de la pauvreté (OMD, influence DFID), l’agenda de l’aide est
arrivé au bout de sa logique (logique compassionnelle). Il faut désormais intégrer les
problématiques du G20.
En structurant la pensée française, le Document cadre de coopération au développement
(DCCD) a permis d’anticiper les sujets du G20 développement ainsi que ceux abordés à
l’échelle de l’Europe.
Dans leur ouvrage « Le grand basculement », O. Ray et JM Severino avancent trois idées
convergentes avec celles du G20 :
1. Le basculement évoque l’inversion de la rareté et de l’abondance dans le monde : pour la
première fois dans l’histoire de l’humanité, l’abondance n’est plus du côté des ressources
naturelles mais des hommes, tandis que les ressources naturelles sont devenues rares. Le
débat sur l’économie verte doit surmonter l’opposition américaine.
2. Notre modèle économique accroît les inégalités et génère la pauvreté. Les filets de
sécurité sociaux requis nécessitent des taxes internationales (cf. G20).
3. Dépourvu de remède au déséquilibre des paiements (les producteurs ne consomment pas
tandis que les consommateurs s’endettent), notre modèle économique s’oppose au
décollage économique des pays en développement. Or, ce décollage génèrerait la
croissance voulue. L’investissement dans les nouveaux pôles de développement (flux
publics et flux privés) doit remplacer l’approche compassionnelle de l’aide.
Un des objectifs de Busan était d’associer la Chine et les pays émergents au nouveau
partenariat mondial envisagé. Le G20 développement a montré la capacité de dialogue des
pays émergents, au point que dans les débats, les pays émergents se trouvaient souvent alliés
des pays d’Europe du sud. Moyennant la reconnaissance de la coopération sud-sud et de ses
particularités, insérée au deuxième paragraphe du document de Busan, les pays émergents
peuvent se reconnaître dans ce document.
Le second objectif de Busan était le pilotage politique de l’agenda de l’efficacité, lequel s’est
embrouillé dans les débats techniques de l’OCDE. Déliement et division du travail soulèvent
des enjeux typiquement politiques. Le partenariat mondial devrait redonner l’élan politique au
débat en combinant la compétence de l’OCDE et la légitimité mondiale de l’ONU (recours au
PNUD de préférence au FCPNU - forum de coopération pour le développement).
Le passage de l’agenda de l’efficacité de l’aide à celui de « l’efficacité du développement »
(efficacité des politiques de développement) répond aux souhaits des pays du sud, l’agenda de

2
l’efficacité de l’aide étant de toute manière limité par l’influence réduite de l’aide dans les
flux des financements pour le développement.
Le document final de Busan reflète un consensus négocié sur plusieurs points.
• Sur le déliement, l’engagement de Busan reste limité. La France (85% d’aide déliée)
ne saurait aller au-delà, compte tenu des enjeux politiques internes. Les USA et
l’Allemagne sont proches de la position française.
• Sur la transparence, le document de Busan se réfère aux travaux du CAD avant
d’évoquer ceux de l’IATI.
1
La France, qui n’est pas opposée au principe de la
transparence, se heurte aux difficultés de son dispositif éclaté et peut donc être
satisfaite de la formule retenue.
• Sur l’alignement, le recours aux systèmes nationaux devient urgent. Les pays
d’Afrique ont exprimé haut et fort leur volontarisme sur ce point.
• Les droits de l’homme restent un sujet délicat dans le dialogue avec les pays
émergents, sur lequel les organisations de la société civile et les Etats-Unis ont insisté
au point de risquer la rupture de la négociation. D’autres enceintes que celles du
financement du développement existent pour traiter ce sujet.
• Sur la fragmentation de l’aide multilatérale, la Banque mondiale, dans une posture
défensive, a bloqué la discussion alors qu’à l’évidence elle ne figure pas parmi la
centaine d’institutions multilatérales qui totalisent moins de 10% de l’APD.
Au total :
• l’AFD doit se rapprocher des représentants des émergents dans ses pays d’intervention.
C’est l’esprit du G20, endossé à Busan.
• Développer la coopération triangulaire (bailleurs du nord, coopération du sud, pays
récipiendaire) pour diffuser les bonnes pratiques.
• Mettre l’accent sur les procédures nationales, leur utilisation et leur renforcement,
comme demandé par l’Afrique.
Points évoqués par M. de Milly, secrétariat de l’OCDE.
• L’adhésion de la Chine reste à consolider. La Chine avait déjà participé au forum
d’Accra. Elle n’a participé à l’enquête de suivi 2011 que dans trois pays sur 77. Mais à
Busan un sherpa chinois a participé aux négociations du document final.
• Il importe de souligner que Busan a endossé la déclaration de Paris et le programme
d’action d’Accra, confirmant le succès des enquêtes de suivi. Tout reste à faire pour
poursuivre l’agenda ancien endossé à Busan. Aussi, le mandat du groupe de travail
« efficacité » du CAD a été prorogé jusqu’en juin 2012 avec des modalités de travail à
décider (restreint aux sherpas ?).
• La programmation conjointe européenne représente une avancée majeure pour la
réduction de la fragmentation, même si l’Union européenne n’a pas fait étalage de
cette importante réforme.
• Un important projet relancé à Busan est celui du standard commun CAD/IATI de
transparence.
Débat
Question : comment articuler les suites du G20 et de Busan ?
• Réponse : la question demeure ouverte: réunions OCDE adossées au G20 ?
1
Avec l’annonce à Busan (Mme Clinton) de l’adhésion des USA, le nombre d’adhérents du CAD à l’IATI
s’élève désormais à quinze : Allemagne, Australie, Canada, Danemark, Espagne, Etats-Unis, Finlande, Irlande,
Norvège, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suède, Suisse, Union Européenne.

3
Question : comment concilier déliement incomplet et alignement ?
• Réponse : il faut plus de réciprocité dans le déliement (les pays émergents doivent s’y
résoudre). D’autres tensions existent dans l’agenda de l’efficacité, comme celle des
conditionnalités face à l’appropriation, sujet de l’évènement parallèle organisé par la
FERDI.
Question : comment mettre en œuvre les engagements de Busan, notamment en matière de
résultats et de responsabilité mutuelle ?
• Réponse : ces engagements ne sont pas nouveaux et figuraient pour l’essentiel dans la
déclaration de Paris. Il faut maintenant s’atteler à les remplir car les bailleurs ont une
obligation de résultats envers leur opinion publique.
Question : le partenariat mondial n’ajoute-t-il pas encore un organe de concertation dans un
paysage déjà complexe ?
• Réponse : pour l’OCDE, les résultats du G20 et de Busan pourraient constituer une
aubaine face au risque de marginalisation que présente pour l’OCDE la montée en
puissance des émergents. La coopération et le développement, domaines de
prédilection de l’OCDE, constituent des terrains intéressants de rapprochement avec
les pays émergents.
Question : que penser de la suspension de l’aide européenne à la Chine au lendemain de
Busan ?
• Réponse : c’est la mise en œuvre d’une idée de coopération différenciée défendue par
la France.
Points évoqués par Mme Leroy-Thémèze, responsable de l’unité d’évaluation (direction
générale du Trésor, Ministère des finances). Au sujet des travaux de Busan sur les résultats et
la responsabilité mutuelle, Mme Leroy-Thémèze, à l’aide d’un diaporama, a fait valoir que :
• les engagements de Busan figuraient déjà dans la déclaration de Paris,
• les résultats évoqués sont ceux des politiques nationales,
• leur atteinte suppose des politiques de développement effectives, des systèmes
nationaux efficaces et l’appui soutenu au renforcement des capacités.
• A l’échelle mondiale, l’agenda des résultats peut suivre plusieurs pistes ; le groupe de
travail, qui poursuit ses travaux, doit les préciser.
• Pour la France, l’enjeu se situe principalement au niveau des stratégies de coopération-
pays ; ces stratégies doivent s’insérer dans les politiques nationales.
Points évoqués par M. Bouthelier, président-délégué du CIAN (Conseil des investisseurs
français en Afrique).
• Le secteur privé est nécessaire au développement, mais l’inverse n’est pas vrai ; pour
que le secteur privé contribue au développement, il faut un Etat de droit.
• Il faut aussi une forme d’osmose entre secteur public et secteur privé. L’expérience
(notamment asiatique) montre que les plateformes de dialogue en amont de la
conception des politiques est un facteur de succès. Tel était aussi le dessein en France
du Plan indicatif sous de Gaulle. Les entreprises sont des pourvoyeurs d’emploi.
• La part désormais réduite de l’aide dans les flux d’investissement accroît le besoin
d’associer le secteur privé et d’attirer leurs investissements.
• Dans les Etats « kleptocratiques », les bailleurs doivent veiller à ne pas favoriser le
réseau de liens féodaux bloquants.
Le débat final a évoqué : l’efficacité de l’aide privée, philanthropique ; le dilemme de l’aide
dans les Etats fragiles, généralement des « Etats kleptocratiques » et la proximité du débat sur
les résultats et la responsabilité mutuelle avec celui des institutions efficaces. Celles-ci

4
doivent être conçues en fonction de résultats, eux-mêmes inscrits dans des accords ou cadres
de performance, véritables contrats sociaux.
1
/
4
100%