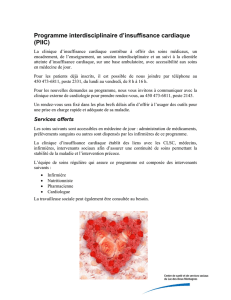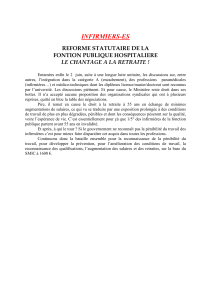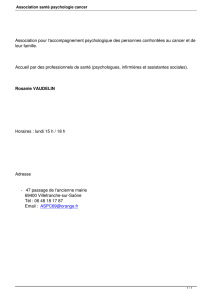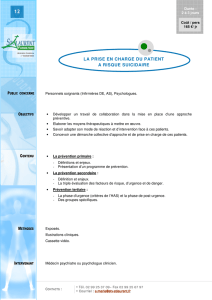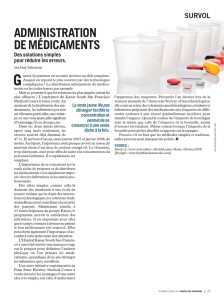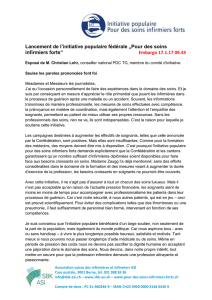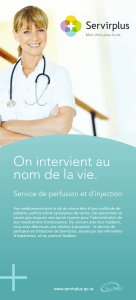Les reconfigurations du travail infirmier à l`hôpital

Les reconfigurations du travail infirmier
à l’hôpital
Françoise Acker*
Les établissements de santé, hôpitaux publics, hôpitaux privés participant
au service public et cliniques privées à but lucratif, sont actuellement tous
« en chantier », qu’il s’agisse de la redéfiniton de leur mode de fonctionne-
ment interne ou de leur positionnement dans l’ensemble de l’offre de soins.
L’encadrement externe des établissements a surtout porté sur leurs mis-
sions (types de spécialités médicales offertes, niveau de spécialisation des
services, niveau du plateau technique) définies dans le cadre des schémas
régionaux d’organisation sanitaire (SROSS) et des contrats pluriannuels
entre les établissements et les agences régionales d’hospitalisation (ARH)
ainsi que sur les modalités d’établissement de leurs ressources financières
en fonction d’une évaluation de leur activité (PMSI et, plus récemment,
T2A 1). Dans ce cadre les directions des établissements mettent en place de
nouveaux modes d’organisation qui ont pour objet d’assurer une meilleure
intégration des différents services et d’accroître l’efficience d’ensemble.
La gestion des ressources humaines devient plus resserrée et les responsa-
bles cherchent à calculer au plus juste les effectifs et les compétences
nécessaires dans les services de soins. Tout ceci conduit à définir de nou-
veaux espaces de travail et de nouveaux référentiels (Mossé, 2000). Cepen-
dant, la nécessité de porter attention aux modifications du travail lui-même,
travail qui constitue la « part oubliée des restructurations hospitalières »
selon Raveyre et Ughetto (2003), ne semble s’imposer que de façon
récente. La plupart des travaux ont abordé cette question sous l’angle de la
recomposition des personnels (réduction des effectifs et recomposition des
qualifications), de l’organisation du travail, de l’intensification du travail,
des conditions de travail ou encore de la souffrance au travail.
Dans cet article, je m’intéresse à la façon dont le travail des infirmières se
reconfigure actuellement dans les établissements de court séjour en fonc-
tion des nouvelles donnes qui pèsent sur le développement des établisse-
ments de santé de l’extérieur et en fonction des situations locales dans
lesquelles les infirmières ont à conduire leurs actions de soins. E. Hughes
avait, au début des années cinquante, proposé un programme d’analyse du
travail infirmier (Hughes, 1996). Pour lui, le travail des infirmières com-
prend tout ce qui doit être fait dans un hôpital, mais qui n’est pas fait par
d’autres catégories de personnes. Il convient donc d’étudier les tâches à
161
*Sociologue au Centre de recherche médecine, sciences, santé et société, CERMES.
1PMSI : programme de médicalisation du système d’information ; T2A : tarification à l’activité.

accomplir et d’identifier qui les réalise. Ceci oblige à porter attention aux
frontières entre le travail des infirmières et celui des autres types de person-
nel, ainsi qu’aux conflits et aux négociations que soulève la délimitation de
ces frontières.
En m’inscrivant dans le cadre de travail fixé par Hughes j’ai étudié les
façons dont les infirmières effectuent leur travail dans différents types de
services hospitaliers (Acker, 2004 a). Je me suis intéressée au travail lui-
même, aux tâches qui le composent, au processus d’interactions dans le
cadre duquel elles se déploient, aux relations que les différents acteurs
entretiennent avec le travail et à la façon dont, dans leurs pratiques quoti-
diennes, ils analysent les situations de travail et y réagissent pour accomplir
leurs tâches. J’ai été attentive aux contraintes qui pèsent sur les pratiques
quotidiennes, de façon directe, dans le cours des actions de soins, de façon
moins directe, mais tout aussi présente, dans les modes de présentation de la
réorientation des activités médicales et soignantes. J’ai également cherché
à comprendre comment le personnel infirmier pouvait, dans le cadre des
restructurations en cours, continuer à s’inscrire dans une dynamique pro-
fessionnelle qui a eu pour objet de développer une certaine autonomie dans
la définition des actions à entreprendre pour un patient et son entourage, et
de stabiliser, formaliser et mettre en œuvre des savoirs infirmiers (Acker,
2004a, 2004b ; Feroni, 1994).
Je présente ici quelques aspects des réorganisations en cours du travail des
infirmières : modes de redistribution des activités, modifications de la prio-
rité des tâches, réagencement des compétences entre les infirmières et les
autres personnels de soins. Ces déplacements ont souvent pour origine le
nouveau cadre temporel de la prise en charge des patients, la brièveté de
plus en plus grande des séjours hospitaliers, déterminée en fonction de cri-
tères médicaux et techniques. Les personnels infirmiers doivent redéfinir
une partie de leurs actions en mettant en balance les différents types de
soins requis par les patients, les tâches qu’ils souhaitent développer pour
donner une visibilité à leurs actions et les tâches supplémentaires qui leur
incombent, comme conséquences des modes de rationalisation des services
médico-techniques et logistiques, ou parce qu’elles s’avèrent nécessaires
pour maintenir l’intégration des actions indispensables au bon déroulement
du séjour des patients, mais sans être attribuées à des professionnels parti-
culiers. Cependant, les remaniements actuels du travail des infirmières ne
concernent pas seulement les tâches et leur redistribution mais aussi les
normes professionnelles qui les sous-tendent. Ce sont les conditions du tra-
vail lui-même, le travail et le mode d’engagement des infirmières dans le
travail qui sont en train de se recomposer.
162
RFAS No1-2005

Encadré 1 : Méthodologie
Cet article s’appuie sur les résultats d’un travail de recherche mené en
réponse à l’appel d’offres de la DREES-MiRe – « Les dynamiques profession-
nelles dans le champ de la santé » – qui avait notamment pour objectif
d’apporter des connaissances sur les « pratiques effectives des personnels ».
Pour étudier les reconfigurations en cours du travail infirmier j’ai décidé de
mener mes investigations dans un établissement spécialisé en cancérologie
dans lequel j’avais déjà procédé à des observations dans les années 1993-
1996 (Acker, 1997). Ceci me permettait de mobiliser d’emblée une connais-
sance de l’organisation du travail médical et soignant antérieure ainsi que
des liens tissés avec un certain nombre de cadres, d’infirmières et d’aides-
soignantes déjà rencontrés lors de la première recherche. Le fait de disposer
de quelques repères communs offrait un cadre de référence pour analyser le
travail et discuter avec les personnels en place des évolutions observées,
bien que les deux recherches n’aient pas porté de façon précise, comme
dans des études longitudinales, sur les mêmes aspects du travail infirmier.
L’étude s’est déroulée en
plusieurs étapes
:
– elle a débuté par une présentation de l’objet de la recherche à l’ensemble
des cadres supérieurs soignants de l’établissement, et par des entretiens
avec chacun de ces cadres pour établir un premier tableau des remanie-
ments en cours dans le département ;
– ont suivi des périodes d’observation du travail dans trois services de soins
– médecine et chirurgie – ainsi que dans des consultations infirmières ;
– à la suite de ces observations, j’ai mené des entretiens longs avec les
infirmières et les aides-soignantes de ces services pour revenir sur des évé-
nements, des pratiques particulières, pour mettre à l’épreuve ma compré-
hension de certaines situations et obtenir des informations complémentaires.
Certains entretiens ont été menés en groupe lorsque la charge de travail des
personnels soignants ne permettait pas de mener des entretiens individuels.
Des entretiens ont aussi été menés avec des médecins travaillant dans ces
services ;
– j’ai également été amenée à rencontrer des personnes extérieures aux
services observés : personnels d’autres services de soins, de services
médico-techniques, administratifs, du service social... lorsque leur présence,
l’incidence de leur travail sur celui des soignants, l’intrication de différents
types de travail m’apparaissaient au cours des observations, de l’analyse de
mes notes ou pendant les entretiens.
■La brièveté des séjours : un nouveau cadre
de travail
Le raccourcissement de la durée de séjour ne constitue pas, en soi, une ten-
dance nouvelle. C’est un objectif poursuivi depuis plusieurs dizaines
d’années par les responsables hospitaliers et leurs tutelles, afin de limiter les
coûts liés à l’hébergement et à la mobilisation de personnels qualifiés pour un
même patient. Il s’agit de réserver le recours à l’hôpital aux patients dont
l’état requiert la mise en œuvre d’actes diagnostiques et chirurgicaux devant
s’appuyer sur un plateau technique développé, de soins postopératoires et de
163
Les reconfigurations du travail infirmier à l’hôpital

traitements exigeant un environnement médical et soignant. L’accentuation
de la diminution des séjours hospitaliers a été rendue possible grâce aux
avancées des techniques médicales et chirurgicales (progrès de l’anesthésie,
chirurgies moins invasives et requérant moins de soins postopératoires),
grâce à la diversification et la multiplication de nouveaux dispositifs médi-
caux (pompes par exemple) et à la standardisation de certains traitements qui
permettent de laisser sortir plus rapidement les patients.
En revanche, la grande brièveté des séjours s’accompagne de restructura-
tions organisationnelles. Comme le mentionnent les travaux nord-améri-
cains (Lapointe, 2000 ; Bourgeault, 2001) les établissements ont regroupé
les patients non seulement selon la spécialité médicale, voire le même type
de traitements ou de stade de développement de la maladie, mais aussi selon
le temps de séjour programmé. Aujourd’hui, certaines réorganisations des
activités médicales et soignantes peuvent être entreprises sur le seul critère
de la durée de prise en charge. Selon le poids relatif des hospitalisations de
très court séjour ou des prises en charge ambulatoires, les patients sont
accueillis dans des lits ou places réservées à cet effet au sein d’un service
continuant à assurer des hospitalisations classiques ou au contraire sont réu-
nis dans des services spécialement redéfinis. Ces derniers sont consacrés
alors à des hospitalisations de semaine, et fermés en fin de semaine, ou à des
hospitalisations de jour. Les entrées des patients sont programmées en
fonction du temps de séjour anticipé, et la gestion des patients s’effectue en
flux tendus. Cette forme de « séjour » est proposée pour un certain nombre
d’interventions chirurgicales et pour des traitements médicaux, comme cer-
taines chimiothérapies anticancéreuses par exemple.
Ce raccourcissement de la durée de séjour a pour corollaire une augmenta-
tion des flux de patients soignés dans un même service. Chacun de ces
patients a besoin, à peu près au même moment, de soins spécialisés et des
surveillances qui y sont liées. La mise en forme de séjours très courts du
patient, déterminée sur des critères médicaux et techniques, tend à gommer
la variabilité des situations personnelles des patients et de leurs réactions à
la maladie et aux traitements. Et dans la mesure où l’autorisation d’ouver-
ture de « places » destinées à des prises en charge ambulatoires a souvent
été accordée en échange de la fermeture de lits d’hospitalisation, notam-
ment en médecine, le nombre limité de lits disponibles pèse sur les possibi-
lités d’aménager la durée de séjour anticipée des patients. Pour bon nombre
d’infirmières, l’attention aux problèmes personnels et sociaux du patient,
l’aide à leur apporter constituent une dimension centrale des soins (Acker,
1997) mais les tâches qui en découlent requièrent du temps, un temps qui
s’inscrit parfois difficilement dans le temps prédéfini du séjour du patient.
La standardisation des séjours et leur brièveté font naître des tensions inhé-
rentes à la gestion de la singularité à grande échelle d’une part (Minvielle,
2000), au besoin de mettre en œuvre des actions de soins non seulement
dans le cadre prévu du traitement médical mais aussi en fonction des
besoins d’un patient, tels que les évaluent les infirmières d’autre part.
164
RFAS No1-2005

■Réorganiser les soins
Si une réorganisation du travail médical s’est imposée en raison de la réduc-
tion de la durée de séjour, cette durée est souvent si brève qu’elle s’accom-
pagne d’un effet de seuil en terme d’organisation des soins. Lorsque tous
les patients d’un même service n’y sont accueillis que pour quelques heures
ou quelques jours et que les soins liés aux traitements et aux interventions
chirurgicales s’enchaînent selon un rythme soutenu, on peut observer des
perturbations et des dysfonctionnements dans le déroulement des soins et
dans le respect de la fluidité des flux de patients prévus. Face à de telles
situations, les personnels infirmiers et leur encadrement ont réagi en propo-
sant de nouveaux modes d’organisation des soins. Certaines dimensions du
travail infirmier ont ainsi été reportées en amont ou en aval de l’hospitalisa-
tion proprement dite, faute de temps pour les déployer pendant le séjour. On
assiste donc à une redistribution dans l’espace – lieux de prise en charge –
et dans le temps – pendant ou en dehors de l’hospitalisation – de différents
types de travail infirmier jusque-là enchevêtrés dans le cours des soins. Ces
derniers sont désimbriqués du travail assuré pendant le séjour pour consti-
tuer de nouvelles entités, identifiées en tant que telles dans l’organisation
du travail du service de soins.
Les consultations infirmières
Les consultations infirmières (cf. encadré 2) proposées avant l’entrée en hôpital
ou avant le début de certains traitements ou les suivis téléphoniques des
patients sortis de l’hôpital sont des modes de réponse organisationnelle élabo-
rés par le personnel soignant pour pouvoir continuer à assurer des tâches indis-
pensables d’information et de surveillance de l’évolution des patients.
Ainsi dans un service de chirurgie la non-information ou l’information insuf-
fisante des patients à leur arrivée se sont traduites par un débordement des
soignants confrontés à des demandes d’éclaircissement sur les interventions
et les traitements et des expressions d’inquiétude, de peur, voire d’angoisse.
Lorsque les patients étaient hospitalisés la veille de leur intervention, les
infirmières avaient le temps de leur donner les informations et explications
concernant l’intervention qu’ils allaient subir. Au moment où le service de
chirurgie est passé à un fonctionnement d’hospitalisation de semaine, les per-
turbations ont été particulièrement fortes certains jours, lorsque plusieurs
patients arrivaient en début de matinée, pour subir une intervention dans
l’heure ou les heures qui suivaient, alors que le personnel infirmier et aide-
soignant devait au même moment assurer le travail lié au départ au bloc opé-
ratoire et les soins aux patients opérés la veille ou les jours précédents. Ces
situations de départ insuffisamment traitées ont ensuite pesé sur l’ensemble
du déroulement du séjour et sur le type de relations établies avec les patients.
Le rétablissement de la confiance et du sentiment de sécurité demandait alors
165
Les reconfigurations du travail infirmier à l’hôpital
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
1
/
21
100%