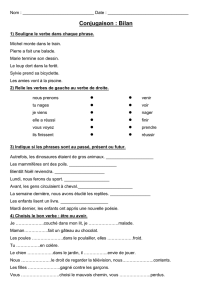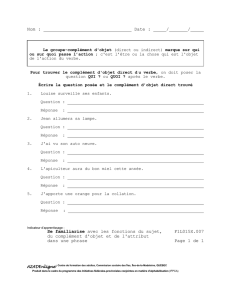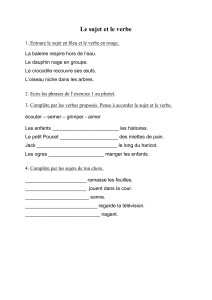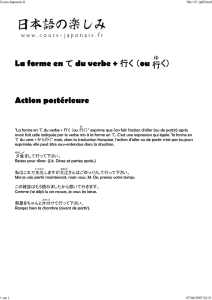Geneviève GIRARD-GILLET (éd.) Autour du verbe anglais

Geneviève GIRARD-GILLET (éd.) Autour du verbe anglais. Construction, lexique, évidentialité, Presses Sorbonne
Nouvelle, 2014, 199 p.
L’ouvrage regroupe des articles issus de communications prononcées au colloque « Autour du verbe /
Around the Verb », organisé en l’honneur de Claude DELMAS par Geneviève GIRARD-GILLET, Eric CORRE, et
Aliyah MORGENSTERN (SeSyLIA, EA 4398 PRISMES) les 21-22 septembre 2012 à la maison de la Recherche
de l’université de Paris 3. Sur les 18 contributions au colloque, toutes citées, 10 figurent ici, traitant de
phénomènes variés sous des angles théoriques différents. A ces articles s’ajoute une substantielle présentation
ainsi qu’une conclusion de Geneviève GIRARD-GILLET, responsable du volume.
Il s’agit d’un volume élégant et très lisible publié dans la collection Sciences du langage et Traduction
des PSN. L’équilibre du volume est appréciable, avec des articles de même longueur (11 à 13 pages pour la
plupart, 2 légèrement plus longs). S’agissant d’actes d’un colloque, il faut bien entendu faire la part d’une
certaine hétérogénéité naturelle des problématiques, d’autant que la diversité des approches n’a pas été refusée,
mais les contributions ont été utilement regroupées en 3 parties thématiques assez solides :
1- Construction - présence / absence : 3 articles sur l’absence du verbe lui-même (« Les procès dans
les énoncés averbaux », Jacqueline GUILLEMIN-FLESCHER), son anaphorisation et son ellipse avec les
constructions de pseudogapping et gapping face à des constructions à verbe plein (do it/this/that et do so)(« Les
compléments orphelins dans les ellipses et anaphores verbales en anglais », Philip MILLER), et l’absence du
sujet et sa récupération grâce au programme sémique du verbe régi dans les complémentations en -ING (« La
complémentation gérondive : étude du schéma V1 - V2+ ING », Alain DESCHAMPS).
2- Lexique - compositionnalité : 4 articles sur la sémantique verbale. Le « débordement » de sens du
verbe go et sa grammaticalisation tout d’abord (« ‘Bang goes the theory’ : le verbe go et ses constructions
multiples », Jean ALBRESPIT), le cadrage réputé « satellitaire » de l’anglais et le rôle de la déixis pour le
déplacement et la manière (« Le français langue à cadrage verbal et l’anglais langue à cadrage satellitaire... ou
non : interrogations à partir d’un court corpus de textes littéraires », Catherine CHAUVIN), la structure
argumentale du verbe give et l’apprentissage (« The blossoming of three-argument verbal constructions in child
language: a study of "give constructions », Aliyah MORGENSTERN & Nancy CHANG), et enfin la complémentarité
du moyen et de la fin dans la théorie atomique (Atom Theory) (« Verb meaning and context: a criticism of
Manner-Result Complementarity », Tova RAPOPORT).
3- Evidentialité - Perception : 3 articles à propos de la place de l’ « individu-locuteur » et de ses
spécificités ou capacités, autour de l’évidentialité, avec le caractère de témoignage que prend le present-perfect
dans ses emplois narratifs, sa « contribution évidentielle » (« Remarques sur le perfect en anglais et dans d’autres
langues », Jacqueline GUERON), avec can et la construction de la connaissance à partir de la vision (« Can avec
les verbes de perception », Lionel DUFAYE), avec les relations d’échange par la gestuelle (« Marqueurs
grammaticaux et marqueurs kinésiques : vers une reconnaissance de la gestualité co-grammaticale », Jean-Rémi
LAPAIRE).
Le lecteur trouvera des informations essentiellement sur l’anglais et le français, avec seulement
quelques notes comparatives dans l’article de J. GUERON sur le parfait (bulgare) et des remarques sur les créoles
par J. ALBRESPIT. Cette concentration est conforme au centrage de l’ouvrage sur le verbe anglais, et garantit la
relative homogénéité de ce groupement d’articles, mais, en pensant à Claude DELMAS, on pourrait regretter à
propos de cette immense question du verbe que la comparaison ne soit pas plus présente et plus étendue. De
même, à la première lecture de la table des matières, le lecteur aura sans doute l’impression d’ouvrir un énième
recueil sur l’anglais, avec des questions aussi peu originales que le parfait, la forme en V-ing, can et la
perception, ou les compléments orphelins, l’ellipse et l’anaphore.
Cependant, la lecture de l’introduction de Geneviève GIRARD-GILLET amène à qualifier rapidement
cette première impression, car les articles y sont bien entendu très bien présentés, mais aussi argumentés selon un
fil d’ariane parfois discret dans les textes mais beaucoup plus net dans leur succession : l’exploration de cette
obsédante « béance » entre les structures formelles et leur fonctionnement effectif, et le besoin de plus en plus
net d’une problématique de la construction du discours plutôt que de son héritage sous forme de langue
saussurienne. De ce point de vue, la diversité des approches théoriques, au lieu d’affaiblir l’ouvrage, renforce sa
pertinence.

La première partie traite directement de l’absence : pour J. GUILLEMIN-FLESCHER, si le verbe est absent,
où est le procès ? que sont devenues les règles de bonne formation ? ou bien P. MILLER pose la question du
procès construit qui permet d’interpréter des énoncés elliptiques et les relations anaphoriques, et A. DESCHAMPS
se demande comment est construit le sujet « sémantiquement nécessaire » mais formellement absent dans les
complémentations propositionnelles. Sans qu’il soit explicitement et directement question de l’évidentialité dans
ces 3 articles, il y est dit que la « construction » de l’énoncé en est indissociable.
La deuxième partie tend davantage le fil, avec l’article de J. ALBRESPIT à propos du verbe go et la
relation de la langue à l’expérience « sensori-motrice du monde », thème actuellement très débattu autour de la
cognition et de la grammaticalisation : quelle médiation relie la langue à notre expérience ? Quel « potentiel
sémantique » recèle le verbe go et, plus largement, la notion l’aller ou celles du mouvement en général ? Cette
réflexion se poursuit dans l’article suivant de C. CHAUVIN entre l’anglais et le français et le
« cadrage satellitaire » ou « verbal » de TALMY (1985), le caractère « déictique » de l’anglais par rapport au
français. La notion de déplacement, dans un sens cognitiviste ou non, se retrouve dans le verbe give, étudié par
A. MORGENSTERN et N. CHANG de manière très argumentée et très concrète dans l’apprentissage qu’en font trois
enfants anglophones. Enfin, l’article de T. RAPOPORT sur sa Théorie Atomique originale (avec N. ERTESCHIK-
SHIR) associe la Manière des procès (manière, progression, moyen) et leur Résultat (états) à la « tête »
morphologique du verbe comme autant d’« atomes sémantiques » qui se retrouvent dans les arguments. Par
conséquent, le lexique apparaît comme indissociablement lié à l’expérience, non seulement par son statut
sémantique ordinaire, mais également par son statut de médiateur cognitif, pour ainsi dire.
L’évidentialité est posée centralement comme fil conducteur de la troisième partie. J. GUERON la donne
de façon convaincante comme une problématique du present perfect et du parfait en général. L’observation, le
témoignage, trouvent dans le parfait une forme spécifique d’expression, ce qui remet en perspective nombre d’a
priori sur les notions de temps et surtout d’aspect. Même chose pour L. DUFAYE pour qui le verbe de perception
permet de focaliser l’objet perçu, et non le témoin, ce qui provoque des écarts importants entre l’anglais et le
français, can n’étant traduisible par pouvoir que dans 12% des cas. A contrario, l’absence de can pose la
perception comme centrée sur l’observateur, ce qui permet de moduler de manière intéressante les interprétations
des formules à verbe simple, trop souvent prises pour des généralités désincarnées.
L’ouvrage se termine par l’article de J-R. LAPAIRE sur les marqueurs kinésiques et leur lien avec la
représentation, au point que l’auteur suggère de les appeler « co-grammaticaux », avec toute leur force inter-
subjective. Dès lors, le geste ne doit plus être compris comme un accompagnateur du discours mais comme un
épisode d’une « série d’actions symboliques » qui font que, loin de « coder » ou « exprimer », nous
« fabriquons » le sens. Un geste, c’est un « geste propositionnel manifestant la vie ».
La conclusion de G. GIRARD-GILLET confirme cette lecture : l’énoncé est une « construction » qui a
besoin d’un « énonciateur/témoin » comme « source de la pertinence de ce qui est dit ». Il s’agit là d’un recueil
qui pose sans doute plus de questions qu’il n’apporte de réponses, mais si on le lit dans la perspective décrite
rapidement ci-dessus, on comprend qu’il aborde le domaine essentiel, qui commence à peine à être retrouvé et
exploré en linguistique structurale : celui de l’interactivité, possiblement de l’interférence, peut-être de la
médiation cognitive, qui font le discours. Et derrière la catégorie de l’évidentiel se profile toute la question de
l’observation et de la relativité. La grande question de la construction du sens est certes « qui parle ? », mais elle
devrait être aussi, et peut-être d’abord, comme il est montré ici, « qui observe qui ? »
D. ROULLAND
4/11/2014
Talmy, L. (1985) “Lexicalization patterns: semantic structure in lexical forms”, in Schopen, T. (ed) Language
Typology and Syntactic Description, vol. 3, CUP, 57-149.
1
/
2
100%