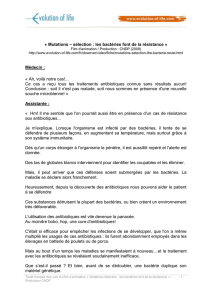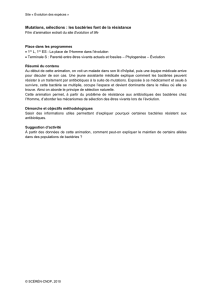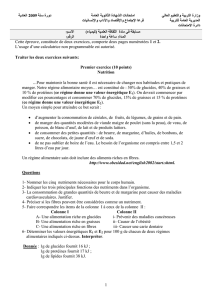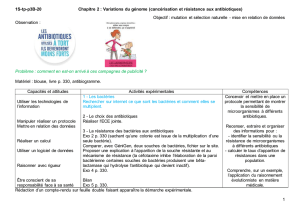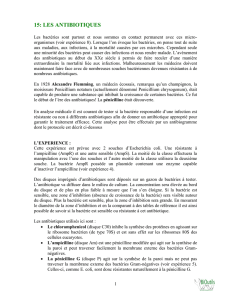BOUÉ Kévin AIH Pr B. LA SCOLA 16 pages Bactéries Gram

AIH – Bactéries Gram négatif
07/03/2016
FOULHIOUX Laura L2
CR : BOUÉ Kévin
AIH
Pr B. LA SCOLA
16 pages
Bactéries Gram négatif
A. Généralités : les protéobactéries
On remarque qu'il y a des espèces
très fréquemment isolées (comme
!"!#$%&!, 127 fois par
semaine en moyenne) et d'autres
plus rares (comme
'( %)#"( !#* %+', 4 fois
par semaine en moyenne).
Les bactéries fréquemment
isolées à l’hôpital ne sont pas
toujours les mêmes que celles
isolées dans les laboratoires de
ville.
1/14
Plan
A. Généralités : les protéobactéries
B. Les δ-ε proteobactéries
,- $#./0&%)#"( 112'!
,,- 3&!"%)#"( /0&% !
C. Les α protéobactéries
D. Les β protéobactéries
,- 4! !#.'!'+!(!5!6%2.7'!'+%"%829
,,- 4! !#+%'% %#6%2+%'%"%829
,,,- :% 5(&&#/ (2!
E. Les γ protéobactéries
,- ; %2/<
,,- ; %2/=
,,,- ; %2/>
,?- *2( @/ %(7%)#"(7 !82!'%'(/#5'(7 %)#"(7 !
F. Bactéries à Gram négatif intracellulaires : Chlamydiales
G. Bactéries à Gram négatif anaérobies

AIH – Bactéries Gram négatif
Les bactéries à Gram négatif font essentiellement partie de la famille des protéobactéries.
Il s'agit d'un groupe majoritaire de pathogènes humain car elle donne l'essentiel des infections chez l'Homme.
Les protéobactéries sont divisées en 4 groupes :
–Les α protéobactéries
–Les β protéobactéries
–Les δ-ε protéobactéries
–Les γ protéobactéries
La plupart de ces bactéries sont aérobies, c'est à dire qu'elles ont soit besoin de dioxygène pour leur croissance
soit qu'elles le tolèrent. Les protéobactéries les plus fréquentes sont les γ protéobactéries (entérobactéries).
B. Les δ-ε protéobactéries
Ces bactéries sont microaérophiles : elles ont besoin d'O2 pour leur croissance mais des concentrations trop
élevées sont toxiques pour elles.
Il y en a deux qui ont un intérêt médical majeur :
–Le genre $#./0&%)#"(
–Le genre 3&!"%)#"(
,-$#./0&%)#"( 112'!682!!'A"(&112'2.9
Habitat :
On retrouve cette bactérie dans la flore bactérienne digestive animale. L'homme est contaminé par la
consommation de produits d'origine animale (volailles, produits laitiers non pasteurisés, viandes...)
Pouvoir pathogène :
Ce sont des infections très fréquentes qui causent des diarrhées. Les diarrhées bactériennes sont en effet le plus
souvent liées à ce $#./0&%)#"( 112'!. Elles sont très fréquentes chez les enfants mais les adultes quant à eux
sont relativement immunisés.
Cette bactérie peut également causer, plus rarement, un syndrome de Guillain Barré, c'est-à-dire une
polyradiculonévrite. Il s'agit d'une atteinte de tous les nerfs de l'organisme aussi bien moteurs que sensitifs. Les
manifestations cliniques sont variables avec une hypoesthésie/anesthésie et une paralysie ascendante qui
commence au niveau des pieds. Dans les formes sévères les muscles respiratoires sont paralysés pouvant
entraîner la mort, les patients sont donc placés sous respirateurs artificiels.
Traitement :
Pour la diarrhée : La plupart du temps on ne donne pas de traitement et la guérison de la diarrhée est
spontanée. Pour le syndrome de Guillain Barré : On utilise des techniques basées sur des
immunosuppresseurs. Après passage en réanimation les patients guérissent.
Identification :
C'est une bactérie que l'on peut isoler en culture en microaérophilie. Elle ne cause pas de problème de
résistance aux antibiotiques.
L'infection devient problématique quand tout un élevage de volailles est contaminé...
2/14

AIH – Bactéries Gram négatif
,,-3&!"%)#"( /0&% !
Habitat normal :
On trouve cette bactérie dans l'estomac d'un grand nombre de mammifères. Tous les mammifères sont en fait
plus ou moins infectés. Dans les populations humaines le taux d’infection est variable et peut atteindre jusqu'à
30%. Chaque espèce a son 3&!"%)#"( propre qui colonise son estomac, chez l'Homme c'est 3&!"%)#"(
/0&% !. Elle est capable de survivre dans des conditions très acides : c'est une des seules bactéries capables de
survivre dans l'estomac.
Pouvoir pathogène :
Pour survivre dans l'estomac, elle a développé un phénotype particulier : elle est spiralée et est capable de se
mouvoir dans le mucus de l'estomac. Elle se protège de l'environnement acide en sécrétant des bases
(essentiellement de l'ammoniac) et créé ainsi un environnement basique autour d'elle. Cependant cette sécrétion
basique stimule la sécrétion d'acide dans l'estomac, c'est un cercle vicieux. Cette surproduction d'acidité
entraîne à terme l'ulcère de l'estomac.
Pendant longtemps l'ulcère est resté une maladie mystérieuse, récidivante continuellement et traitée par des
anti-acides qui bloquaient l'acide chlorhydrique au niveau de l'estomac. On pensait que cette maladie était
d'origine psychologique (stress, surmenage). Marshall, un gastro-entérologue néo-zélandais a remarqué
lorsqu’il faisait des biopsies de l'estomac pour surveiller des ulcères (afin de vérifier qu'ils ne se transforment
pas en cancers) qu'il observait toujours ces petites bactéries spiralées. Cependant il n'a jamais réussi à les mettre
en culture. Par mégarde, il a un jour oublié ses cultures et est parti en vacances. A son retour, les bactéries
avaient proliféré. La croissance des 3&!"%)#"( /0&% ! est en effet très lente. Marshall a donc découvert l'agent
responsable de l'ulcère de l'estomac et, pour le prouver à la communauté scientifique, il a bu sa suspension
d'3&!"%)#"( /0&% ! pour s'auto-infecter et il a bien développé un ulcère à l'estomac.
Çà a été très long pour que la communauté médicale accepte que l'ulcère soit une maladie infectieuse et non pas
une maladie liée au stress. On a alors commencé à traiter les ulcères par des antibiotiques. Les résultats étaient
mitigés car ces derniers fonctionnement mal en milieu acide. Il fallait trouver des protocoles associant des anti-
acides et des antibiotiques. Marshall a finalement guéri de son ulcère et a eu le prix Nobel.
Aujourd'hui il faut environ 5 semaines de traitement pour éradiquer la bactérie au niveau de l'estomac.
L'éradication complète n'est pas si simple : résistance aux antibiotiques, réinfections au contact de patients
(notamment les enfants qui s'infectent au contact de la salive des parents)...
Il y a des populations beaucoup plus atteintes, notamment celles d'Inde où tout le monde mange avec les doigts
dans le même plat et où toute la famille se contamine.
On s’est aperçu que cette bactérie était également responsable du cancer de l'estomac (une des rares bactéries
ayant un pouvoir cancérigène).
C. Les α protéobactéries
6B'#2 #2'"%2 /7"!A!822 ")#"(7 !-9
➢C!"D((!#//-
•Rickettsies du groupe boutonneux
– - C-"%'% !!EC-&%F#"#
G-#A !"#
•Richettsies du groupe typhus
GC-(0/!
GC-/ %H#ID!!
3/14

AIH – Bactéries Gram négatif
➢:# (%'&&#//-
G:-82!(#'#
G:-'&#
➢: 2"&&#//-
D. Les β protéobactéries
,-4! !#.'!'+!(!5!6%2.7'!'+%"%829
Pouvoir pathogène :
C'est une bactérie avec un pouvoir pathogène important : c'est l'agent de la méningite cérébro-spinale.
La méningite cérébro-spinale se traduit par des céphalées, de la fièvre, une photophobie, une raideur méningée
(les patients ont une raideur de la nuque, ils sont bloqués quand on veut leur soulever la tête en position
allongée) et une constipation.
La bactérie peut également donner une septicémie : le Purpura fulminans.
Il s'agit de suffusions hémorragiques qui surviennent au niveau de la peau,
dues à la rupture de capillaires sanguins. Ces taches apparaissent très
rapidement. (C'est différent d'une simple vasodilatation : quand on appuie avec
un verre sur les lésions les taches purpuriques ne disparaissent pas puisque le
sang est passé à l'intérieur de la peau)
Le purpura est le signe d'une coagulation intravasculaire disséminée et précède
un choc septique qui peut mener à un arrêt cardiaque.
C'est la seule urgence antibiotique : la première chose à faire est d'injecter des
antibiotiques au patient. Plus ils sont administrés tôt, plus on a de chance de
guérir le patient.
La transmission est interhumaine et se fait vraisemblablement par voie aérienne. La bactérie va se localiser au
niveau du rhino-pharynx.
On ne sait pas expliquer pourquoi, mais lors d'une épidémie de méningite, il n'y a que 2 ou 3 cas de méningites
par rapport au grand nombre de personnes entrées en contact avec une personne malade.
Diagnostic :
Avant on faisait le diagnostic par culture à partir du LCR recueilli par ponction lombaire. Le LCR n'est plus
transparent mais trouble (l'aspect « eau de roche » se transforme en un aspect « eau de riz ») car au lieu de
n'avoir que quelques rares cellules il y a de nombreux polynucléaires et du pus.
Une autre méthode était de faire une hémoculture dans un automate qui détecte la croissance des bactéries.
Aujourd'hui on ne peut plus faire les diagnostics de cette façon car les patients sont sous antibiotiques dès que
les premiers signes apparaissent : il n'y a donc plus de bactéries vivantes quand on fait le prélèvement.
Le diagnostique actuel se fait donc par biologie moléculaire : on utilise une réaction de PCR pour amplifier le
gène spécifique du méningocoque. On met ainsi en évidence une partie d'acide nucléique mort puis on fait un
typage pour savoir de quelle souche de méningocoque il s'agit.
Cela a son importance en épidémiologie : En France le sérotype B est le plus fréquent, en Afrique il s'agit des
sérotypes A et C et au proche Moyen Orient des sérotypes Y et E. À Marseille on note un pic de phénotype Y et
E au retour du pèlerinage de la Mecque. Aujourd'hui il existe un vaccin contre tous les sérogroupes. En Arabie
Saoudite le vaccin est obligatoire pour le pèlerinage car il y a trop eu de problèmes de contamination entre les
individus.
Traitement :
Il est désormais possible de se faire vacciner contre la méningite, le vaccin est non obligatoire mais il est
intelligent de vacciner les communautés (autrefois on pouvait vacciner les jeunes hommes lors du service
militaire). Quand il y a un cas de méningite dans une école, on met en place la vaccination des enfants ayant été
en contact avec le malade. Le traitement repose sur les antibiotiques en urgence.
4/14

AIH – Bactéries Gram négatif
,,-4! !#+%'% %#6%2+%'%"%829
Pouvoir pathogène :
Le gonocoque entraîne une infection sexuellement transmissible (IST).
•Chez l'homme : Cette IST entraîne une urétrite aiguë qui se manifeste par des brûlures urinaires
intenses (blennorragie) encore appelée la « chaude pisse » en terme populaire. On note également la
présence de pus au niveau du méat urinaire. L'urétrite est très douloureuse et peut se compliquer par des
orchites ou des épididymites.
•Chez la femme : L'infection est plus vicieuse car les manifestations cliniques sont moins flagrantes. Elle
engendre une dysurie (pertes urinaires moins importantes, inconfort urinaire) et une pesanteur sus-
pubienne. Les femmes peuvent donc garder l'infection relativement longtemps sans s'en apercevoir et
c'est ce qui explique que cette maladie ne disparaisse pas. Des complications sont également possibles :
salpingites purulentes, et cervicites (inflammation du col de l'utérus).
Diagnostic :
Chez l'homme la symptomatologie est évidente, on ne cherche qu'une confirmation, on n'attend pas le
diagnostic de certitude avant le traitement. On cultive alors la bactérie à partir du pus. Il s'agit d'une bactérie
très fragile et la culture est peu efficace. Ce qui fonctionne le mieux est la biologie moléculaire avec
amplification par PCR.
Chez la femme on fait un prélèvement cervical puis une biologie moléculaire.
Les infections à gonocoque peuvent se compliquer chez les deux sexes par des phénomènes bactériens.
La bactérie passe dans le sang et va se localiser dans d'autres endroits, notamment au niveau des articulations,
ce qui peut causer des arthrites infectieuses, relativement rares bien que cette bactérie en est la cause
principale. Chez la femme c'est au moment des règles que la localisation de la bactérie change : l'afflux de sang
stimule la bactérie et celle ci passe dans la circulation générale.
Traitement :
On fait un traitement-minute à l'aveugle. Quand on a un patient qui présente les signes cliniques du
gonocoque, on lui injecte des antibiotiques à longue durée de vie dans le sang directement au cabinet ou en salle
de consultation sans attendre. En effet si on ne le fait pas, le patient risque de mal prendre les antibiotiques ou
de ne pas les prendre du tout. En pratiquant cette méthode, on est certain que le patient sera guéri et qu'il n'ira
pas contaminer d'autres personnes. Ce traitement-minute fait donc partie du traitement, mais aussi de la
prévention. Une autre prévention est l'utilisation de moyens de contraception comme les préservatifs.
,,,-:% 5(&&#/ (2!
Pouvoir pathogène :
C'est une bactérie qui a pour particularité de secréter une toxine tussigène (qui fait tousser) et d’entraîner la
maladie de la coqueluche (appelée ainsi car la toux ressemble au chant du coq). La contamination se fait par
voies aériennes et la bactérie se multiplie au niveau du rhino-pharynx.
Selon l'âge l'infection est plus ou moins grave. Cette maladie est bénigne chez l'enfant et l'adulte, en revanche
elle est dangereuse pour les nourrissons : ils vont tousser au point de se mettre en détresse respiratoire, ne
plus arriver à reprendre leur respiration et s'asphyxier. Plus l'enfant est petit plus la maladie est sévère.
Cette maladie est donc responsable de mortalité/passage en réanimation.
5/14
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
1
/
14
100%