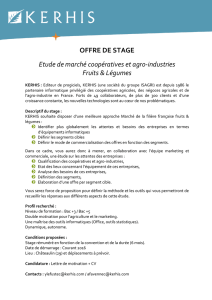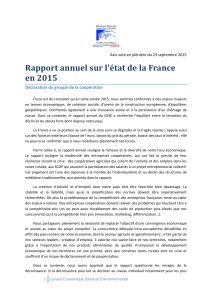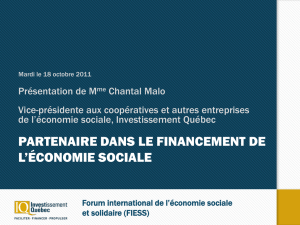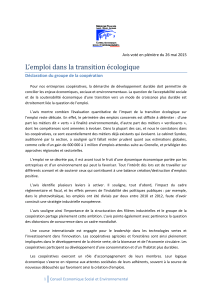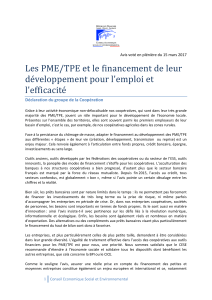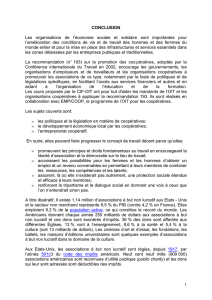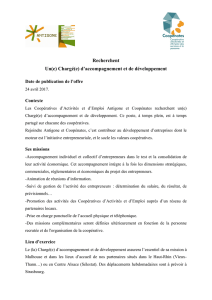Rapport Mission étude coop santé Japon

1

RAPPORT DE MISSION LES COOPÉRATIVES DE SANTÉ AU JAPON : Octobre 2007
Présentation
L’idée d’organiser une mission d’études canadienne au Japon à l’automne 2007 vient de deux sources : depuis
1995, aux fins de divers rapports et travaux de recherche, j’ai eu l’occasion d’étudier plus en détail à la fois le
système de santé japonais et la place des coopératives de santé dans ce système. D’un point de vue pratique, aussi
depuis le milieu des années 1990, j’ai l’opportunité de suivre le développement de la concertation des réseaux de
coopératives de santé à l’échelle internationale. Ceci a d’ailleurs donné naissance en 1996 À l’Organisation
internationale des coopératives de santé connue sous son appellation anglaise “International Health Cooperative
Organisations” (IHCO). Depuis 2001, j’ai le privilège de représenter à son bureau de direction, le mouvement
coopératif canadien, tant francophone qu’anglophone et en 2005 on m’a désigné à titre de commissaire pour
l’Amérique du Nord. Cette tribune m’a permis d’y nouer d’excellentes relations avec les délégués de l’organisation
japonaise des coopératives de santé présente à ce bureau, l’Association des coopératives de santé de l’Union
japonaise des coopératives de consommateurs (ACSUJCC). Une délégation de cette association a d’ailleurs effectué
au Canada, essentiellement du côté du Québec, une visite d’une semaine au printemps 2004 et depuis, quelques
médecins de cette organisation sont venus au pays. Je dois d’ailleurs souligner que suite à la visite de 2004,
l’Association a pris sur elle de traduire en français une brochure d’une trentaine de pages présentant son
organisation, sa philosophie, ses engagements, «A tous ceux qui ont des rêves à réaliser…» Ce document a été
largement diffusé auprès de locuteurs francophones intéressés au sujet.
Mais pourquoi ce réseau de coopératives en particulier? De ce qui m’a été possible de voir sur le plan
international, ce réseau se singularise à plusieurs égards et me semble un exemple fort inspirant pour le Canada.
• Une organisation coopérative : de la base au sommet, il s’agit d’un réseau coopératif qui respecte
les règles et principes de la coopération : libre adhésion, démocratie, éducation à la coopération,
intercoopération, engagement dans la communauté. À ce dernier égard, il faut souligner un
ensemble d’externalités positives : on ne compte plus les exemples ou ce réseau a un impact
remarquable auprès de ses membres, mais aussi dans les milieux ou il intervient. À ce sujet, tel
que nous l’avons appris dans la mission d’études, il faut souligner l’engagement de ce réseau dans
un programme avant-gardiste de l’Organisation mondiale de la santé, celui des villes amies des
aînés;
• Une forte intégration de la prévention et de la promotion de la santé dans ce réseau coopératif. Il
ne s’agit donc pas seulement de vœux pieux comme on le voit trop souvent dans de nombreuses
organisations en santé, mais d’engagements et de pratiques aux divers échelons du réseau dont le
développement des groupes Hans, un moyen de prévention qui rejoint l’individu dans sa
communauté de vie;
• Un engagement constant dans l’animation d’une association Asie-Pacifique (APHCO) regroupant
des coopératives de santé de divers pays de cette grande région du monde.
Après avoir rappelé des éléments de contexte –histoire, système de santé et état de santé de la population -- ce
rapport se veut l’écho aux observations et apprentissages réalisés durant cette semaine fort intensive d’immersion
dans la réalité de ce réseau coopératif dans le domaine de la santé au pays du Soleil levant.
Jean-Pierre Girard
Note : J’adresse mes remerciements chaleureux à Marie-Joëlle Brassard du Conseil québécois de la coopération et
de la mutualité et Michel Clément de la Direction des coopératives du Ministère du Développement économique, de
l’Innovation et de l’Exportation du gouvernement du Québec dont les rapports respectifs m’ont inspiré. Nobu
Kitajima de l’ACSUJCC a aimablement révisé certaines informations techniques de ce rapport.
1

Table des matières
1-Objectifs de la mission 3
2-Données de base 4
3-Survol historique du Japon 4
4-Le Japon au XXIe siècle 5
Démographie et population
La santé des Japonais
5-Le système de santé 6
Défis du système de santé
6-Les coopératives japonaises et la santé : contexte 10
7-Les coopératives dans le secteur de la santé et le réseau de l’ACSUJCC 11
Les coopératives de santé en quelques mots
La Charte des droits des patients
Les groupes hans
Vision régionale de la santé (à travers la « carte de rêve en santé »)
Des centres de ré-adaptation
Une organisation engagée
Un positionnement global dans le domaine de la santé et des défis
Références 21
Annexes
1. Programme de la mission 22
2. Conférenciers au 3e Forum international des coopératives de santé 24
3. Liste des participants à la mission 26
4. La mission en quelques photos 27
Partenaires de la mission 31
2

RAPPORT DE MISSION LES COOPÉRATIVES DE SANTÉ AU JAPON : Octobre 2007
1-Objectifs de la mission
La mission visait quatre grands objectifs complémentaires entre eux, soit :
• Se familiariser avec le système de santé du Japon et ses principales composantes;
• Approfondir le modèle des coopératives de santé du Japon (description du réseau, services
offerts, philosophie d’intervention et autres particularités);
• Approfondir le modèle des « Groupes Hans » qui sont des groupes de bénévoles axés sur la
prévention et rattachés aux coopératives de santé;
• Mieux connaître les services réseau développés par les coopératives de santé (à travers leurs
regroupements de 2e et 3e niveaux).
3

RAPPORT DE MISSION LES COOPÉRATIVES DE SANTÉ AU JAPON : Octobre 2007
2-Données de bases
Population : 128,085,000
Produit national brut per capita ($) : 31,410
Espérance de vie h/f (année) : 79/86
Espérance de vie en santé à la naissance h/f (années, 2002) : 72/78
Probabilité de mourir avant 5 ans (par 1 000 naissances) : 4
Probabilité de mourir entre 15 et 60 ans h/f (par 1 000 pop.) : 92/45
Dépenses totales en santé per capita (Intl $, 2004): 2,293
Dépenses totales en santé en % du PNB (2004) : 7.8
Données de 2005, sauf indication contraire. Source: World Health Statistics 2007
3-Survol historique du Japon
Situé à l’extrémité orientale du continent asiatique, le Japon est composé de quatre grandes îles et
de 3900 petites îles, pour une superficie de 377 435 kilomètres carrés. Une grande partie du
territoire est couvert de forêts et de montagnes, lieux plus ou moins propices à l’habitation
humaine, ce qui fait que la majorité des 128 millions d’habitants doivent se concentrer sur le tiers
du territoire, en fait 50% de la population se concentre sur 2% du territoire. Ceci explique
pourquoi le Japon se situe dans les pelletons des têtes des pays ayant la plus forte densité de
population au monde soit 337,4 habitants/km2 sur l’ensemble du territoire et de 1523
habitants/km2 en ne considérant que les zones habitables Sur le plan administratif, le pays est
divisé en 47 préfectures et 26 administrations municipales majeures.
Longtemps fermé à toute ouverture vers l’extérieur, ce n’est qu’à la faveur de la Restauration de
Meiji en 18681, que ce pays va graduellement délaisser son attachement à une société féodale
pour s’engager dans la construction d’un État moderne. Missions d’études à l’étranger,
investissement dans des infrastructures, urbanisation, développement de méga-entreprises, le
Japon au tournant du XXe siècle va s’imposer comme première grande puissance commerciale en
Asie. Sur le plan sociosanitaire, le Japon va importer le modèle de la santé mis au point en
1 Fin de la politique d’isolement volontaire. Le nom Meiji fait référence au nom d’emprunt alors adopté par
l’empereur du Japon, Mutsohito.
4
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
1
/
32
100%