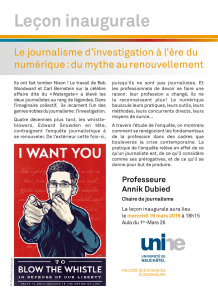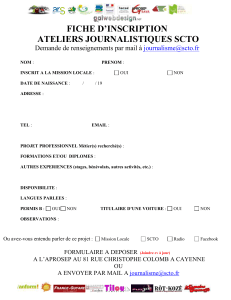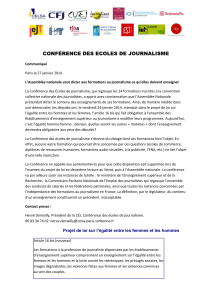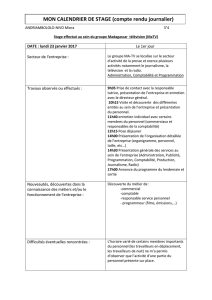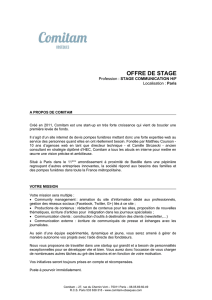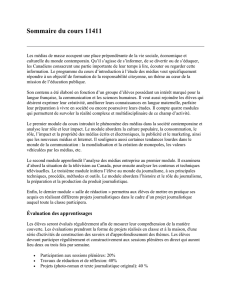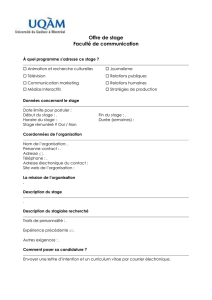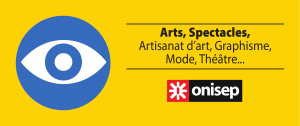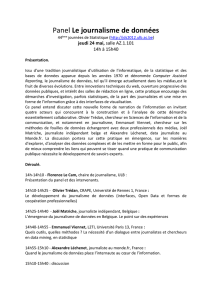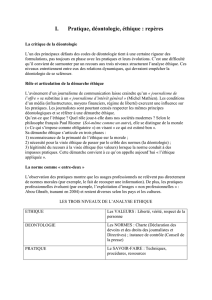Le journaLisme guerre et paix au rwanda

Le journaLisme
entre
guerre et paix
au rwanda
Annie Laliberté
Sciences sociales/Sociologie
Photo de couverture :
Annie Laliberté, anthropologue, a séjourné en Bosnie-Herzégovine et au Rwanda an
de témoigner du quotidien des journalistes mandatés pour réhabiliter un métier entaché
par la propagande de guerre. Depuis 15 ans elle s’intéresse aux zones post-conit et tente
de cerner les métastases de guerre qui perdurent au-delà des règlements internationaux.
Dirigée par
Francine Saillant
Le journaLisme entre guerre et paix au rwanda
Le journaLisme entre guerre et paix au rwanda
Annie
Laliberté
La condamnation pour incitation au génocide d’éditeurs et d’animateurs qui
s’achaient comme journalistes par le Tribunal pénal international pour le
Rwanda, une première dans l’histoire des médias, a été le catalyseur d’un vaste
mouvement international de rehaussement des compétences des journalistes
en zone de conit. Depuis 15 ans, des coopérants, souvent des journalistes
chevronnés, se donnent pour but de rebâtir des médias de qualité au Rwanda,
en donnant des formations et en appuyant le développement d’une législation
de la presse. De manière paradoxale, ce mouvement de construction de paix
par le journalisme coïncide avec une répression politique grandissante envers
les journalistes locaux. Un journalisme de « paix » peut-il vraiment se substi-
tuer à un journalisme de « guerre » ?
Cet ouvrage d’anthropologie entend apporter une modeste contribution à
l’étude des formes contemporaines de la violence et des conits. En plus de cet
apport théorique, l’auteure tente de développer une méthode d’écriture pou-
vant s’adapter aux eets de violence et d’autoritarisme déployés sur le terrain,
et qui obligent l’être humain à une coupure drastique avec son environnement.
Enn, sur le plan empirique, elle insiste sur la pertinence d’allier l’observation
de l’expérience immédiate de la coopération dite « postconictuelle » à une
généalogie des conits qui ont inspiré cette forme de coopération.


LE JOURNALISME
ENTRE GUERRE ET PAIX AU RWANDA


Annie Laliberté
LE JOURNALISME
ENTRE GUERRE ET PAIX AU RWANDA
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
1
/
35
100%