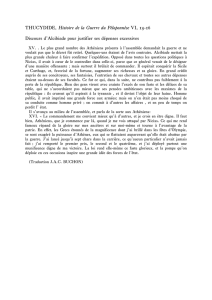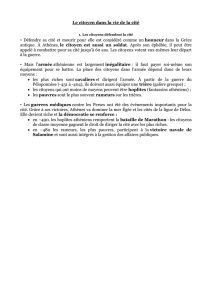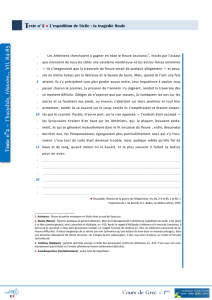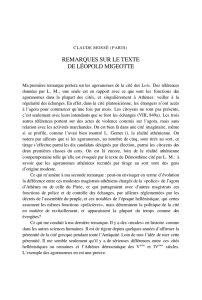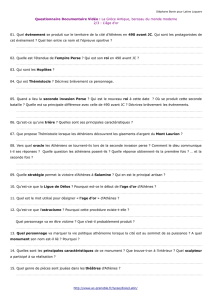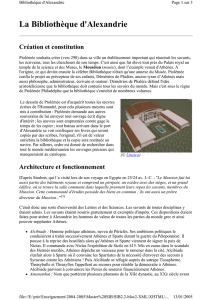La revanche des Perses - L`Histoire antique des pays et des

LA MARINE DES ANCIENS
LA REVANCHE DES PERSES
PAR LE VICE-AMIRAL JEAN-PIERRE E. JURIEN DE LA GRAVIÈRE
MEMBRE DE L’INSTITUT.
PARIS - 1887.

CHAPITRE PREMIER — Le combat de Symé.
CHAPITRE II — Le gouvernement des quatre cents.
CHAPITRE III — La révolte de la flotte de Samos.
CHAPITRE IV — Le combat de Cynosséma.
CHAPITRE V — Le combat d’Abydos et le combat de Cyzique.
CHAPITRE VI — Le rappel d’Alcibiade.
CHAPITRE VII — Le combat de Notium et la disgrâce d’Alcibiade.
CHAPITRE VIII — La prise de Méthymne et le combat de Mitylène.
CHAPITRE IX — La bataille des Arginuses.
CHAPITRE X — Le jugement des stratèges.
CHAPITRE XI — La bataille d’Ægos-Potamos.
CHAPITRE XII — Le massacre des prisonniers.
CHAPITRE XIII — Les derniers jours de la marine grecque.
CHAPITRE XIV — Un mot sur le passé et un programme pour l’avenir.

CHAPITRE PREMIER. — LE COMBAT DE SYMÉ.
Entre la fin du règne de Louis XIV et notre orageuse époque, on compte
aujourd’hui cent soixante-quatre ans ; Marathon et Chéronée sont à peine
séparés par un siècle et demi d’intervalle. De Marathon à Chéronée, vous ne
trouverez ni une bataille de Marengo, ni une victoire d’Austerlitz ; Issus et
Arbèles appartiennent au règne d’Alexandre. C’est une heure triste et grave que
celle où les peuples s’en vont. Il est, nous ne le savons que trop, dans la
destinée de toute chose humaine de finir ; mais il semble que le sort devrait au
moins de nobles funérailles à ces nations privilégiées auxquelles il fut donné
d’être tout à la fois l’emblème de l’héroïsme et le flambeau de l’univers. Cette
faveur dernière d’une belle mort ne fut pas accordée à la Grèce ; les dieux
l’avaient condamnée d’avance à se dissoudre dans de misérables querelles
intérieures. La guerre du Péloponnèse, cette source de tout lé mal, ce fléau
déchaîné par Corcyre et plus encore peut-être par Corinthe, ne se termina pas
avec l’expédition de Sicile ; elle alla se poursuivre sur les côtes de l’Ionie et sûr
celles de l’Hellespont. Ce fut là que les généraux de Sparte apprirent à tendre
leur casque à l’obole des satrapes, à. vaincre au profit de Tissapherne ou de
Pharnabaze. Quand ils eurent dévoré en silence ces longues humiliations qui ne
révoltaient plus que quelques âmes généreuses, quelques cœurs attardés dans
un siècle corrompu, Philippe de Macédoine pouvait apparaître sans crainte. Le
fruit était mûr. Athènes eut cependant, de l’année 413 avant Jésus-Christ à
l’année 407, un retour inattendu de fortune. Ce retour coïncide avec l’époque du
retour d’Alcibiade. N’allons pas pour cela exagérer l’importance du concours
apporté à sa patrie par le transfuge repentant ! Les premières victoires qui
rétablirent un instant la fortune d’Athènes furent gagnées contre Alcibiade ou du
moins contre ses alliés ; les autres furent, pour la plupart, gagnées en son
absence. N’importe l sans Alcibiade, sans son activité, sans sa vive et audacieuse
impulsion, les Athéniens n’auraient jamais su tirer un parti suffisant de leurs
succès. Il n’est donc que strictement juste d’en faire remonter l’honneur à
l’homme qui, d’autre part, a peu de droits à nos sympathies.
L’escadre invisible de l’amiral Allemand est restée célèbre. On se rappelle qu’au
moment où l’empereur Napoléon préparait mystérieusement en 1804 la
concentration de ses forces navales dans la Manche, l’amiral Allemand reçut
l’ordre d’arrêter tous les navires neutres qu’il rencontrerait sur sa route. L’an 413
avant notre ère, quelques mois à peine après le grand désastre de Sicile, quand
la Grèce tout entière était en fermentation, une autre escadre invisible s’avançait
avec les mêmes précautions vers les côtes de l’Ionie : Dès que cette escadre eut
touché le continent asiatique, elle relâcha les bâtiments interceptés. Son but
était atteint : elle venait de débarquer Alcibiade dans les États du roi des Perses.
Nous avons vu les Anglais, en paix avec l’empereur de Chine, faire la guerre au
vice-roi de Canton ; réconciliés avec le vice-roi, rouvrir les hostilités contre le
gouverneur du Che-kiang. Le Céleste Empire formait alors un ensemble de
provinces qu’on pouvait aisément confondre avec une série de royaumes
juxtaposés. La monarchie des Perses admettait dans l’organisation de ses
satrapies une indépendance tout à fait analogue. Le roi Darius II, le successeur
d’Artaxerxés Longue-Main, n’eût probablement pas songé à profiter des
événements survenus en Sicile ; ceux de ses satrapes qui avaient à gouverner
des provinces maritimes trouvèrent l’occasion singulièrement propice pour

recouvrer la faculté de taxer à leur gré les villes du littoral. Le roi leur réclamait
sans cesse-le payement des tributs arriérés ; les Athéniens les tenaient à l’écart
des opulentes cités qu’Athènes avait prises sous sa protection ; le moment était
venu de tenter quelque chose pour se soustraire à un joug aussi humiliant que
ruineux. Par elle-même, la Perse, malgré l’importance que conservait encore la
marine phénicienne, ne pouvait rien ; les victoires de Cimon avaient trop bien
assuré l’ascendant d’Athènes. Mais tout le Péloponnèse était en armes, et tout le
Péloponnèse, à cette heure, construisait des vaisseaux ; Sparte allait bientôt
avoir à ses ordres cent navires de guerre. Sauvée par Sparte, Syracuse, à son
tour, lui envoyait sa flotte pour achever l’anéantissement de l’ennemi commun.
La Perse et le Péloponnèse pouvaient donc à merveille se compléter : le
Péloponnèse en fournissant des vaisseaux ; la Perse en fournissant des subsides.
C’était là ce qu’avait pressenti avec la perspicacité de sa haine le dangereux
transfuge accueilli par Lacédémone.
Deux des satrapes de Darius étaient particulièrement intéressés à se procurer le
concours de la flotte lacédémonienne : le satrape qui gouvernait l’Ionie et celui
qui commandait sur les bords de l’Hellespont, — Tissapherne et Pharnabaze. —
Tissapherne reçut le premier la visite d’Alcibiade. Le perfide savait bien où
devaient porter ses coups pour atteindre sa patrie au cœur. Il fallait d’abord lui
enlever les îles qui bordent la côte ionienne ; on s’attaquerait ensuite à Byzance
et aux villes de la Chersonèse. Avec Alcibiade s’était embarqué dans le golfe
d’Égine un délégué de Sparte, Chalcidéus ; un traité fut bientôt conclu. S’il ne
l’eût pas été par Tissapherne, il l’aurait été par Pharnabaze, car les deux
satrapes se disputaient l’honneur et l’avantage de prendre des Grecs à leur
solde. Tissapherne promit de payer quatre-vingt-dix centimes par homme et par
jour. Alcibiade et Chalcidéus se mirent sur-le-champ à l’œuvre pour soulever
Chio et pour insurger Milet.
L’empereur Napoléon, revenu de Russie, eut encore la puissance de faire sortir
pour ainsi dire de terre une armée de six cent mille hommes. Athènes ne mit pas
moins d’activité à. réparer ses pertes. Une nouvelle flotte ne tarda pas à
descendre des chantiers du Pirée. Les géants ne tombent pas sous une seule
blessure. Il fallut deux ans à l’Europe pour terrasser Napoléon Ier ; Athènes,
pendant huit années, tint le Péloponnèse et la Perse en échec. Elle avait trouvé
dans les eaux ioniennes une inappréciable alliée. Haine invétérée de Sparte,
amour farouche de la démocratie, tout se rencontrait à Samos pour faire de cette
île si riche en guerriers et en ports l’avant-garde d’Athènes, la surveillante
jalouse des cités infidèles. Ce fut de Samos que partirent à bord de cinquante-
deux vaisseaux, pour aller débarquer sur le territoire milésien, mille hoplites
d’Athènes, quinze cents d’Argos, mille autres fournis par les villes tributaires.
Conduits par Chalcidéus et par Alcibiade, soutenus par la présence de
Tissapherne, les habitants de Milet se crurent de force à tenter une sortie. Ils
furent complètement battus, refoulés dans leur ville. et investis le jour même par
les. forcés athéniennes. Chalcidéus, le négociateur de Sparte, avait bravement
payé de sa personne ; il trouva la mort dans cet engagement. Quant au fils de
Clinias, son rôle n’était pas fini. Échappé sain et sauf du combat, il courut à
cheval jusqu’aux bords du golfe qui s’ouvre entre Halicarnasse et Milet, juste en
face de Pathmos, de Léros et de Calymnos. Là venaient de mouiller vingt
vaisseaux de Syracuse, deux de Sélinonte, trente-trois du Péloponnèse.
Théramène de Lacédémone amenait cette escadre au nouveau commandant en
chef des forces alliées, au navarque Astyochos. Dès le point du jour, la flotté
combinée cinglait vers Milet. Théramène s’était flatté de surprendre les Athéniens

; il fut cruellement déçu. Un avis venu de l’île Léros avaient mis les généraux
d’Athènes, Phrynicos, Onomaclès et Scironidès, sur leurs gardes. En un instant,
l’armée, les blessés, le matériel de siége, furent embarqués, le butin abandonné
sur la plage et les vaisseaux dirigés à toutes rames sur Samos. Si l’amiral
Persano eût montré à Lissa autant de diligence, il n’eût pas été réduit à
combattre Tegethof dans les conditions défavorables qu’il accepta. Pouvait-il, en
cette occasion, imiter l’exemple que lui donnait, en l’an 413 avant Jésus-Christ,
Phrynicos ? Pour mettre des troupes à terre, pour les reprendre à bord, nous
sommes bien loin de disposer des moyens rapides et sûrs que possédaient les
anciens. Ne m’a-t-il pas fallu à moi-même, dans la seconde année de l’expédition
du Mexique, près d’un mois pour embarquer un seul bataillon groupé près de
l’embouchure de la rivière de Tampico ? Théramène avait manqué l’occasion de
surprendre une flotte athénienne ; il saisit avidement celle qui s’offrait à lui de
gagner les bonnes grâces de Tissapherne. Le satrape avait dans la ville de Iasos,
sur la côte de Carie, un ennemi personnel ; il fit appel au zèle des
Lacédémoniens. Les Lacédémoniens s’emparèrent de la place désignée à leurs
coups et l’abandonnèrent aux vengeances du gouverneur de l’Asie maritime. La
revanche des Perses commençait. Pour payer le service qui lui était rendu,
Tissapherne apporta de l’or. Tous les navires alliés reçurent un mois de solde.
Tissapherne avait désormais sa flotte ; Pharnabaze, à son tour, voulut avoir la
sienne. Les Péloponnésiens lui promirent vingt-sept vaisseaux, et Antisthène de
Sparte reçut l’ordre de les lui conduire. La mission était plus facile à donner qu’à
remplir ; Athènes gardait avec soin les avenues de l’Hellespont. Trente-cinq
vaisseaux, commandés par Charminos, Strombichidès et Euctémon, cinglaient en
ce moment même vers Chio ; soixante-quatorze autres, maîtres de la mer,
faisaient de Samos des courses sur le territoire de Milet. La flotte d’Antisthène
partit du cap Malée, entra dans Milo et y trouva dix vaisseaux athéniens. De ces
dix vaisseaux, trois, abandonnés par leurs équipages, tombèrent en son pouvoir
; les autres réussirent à lui échapper et firent route vers Samos. C’était là un
fâcheux contretemps pour Antisthène. La flotte athénienne allait être avisée de
son départ : comment parviendrait-il à lui dérober ses mouvements ?. Antisthène
suivit l’exemple d’Alcidas ; il brava les hasards de la grande navigation. Ses
vingt-sept vaisseaux firent voile pour la Crète, y rencontrèrent l’obstacle presque
insurmontable alors des vents étésiens, et, après bien des péripéties, finirent par
arriver à Cannes en Asie. Caunes n’était guère sur le chemin de l’Hellespont,
mais Cannes était peu éloignée de Milet, et à Milet se trouvait rassemblée la
flotte d’Astyochos. Antisthène demanda qu’on vînt l’escorter ; Astyochos ne
pouvait se refuser à ce légitime désir. Il prit sur-le-champ la route de Caunes, à
la façon antique, par étapes. Sa flotte passa donc de Milet à Cos et de Cos à
Cnide.
Si vous avez jamais relâché au cap Crio, vous y aurez contemplé avec admiration
les débris de ce port où s’arrêtait, indécis dans sa marche, vers lés premiers
jours du printemps de l’année 412 avant notre ère, le navarque Astyochos. Ce ne
sont que fûts de colonnes, architraves de marbre, blocs énormes tirés. de
carrières inconnues. Le roi Louis Philippe songea, en 1832, à faire servir ces
décombres délaissés aux embellissements du palais de Versailles. Le vaisseau la
Ville de Marseille et le transport le Rhône vinrent jeter l’ancre sur cette rade, qui
pour la première fois sans doute abritait de pareils colosses. Le butin fut maigre,
non que le marbre manquât ; mais nous nous trouvâmes inhabiles à soulever et
à emmagasiner de pareils débris. Les masses que les anciens se faisaient un jeu
de remuer ont toujours embarrassé la mécanique dégénérée de nos ingénieurs.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
 52
52
 53
53
 54
54
 55
55
 56
56
 57
57
 58
58
 59
59
 60
60
 61
61
 62
62
 63
63
 64
64
 65
65
 66
66
1
/
66
100%