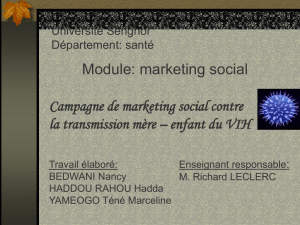Lire l`article complet

augmentation régulière des dépenses de santé et des
ressources limitées ont conduit à s’interroger sur le
financement des nouvelles thérapeutiques. La phar-
maco-économie s’est donc imposée comme une discipline
essentielle dans l’univers du médicament. À Lille, les 19 et
20 avril 2001, des orateurs économistes et méthodologistes,
mais aussi cliniciens, ont présenté à un large auditoire composé
de praticiens, de biologistes et de chercheurs les outils de
recherche et d’application de cette matière relativement récente
dans le cadre d’une réunion sur les études coût-efficacité appli-
quées aux maladies infectieuses.
Le point de vue du clinicien dans l’évaluation économique
(A.D. Paltiel,Yale University School of Medicine, États-Unis)
Pour cet auteur, il s’agit d’une aide aux choix de différentes
alternatives thérapeutiques dans un contexte de ressources
limitées.
L’analyse quantitative aide la décision qualitative.
L’évaluation économique ne veut pas être la réponse absolue,
mais plutôt une réelle assistance aux décideurs.
✓Les principes de l’évaluation économique reposent sur
une demande illimitée des biens de santé dans un contexte de
ressources limitées avec nécessité implicite d’un choix qui peut
être subjectif. Une balance s’établit entre bénéfice et coût.
✓La structure de l’évaluation économique repose sur trois
types d’analyse :
– L’analyse des coûts, qui répond aux questions : “Combien
cela coûte-t-il ?”, et “Quelles sont les ressources utilisées ?”
Elle consiste à identifier les meilleures pratiques et les alter-
natives les moins coûteuses ainsi que les coûts générés par une
maladie. Cette analyse des coûts peut conduire à une étude de
minimisation des coûts, qui s’applique à la comparaison de stra-
tégies ayant la même efficacité.
– L’analyse coût-efficacité, qui répond à la question : “Qu’ac-
cepte-t-on de payer pour une unité supplémentaire d’effica-
cité ?”. Les avantages des stratégies ne sont pas équivalents.
Il n’est pas possible de réaliser une simple analyse de mini-
malisation des
coûts. On réa-
lise alors une
comparaison
des coûts d’une
stratégie médicale
avec ses avan-
tages, exprimés
en unités phy-
siques, comme
par exemple le
nombre d’années de vie gagnées. Ces études sont plus
fréquemment utilisées pour l’évaluation des interventions
médicales.
Le ratio coût/efficacité se calcule selon le rapport suivant : aug-
mentation du coût/augmentation de l’efficacité médicale.
La stratégie thérapeutique à privilégier sera celle dont le coût
par unité d’efficacité sera le moins élevé.
– L’analyse coût-bénéfice, qui répond à la question : “Com-
bien est-on prêt à payer pour éviter une maladie ou un aspect
de la maladie ?” . Ces études visent à comparer le coût d’une
stratégie médicale à ses avantages exprimés en unités de mon-
naie. Une échelle de mesure commune facilite la comparaison
de différents programmes. On peut imaginer les difficultés
éthiques ou pratiques pour attribuer une valeur monétaire à un
bénéfice clinique.
Le choix de l’analyse repose donc sur le type de questions
posées.
■Les perspectives de l’évaluation dépendent :
✓De l’analyse : de nombreuses réponses sont possibles en
termes de coût et de bénéfices. Il est donc recommandé de tes-
ter la sensibilité du modèle et de connaître l’identité du décideur.
✓Du choix du comparateur, qui doit être le plus approprié
possible et le plus employé. Ce choix doit être régulièrement
réévalué.
✓Des coûts utilisés : la valeur monétaire la plus adaptée aux
ressources consommées doit être utilisée.
✓Des résultats : spécifiques à la pathologie (diagnostics écar-
tés, événements morbides évités) et génériques (survie, années
de vie gagnées, années de vie gagnées pondérées par la qualité
de vie [QALYS]).
Lille : place Charles-de-Gaulle et, derrière,
le beffroi de la Chambre du commerce.
La Lettre de l’Infectiologue - Tome XVI - n° 10 - décembre 2001
337
RÉUNIONS
Les études coût/efficacité
appliquées aux maladies infectieuses*
* Lille, 19-20 avril 2001.
L
’
© Droits réservés

La notion de QALYS est une valeur numérique attribuée à chaque
stade de l’état clinique (1 = parfaite santé, 0 = décès). Pour calculer
les années de vie gagnées, pondérées par la qualité de vie, on estime
la durée de chaque stade clinique auquel on assigne une valeur de
qualité. On multiplie ensuite les deux variables numériques et on les
additionne. Les valeurs de QALYS proviennent soit d’une attribu-
tion par le patient lui-même, soit d’échelles de préférence :
– Health Utilities Index (Torrance GW et al. Operations
Research 1982 ; 30 : 1043-69) ;
–Disability/Distress Index (Rosser RM [Hopkins A, Costain B,
Eds]. Measuring the outcomes of medical care ; London : Royal
College of physicians 1990 ; 17) ;
– Q-tility Index (Weeks JC et al. Proceedings of the American
Society of Clinical Oncology 1994 ; 13 : 436) ;
✓De la gestion des variables aléatoires : que ce soit au niveau
de l’évolution clinique, des ressources utilisées ou des valeurs accor-
dées à la QALYS. Une analyse de sensibilité du modèle doit être
pratiquée avec un ou plusieurs paramètres, avec détermination du
seuil qui conduirait à une modification de la décision politique.
L’analyse probabiliste de sensibilité permet d’incorporer au
modèle la probabilité de distribution des variables aléatoires
avec une représentation graphique de la surface du ratio
coût/efficacité, de la courbe d’acceptabilité du ratio coût/effi-
cacité et, enfin, de l’analyse du bénéfice net.
✓De la fixation de la valeur seuil à partir de laquelle un ratio
coût/efficacité est acceptable.
Ce seuil varie selon le contexte. Aux États-Unis, il pourrait se
situer entre 20 000 et 100 000 $/QALYS par année de vie pon-
dérée par la qualité.
Étude de coût/efficacité de la prévention des complications
du sida (CEPAC), à destination des autorités de santé
(K.A. Freedberg, Massachusetts General Hospital, États-Unis)
Cette simulation informatique de l’infection à VIH permet une
comparaison des évolutions cliniques avec les rapports “coût/effi-
cacité” en intégrant dans le modèle mathématique les taux de
CD4, les différentes stratégies antirétrovirales et la charge virale.
Les valeurs proviennent de différentes bases de données. Cette
étude concerne la prophylaxie primaire et secondaire des infec-
tions opportunistes : pneumocystose, toxoplasmose, mycobac-
térie atypique, cytomégalovirus, infections fongiques.
La méthodologie est la suivante :
– On utilise un million de simulations. Chaque patient hypo-
thétique est tiré au sort à partir de la distribution initiale de l’âge,
du sexe, du taux de CD4 et de la charge virale avec le suivi de
chaque événement clinique (pneumocystose ou décès).
– L’espérance de vie, la détermination des QALYS et des coûts
médicaux directs sont calculées selon la perspective de la col-
lectivité en fonction de l’unité ($/QALY), avec un taux d’ac-
tualisation de 3 % par an.
Ce modèle a permis de calculer le rapport coût/efficacité de la
trithérapie en fonction de la charge virale du patient, de l’uti-
lisation des tests de résistance, de l’arrêt de la prophylaxie de
la pneumocystose en cas de restauration de l’immunité, des pro-
grammes d’aide à la compliance.
Y. Yazdanpanah et al. (XIIIth International Aids Conference
2000) ont utilisé ce modèle pour déterminer le coût/efficacité
des prophylaxies des infections opportunistes en France, à par-
tir des données des CISIH de Tourcoing et d’Aquitaine, sur le
plan de l’histoire naturelle de la maladie et du coût. Une ana-
lyse bibliographique a permis de déterminer l’efficacité des dif-
férentes stratégies de prophylaxie. Les résultats sont décrits
dans le tableau I.
Le modèle peut être utilisé pour évaluer le rapport coût/
efficacité d’autres stratégies, comme la généralisation du test
de dépistage des patients hospitalisés, la centralisation de la
mesure de la charge virale dans un centre de référence ou encore
du délai de mise en route d’un traitement antirétroviral.
Des critiques peuvent être émises sur ce type d’approche : il
s’agit d’un modèle de simulation mathématique dont les don-
nées utilisées évoluent très rapidement. La démarche peut ne
pas paraître éthique pour certains, mais est-il éthique de gâcher
des ressources que l’on sait limitées ?
Face aux nombreuses questions et possibilités thérapeutiques
de l’infection à VIH, les cliniciens et les pouvoirs publics
disposent désormais d’outils leur permettant une aide à la
décision par ces analyses pharmaco-économiques.
Intérêt d’une analyse coût/efficacité
dans la mise au point de guides spécifiques
de recommandations des pratiques cliniques
(D.K. Owens, université de Stamford, États-Unis)
L’objectif des recommandations de pratiques cliniques est
double : l’amélioration de la qualité des soins et la réduction
des coûts par la suppression des pratiques inutiles, coûteuses
et sans efficacité supplémentaire.
Les guides de recommandations de pratiques cliniques
doivent prendre en compte les variations existantes parmi les
populations de patients sous peine d’être trop coûteux sans
entraîner une meilleure efficacité. Par exemple, le taux de
séroprévalence vis-à-vis du VIH varie selon le lieu d’hospita-
lisation (tableau II).
338
La Lettre de l’Infectiologue - Tome XVI - n° 10 - décembre 2001
RÉUNIONS
Tableau I. Efficacité des différentes stratégies de prophylaxie des
infections opportunistes.
Stratégie prophylactique Coûts QALYS Ratio
(euros) (mois) (euros/QALY)
coût/efficacité
Pas de prophylaxie 191 000 111,9 –
TMP/SMX 193 000 113,7 17 000
TMP/SMX azithromycine 195 000 114,5 18 000
TMP/SMX, azithromycine,
fluconazole 198 000 115,6 39 000
TMP/SMX, azithromycine,
fluconazole, ganciclovir 217 000 116,1 491 000
TMP/SMX : cotrimoxazole.

La Lettre de l’Infectiologue - Tome XVI - n° 10 - décembre 2001
339
RÉUNIONS
On oppose aux recommandations globales pour la prise en
charge de tous les patients (par exemple le dépistage du VIH
pour les patients hospitalisés) des recommandations particu-
lières adaptées aux populations spécifiques (par exemple le
dépistage du VIH pour les patients des hôpitaux où la préva-
lence est supérieure à 1 %). Le modèle de mise au point d’un
guide spécifique de recommandations dans l’infection à VIH,
parmi une population dont les variations sont connues, repose
sur le développement d’un arbre décisionnel, la mise au point
de recommandations générales et la détermination des recom-
mandations spécifiques pour chaque situation dont les varia-
tions sont connues.
L’arbre décisionnel du dépistage de l’infection à VIH évalue
les coûts/bénéfices du dépistage du VIH dans un hôpital de court
séjour. Les bénéfices sont l’augmentation de survie due au trai-
tement précoce et la possibilité de diminuer le risque de trans-
mission, d’où un avantage certain en termes de santé publique.
Les coûts reposent sur le coût du dépistage et des traitements.
La séroprévalence du VIH dans les hôpitaux américains de court
séjour est en moyenne de 1,44 %, avec un intervalle de
confiance de 0,1 à 7,8 %. Cela indique qu’il existe trois types
d’hôpitaux avec une prévalence basse de 0,1 % correspondant
à 50 % des hôpitaux américains, moyenne de 1,4 % (25 %
des hôpitaux américains) et haute de 4 % (25 % des hôpitaux
américains).
Le ratio coût/efficacité est de 50 000 $, soit 55 491,44 €
(364 000 F) par année de vie pondérée par la qualité de vie. Ce
ratio est supérieur au seuil communément accepté, et il n’est
donc pas licite de recommander un dépistage systématique pour
l’ensemble de la population des hôpitaux américains de court
séjour. Une recommandation spécifique est nécessaire pour les
hôpitaux à haute prévalence. Lorsque les variations des diffé-
rentes situations ne sont pas connues, il est nécessaire de faire
varier la prévalence et d’autres données, comme le coût, par
exemple, etc.
Dans le cas du dépistage du VIH, les recommandations de dépis-
tage doivent s’adapter à chaque situation où la séroprévalence
n’est pas forcément connue. Par conséquent, les recommanda-
tions spécifiques nécessitent l’obtention de données complé-
mentaires dont le recueil est potentiellement plus coûteux. La
question se pose alors de savoir s’il est rentable de développer
de tels modèles compte tenu du coût du recueil des informa-
tions complémentaires. Pour répondre à cette question, un
modèle peut être bâti, incluant le coût de collecte des informa-
tions complémentaires, et estimant les probabilités de valeur et
de fréquence des variables inconnues.
La comparaison du coût/efficacité d’un guide spécifique par
rapport à un guide général s’établit selon le rapport suivant :
En conclusion. La variation des situations cliniques justifie le
plus souvent la réalisation de guides de recommandations spé-
cifiques. Pour évaluer le coût/efficacité d’un guide de recom-
mandations spécifiques, il faut inclure le coût de collecte de
données complémentaires et estimer le coût/bénéfice.
Point de vue des décideurs, vis-à-vis des études pharmaco-
économiques
(B. Dupuis, président de la Commission de la transparence)
Il a rappelé brièvement les différentes étapes d’évaluation du
médicament par les pouvoirs publics.
L’avis technique sur un médicament est donné par la Commis-
sion d’AMM, aidée par la Commission de pharmacovigilance
et la Commission des stupéfiants ; la Commission de la trans-
parence décide ensuite de la prise en charge du médicament. Au
niveau économique, le Comité économique des produits de santé
(CEPS) fixe le prix. L’organisme payeur qu’est la Sécurité
sociale siège au niveau de ce comité. Tous les systèmes d’enre-
gistrement s’appuient sur une clause d’équivalence et non sur
une clause de supériorité. Une autorisation de mise sur le mar-
ché donne la garantie que le nouveau médicament ne fait pas
moins bien que le médicament existant. Le décideur ne sait pas
si le nouveau médicament fait seulement aussi bien ou mieux
que les autres médicaments de la classe thérapeutique. La Com-
mission de la transparence procède à l’évaluation
comparative du service médical rendu (SMR). Cette apprécia-
tion se fait à partir de l’efficacité et de la survenue des effets
secondaires, de la place du médicament dans la stratégie
thérapeutique et de la gravité de la pathologie en cause. Une
appréciation de l’efficacité du médicament par rapport à celle
d’autres médicaments comparables est faite, déterminant l’amé-
lioration du service médical rendu (ASMR). S’il n’existe pas de
comparateur, cette comparaison se fait vis-à-vis du placebo.
Quatre niveaux de SMR sont déterminés : SMR majeur, SMR
important, SMR modéré et SMR mineur.
L’ASMR est également appréciée sur la base de cinq niveaux
(I, II, III, IV,V). Cette classification prend en compte l’ensemble
des avantages que procure un traitement en termes d’efficacité,
d’utilité et d’intérêt thérapeutique pour le malade par rapport
aux traitements déjà existants.
Une nouvelle spécialité ne peut être inscrite sur la liste des médi-
caments remboursables que si elle conduit à une amélioration
Tableau II. Répartition de la prévalence du VIH en fonction du
lieu d’hospitalisation.
Lieu d’hospitalisation Prévalence du VIH
●Service de maladies infectieuses 0 à 48 %
et tropicales (IDV)
●Clinique de maladies sexuellement 0 à 40 %
transmissibles
●Population hospitalière générale 0,1 à 8 %
(Cgs + Cdonnées) - Cgg
Bgs - Bgg
Cgs : coût du guide spécifique ; Cgg : coût du guide général ; Bgs : bénéfice
du guide spécifique ; Bgg : bénéfice du guide général.

340
La Lettre de l’Infectiologue - Tome XVI - n° 10 - décembre 2001
RÉUNIONS
du service médical évaluée par la Commission de la transpa-
rence (soit une ASMR I, II, III ou IV). Si l’ASMR est de
niveau V, c’est-à-dire sans amélioration du service, la spécia-
lité n’est prise en charge au titre du remboursement que si elle
entraîne des économies (par exemple : les génériques).
La fixation des prix se fait après une négociation entre le CEPS
et la firme, en tenant compte du niveau d’ASMR tel qu’il a été
défini par la Commission de la transparence, et une comparai-
son des prix européens du produit.
B. Dupuis, se voulant l’avocat du diable, s’est interrogé sur la
place des études pharmaco-économiques dans les processus
d’évaluation du médicament. Il énonce les réserves à l’égard
de ce type d’études :
– la valeur intrinsèque et la puissance de ces travaux ne sont
pas toujours connues ;
– les résultats non probants ne sont généralement pas publiés ;
– le promoteur de ces études est la firme pharmaceutique elle-
même la plupart du temps, ce qui, selon l’orateur, ne garantit
pas les complètes règles d’indépendance ;
– la non-fongibilité des enveloppes, soit la séparation des bud-
gets hospitaliers et du budget de médecine de ville, contribue
au peu d’intérêt de ces études pour les autorités de santé.
En France, aucune instance n’a été commissionnée pour prendre
en compte ce type d’études. Cependant, un groupe d’experts a
été créé pour procéder à l’évaluation de ces travaux. La saisie
ne peut être faite que par le CEPS, la Commission de la
transparence ou la Commission de la publicité. Une critique
peut être émise vis-à-vis de ce groupe d’experts. Ces derniers
ne devaient jamais avoir travaillé avec les firmes pharmaceu-
tiques ; or, la plupart des études pharmaco-économiques étaient
faites à la demande des industriels. En Grande-Bretagne,
le National Institute for Clinical Excellence (NICE) est
commissionné à la fois pour remplir les fonctions de la
Commission de la transparence et pour évaluer les études pharmaco-
économiques.
Bien que les travaux doivent être spécifiques à chaque pays, car
le coût, les systèmes de soins et de prise en charge sont diffé-
rents, le dossier d’enregistrement, lui, est unique. La prise en
compte de considérations médico-économiques n’est faite par
l’usager ou le prescripteur qu’en période de pénurie. Quant aux
payeurs et aux politiques, ils ne s’y intéressent que pour une
meilleure allocation des ressources de santé.
S. Renard-Dubois, Saint-Mandé
1
/
4
100%