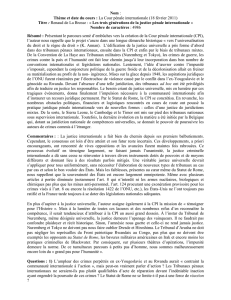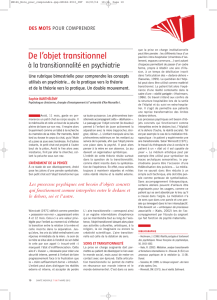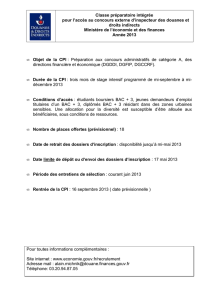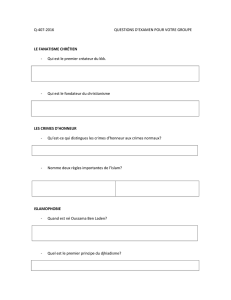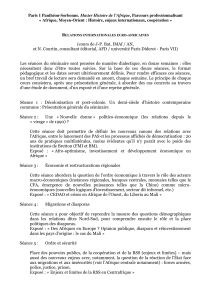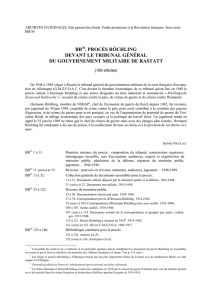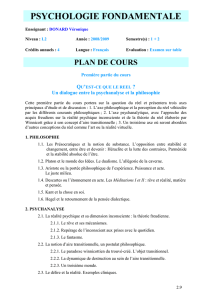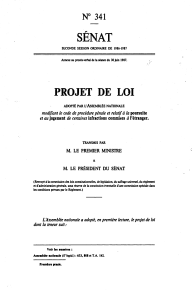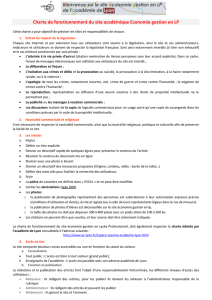Mise en page 1

LA JUSTICE RECONSTITUTIVE :
UN OBJECTIF DIPLOMATIQUE
POUR PRÉVENIR ET SURMONTER
LES CRIMES DE MASSE
Antoine Garapon et Joël Hubrecht
Rapport du séminaire « Justice internationale et de transition » :
éléments pour une doctrine diplomatique française » (avril 2011-décembre 2012)
organisé par le Centre d’analyse de prévision et de stratégie (CAPS), la Sous-direction de
la gouvernance démocratique (DGM/DBM/GOUV) et l’Institut des hautes études sur la
justice (IHEJ).
www.ihej.org
RAPPORT DE L’IHEJ
JUIN 2013

RAPPORT DE L’IHEJ JUIN 2013
LA JUSTICE RECONSTITUTIVE : UN OBJECTIF DIPLOMATIQUE POUR PRÉVENIR ET SURMONTER LES CRIMES DE MASSE
SOMMAIRE
Synthèse P. 3
Remerciements P. 7
INTRODUCTION P. 9
Les contours flous de la justice transitionnelle
Deux notions parentes
Deux versions d’une même perspective reconstitutive
I UN DOUBLE ENJEU STRATÉGIQUE ET MORAL P. 13
CIJ, TMI de Nuremberg et CPI : trois « forces imaginantes » du monde
II LE PROCÈS DE NUREMBERG, UNE RÉFÉRENCE FONDATRICE MAIS TRÈS ATYPIQUE P. 15
La diversité des formes de conflit
III LES CRIMES DE MASSE : UN PROBLEM OU UN EFFONDREMENT POLITIQUE ? P. 19
L’impossible évacuation de la politique
Une perversion et non une suspension de la loi
IV L’OBJECTIF : ÉVACUER, RESTAURER OU RELEVER LA POLITIQUE ? P. 23
Le rôle central des victimes
La valeur paradoxale de la division
V UN TRAITEMENT DES CAUSES DE LA VIOLENCE POLITIQUE P. 26
Version faible et version forte du rôle de la justice en transition
Assurer un passage ou faire lien ?
Construire ou (re)constituer ?
État d’exception, état de transition
Conjuration ou conversion de la violence vengeresse
Une refondation dans une violence par procuration
Un moment entre la violence et la paix ou l’introjection de la fondation dans l’ordinaire ?
Une mise en scène du passé pour représenter l’avenir
VI PAS DE PAIX SANS JUSTICE P. 37
Le temps de la justice : un temps à part
La justice en temps réel dans le conflit
Une fausse opposition
Comment les articuler ?

RAPPORT DE L’IHEJ JUIN 2013
LA JUSTICE RECONSTITUTIVE : UN OBJECTIF DIPLOMATIQUE POUR PRÉVENIR ET SURMONTER LES CRIMES DE MASSE
L’horizon d’une transition effective et juste
Justice transitionnelle et justice mémorielle : deux formes de justice du passé ?
VII POUR UNE APPROCHE SYSTÉMIQUE DE LA JUSTICE TRANSITIONNELLE P. 45
Les acteurs de la transition
Les tiers-médiateurs
Les ONG
Les autres acteurs de la société civile
Les secteurs clé de la transition
La justice et la réforme des institutions
L’armée et les forces de sécurité
L’économie et le développement (notamment la question foncière)
L’éducation, la culture, les mémoriaux : les politiques mémorielles
VIII UN ÉTAT DES QUESTIONS DE LA JUSTICE PÉNALE INTERNATIONALE P. 61
Une justice trop lente ?
Une justice trop chère ?
Deux poids, deux mesures ?
Une justice trop dépendante de la bonne volonté des États ?
Un désaccord persistant sur le crime d’agression
IX UNE NOUVELLE MANIÈRE DE FAIRE MONDE P. 69
Les conséquences indirectes de la CPI
La mise sous examen préliminaire d’analyse de situations
La complémentarité
La combinaison de la justice pénale internationale avec d’autres instruments nouveaux
Un nouveau champ de luttes d’influence
Moins une défense que la participation à la construction d’un droit nécessairement hybride
Une ouverture culturelle
X LA FRANCE, EN EUROPE ET DANS LE MONDE P. 76
La France occupe une place particulière dans un moment historique critique
La France dans l’Europe : un exemple, pas un modèle
ANNEXES P. 83
Annexe 1 : les participants du séminaire
Annexe 2 : le calendrier et le programme du séminaire

2
RAPPORT DE L’IHEJ JUIN 2013
LA JUSTICE RECONSTITUTIVE : UN OBJECTIF DIPLOMATIQUE POUR PRÉVENIR ET SURMONTER LES CRIMES DE MASSE

3
RAPPORT DE L’IHEJ JUIN 2013
SYNTHÈSE
Comment surmonter l’effondrement humain et politique causé par les crimes de masse ? Com-
ment prévenir leur retour ou leur intensification ? Comment intégrer la justice dans une stratégie
plus globale de retour à la paix et de construction démocratique ? La prise de conscience qu’il y a
là un enjeu stratégique central pour la diplomatie française ne pourra porter ses fruits qu’en re-
considérant l’idée de justice transitionnelle, une notion complexe au carrefour du droit, de la mo-
rale, de la politique et de la sécurité. Sans vouloir substituer un nouveau concept à celui désormais
communément utilisé, en dépit de ses évidentes limites, de « justice transitionnelle », les auteurs
du rapport préfèrent utiliser le terme de « justice reconstitutive » pour désigner l’effort de saisir
ensemble droit et politique, national et international, fondement et évolutions sous l’horizon d’une
action juste.
La reformulation de l’idée de justice repose sur ce triple défi. Elle requiert tout d’abord de dépasser
les approches les plus courantes dans le domaine pour prendre plus, ou autrement, en considéra-
tion la dimension politique de la justice transitionnelle, en évitant aussi bien l’idéalisme légaliste
(le rêve d’une justice « pure » et autosuffisante) que la « réal-politisation » du droit (la justice comme
simple instrument des luttes politiques).
Elle suppose ensuite de réunir, sans les confondre, le champ classique de la justice transitionnelle,
souvent réduit au national et au non pénal, et celui de la justice pénale internationale du fait des
phénomènes de globalisation / « glocalisation » dans lesquels les États en reconstruction s’inscri-
vent. Le rapport tire ainsi également les conséquences du principe de « complémentarité active »
promu par le Statut de Rome, n’abolissant pas mais bouleversant les délimitations anciennes entre
le national et l’international. La Cour pénale internationale n’est ni une organisation internationale
classique ni une juridiction comme nous en connaissons sur le plan interne. Ces juridictions sont
à la fois des ressources pour la diplomatie et de nouveaux terrains de luttes d’influence. Il s’agit
enfin de ne pas perdre le sens profond et la force originelle de la « période héroïque », celle de la
défense de l’idée même de justice pénale internationale, mais de prendre la mesure des évolutions
en cours dans la phase plus « prosaïque » de sa mise en œuvre concrète. D’une part pour com-
prendre le sens profond du moment fondateur mais atypique des procès de Nuremberg et Tokyo,
de l’élaboration des charges de « crimes contre l’humanité » puis de « génocide », de l’expérience
totalitaire pour appréhender le lien entre la responsabilité individuelle et la dimension collective
ou idéologique du crime de masse dans laquelle s’enracine les liens ambigus et inextricables entre
justice et politique.
SYNTHÈSE
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
 52
52
 53
53
 54
54
 55
55
 56
56
 57
57
 58
58
 59
59
 60
60
 61
61
 62
62
 63
63
 64
64
 65
65
 66
66
 67
67
 68
68
 69
69
 70
70
 71
71
 72
72
 73
73
 74
74
 75
75
 76
76
 77
77
 78
78
 79
79
 80
80
 81
81
 82
82
 83
83
 84
84
 85
85
 86
86
 87
87
 88
88
 89
89
 90
90
 91
91
 92
92
 93
93
 94
94
 95
95
1
/
95
100%