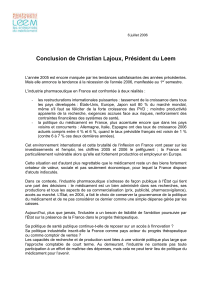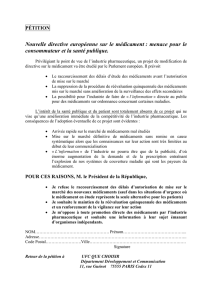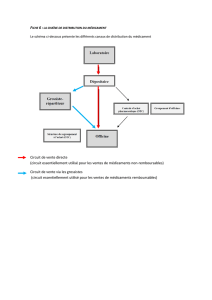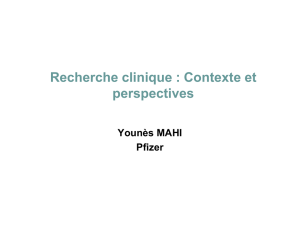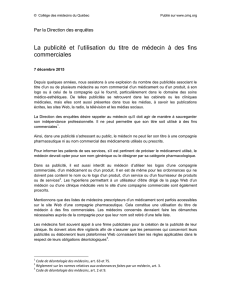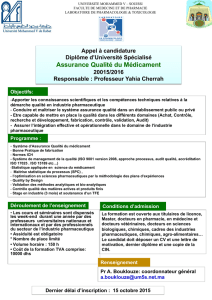Contribution à l`histoire des bonnes pratiques cliniques

La Lettre du Pharmacologue - vol. 22 - n° 4 - octobre-novembre-décembre 2008
Essai clinique
Essai clinique
16
Contribution à l’histoire des bonnes pratiques cliniques
dans les essais de médicaments : l’initiative française
Contribution to the story of good clinical practices in the clinical trials: the french initiative
●● J.P. Demarez*
RÉSUMÉ 왘
Tous les essais cliniques portant sur des médicaments
doivent être réalisés selon les “bonnes pratiques cliniques”
(BPC). Il aura fallu près de trente ans pour qu’il en soit ainsi.
Nous reprenons ici les principales étapes ayant conduit
d’abord à constater la nécessité de ce dispositif devenu
essentiel à la qualité des recherches biomédicales puis à
le mettre en forme.
Mots-clés : Bonnes pratiques cliniques – Recherche bio-
médicale.
ABSTRACT 왘
All clinical trials should be realized according to good clinical
practices. It took thirty years to get there. Here are the main
steps that led rst of all to see the need for this device which
has become essential to the quality of biomedical research to
and then, formalize it.
Keywords: Good clinical practices – Biomedical research.
L
’article L. 1121-3 du Code de la santé publique dispose :
“Les recherches biomédicales portant sur des médicaments
sont réalisées dans le respect des règles de bonnes pratiques
cliniques”. Le présent travail se propose de rappeler pourquoi il en
est ainsi, et comment cela est arrivé. Donc, il était une fois…
LES ORIGINES DE LA PRÉOCCUPATION DE QUALITÉ
DANS LES ESSAIS CLINIQUES
Le souci de la qualité n’est pas une préoccupation récente. Le
concept de qualité lui-même remonte à Platon (1), qui fabrique
le mot “poiotês” à partir du mot grec poieô, signifi ant “faire,
dans un jeu à deux, le fournisseur qui agit, le client qui subit”.
Le mot passe par Aristote (1), qui lui donne cette défi nition :
“Ce en vertu de quoi on est dit être tel”. Par la suite, Cicéron (1),
de qualis, “manière d’être” et talis, “tel”, va donner à l’idée un
nom latin : qualitas. La qualité est la conformité d’un produit
à ce qu’on est en droit d’attendre.
Fils de drapier, Colbert savait ce qu’étaient les draps de mauvaise
qualité. Pour faire en sorte qu’on en vende de beaux, il édicta, en
1669, le Règlement général pour longueur, largeur et qualité de
draps, serge et autres étoff es de laine et de fi l qui seront manu-
facturés dans le royaume. Il créa, dans le même mouvement, le
corps des inspecteurs des manufactures, chargé de démasquer
les fraudeurs, et, pour faire pénétrer les règlements chez les
professionnels, les jurandes, organisations corporatistes des
métiers. Il n’oublia pas de prévoir, à l’intention des fraudeurs,
une échelle de sanctions : l’amende pour le primo-délinquant,
le pilori pour le récidiviste, les galères à la troisième infraction.
Souhaitant des draps de qualité, Colbert avait mis en place ce
que le mot appelle immédiatement à l’esprit : des normes, l’im-
plication des professionnels dans l’observance des normes, le
rôle nécessaire de l’inspection pour en assurer le respect, et
les sanctions qui peuvent en découler pour les malfaisants qui
bafouent les normes dans un esprit de lucre. Car le mépris de
la qualité peut souvent s’avérer rentable.
La démarche de qualité suit toujours le même chemin. Un jour,
on s’aperçoit que, dans tel domaine de l’activité humaine, la
qualité n’est pas au rendez-vous. Il découle de cette observation
un certain nombre de conséquences… qui rappellent les mesures
mises en place par Colbert.
La démarche de qualité, en matière d’essais cliniques, va résulter
d’une succession de constatations, faites à partir d’études plus ou
moins marquantes, réalisées aux États-Unis. La plus embléma-
tique (2), côté “académique”, est probablement celle de l’UGDP
(University Group Diabetes Program). Il s’agissait d’un travail à
l’initiative de chercheurs, réalisé avec le soutien du National Insti-
tutes of Health (NIH), tentant, entre 1960 et 1970, de résoudre
la question suivante : “La baisse de glycémie obtenue au moyen
de thérapeutiques réduit-elle le risque cardiovasculaire ?” Le
protocole comparait à un placebo tous les traitements hypogly-
cémiants disponibles à l’époque : tolbutamide, insuline à dose
fi xe, insuline à dose adaptée, phenformine.
La prédominance de décès d’origine cardiovasculaire dans
le groupe tolbutamide a conduit le comité de surveillance à
préconiser l’arrêt de ce traitement. La nouvelle s’est répandue.
* Département de pharmacologie clinique, faculté de médecine de l’hôpital Saint-Antoine,
Paris.

La Lettre du Pharmacologue - vol. 22 - n° 4 - octobre-novembre-décembre 2008
Essai clinique
Essai clinique
17
a. Le numéro d’octobre 1986 de la revue Sciences et Vie en présente un très intéressant o-
rilège, où se mêlent l’incompétence crasse et la malhonnêteté agrante, sous le titre “Les tri-
cheurs en blouses blanches” (Siences et Vie 1986;826:14-23).
b. Parallèlement, la FDA mit en place toute une série de “guidelines” exposant comment dé-
montrer l’e cacité clinique d’une molécule dans telle ou telle pathologie.
obligations des promoteurs et des moniteurs d’essais cliniques,
et en 1978 (7), celles des investigateurs. En 1981, la réglemen-
tation concernant les comités institutionnels de révision (IRB)
est publiée (8). Quant aux dispositions relatives à l’information
et au consentement à la recherche (9), elles sont reprises de la
jurisprudence américaine, et ressemblent à celles énoncées dans
la déclaration d’Helsinki, elles-mêmes dérivées du procès des
médecins nazis, jugés en 1947 à Nuremberg par un tribunal
américain. Ces quatre dispositifs– consentement informé,
comité indépendant, obligations du promoteur, obligations de
l’investigateur– issus de la réglementation fédérale américaine,
seront rassemblés, par les fi rmes pharmaceutiques des États-
Unis, à l’intention des médecins expérimentateurs impliqués
dans les essais de médicaments qu’elles entreprennent, sous la
forme d’un petit opuscule intitulé Good Clinical Practices. C’est
ainsi que, des maisons mères à leurs fi liales européennes, les
bonnes pratiques cliniques (BPC) traverseront l’Atlantique pour
apparaître, par exemple, chez quelques médecins hospitaliers
français, pour ensuite se propager.
Le but poursuivi par les fi rmes américaines était essentielle-
ment prosaïque : faire en sorte que certains des essais cliniques
entrepris en Europe avec leur soutien soient utilisables dans
un dossier d’enregistrement présenté à la FDA. Le mieux, en
la circonstance, était de conduire les médecins expérimenta-
teurs européens à travailler selon les dispositions en vigueur
aux États-Unis. Ces études n’ayant, la plupart du temps, qu’un
caractère accessoire pour la démonstration d’effi cacité de la
spécialité nouvelle, la préoccupation principale n’était pas tant
les écarts par rapport au protocole ou les déviations vis-à-vis
des documents originaux, que les atteintes possibles au droit des
personnes, en termes de consentement informé. Un tel défaut
constituait un risque juridique pour la fi rme pharmaceutique
qui l’aurait laissé perdurer. D’autre part, attendu que, depuis
1975, la FDA n’acceptait les études cliniques réalisées hors des
États-Unis qu’à la condition qu’elles respectent la déclaration
d’Helsinki, version Tokyo, il était nécessaire que tout protocole
mis en place ait été, préalablement, soumis à l’avis d’un comité
indépendant. Ce qui n’était pas, à l’époque, possible en France,
faute de comité. Cela eut d’ailleurs un rôle moteur dans l’ap-
parition des comités d’éthique dans les hôpitaux universitaires
français.
De juin 1977 à septembre 1983, la FDA a réalisé 964 inspections
de routine, visant à évaluer la concordance entre les conditions
de réalisation des essais cliniques examinés et les dispositions
normatives évoquées ci-dessus (10). Ces inspections permirent
de mettre en évidence :
dans 40 % des cas, un défaut aff ectant le consentement des ✓
patients ;
dans 34 % des cas, un bilan inadéquat des produits utilisés
✓
dans l’essai ;
dans 23 % des cas, des violations du protocole ; ✓
dans 18 % des cas, des données inexactes ; ✓
dans 4 % des cas, des données originales non disponibles,
✓
jetant le doute sur l’exactitude des résultats rapportés.
La conclusion fut que si, pour de nombreuses raisons, on obser-
Il en a résulté, d’une part, un mouvement hostile des médecins
convaincus de l’effi cacité d’une spécialité qu’ils utilisaient de
façon courante et, d’autre part, des manœuvres des laboratoires
concernés, visant à décrédibiliser une étude dont les résultats
nuisaient à leur cotation en bourse.
Précisément, la manière dont les causes des décès ont été validées
est sujette à caution. Comme il s’agissait de très petits eff ectifs, et
que la méthode retenue était l’analyse séquentielle, toute erreur
sur la cause des décès rapportés était de nature à invalider la
diff érence constatée entre le groupe tolbutamide et le groupe
placebo. Dès lors, les conclusions du comité de surveillance
ne seraient plus pertinentes. Or, neuf décès observés dans le
groupe tolbutamide soulèvent des diffi cultés d’interprétation.
En fait, ils ont été pris en compte, mais bien que morts avant
la date limite de réception des dossiers, les patients ont été
enregistrés après cette date. Il apparaît, de surcroît, que certains
paramètres cardiovasculaires fi gurant dans la base de données
diff èrent de ceux relevés dans les documents originaux. On
remarquera, par la suite, après une inspection de la FDA (3),
qu’aucune des anomalies relevées ne concernait des paramè-
tres intervenant dans la réponse à la question posée. Mais ces
défauts aff ectant la qualité procurent un excellent motif pour
disqualifi er l’ensemble du travail devenu objet de controverses ;
cela, à la grande satisfaction des industriels commercialisant le
tolbutamide, dans un marché en plein essor.
Autre dossier, côté “industrie”, le refus d’autorisation par la
Food and Drug Administration (FDA) de la sulfi npyrazone en
prévention de la mort subite dans les six premiers mois post-
infarctus. Là encore, les conclusions d’une étude dépendaient
de ce que l’on considérait comme un décès de cause cardiaque
“analysable” parmi les morts subites observées. La diff érence
était ou n’était pas statistiquement signifi cative, selon quelques
subtilités d’analyse. Et la qualité des données collectées laissait
singulièrement à désirer. Cette mauvaise qualité permettait, à
tort, de conclure en faveur du traitement évalué. Ce que la FDA
tenait à faire savoir (4).
Suite à un faisceau de constats préoccupants
a
, tant du point de
vue éthique que technique, la FDA va organiser, dans sa division
des investigations scientifi ques, un programme d’assurance
qualité dans les recherches biomédicales. Car “les études clini-
ques conduites de façon inadéquate (poorly conducted) expo-
saient des personnes à des risques inutiles ; en outre, l’existence
d’essais frauduleux avait le grand inconvénient de permettre
l’autorisation de médicaments sur la base de résultats menson-
gers relatifs à l’effi cacité et à la sécurité” (5).
Ces dispositions s’inscrivent dans le contexte du National
Research Act, adopté en 1974 par le Congrès des États-Unis,
dont la fi nalité était de prévenir la réalisation de recherches
attentatoires aux droits des patients. Il en résultera diff érents
documents de nature réglementaire
b
, décrivant, en 1977 (6), les

La Lettre du Pharmacologue - vol. 22 - n° 4 - octobre-novembre-décembre 2008
Essai clinique
Essai clinique
18
c. À cette époque-là, Alain Spriet est directeur médical des laboratoires Hoechst et Pierre SI-
MON est professeur des universités et initiateur d’un enseignement de la pharmacologie clini-
que à la Pitié-Salpêtrière. Il est en outre créateur avec Alain Spriet et Jean-Michel Alexandre du
premier certi cat de pharmacologie clinique, dont les deux tiers des 1 000 étudiants formés en
huit ans deviendront pharmacologues cliniciens industriels.
vait des errances sérieuses dans la réalisation des essais, seul un
contrôle adéquat des investigateurs par les fi rmes pharmaceu-
tiques pouvait, par des mesures effi caces, améliorer le niveau
du travail de ceux-ci. La FDA se donnait, pour sa part, le devoir
de redoubler de rigueur.
SITUATION EN FRANCE À L’AUBE
DES BONNES PRATIQUES CLINIQUES
Le jeune pharmacologue clinicien qui aurait, aujourd’hui, la curio-
sité de consulter un dossier de demande de visa d’une spécia-
lité pharmaceutique conforme aux dispositions du décret du
26 novembre 1953 n’en croirait pas ses yeux (11). Le visa ministé-
riel autorisant l’exploitation d’une spécialité était accordé “lorsqu’il
avait été constaté qu’elle présentait un caractère de nouveauté
ainsi qu’un intérêt thérapeutique, et qu’elle n’entraînait pas de
danger pour la santé morale et physique de la population”. Ce
constat était eff ectif dès lors que des notabilités médicales attes-
taient, par leurs observations cliniques jointes au dossier, qu’il en
était ainsi. Il s’agissait, la plupart du temps, de quelques feuilles,
déclarant combien, chez tel et tel patient, le produit s’était avéré
bénéfi que. En 1965, le système est modifi é. La directive 65/65/
CEE, “concernant le rapprochement des dispositions législatives
réglementaires et administratives relatives aux spécialités phar-
maceutiques”, crée l’autorisation de mise sur le marché (AMM),
transposée en droit français par l’ordonnance du 23 septembre
1967. Cette directive introduit les critères de qualité, d’effi cacité
et d’innocuité dans les éléments à prendre en considération par la
Commission d’AMM (crée en 1978), lors de l’examen d’un dossier
de demande de commercialisation, préalablement à la décision du
ministre. La Commission d’AMM ne se contente pas des intui-
tions et des observations d’experts, mais elle va vérifi er, à partir
du dossier clinique établi par le fabricant, la preuve scientifi que
de l’effi cacité et de l’innocuité du produit. Les travaux cliniques
présentés doivent suivre la méthodologie de la pharmacologie
clinique, dont la connaissance, à l’époque, se trouvait plus dans
les laboratoires pharmaceutiques que chez les médecins expé-
rimentateurs ; grâce, en particulier, à l’enseignement du CESAM
(certifi cat d’études statistiques appliquées à la médecine).
Certes, l’arrêté du 16 mai 1972 fait apparaître la nécessité d’un
protocole relatif aux essais cliniques. Il se borne cependant à
laisser la liberté “aux experts de déterminer les modalités de
mise en œuvre qui leur paraîtront les plus adéquates dans chaque
cas d’espèce, tout en tenant compte des impératifs éthiques
qui gouvernent les essais sur l’homme”, sans dire un mot de
méthodologie. Les experts fi gurent sur une liste offi cielle, où
les laboratoires pharmaceutiques ont la liberté d’aller choisir,
“mais rien n’est dit sur la manière dont [ces experts] doivent
procéder” (11).
Les directives 75/318/CEE et 75/319/CEE vont harmoniser les
règles d’obtention des AMM et créer le Comité des spécialités
pharmaceutiques pour les procédures d’AMM européennes,
en précisant le rôle des experts.
Consécutivement, l’arrêté du 16 décembre 1975 dispose, pour
la France.
“Il est nécessaire que les essais cliniques s’eff ectuent sous forme
d’essais contrôlés. La manière dont ils sont réalisés varie dans
chaque cas et dépend également de considérations d’ordre
éthique. Ainsi, il peut parfois être plus intéressant de comparer
l’eff et thérapeutique d’une nouvelle spécialité à celui d’un médi-
cament déjà appliqué dont la valeur thérapeutique est commu-
nément connue, plutôt qu’à l’eff et d’un placebo.”
“Dans la mesure du possible, mais surtout lorsqu’il s’agit d’essais
où l’eff et du produit n’est pas objectivement mesurable, il faut
avoir recours à des essais contrôlés réalisés selon la méthode
du double insu. […] les critères adoptés […] doivent être suffi -
samment précis pour permettre un traitement statistique. Le
recours à un grand nombre de patients […] ne doit dans aucun
cas être considéré comme pouvant remplacer un essai contrôlé
bien exécuté […]”
“À compter du 1er novembre 1976, les demandes d’autorisation
de mise sur le marché […] ne seront recevables que si elles sont
accompagnées de comptes rendus d’essais cliniques poursuivis
dans le respect du protocole fi xé [par le présent arrêté].”
On sait, depuis la publication, en 1970, de l’ouvrage de D.
Schwartz, R. Flamant et J. Lellouch intitulé L’Essai thérapeu-
tique chez l’homme (12), qu’un essai clinique doit obéir à une
méthode rationnelle. Mais il faudra attendre 1980 pour que le
traité d’A. Spriet et P. Simon
c
expose, à l’intention des cliniciens,
une “méthodologie des essais cliniques de médicaments” (13)
se préoccupant, de façon simple et didactique, des marqueurs
de qualité, qualité éthique comme méthodologique.
Conseiller de Simone Veil, ministre de la Santé de 1975 à 1980,
J.P. Bader a une infl uence notable sur l’évolution des idées en
matière de médicament, notamment par la création, en 1977, de
la Direction de la pharmacie et du médicament (DPhM), nouveau
département du ministère de la Santé. Lors d’une réunion au
ministère de la Santé, le 23 janvier 1975, il est décidé, au sujet des
AMM, que les expertises cliniques présentées par un laboratoire
pharmaceutique seront soumises à l’évaluation anonyme de deux
experts. Il est également convenu de procéder rétrospectivement
à l’évaluation réelle de l’intérêt des médicaments déjà présents
sur le marché, par le biais d’une Commission de révision des
dictionnaires des spécialités pharmaceutiques, sous l’autorité
de J.M. Alexandre. Pour la première fois, certains laboratoires
français sont confrontés à de vraies questions de méthodologie
concernant leur source de bénéfi ces.
Il résultera de cette révision un classement des spécialités
pharmaceutiques en deux catégories : celles pour lesquelles
des données objectives disponibles permettent une validation
immédiate dans les indications thérapeutiques revendiquées,
et celles pour lesquelles les indications revendiquées deman-
dent à être démontrées par des travaux complémentaires. Cette
seconde catégorie était destinée à éclater. Certains des médica-

La Lettre du Pharmacologue - vol. 22 - n° 4 - octobre-novembre-décembre 2008
Essai clinique
Essai clinique
19
ments concernés allaient voir leur indication établie. Les autres,
dans la logique européenne, devaient disparaître en 1990, faute
de répondre aux critères exigés par le processus de validation
des AMM accordées antérieurement au 20 novembre 1976.
Toutefois, pour des raisons mêlant santé publique et intérêts
économiques, des solutions appropriées devaient être trouvées
pour le marché français.
Au chapitre des “bonnes pratiques”, relevons un premier texte,
celui des “bonnes pratiques de fabrication” (14), paru le 3 octobre
1978. Il faisait suite à l’adhésion de la France en 1976 au “système
de certifi cation de la qualité des produits pharmaceutiques
entrant dans le commerce international”, objet lui-même d’une
résolution de l’organisation mondiale de la santé (OMS) en 1969.
Le texte, élaboré sous les auspices de la Commission nationale
de la pharmacopée, eut d’abord le caractère d’une circulaire
administrative, accompagnée d’une instruction du ministre de
la Santé, précisant que “tous ceux qui, à tous les échelons, sont
responsables de la qualité des médicaments pourront désormais
se référer à ce document”. Il ne prendra un caractère obligatoire
qu’avec l’arrêté du 20 janvier 1992.
Puis vint l’instruction ministérielle du 31 mai 1983 conte-
nant un “Guide des recommandations de bonnes pratiques
de laboratoire (BPL)”. Ces règles visaient à garantir la validité
et l’intégrité des données recueillies au cours des études de
toxicologie expérimentale réalisées en vue de la constitution
du dossier d’AMM. Le texte était issu d’un consensus entre
experts de l’administration, de l’industrie, et de toxicologues
“académiques”. Il s’inspirait d’un document publié par l’Orga-
nisation de coopération et de développement économiques
(OCDE).
Dans l’esprit de ses concepteurs, le système dit “des bonnes
pratiques” “avait l’avantage de la souplesse”. Il s’agissait “de
constituer des objectifs à atteindre, et non une série de recettes
réglementaires étroites, laissant ainsi le maximum d’autonomie
et de responsabilités aux acteurs eux-mêmes” (15).
Toutefois, la nécessité d’une assurance offi cielle de la qualité
du médicament français soulevait les questions des inspec-
tions et du caractère d’opposabilité juridique des recommanda-
tions de bonnes pratiques. Les BPL donnèrent par conséquent
lieu, le 20 janvier 1986, puis le 6 mai 1988, à des décrets les
insérant dans le Code de la santé publique. Cette évolution
dans la hiérarchie des normes n’était pas sans rapport avec les
directives européennes 87/18/CEE et 88/320/CEE. Dès lors,
le rôle des inspecteurs était de vérifi er le “degré de conformité
aux principes des BPL”, “les noms des laboratoires soumis à
des inspections dans le cadre d’un programme national de
mise en conformité aux BPL, leur degré de conformité aux
principes des BPL, et les dates des inspections [devant] être
mis à la disposition des autorités nationales de vérifi cation en
matière de BPL d’autres pays membres sur demande… ceci
étant gage de réciprocité”. Mais si les inspecteurs attestaient
offi ciellement la conformité aux règles de bonnes pratiques, ils
n’avaient pas à apprécier la valeur scientifi que intrinsèque des
travaux présentés, ce qui était du ressort du rapporteur près
la Commission d’AMM.
Parallèlement au travail des structures administratives, retracé
ci-dessus, il convient de mentionner l’activité créatrice des
professionnels de la pharmacologie clinique, hospitaliers, univer-
sitaires comme industriels. Le colloque organisé à Lyon du 9 au
11 septembre 1977 (16), à l’initiative et sous la présidence de J.P.
Boissel et de C.R. Klimt, constitue une avancée véritablement
porteuse. Il est intitulé “Essais contrôlés multicentres : principes
et problèmes”. Lors de ce colloque, l’exposé “Quality assurance
in clinical trials” a permis à C.L. Meinert (17) de préciser : “Le
contrôle de qualité se propose de maintenir et de renforcer la
validité des résultats d’un essai clinique. Il doit commencer
avant le début de l’essai et se poursuivre jusqu’à la publication
du dernier rapport concernant l’étude. Un grand nombre de
patients et d’enquêteurs sont impliqués dans l’essai multicen-
trique, et un grand nombre d’informations sont recueillies et
traitées. Cela mobilise beaucoup de temps, d’énergie humaine
et d’argent, il n’est pas concevable de s’embarquer dans une telle
aventure sans précautions quant à la qualité du travail à eff ectuer.”
Suivaient dix recommandations relatives aux diff érents aspects
du contrôle de qualité, l’essai pris en exemple étant une étude
“institutionnelle”, le Coronary Drug Project, entreprise avec le
soutien de fonds publics aux États-Unis.
En 1980 (18), un premier congrès INSERM/DPhM fait le point
sur les bases scientifi ques et réglementaires de l’évaluation des
médicaments. Dans l’article Contrôle de qualité des essais
thérapeutiques (19), J.P. Boissel et A. Leizorovicz défi nissent
une prospective très futuriste pour l’époque. Cette prospective
découlait largement d’un essai fi nancé par la Délégation générale
à la recherche scientifi que et technique (DGRST), l’INSERM et
la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés
(CNAMTS) et réalisé en 1974 par le groupe Étude de prévention
des récidives de l’infarctus du myocarde par l’aspirine (EPSIM).
Cet essai constituait une sorte de prototype, tant en matière de
contrôle de qualité que d’utilisation de moyens informatiques.
Le manuel d’opérations de l’étude prévoyait une certifi cation du
consentement oral des patients participant, des visites de centres
pour vérifi er l’adéquation entre les informations fi gurant dans
le dossier hospitalier et ce qui avait été noté sur les bordereaux
servant au recueil d’observation (on ne parlait pas encore de case
report form [CRF]). Ces visites sur site avaient été précisément
eff ectuées par les deux intervenants, J.P. Boissel et A. Leizorovicz.
Ainsi donc, la valeur objective d’un essai dépendrait-elle, en plus
des éléments classiques comme l’analyse du problème posé,
l’adéquation du protocole à la réponse attendue et la justesse de
l’analyse statistique, d’une considération nouvelle, la qualité des
données recueillies. Le “contrôle de qualité” viserait à optimiser
ce dernier élément, ce contrôle de qualité représentant l’ensemble
des processus certifi ant la fi abilité des résultats, démarche que
J.P. Boissel et A. Leizorovicz considèrent constituer une exigence
éthique. On rapporte, parmi les éléments sensibles, les “perdus de
vue”, les visites manquées, les données absentes ou erronées, les
mauvaises administrations des traitements testés, les “événements
critiques”, toute une série de critères sur lesquels se fondent les
indices de qualité, soumis à des contrôles internes, voire externes.
Dans le même congrès, R. Flamant et son équipe (20) dressent

La Lettre du Pharmacologue - vol. 22 - n° 4 - octobre-novembre-décembre 2008
Essai clinique
Essai clinique
20
un bilan critique d’une série de dossiers cliniques adressés à la
commission d’AMM, photographie d’un ensemble de défi ciences
traduisant une indigence chronique.
Le deuxième congrès INSERM-DPhM (21), en 1983, intitulé
“Voies nouvelles de l’évaluation scientifi que et réglementaire
du médicament”, permet de revenir sur ce “bilan critique des
essais cliniques soumis à l’avis de la Commission d’AMM” (22).
Il complète l’état des lieux réalisé trois ans plus tôt. Le résultat
n’est toujours pas glorieux, mais on est parti de tellement bas. Les
auteurs relèvent l’absence d’une méthodologie rigoureuse dans
la majorité des dossiers présentés, et regrettent que “l’expertise
française de certains produits se réduise à une étude ouverte
de faible intérêt alors que le dossier international, s’il était bien
critiqué et étayé, suffi rait largement à emporter la conviction”.
Ils concluent en formulant des souhaits :
que l’industrie aide le clinicien à assurer le bon déroulement
✓
de son expertise, l’infrastructure hospitalière ne donnant pas
les moyens matériels indispensables à la bonne marche et à la
bonne surveillance des essais ;
que l’administration prenne conscience de la nécessité de
✓
règles méthodologiques obligatoires comme condition de
l’amélioration des essais cliniques français, avec, en complé-
ment, l’élaboration de guides et la formation des cliniciens aux
essais cliniques.
Au cours d’une communication de ce colloque, intitulée
“Contrôle de qualité des essais cliniques chez le praticien”,
l’orateur J. Ankri fait remarquer que “la préoccupation de la
vérifi cation de la qualité des actes et des documents liés à la
pratique des essais cliniques pour les nouveaux médicaments
est récente” (23). Il reprend les principes énoncés dans les actes
du congrès précédent relatifs au contrôle de qualité pour les
appliquer aux essais en médecine praticienne. Il souligne qu’à
côté des aspects techniques, il existe des “obligations éthiques
à l’égard des sujets participant à une étude, et qui impose la
rigueur de sa réalisation. La garantie minimum que peut exiger
un sujet acceptant de participer à un essai thérapeutique est
bien celle de la qualité de son exécution.”
Aux États-Unis, remarque-t-il, la FDA “a édicté des règles dites
de good clinical practices, précises, détaillées […]. L’industriel
qui souhaite demander une autorisation de commercialisation
d’un nouveau médicament ainsi que l’investigateur qui souhaite
participer à ces programmes d’études doivent appliquer rigou-
reusement les règles de bonnes pratiques, c’est-à-dire les règles
de contrôle de qualité des essais”.
Malheureusement, en France, ces règles n’existent pas.
L’ÉLABORATION DES BONNES PRATIQUES
CLINIQUES
Ces règles vont donc devoir être défi nies.
Pour la DPhM, l’idée des BPC comme démarche de qualité
était une étape d’un processus plus large, la modernisation de
la pharmacie française. Elle s’inscrivait également dans une
perspective internationale. Les États-Unis, le Canada et la Suède
avaient déjà travaillé le sujet, le Japon manifestait de l’intérêt
pour le concept. Il s’avérait indispensable de concevoir un projet
français à présenter à l’Europe. Sinon, le risque de se retrouver
face à un texte copie conforme des dispositions américaines
n’était pas nul. Il était, de plus, impératif de disposer d’un texte
avant que l’Europe mette cette réfl exion en route. Précisément,
sous la forme d’un document intitulé Conduct of clinical trials
(24), l’idée commençait à germer au Committee for Proprietary
Medicinal Products (CPMP).
La façon dont les bonnes pratiques de laboratoires avaient été
élaborées démontrait l’intérêt de la “concertation tripartite”
administratifs-industriels-académiques. Ce type de concertation
se trouvait facilité, depuis 1984, par la création, à l’initiative de
la DPhM et de la Délégation générale à la recherche scientifi que
et technique (DGRST), de “Rencontres nationales de pharma-
cologie clinique”, à Giens. Ces rencontres avaient permis de
faciliter les échanges entre spécialistes institutionnels et indus-
triels, dans un esprit de coopération et de partenariat. Depuis,
diff érents ateliers de ces rencontres avaient été consacrés à la
façon de conduire des essais cliniques du point de vue aussi bien
de la qualité éthique que de la qualité méthodologique, chez le
malade comme chez le volontaire sain. Cela, rappelons-le, dans
le contexte juridique antérieur à celui que mettra en place la loi
dite Huriet-Sérusclat en décembre 1988.
Sans s’être livrée à une enquête exhaustive, la DPhM détenait
quelques dossiers, rapportés par ses inspecteurs, de fraudeurs
pris sur le fait, médecins ayant inventé des patients, offi cine
spécialisée dans la construction de dossiers de demande d’AMM
ayant produit des rapports d’essais cliniques mensongers. Le
milieu des pharmacologues cliniciens avait, de son côté, été
sensibilisé par quelques dérapages, aussi bien en matière d’es-
sais que de publications. Certaines fi rmes pharmaceutiques
nationales s’étaient, pour leur part, risquées à commencer la
mise en place de procédures dans les essais cliniques qu’elles
entreprenaient (25), faisant, en quelque sorte, des bonnes prati-
ques cliniques comme M. Jourdain faisait de la prose. Et pour
les fi liales françaises de fi rmes américaines, l’exemple venait
de la maison mère.
Le projet de BPC présentait toutefois le risque d’être rejeté par
une majorité d’industriels, ceux-ci ayant déjà vu, depuis dix ans,
les contraintes et obligations réglementaires croîtrent de façon
notable. Les BPC avaient pour conséquence prévisible l’augmen-
tation du coût des essais. Ces coûts aff ectaient essentiellement
les fi rmes françaises, et non les fi liales françaises de fi rmes étran-
gères, moins impliquées dans les programmes de développement,
car recevant les dossiers de demande d’AMM des maisons mères,
dans le but éventuel de leur donner une coloration nationale. À
l’époque, le poids des fi rmes françaises dans le Syndicat national
de l’industrie pharmaceutique était important.
Les BPC ne manqueraient pas de créer des diffi cultés chez
les cliniciens, du temps nécessaire aux contrôles de qualité,
qui allongerait d’autant les essais. À ce propos, ces contrôles
de qualité comportaient l’inconvénient d’exposer le médecin
hospitalier, personnage toujours considérable, aux vérifi cations
tatillonnes d’un “petit salarié” de l’industrie pharmaceutique.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
1
/
9
100%