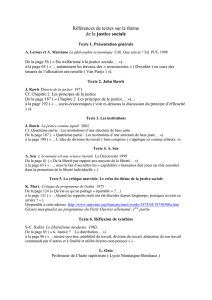REGARDS CROISÉS SUR L`ÉTHIQUE

REGARDS CROISÉS SUR L’ÉTHIQUE
Chapitre 13
DEUX APPROCHES CONTRASTÉES
DE L’ÉTHIQUE MACROÉCONOMIQUE
Hugues Puel
Économie et humanisme
L’éthique macro-économique soulève des problèmes radicaux d’épistémologie. Le chapitre
précédent a bien montré l’immoralité foncière de la théorie économique dominante qui sert
généralement de justification aux fonctionnements présents de l’économie concrète.
Dans ces conditions, il importe de découvrir des fondements éthiques possibles de la macro-
économie. On ne peut se contenter de moraliser vaille que vaille la vie des affaires, ce qui déjà en
soi n’est pas tâche aisée, comme le prouvent plusieurs chapitres précédents de cet ouvrage.
Mais pour rentrer plus avant dans la problématique de l’éthique macro-économique, on cherchera
une voie susceptible de fonder une éthique macro-économique. Or on peut penser que la voie
d’entrée n’est pas unique, mais multiple.
Cette hypothèse sera illustrée par la mise en œuvre de deux approches très contrastées du
problème auquel nous sommes affrontés.
La première approche se veut immédiate et réaliste. La macro-économie se définit par rapport aux
besoins humains. C’est la voie suivie à son origine dans les années quarante par l’association
Économie et Humanisme. Elle s’inspire de la théologie traditionnelle de l’Église catholique.
Une autre voie va puiser son inspiration dans la théorie politique de Jean-Jacques Rousseau sur
le contrat social et construire sur un mode abstrait une théorie de la justice sociale comme équité.
C’est celle suivie à la fin des années soixante par le philosophe politique américain John Rawls
s’efforçant de fournir des bases légitimes à une économie capitaliste dominante fortement
contestée à l’époque par le mouvement social et notamment le mouvement étudiant aux États-
Unis et en Europe Par rapport à la première, cette autre voie se caractérise par son abstraction et
son idéalisme. Explorons les, l’une après l’autre.
I. PARTIR DES BESOINS
Dès son origine en 1941, le mouvement Économie et Humanisme, a construit une doctrine des
besoins capable de donner des bases solides à son projet d’économie humaine à construire dans
un esprit spiritualiste. Celle-ci repose sur une double position :
• La première propose un classification les besoins en besoins dits primaires qui sont dits
également essentiels ou fondamentaux, puisque sans les biens et les services qui permettent de
les satisfaire, je m’atrophie ou je meurs, et en besoins secondaires et tertiaires qui représentent,
pour les premiers, l’expansion de biens de commodité et de confort et, pour les seconds, le
développement de la culture cultivée.

DEUX APPROCHES CONTRASTÉES DE L’ÉTHIQUE MACROÉCONOMIQUE 2
•La seconde affirme que l’humanité ne devrait pas procéder à la satisfaction des besoins
secondaires et tertiaires avant d’avoir fourni à tous la satisfaction de leurs besoins fondamentaux.
Dans sa radicalité, cette doctrine est difficile à entendre si l’on ne comprend pas deux choses :
Premièrement, les besoins dits primaires ne sont pas seulement matériels mais incluent des
éléments relationnels (comme le droit de fonder une famille) et des besoins spirituels (la possibilité
de pratiquer sa religion par exemple). Cela n’a rien à voir avec la pyramide de Maslow qui fait une
hiérarchie des besoins en partant des besoins matériels pour s’élever progressivement vers des
besoins dits intellectuels et spirituels. Pour Lebret, il y a une composante spirituelle dans les
besoins primaires.
Deuxièmement, la doctrine se réfère à un ordre du bien commun qui suppose une intention
d’universalisation qui peut se jouer par étape à une échelle plus réduite de communauté locale ou
nationale, de micro en méso-économie, de macro-économie à l’économie mondiale. Cette
référence repose, on l’aura remarqué, sur une grande confiance dans la capacité humaine à
maîtriser l’ensemble du devenir économique des sociétés.
Cette doctrine remarquable du mouvement fondé par le Père Lebret se déploie en pédagogie de la
solidarité et en ouverture à la diversité des cultures et des civilisations1.
Cette doctrine n’est pas facile à entendre et a donné lieu à de nombreuses critiques.
Trois types de critiques sont généralement adressées à la doctrine des besoins fondamentaux :
Une critique libérale : les besoins réels sont flous ; en réalité on ne les connaît dans leur réalité
qu’à travers le marché. Le concept de besoin s’efface ainsi devant celui de demande et de
demande solvable, ce qui ruine la légitimité de toute l’économie non-officielle et non-monétarisée
Une critique néo-marxiste : Marx utilisait le concept de besoin car il savait que la demande
solvable ne permettait pas de satisfaire tous les besoins, mais tout un courant néo-marxiste des
années soixante-dix pense que ce concept est redondant par rapport à celui de rapports sociaux
qui dénoncerait beaucoup mieux le capitalisme dans ses inégalités de niveau de vie, ses
déséquilibres de développement et son système irrationnel de décision économique
Une critique d’inspiration psychanalytique que résume la formule du philosophe Bachelard :
“ l’homme n’est pas un être de besoin, mais un être de désir ”. Ce ne sont donc pas les besoins
qui importent mais les désirs.
Dans son ouvrage intitulé Le basculement du monde, Michel Beaud relance la question des
besoins en écrivant « La question des besoins, cruciale dans nos sociétés, a largement été éludée
par les économistes »2. Et il poursuit « Les besoins sont diversifiés, hétérogènes, relatifs et, à
l’image de nos sociétés dont ils sont partie intégrante, en incessante évolution, diversification et
expansion. En outre, ils s’inscrivent dans trois dimensions : une dimension de nécessité,
d’exigence voire de contrainte (biologique, matérielle ou sociétale), une dimension marquée par la
détermination sociale (donc par la place, la fonction, le rôle dans la société) et une dimension
individuelle ou familiale (liée à la dynamique propre de chaque famille et de chaque personne ».
Ainsi , « dans l’approche humaniste, deux pôles structurent le monde complexe des besoins : le
pôle des besoins vitaux ou essentiels et celui des besoins superflus ou inessentiels » Et l’auteur
de nous proposer un tableau suggestif issu du croisement de deux typologies : besoins
vitaux/besoins superflus d’une part, besoins solvables/besoins insolvables de l’autre3.
Ce retour à la problématique des besoins s’explique par la richesse anthropologique du concept
de besoins fondamentaux ou essentiels et permet de répondre aux diverses objections qui tentent
en vain de l’éliminer.
1 On trouvera un exposé systématique de la doctrine des besoins d’Économie et Humanisme dans le
chapitre neuvième de Hugues Puel L’Économie au défi de l’éthique, Cujas-Le Cerf 1989, p. 83-93.
2 M. Beaud, Le Basculement du monde. De la terre, des hommes et du capitalisme, Paris, La
Découverte/poche, 2000, p. 202.
3 Id., p. 205-211.

DEUX APPROCHES CONTRASTÉES DE L’ÉTHIQUE MACROÉCONOMIQUE 3
À la première objection on peut répondre, que de nombreux besoins sont insolvables et que la
demande, toute efficace qu’elle soit, ne répond pas à tout. L’existence des politiques de lutte
contre la pauvreté, y compris dans les pays les plus riches, le montre clairement. Lorsque des
groupes sociaux luttent pour satisfaire leurs besoins fondamentaux, ce n’est pas au marché qu’ils
s’adressent. Ils prennent des initiatives en dehors de l’économie de marché, comme le montrent
par exemple les services d’échanges locaux qui se situent volontairement à la marge de
l’économie monétarisée.
Deuxièmement, le concept de rapports sociaux réduit le champ de l’économie au rapport capital-
travail et oublie le facteur terre ou nature, heureusement remis en valeur par le mouvement
écologiste.
Troisièmement, la prise en compte des désirs attire justement l’attention sur les aspects
immatériels, psychologiques et symboliques de nombreux besoins. Il n’en reste pas moins que le
concept de besoin garde tout son sens dans la mesure où l’on prend en compte certains invariants
de l’humain, pour ne pas parler de nature humaine. Et même s’il est vrai que la nature humaine est
de vivre à l’état de culture, il y a un spécifique humain, que certains appellent la différence
anthropologique4
Eliminer le concept de besoin peut sans doute satisfaire certaines exigences d'abstraction et de
scientificité, mais dès que la recherche se fait proche de la population en économie du
développement, en socio-économie urbaine, en politique sociale ou en économie du travail et de
l'emploi, elle se trouve bel et bien confrontée à la problématique des besoins. On ne peut éliminer
de l'explication un mobile essentiel de l'activité de l'homme économique. Il y a donc retour à la
problématique des besoins.
Les raisons de ce retour paraissent être à la fois de nature. épistémologique, politique et éthique.
• La raison épistémologique est celle du rationalisme appliqué dans les sciences de la société : la
science sociale ne peut éliminer les fins de l'acteur sans mutiler gravement la construction du
savoir. La reconnaissance du sujet à la fois comme acteur et comme objet du processus de
connaissance, loin d'éloigner de la science en rapproche. Telle est la forme que prend le
rationalisme appliqué dans les sciences sociales. Que les populations soient associées à l'étude
de leur milieu et à l'analyse des moyens de sa transformation n'est pas moins scientifique que la
recherche purement extérieure et «objective», même armée des techniques quantitatives les plus
sophistiquées. Elle est même plus scientifique dans la mesure où elle est plus proche de
l'intervention sociale et plus efficace pour l'action. Elle pousse plus loin le rationalisme appliqué à
l'objet social. On voit donc que, loin d'être non scientifique, la problématique des besoins fonde
une démarche d'économie humaine parfaitement pertinente par rapport à son objet.
•L'analyse de ses besoins par une population est une démarche démocratique fondamentale. Elle
peut être aidée par des méthodes d'enquêtes appropriées. En même temps que scientifique, cette
démarche est anti-technocratique. Elle est potentiellement subversive, car elle trouble le jeu des
notables, des socioprofessionnels et des politiciens en place. Elle constitue un recours de la
société civile contre un État qui tendrait à la sclérose, un appel à la démocratie directe contre des
pouvoirs que tendent à confisquer partis politiques, bureaucraties syndicales, administrations
publiques, grandes firmes. La démocratie représentative est une grande chose et ceux qui en sont
privés savent ce qu'ils perdent, mais elle a besoin d'être corrigée et complétée par un mouvement
de démocratie directe ou démocratie de participation. On appelle cela désormais la gouvernance.
La mise en œuvre sur le terrain de la problématique des besoins fondamentaux, en particulier par
des enquêtes qui impliquent les populations concernées, appuie un tel mouvement.
• Raison éthique enfin, car la dimension du besoin est essentielle à l'homme économique. Elle ne
saurait être éliminée ou réduite, car c'est elle qui fonde un double principe de protestation et de
créativité qui constitue la vérité de l'homme économique : protestation contre des structures
aliénantes, créativité au service d'une économie plus humaine, c'est-à-dire plus communautaire et
plus universelle, plus juste et plus paisible, plus fraternelle et plus cultivée.
4 Frank Tinland, La Différence anthropologique. Essai sur les rapports de la nature et de l’artifice, Paris,
Aubier Montaigne, 1977.

DEUX APPROCHES CONTRASTÉES DE L’ÉTHIQUE MACROÉCONOMIQUE 4
Par homme économique, il ne s'agit pas de l'homo œconomicus mû par un intérêt économique
individuel à la rationalité étroite, mais d'un homme véritable, chair et esprit, avec des intérêts
multiples et complexes à défendre, mais ouvert à la communauté et au dépassement de lui-même
dans une visée de bien commun.
Cette définition de l’économie par référence directe aux besoins ne manque pas de réalisme, mais
elle est défiée par une modernité beaucoup plus incertaine des fondements de ses connaissances
et du vouloir vivre ensemble des hommes. D’où la nécessité de parcourir une toute autre voie
inspirée de la philosophie politique du contrat social, dans la forme que lui a donné John Rawls et
qui joue dans le débat contemporain un rôle important. Une réflexion d’éthique macro-économique
ne saurait l’ignorer.
II. SITUATION PRIMORDIALE, VOILE D’IGNORANCE ET CONTRAT SOCIAL
Philosophe politique aux États-Unis, le professeur John Rawls enseigne à l’Université de Harvard.
Les quelque six cents pages de sa Theory of justice sont élaborées par lui à l’époque où ses
étudiants manifestent contre la guerre du Vietnam, protestent contre les discriminations raciales et
sociales dans la société américaine et proclament à la suite de Nietzsche que Dieu est mort. Il
reprend à la base la question des raisons d’être du vivre ensemble dans une société moderne,
seule réponse philosophique au malaise d’une jeunesse qui refuse le monde des adultes, un
monde de guerre et d’injustice sociale.
Il trouve alors son inspiration dans le Contrat social de Jean-Jacques Rousseau. À la suite de
Hobbes, Rousseau avait fait l’hypothèse d’un état primordial et imaginaire du rapport entre les
hommes, antérieur à toute entente entre eux sur les règles de la vie commune. C’est le contrat qui,
selon Rousseau, permet aux hommes de passer de l’état de nature à l’état de société. Cette
opération fondatrice est une pure fiction théorique que ne vient confirmer aucun témoignage
existant ni aucune étude sur la vie des peuples dits primitifs ! Mais c’est une situation théorique,
strictement formelle, qui fournit une précieuse piste de réflexion.
Encadré 1 : Thomas Hobbes (1588-1679)
Fondateur de la philosophie politique anglaise moderne, Hobbes recherche les principes éthiques à
partir du sujet. Ce subjectivisme éthique s’oppose « à l’objectivisme selon lequel la connaissance de
nos devoirs se déduit rationnellement de distinctions morales connues à partir des propriétés
déterminées des choses elles-mêmes » (Martine Pécharman dans le Dictionnaire d’éthique et de
philosophie morale, p. 660). Toutes les actions humaines sont déterminées par les individus à partir
de leurs désirs et de leurs passions. Et ceci est nécessaire pour le devenir de la vie elle-même. Il y a
donc contradiction entre la nature de la vie et la notion de souverain bien. Pour chaque homme, le
bonheur est la recherche de son identité à travers le temps, à travers l’application constante de son
désir à un objet puis à un autre. Puisque les hommes sont égaux par nature et que chacun poursuit
son propre objet, le conflit est inévitable et tout homme devient l’ennemi de l’autre homme. Comme
l’explique Hobbes dans son livre Le Léviathan (1651), le désir par chacun du maintien de sa propre
vie incline chaque homme à lutter contre chaque autre. De cette guerre de tous contre tous, on ne
peut sortir que par un pacte, un contrat social qui permet de sortir de cet état de guerre et d’instaurer
la paix civile.
Rawls va baptiser cette hypothèse, situation primordiale caractérisée par le voile d’ignorance. Le
point de départ du raisonnement pour découvrir le critère de la justice sera la situation du voile
d’ignorance. Nous sommes dans une société où personne ne sait encore quel sort lui sera
réservé : s’il sera riche ou pauvre, puissant ou misérable, influent ou dominé. Dans un tel contexte

DEUX APPROCHES CONTRASTÉES DE L’ÉTHIQUE MACROÉCONOMIQUE 5
d’ignorance des relations sociales réelles, des différences de classe, des inégalités de revenus,
peut-on se mettre théoriquement d’accord sur un critère de la justice ? Telle est la question à
laquelle Rawls va apporter sa réponse.
Encadré 2 : Jean-Jacques Rousseau (1712-1778)
Le citoyen de Genève va prolonger l’hypothèse de Hobbes sur le contrat social. Mais pour Rousseau,
le premier état de nature, est un état de transparence réciproque des consciences, de communication
totale et confiante, une sorte d’enfance heureuse de l’humanité. Le mouvement de l’histoire ne fera
qu’obscurcir cet état, le défigurer et de le dépraver. Mais l’idéal demeure inscrit au cœur de l’homme,
comme une sorte d’immanence de la nature au cœur du moi, tandis qu’ira croissante la dégradation
de l’humanité.
Le premier état de nature a été rendue possible par la dispersion des hommes sur la terre. Dans cette
situation, ils n’ont pas besoin d’exercer la violence contre leurs semblables. Apparaît alors un
deuxième état de nature qui s’identifie à celui de Hobbes. Avec la multiplication des hommes, se
développe cette guerre de tous contre tous, dont on ne peut sortir que par l’institution de la société
civile. Mais en se socialisant les hommes se dénaturent. Apparaissent l’inégalité, l’excitation des
désirs et toutes les exploitations auxquelles donnent lieu la recherche effrénée des consommations et
des jouissances.
L’idée d’état de nature permet de mesurer la distance avec notre situation actuelle, c’est-à-dire
l’ampleur de notre chute. Quant à l’idée de droit, si elle rend manifeste l’ampleur de nos infractions,
elle offre aussi une perspective de renaissance dans la mesure où la volonté générale c’est-à-dire
l’expression collective de la bonté foncière de l’homme pourra régénérer la société à travers
l’expression démocratique. Cela n’est peut-être pas possible, sauf dans de petits États (la Suisse), et
encore le succès n’est-il pas assuré.
Voir J. Starobinski, Jean-Jacques Rousseau, la transparence et l’obstacle, Paris, Gallimard, 1971.
Les deux principes
Sa réflexion, sous hypothèse du voile d’ignorance, va l’amener à organiser la découverte du critère
de la justice autour de deux principes : un principe d’égalité et un principe de différence.
Sous le voile d’ignorance, c’est-à-dire en situation (théorique) d’état de nature, les hommes ont
intérêt à commencer par poser un principe d’égalité entre eux , sinon c’est la porte ouverte à
toutes formes de sociétés fondamentalement inégalitaires. Le philosophe va donc affirmer un
principe de droit de tous à l’accès aux biens fondamentaux nécessaires pour la vie en société.
Sous voile d’ignorance, on ne peut aller au-delà de l’affirmation de quelques droits abstraits. Ces
droits doivent pouvoir être compatibles entre eux et généralisables à tous les hommes. Ils doivent
pouvoir être accordés à tous sur la base d’une liberté politique ouverte à tous.
Mais il est possible pour Rawls d’aller plus loin et d’imaginer, même en situation primordiale, une
société qui fasse preuve de dynamisme pour se développer. Dans un tel cas, il apparaîtra normal
que soit reconnu un avantage supplémentaire à ceux qui contribuent particulièrement à ce
dynamisme collectif. C’est poser un principe de différence. Le principe de base d’égalité, qui ouvre
toutes les chances à tous, va donc se voir compléter par un principe qui reconnaît certaines
inégalités de fait en faveur de ceux qui œuvrent utilement pour l’intérêt général.
Mais l’hypothèse théorique qui fonde la différence sur le succès doit aussi prendre en compte
l’échec. Il y a ceux qui ne parviennent pas à se faire une place au soleil, qui échouent dans leurs
affaires, qui n’ont pas eu de chance dans la vie. Comment prendre en compte les pauvres et les
exclus ? Ici Rawls imagine un second volet au principe de différence. Ce sont les fameuses
discriminations positives qui confèrent certains avantages limités pour tenir compte de telle
situation d’infériorité ou de tel handicap physique ou social.
Le principe de différence a donc deux aspects : le premier, qui, sur la base d’une ouverture à tous
de toutes les places dans la société, récompense ceux qui en réussissant particulièrement bien
sont précieux pour l’intérêt collectif, et le second, qui justifie certains bénéfices particuliers à ceux
que les circonstances de la vie en société ont désavantagés.
 6
6
 7
7
 8
8
1
/
8
100%