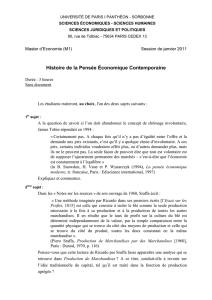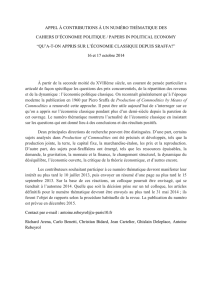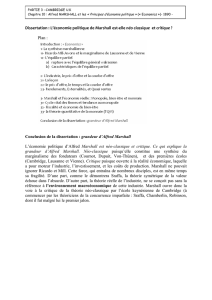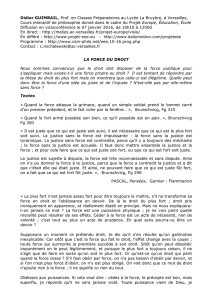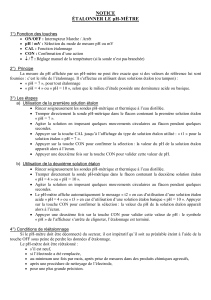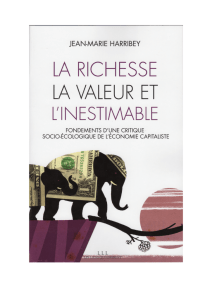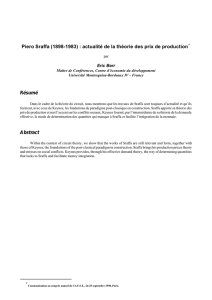Dissertation : Quelle(s) évolution(s) majeure(s) de l`économie

L3S6 – SEG – HPE2 – r.foudi – Chapitre 11 : dissertation –La théorie critique de P. Sraffa – Complément aux notes de
cours - Page 1 sur 5 2011/12
Dissertation : Quelle(s) évolution(s) majeure(s) de l’économie politique entraîne la théorie
critique de Piero Sraffa ?
Plan (Rappel)
Introduction : La théorie critique de Sraffa : une définition
1-Le rejet de la théorie marshallienne de la valeur (coûts et rendements)
11- Des rendements décroissants classiques à la loi de proportionnalité marshallienne
12- La remise en cause de la courbe d’offre à coûts décroissants (donc des rendements croissants)
2- La refondation de la théorie ricardienne de la valeur travail et l’abandon de la loi de l’offre et de la demande
(« production de marchandises.. ») : le modèle de Sraffa
21- Définition du « modèle de Sraffa »
22- « Production de marchandises par des marchandises » : la structure du modèle
23- La résolution des systèmes 1 à 3
24- Le système 4 ou système étalon (ou « étalon invariant des prix » : « standard system ») : objet, définition,
et démonstration simplifiée de la relation inverse « profit-salaire ».
25- Conséquence principale : il n’y a plus de théorie de l’équilibre du marché
Conclusion à la dissertation
Introduction : La théorie critique de Sraffa : une définition
Piero Sraffa (Turin-1898 – Cambridge-1983) rédige son œuvre critique dans la période de transition
entre la première publication des « Principes » de Marshall (1891) et les premiers travaux de
Keynes (les années 1920). La théorie marginaliste est encore dans une période de dynamisme
fécond. Les écoles entretiennent d’importantes controverses théoriques : Wicksell et Fisher revoient
Böhm-Bawerk, Hayek reconsidère l’équilibre général walrassien, Pigou rectifie Marshall, par
exemple. L’édifice théorique et mathématique bâti par Marshall est alors imposant, et confère à
l’économie politique un statut scientifique et mathématique. La connaissance économique paraît
dotée des moyens d’intellection de la réalité économique, celle des consommateurs et des
producteurs. Tout se passe comme si l’équilibre partiel en situation de concurrence pure et parfaite
était une analyse fidèle de la réalité. Issu de l’observation de cette réalité, il est censé permettre
l’analyse de ses dysfonctionnements éventuels. La loi de l’offre et de la demande, élaborée sous la
forme d’une théorie symétrique de la valeur (offre croissante, demande décroissante), est donc
considérée comme une loi scientifique. Les relations mathématiques fondamentales entre coûts et
quantités, qui soutiennent son énoncé, sont considérées comme le résultat naturel d’un progrès de la
connaissance économique depuis Ricardo et JS Mill. On reconnaît toutefois que l’économie
classique (ou ricardienne), par ses égarements sur l’explication du prix par la valeur travail est
dépassée. Dès 1923, l’américain John Maurice Clark (dans The Economics of Overhead Costs, ou
« l’économique des coûts fixes » réalise une critique magistrale de ces supposées relations. Mais,
c’est la critique cambridgienne impulsée par P. Sraffa (et le groupe cambridgien : Besicovitch,
Ramsey, Watson, Robinson, Chamberlin) qui marque une rupture dans cette évolution de la pensée.
C’est par deux publications concises et rigoureuses, que Sraffa réalise un tournant théorique
fondamental pour l’histoire de la pensée. Il publie en 1925 : « Sulle Relazioni fra Costo e Quantita
Perdotta » (Annali di Economia. ), article en italien qui sera simplifié et traduit à Cambridge, à la
demande d’Edgeworth et Keynes, en 1926 sous le titre : « The Laws of Returns under Competitive
Conditions », (Economic Journal). L’équilibre marshallien, ou équilibre partiel de concurrence pure
et parfaite, est remis en cause dans son fondement même : la loi des rendements décroissants. La
portée de la critique de Sraffa est d’envergure, car elle relègue à la mythologie le postulat de la
concurrence pure et parfaite pour initier les travaux sur la concurrence monopoliste (ou imparfaite)
d’une part, et d’autre part elle réduit la prétention de la microéconomie à analyser l’équilibre de
l’industrie pour valoriser l’analyse macroéconomique du marché.
C’est donc l’édifice même de la loi de l’offre et de la demande qui est atteint, et avec lui la
détermination du prix par une théorie symétrique de la valeur. La conception alternative est
élaborée par P. Sraffa sous la forme d’un retour à Ricardo, dans sa troisième publication :

L3S6 – SEG – HPE2 – r.foudi – Chapitre 11 : dissertation –La théorie critique de P. Sraffa – Complément aux notes de
cours - Page 2 sur 5 2011/12
« Production of Commodities by Means of Commodities : Prelude to a critique of economic
theory ». La théorie ricardienne de la valeur travail se voit alors restaurée grâce à la construction
d’un système étalon (ou étalon de mesure invariable des valeurs).
On peut donc définir la théorie critique de P. Sraffa, comme la théorie économique qui
démontre l’impossible explication du prix (ou de la valeur) par l’équilibre partiel, et qui lui
oppose une explication dite « néo-ricardienne ». Résultats de cette définition, deux parties
structurent notre exposé :
Le rejet de la théorie marshallienne de la valeur (coûts et rendements) –(première partie)-
La refondation de la théorie ricardienne de la valeur travail et l’abandon de la loi de l’offre et de la
demande (seconde partie). La conclusion illustrera les conséquences de la critique de Sraffa pour
l’histoire de la pensée.
………..
3- ou S3 (fin de la démonstration)
Trois hypothèses doivent être envisagées :
4- Le système étalon ou la solution aux problèmes de la répartition (ci-dessus)
Définition du problème par Mss J. Robinson : dans une économie capitaliste, la mesure de ce qu’il
y a à répartir dépend de la répartition elle-même. Ou la valeur de ce qu’il y a à répartir change avec
la répartition, a cause des prix de production des biens et du salaire, variables.
Définition matricielle du problème :
Revenu national = profit + salaires = prix du surplus
r (X.A
AA
A
P ) + w = X ( I – A
AA
A ) P
Avec (X.A
AA
A
P) = prix des moyens de production r (X.A
AA
A
P ) = profit global
L’équation de dimension est par définition stable : r (X.A
AA
A
P ) + w = 1 = X ( I – A
AA
A ) P
Donc 1e salaire global s’écrit : w = 1 - r (X.A
AA
A
P )
La leçon est : la variation du salaire global dépend directement de « r » (le taux de profit) et
indirectement de (X.A
AA
A
P ) donc de P, le vecteur des prix.
Ce qu’il y a à répartir X ( I – A
AA
A ) P change de valeur lorsque l’un des éléments constitutif de la
répartition [r ( X A
AA
A P ) + w] se modifie, donc lorsque se modifient les prix (P).

L3S6 – SEG – HPE2 – r.foudi – Chapitre 11 : dissertation –La théorie critique de P. Sraffa – Complément aux notes de
cours - Page 3 sur 5 2011/12
5- La solution à l’impossibilité par la marchandise composite
Soit le programme :
r (X.A
AA
A
P ) + w = 1 (voir supra)
XP – (X.A
AA
A
P ) = 1
( produit brut – prix des moyens de production = 1 = produit net ou équation de
dimension)
Il suffit que dans cette seconde équation les combinaisons des consommations productives soient
dans les mêmes proportions dans toutes les branches, pour que les prix deviennent une constante, et
donc que X = X.A
AA
A
. La marchandise composite est ainsi formée (son expression exacte est donnée
plus loin).
On constate alors (équation 1) que les variations du salaire (w) deviennent directement fonction des
variation du taux de profit (r) : soit w = w(r) ou w = - r (X.A
AA
A
P ) et (p=cste).
6- Définitions du système étalon (SE) et passage du système réel (SR) au système étalon (SE)
La solution précédente montre deux relations définissant le système étalon suivant deux définitions
: 1- Def 1 : production brute (X) et consommations productives (A
AA
A
P ) sont quantité d’une
même marchandise composite,
2- Def 2 : le rapport de la quantité produite (X) aux quantités consommées productivement
(A
AA
A
) est le même dans toutes les branches du système étalon.
L’association d’un système étalon à un système réel (ou passage de l’un à l’autre) utilise des
multiplicateurs notés q
i.
Le système étalon (SE) défini au moyen des multiplicateur est tel que chaque produit net (branche)
est rapporté à la même marchandise composite. Ces rapports sont notés R :
R
Aq
AqAq
n
ijii
n
ijiijj
=
−
∑
∑
=
=
1,
1,
avec A
j
= production de chaque branche, A
ij
= consommations productives.
Comme A
i,j
= a
i,j ×
A
i
, en remplaçant dans R, on obtient :q
j
A
j
= (1+R) (Σ
i
q
i
A
j
) a
i,j.
En écriture matricielle : q
j
A
j
= Y (une matrice des productions) et donc
Y = (1+R) Y A
AA
A
Y A
A A
A = [1/(1+R)] Y.
La solution existe en vertu du théorème de Perron Froebenius. Il existe donc un surplus
(Y>0) dont le taux de rendement est un profit positif (R>0). Et puisque Y>0, alors à chaque
système réel ne peut être associé qu’un unique système étalon, sous une contrainte à choisir
telle que les deux systèmes (SR et SE) utilisent les mêmes quantités totales de travail (YL =
XL = 1).
7- La relation directe et inverse entre taux de profit et taux de salaire (déductible des relations ci-
dessus).
Y (I – A) P = 1 La valeur du produit net du système étalon est égale à l’unité
≡ r Y A P + w = 1 La valeur du produit net est la somme du profit et du salaire
et donc : r Y A P = 1 – w
En reportant dans Y A P = 1/R
r = R ( 1 – w)
la relation directe indépendante
des prix (P) entre taux de salaire (
w
) et de profit (
r
).
R
= taux de profit maximum correspondant à un salaire nul et qui est la mesure du rendement de
l’ensemble du système productif.
Particularités de la relation inverse :
- Elle ne reflète que les seules conditions techniques de la production (coefficients a
ij
),
-Elle est linéaire : la variation de r liée à celle de w est indépendante de l’état initial de la
répartition.

L3S6 – SEG – HPE2 – r.foudi – Chapitre 11 : dissertation –La théorie critique de P. Sraffa – Complément aux notes de
cours - Page 4 sur 5 2011/12
- Elle ne vaut que pour le SR qu’à condition de prendre pour étalon Y (I – A) P = 1. L’égalité entre
la valeur à répartir et la valeur répartie n’existe que dans le système étalon.. Ce qui relève d’une
conception classique de la production et de la répartition.
……..
25- Conséquence principale : il n’y a plus de théorie de l’équilibre du marché
La conséquence immédiate du modèle est explicite si on reprend l’équation précédente du taux de
profit
r = (Y/C) [ 1 – (L w / Y)]. Celle-ci devient pour le système étalon (ou
E
), en remplaçant (Y
E
/C
E
) par
R (taux de profit maximum), L
E
par 1 et Y
E
par 1 :
r (le taux de profit) = R (1-w) .
Comme [(L
E
w / Y
E
)]
= w la part des salaires dans le revenu national du système étalon, alors
la relation est linéaire et
décroissante, et sa représentation est celle de « La relation inverse entre salaire et profit » (voir
annexe 6) . En prenant comme variable indépendante, le taux de profit, la relation inverse doit
plutôt s’écrire : w = 1 – (r/R) avec R, le taux maximum de profit. Il ne s’agit plus d’une relation
linéaire, mais elle est toujours décroissante. Sraffa la décrit ainsi :
« Il s’ensuit que si le salaire vient à baisser en termes de n’importe quelle marchandise
…[dont le prix
est exprimé en proportion de la marchandise- étalon]
, le taux de profit montera ; et vice-versa si le salaire
s’élève. » (Sraffa : « Production… », op. cit., P 49, [..], ajouté par nous :RF).
La démonstration de l’existence d’une théorie de la valeur des biens, indépendante de la loi de
l’offre et de la demande et donc du marché est ainsi achevée. Le marché n’est pas non plus
nécessaire à la définition de la rémunération des facteurs de production. La critique de la théorie
économique néo-classique trouve donc ici sa concrétisation.
La cause réside dans l’hypothèse srafaïenne du caractère déterminant des méthodes de production
(les coefficients dits « aij »). L’analyse néo-classique (marshallienne) dite à l’équilibre n’a plus
d’objet :
Du côté de la demande parce qu’il n’y a pas d’autre demande que celle du surplus réparti entre
salaire et profit. De plus, prix et quantités sont des variables indépendantes, et non dépendantes
comme dans le raisonnement marshallien.
Du côté de l’offre, du fait de l’absence de référence à toute hypothèse sur les rendements, qui fait
que toute référence à une courbe d’offre est superflue
L’offre, après la demande est donc exclue du modèle de la reproduction d’ensemble. En lieu et
place du modèle néo-classique Sraffa parvient ainsi à élaborer une conception classique du prix
basée sur les coûts de production et un taux de profit homogène. Son disciple immédiat, Pierangelo
Garegnani confirmera ce point de vue en démontrant que la théorie néo-classique n’a de validité
que dans un univers à un seul bien, autrement dit sans échange, et donc sans prix.
Conclusion à la dissertation
Si les travaux de Sraffa n’avaient pas infléchi le cours de la réflexion économique, les corrections
ici présentées pourraient être considérées comme secondaires. Mais il n’en est rien. Non seulement
leurs prolongements sont réels et durables, mais de plus ces corrections n’épuisent pas la totalité de
la critique srafaïenne.
Il faut en effet rapporter à cette critique le débat fondamental relatif à la mesure du capital et à la
possibilité de construire une fonction de production macroéconomique à deux facteurs homogènes
(capital et travail). On sait que ce débat a opposé les théoriciens des deux Cambridge (UK et
Massachussets). A l’origine est située la théorie du profit construite (ci-dessus) par Sraffa. Elle

L3S6 – SEG – HPE2 – r.foudi – Chapitre 11 : dissertation –La théorie critique de P. Sraffa – Complément aux notes de
cours - Page 5 sur 5 2011/12
permet de révéler que suite à une hausse du taux de l’intérêt, une technique délaissée au profit
d’une autre pour cause de rentabilité inférieure, peut à nouveau se révéler la plus rentable des deux.
Cette technique « revient en quelque sorte » comme étant la plus rentable. Ce double paradoxe est
connu sous les expressions de « capital reversal » et de « double switching » (voir Cours d’HPE
chapitre 12).
Le modèle de Sraffa est aussi celui qui résout le problème de Marx dit de « la transformation des
valeurs en prix de production ». Franck Van de Velde montre que cette résolution remet en cause
les piliers théoriques de l’analyse de Marx, dont la baisse tendancielle du taux de profit et la
composition organique du capital. Ces piliers sont réduits à des cas théoriques particuliers sans
fondement empirique, dont la démonstration mathématique est impossible.
L’ouverture réalisée par Sraffa après « Sulle » et « The laws » résulte, quant à elle, de la
démonstration de l’incompatibilité (exposée plus haut) des trois postulats néo-classiques : la
concurrence imparfaite, le raisonnement ceteris paribus, et les rendements non proportionnels. On
peut distinguer trois voies :
La voie la plus connue est celle de la concurrence imparfaite. Elle a été développée par Joan
Robinson et E.C Chamberlin, qui conservent cependant les deux autres postulats.
Le refus de l’hypothèse ceteris paribus a revalorisé l’équilibre général walrassien. De nombreux
travaux ont révisé cet équilibre, dès la première moitié du XX
eme
siècle, dont ceux de : Hicks, Allais,
Samuelson, Arrow, Debreu, Mac Kenzie.
Quant aux rendements constants (au lieu des rendements proportionnels de Marshall), ils sont restés
l’hypothèse des premiers travaux de programmation linéaire, mais aussi de la Comptabilité
nationale (Léontieff et le tableau entrées-sorties). La théorie de la croissance de R. Solow suppose
également constants les rendements.
Enfin il importe de mentionner que Sraffa est resté quant à lui distant vis-à-vis de cette évolution
théorique. Son projet radical initial de reconstruire une théorie de la valeur susceptible de résoudre
le cercle vicieux de la répartition, partagé par toute la littérature économique, et son achèvement,
permettent de situer son œuvre dans le prolongement incontestable de celle de Quesnay, Ricardo, et
Marx, et par opposition, de Marshall. Il a donc autant marqué Cambridge UK que J.M Keynes. La
théorie critique de Sraffa est la révélation d’un mythe dans la théorie néo-classique : le mythe d’une
mesure du capital qui serait indépendante de l’évaluation des marchandises, et donc de la
répartition du revenu.
Ж
1
/
5
100%