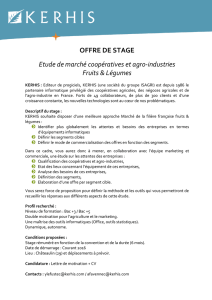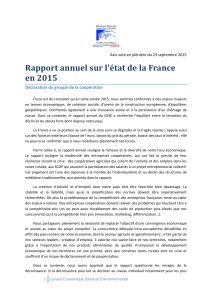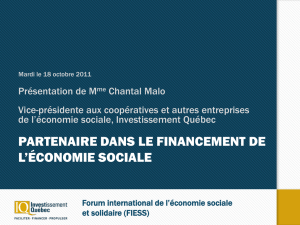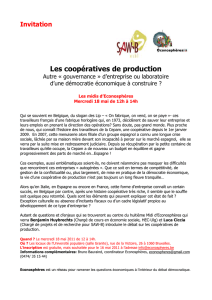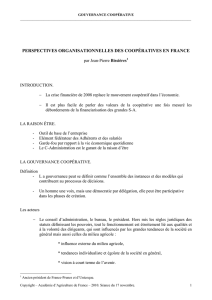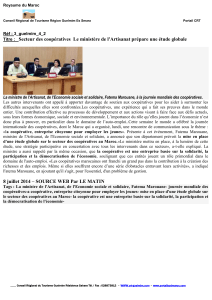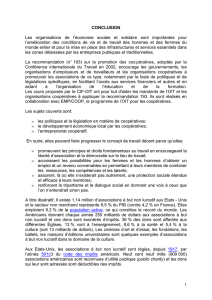Lire la suite

Participer 637
octobre / novembre / décembre 2010 • 13
Espagne,
la coopération
multiformes
L’Espagne est le pays européen qui compte le plus grand nombre de coopératives et
d’entreprises de travail associé. Loin d’être unique, le modèle s’est adapté au fi l du
temps selon les régions et au gré de l’évolution économique et sociale.
DOSSIER
Le paysage coopératif en Espagne
ressemble à un manteau d’Arlequin,
coloré et composé de pièces très di-
verses ! Si en France, une Scop de Poitou-
Charentes ressemble fort à une Scop du
Nord-Pas-de-Calais ou du Limousin, de
l’autre côté des Pyrénées, il peut y avoir
des différences non négligeables entre
une coopérative de travail associé de
Catalogne et une coopérative de travail
andalouse, sans parler des points de di-
vergence avec une sociedad laboral (Sal
ou Sales au pluriel) de Galice, un autre
modèle d’entreprise participative.
Les différences de statuts se superposent
en effet aux pratiques variées de chaque
région autonome, qui sont directement
en charge du développement des coo-
pératives. Si des lois nationales (1991 et
1999 pour les coopératives, 1986 et 1997
pour les Sales) fi xent le cadre général, des
lois régionales favorisent l’adaptation au
niveau local. Par leur histoire, des pro-
vinces sont particulièrement attentives
aux coopératives, comme la Catalogne,
l’Andalousie, le Pays Basque ou la com-
munauté de Valence. Cette adaptabilité
des principes coopératifs aux contextes
régionaux et aux besoins différents des
entrepreneurs est l’un des facteurs qui a
permis un essor de ce modèle unique en
Europe.
Un exemple pour
les coopératives en Europe
Aujourd’hui, l’Espagne est le pays euro-
péen qui compte le plus grand nombre
d’entreprises coopératives et participati-
ves . Elle rassemble près de 23 000 coo-
pératives de travail associé, organisées
plutôt sur le modèle des Scop françaises
au sens des modalités de vote en assem-

14 • octobre / novembre / décembre 2010
Participer 637
DOSSIER
blée générale et de l’impartageabilité
des réserves. Nées dans les années 80, et
donc de création juridique plus récente,
les sociétés anonymes de travailleurs - so-
ciedades laborales - sont aujourd’hui au
nombre de 3 000 SA, et jusqu’à 12 000
dans leur formule de sociétés à responsa-
bilité limitée. Le poids en salariés est lui
aussi important : 240 000 pour les coopé-
ratives et 86 000 pour les Sales.
« Il existe une différence fondamentale
entre les coopératives de travail et les
Sales, explique Isabel Vidal, présidente
du CIES, centre de recherches sur l’éco-
nomie et la société à Barcelone. Les pre-
mières sont, comme les Scop, des sociétés
de personnes (1 personne = 1 voix) tan-
dis que les deuxièmes sont des sociétés
de capitaux (1 euro = 1 voix). Mais dans
les deux cas, ce sont les salariés-associés
qui détiennent la majorité du capital et
donc qui prennent les décisions. » De
même, les Sales se sentent comme les
coopératives pleinement partie prenante
de l’économie sociale, et leur confédéra-
tion, la Confesal, est membre de la Cecop
(confédération européenne des coopéra-
tives de production), au même titre que
la Coceta, qui représente en Espagne les
coopératives de travail.
Avant 1997, les Sales avaient conquis leur
légitimité économique, en reprenant des
entreprises, notamment publiques, en
diffi culté. « L’exemple le plus célèbre est
celui de la reprise de la société de bus
de la communauté de Valence en 1964,
précise Marc Mathieu, secrétaire géné-
ral d’EFES (Fédération européenne de
l’actionnariat salarié). Petit à petit, les
sociedades laborales sont devenues un
modèle de création et de reprise d’entre-
prise à part entière. « En 1997, les Sales
ont connu un nouvel essor avec la créa-
tion du statut de société à responsabilité
limitée », précise Isabel Vidal. « Le capital
minimum n’est que de 3 005 euros, d’où
une plus grande facilité à créer des en-
treprises collectives nouvelles, à partir de
trois membres associés. »
Les mêmes origines pour
les Sales et les coopératives
Les Sales et les coopératives ont des origi-
nes identiques au sein des organisations
de travailleurs, qui ont voulu prendre en
main leur outil de travail. On peut même
dire que les chauffeurs de bus de Valence,
puis d’autres repreneurs d’entreprises,
ont inventé le statut de SAL en adaptant
une gouvernance participative et démo-
cratique aux classiques SA et Sarl.
Comme en France, c’est bien le sociétariat
qui marque en grande partie l’identité
coopérative, que ce soit en coopérative de
travail ou en SAL, mai aussi en coopéra-
tive d’agriculteurs ou de consommateurs.
Recevoir votre magazine Participer en langue
bretonne ou occitane, ce n’est pas encore à
l’ordre du jour ! Mais en Espagne, nos confrères
d’Empresa y Trabajo, le journal d’informations
de la Coceta, la Confédération des coopératives
de travail associé, publient quelques pages en
catalan. Ce n’est que depuis 2006 que l’on peut
lire Empresa y Trabajo. « A cette époque, explique Mariana Vilnitzky, chargée de
communication, la Coceta a décidé de créer un journal, pour mieux exposer les bonnes
idées des coopératives de travail, en essayant de toucher les coopérateurs eux-mêmes
bien sûr, mais aussi le public qui ne connaît pas encore les mécanismes coopératifs.
» Autre particularité, chaque région autonome a sa propre page d’informations
où les fédérations régionales et les coopératives locales peuvent donner leur
éclairage sur ce qui se passe sur le terrain. Chaque région a son correspondant
sur place. Selon Mariana Vilnitzky, ce sont les pages les plus lues du journal. Tous
les deux mois, Empresa y Trabajo diffuse ainsi plus de 30 000 exemplaires, pour
une grosse moitié à destination des membres des coopératives et des agents des
administrations locales, et pour l’autre moitié en direction des étudiants, des centres
de recherche d’emploi ou des agences de développement économique. Les lecteurs
français ou internationaux peuvent aussi retrouver Empresa y Trabajo sur le net :
www.empresaytrabajo.coop
Les coopératives s’expriment dans Empresa y Trabajo

Participer 637
octobre / novembre / décembre 2010 • 15
DOSSIER
Une loi sur l’économie sociale devrait
être votée d’ici la fi n de l’année en
Espagne. Elle a été adoptée en conseil
des ministres le 16 juillet dernier.
C’est une loi portée par le ministère
du Travail, qui veut redonner un
cadre général pour le secteur, étant
entendu que les régions autonomes
continuent, par subsidiarité, de fi xer
les modalités pratiques. L’exposé des
motifs rappelle d’ailleurs les étapes
de la reconnaissance du secteur,
que ce soit en Espagne, avec la loi
de 1999, qui a créé un Conseil pour
le développement de l’économie
sociale, ou à l’échelon européen
(statut de société coopérative
européenne, rapports du Conseil
économique et social).
A l’origine du texte, il y a plus
directement les demandes du
Cepes, la confédération des
entreprises de l’économie sociale, et
les travaux d’une sous-commission
parlementaire. Ce texte, qui a pour
objectifs premiers d’assurer une
reconnaissance, une sécurisation
juridique et une meilleure visibilité
du secteur, donne une place toute
particulière aux coopératives, citées
dès les premières lignes du projet de
loi et présentées comme exemples
d’entreprises qui donnent la primauté
aux personnes et à la fi nalité
sociale, avec une gestion autonome,
démocratique, transparente et
participative.
Loi sur l’économie sociale
En Espagne, le sociétariat respecte des rè-
gles très strictes, en fonction du nombre
d’associés. « Si la coopérative a moins de
25 associés, elle ne peut employer qu’un
maximum de 25 % de travailleurs non
membres, indique Rafael Chaves, cher-
cheur à la faculté d’économie de Valence.
Si elle a plus de 25 associés, la limite est à
15 %. Par exemple, une coopérative, qui
compte 100 travailleurs membres, ne peut
embaucher que 15 salariés non membres.
En revanche, elle peut employer des per-
sonnes en CDD ou des intérimaires. Il y a
actuellement un débat en Espagne, pour
évaluer quel serait le niveau acceptable
du nombre d’emplois intérimaires et pré-
caires dans les coopératives. »
Au Pays basque, Mondragon est
incontournable
Profi tant de ce cadre général, des com-
munautés autonomes font des efforts
particuliers pour permet-
tre aux salariés de créer
leur propre entreprise ou
d’entrer dans une forme
coopérative déjà en fonc-
tionnement. Au-delà des
frontières du Pays Basque
espagnol, le nom de
Mondragon est évocateur
de la taille que peut attein-
dre un groupe coopératif,
qui comprend des mar-
ques comme Fagor dans
l’électroménager ou les
supermarchés Eroski. La
Fonderie Ederlan fait aus-
si partie de Mondragon
Corporacion Cooperativa.
Il y a quelques dizaines d’années, Peio
Uhalde y a travaillé comme salarié-coopé-
rateur, avant de devenir PDG de la Scop
Alki qui fabrique des meubles à Itxassou
(Pyrénées-Atlantiques).
« Au Pays Basque Sud, c’est naturel de
travailler dans une coopérative, rapporte
Peio Uhalde. Lors des assemblées géné-
rales, ce n’est pas rare que la population
de villages tout entiers soit concernée. La
solidarité entre coopératives s’y exprime
de plusieurs manières. Les plus petites
peuvent être sous-traitantes des plus im-
portantes. En temps de crise, elles peu-
vent échanger leurs salariés, pour éviter
d’avoir à les licencier. » Les coopératives
du Pays Basque ont aussi des outils pro-
pres pour se développer : des écoles et
des centres de formation ainsi qu’une
banque coopérative, la Caja Laboral et
une mutuelle. La fonderie Ederlan, dans
laquelle Peio Uhalde a travaillé, est une
des plus grandes d’Europe, avec 600 sala-
riés. Maier, une entreprise de plasturgie
a une taille équivalente. Dans les années
2000, Olaberria, la Scop
dont Benat Castorene est
le PDG à Ustaritz (Pyrénées-
Atlantiques), a fourni à
Maier des moules à injec-
tion. Il remarque pour sa
part que les entreprises affi -
liées au groupe Mondragon
sont très pragmatiques : «
elles n’hésitent pas à aller
chercher les produits les
moins chers en Asie et en
Europe de l’Est. Aujourd’hui,
leur développement est in-
ternational ».
Mondragon est un acteur
économique majeur de la
province basque. Xavier
Itçaina, professeur à Sciences Po Bordeaux
rappelle que MCC représente plus de 85
000 emplois, avec un taux de sociétariat
Il y a
actuellement
un débat en
Espagne, pour
évaluer quel
serait le niveau
acceptable du
nombre d’emplois
intérimaires et
précaires dans
les coopératives.
de 88 % dans les branches industrielles et
confi rme que le groupe s’est lancé dans
la compétition internationale depuis
les années 90, en n’hésitant pas à ouvrir
l’échelle des salaires pour attirer des ca-
dres à même de leur faire gagner des
parts de marché. « Avec une tendance
à la désindustrialisation, indique Xavier
Itçaina, les coopératives basques diver-
sifi ent désormais leurs secteurs d’inter-
vention, en répondant aux besoins émer-
gents : insertion, social (avec le nouveau
statut de coopérative d’initiative sociale
en 2000), services à la personne, fi nan-
ces solidaires (réseau Reas Euskalerria) et

16 • octobre / novembre / décembre 2010
Participer 637
DOSSIER
Aux côtés des coopératives, reconnues pour leurs vertus en matière d’entrepreneuriat collectif, d’emploi local et
de pérennisation des activités économiques, l’Espagne soutient depuis vingt-cinq ans
le modèle des Sales, sociétés anonymes de travailleurs.
Participer a rencontré José Maria Algora, président de la Confédération des sociedades laborales.
■ Quel est le poids actuel
des sociedades laborales
en Espagne ?
On compte plus de
15 000 Sales en Espagne,
qui rassemblent plus
de 86 000 salariés :
on compte 50 000
salariés dans le
secteur des services, 20 000 dans
l’industrie, 15 000 dans le BTP et un
millier dans l’agriculture. Dans une
période où l’économie espagnole a
détruit beaucoup d’emplois, les Sales
représentent 30 % des emplois créés
dans l’économie sociale, qui regroupe
aussi les coopératives, les mutuelles et
les fondations.
■ Quel impact peuvent avoir les Sales
pour amortir la crise économique ?
A peine nées au début des années 80,
elles ont joué un rôle très important
pour juguler la crise qui touchait
alors l’Espagne : des entreprises de
taille importante sont devenues la
propriété de leurs salariés, pour éviter
de mettre la clé sous la porte. La loi de
1997 sur les sociétés participatives a
créé une nouvelle possibilité de Sal à
responsabilité limitée, ce qui a donné
un coup d’accélérateur à la création
de plus petites entités. Aujourd’hui,
les Sales sont un modèle économique
de choix, à la fois pour maintenir des
entreprises affectées par la crise et pour
que des personnes créent leur propre
emploi dans un cadre collectif.
■ Comment les pouvoirs publics aident-
ils les sociedades laborales ?
Au même titre que les autres structures
de l’économie sociale en Espagne,
les Sales ont un soutien à la fois
du gouvernement central et des
régions autonomes. Tous les ans, le
gouvernement, par la
Direction générale de
l’économie sociale, de
l’auto-emploi et de la
RSE du ministère du
Travail, publie une liste
de subventions pour
promouvoir et soutenir
techniquement le
secteur, mais surtout
il accorde des aides
fi nancières aux salariés
et aux chômeurs pour
prendre des parts
dans leur entreprise.
Les Communautés
autonomes, qui sont
chargées de répartir
ces subventions,
les complètent par des lignes de
fi nancement ad hoc, des déductions
fi scales ou des garanties.
Les Sales bénéfi cient aussi du mécanisme
du Pago Unico, le paiement unique.
Le salarié peut recevoir l’équivalent
de ses allocations chômage d’un seul
coup, à condition de les consacrer à
l’achat de parts de son entreprise. C’est
intéressant aussi pour les entreprises,
déjà créées ou en création, qui voient
leur capital se consolider.
■ Qu’attendez vous de la future loi sur
l’économie sociale ?
Cela va d’abord donner de la visibilité à
un secteur qui n’est pas encore familier
à tous les Espagnols. Cela va aussi
clarifi er l’appartenance au secteur,
quelles valeurs nous voulons mettre
en avant et quelles
réussites économiques
nous avons. A mon
avis, cette loi est un
pas important dans
la reconnaissance
du secteur, et de ses
atouts sociaux et
économiques, par le
gouvernement. Dans
le même temps, la
Confesal va continuer
à lutter pour des
améliorations de la
loi sur les Sales, pour
l’adapter au nouveau
contexte économique
et en faire un modèle
de qualité capable de
créer de l’emploi stable, comme c’est le
cas depuis vingt-cinq ans.
■ Dans quels partenariats européens
la Confesal est-elle engagée ?
En-dehors de notre participation aux
instances de la Cecop et de Diesis, nous
travaillons régulièrement avec la CG
Scop et avec Legacoop en Italie, sur des
projets européens qui mettent en avant
le modèle économique des sociétés
coopératives et participatives.
José Maria Algora, président de la Confesal
en exclusivité pour Participer
« Les Sales, un modèle économique de choix »
José Maria Algora
Au même titre
que les autres
structures de
l’économie sociale
en Espagne, les
Sales ont un
soutien à la fois
du gouvernement
central et des
régions autonomes.

Participer 637
octobre / novembre / décembre 2010 • 17
DOSSIER
■ Quelles sont les évolutions des
coopératives de travail en Espagne ?
Comme dans la Région de Murcie,
dans laquelle j’ai créé une coopérative
il y a plus de 25 ans (la coopérative
de formation Severo Ochoa),
les coopératives de travail sont
parfaitement intégrées au monde
économique. En Espagne, plus que le
nombre de structures, je pense que ce
sont les valeurs et les principes transmis
au reste de l’économie, qui sont
importants : démocratie, participation,
égalité, respect de l’environnement,
etc.
■ A quels défi s les coopératives font-
elles face ?
Nous devons encore accroître notre
visibilité pour maintenir notre
contribution au maintien de l’emploi
et au développement économique.
Nous avons aussi d’autres challenges
comme l’amélioration de la formation
et de nos capacités d’innovation,
l’ouverture à l’international.
■ Comment les coopératives ont-elles
résisté dans la crise ?
Nous avons sans doute passé le cap le
plus diffi cile. Pendant cette période de
trois ans, les coopératives ont autant
souffert que le reste de l’économie,
mais l’inquiétude fait place à
l’optimisme. Les coopératives ont
montré qu’elles avaient des qualités
pour résister à la crise.
■ Qu’attendez-vous de la loi sur
l’économie sociale ?
Beaucoup de choses ! Jusqu’à présent,
les différentes familles de l’économie
sociale étaient règlementées par
des lois, mais pas l’économie sociale
dans son ensemble. Cela va changer.
Par ailleurs, cette loi marque une
tendance des pouvoirs publics à
prendre des mesures favorables à ce
modèle économique. Enfi n, l’économie
sociale va acquérir une nouvelle
représentativité auprès des autorités
du pays. Ce qui devrait aboutir à une
normalisation de nos modèles.
■ Comment voyez-vous l’avenir des
coopératives de travail ?
Notre modèle économique est le
modèle de l’avenir. Les valeurs
qu’il représente et l’implication des
personnes qui composent l’entreprise
doivent contribuer à un nouveau
développement économique Nous
avons envie de travailler à ce
développement.
Juan Antonio Pedreno, président de la Coceta
« Le modèle de l’avenir »
SAL
(société anonyme de travail)
SLL
(société de travail
à responsabilité limitée)
Coopérative de travail
• Société de capitaux
• Une action = une voix
• Salariés détiennent majoritairement
le capital (au moins 51 %)
• Aucun associé ne peut détenir plus
d’un tiers du capital
• Réserves (10 % des résultats)
• Allocations chômage possibles pour
constituer le capital
• Société de capitaux
• Une action = une voix
• Salariés détiennent majoritairement le
capital (3 005 euros minimum)
• Aucun associé ne peut détenir plus
d’un tiers du capital
• Réserves (10 % des résultats)
• Allocations chômage possibles pour
constituer le capital
• Société de personnes
• Une personne = une voix
• Salariés détiennent le capital (trois
associés minimum)
• Réserves obligatoires
• Réserves pour la formation obliga-
toire
• Régime général ou statut de tra-
vailleur indépendant
• Allocations chômage possibles pour
constituer le capital
culture ». Et le gouvernement
basque, au travers de sa di-
rection de l’économie sociale
continue d’inciter fortement à
la création de coopératives, avec
l’outil Elkarlan : une coopérative de
second degré qui soutient les projets de
créations d’entreprises.
Effervescence en Catalogne
Pour le soutien à l’économie coopérative,
qui rassemble là aussi les coopératives
de travail et les Sales, la Catalogne n’est
pas en reste. « Comme dans les autres ré-
gions, ce sont des lois successives qui ont
organisé le développement des formes
coopératives, insiste Fanny Chaze, auteur
d’une étude comparative sur les coopé-
ratives en France et en Espagne pour l’UR
Scop Languedoc-Roussillon. Elles sont
en effet régies par des règles différen-
tes des autres sociétés commerciales, en
matière d’organisation et de fi scalité.
D’une région à l’autre, ces règlementa-
tions peuvent varier. En Catalogne, on
est ainsi passé de sept à trois associés au
fi l des lois. Comme la plupart des régions,
la Catalogne a adopté la possibilité de
capitaliser ses allocations chômage pour
créer une coopérative ou une sociedad
laboral, ou pour en devenir membre. »
Le Pago Unico a été à l’origine d’un
boom des coopératives, mais surtout des
Sales dans les années quatre vingt-dix. Le
rythme des créations annuelles s’est de-
puis de nouveau tassé, avec la crise éco-
nomico-fi nancière de 2008 : même avec
l’activation des allocations chômage, les
 6
6
1
/
6
100%